
Pour l’honneur de
l’École
Passions et
controverses en éducation
extraits d'un
ouvrage paru en 2000, éd. Hachette éducation (droits libérés) |
I Genèse et devenir des institutions culturelles et
enseignantes
PARTIE 1:
L’imbroglio des querelles anciennes et toujours modernes !
C HAPITRE
1: Une perplexité mondiale
C HAPITRE
2: La querelle des anciennetés
.
C HAPITRE
3: Absolutisme et quiétisme
.
C HAPITRE
4: Ordre et liberté
C HAPITRE
5 : École des notables et École
du peuple
C HAPITRE
6 : Le stupide
XIXe
siècle
C HAPITRE
7 : Élitisme ou démocratie
.
C HAPITRE
8 : Intermède d’une étude de cas
: la « réforme de 1902 » (avant, pendant,
après)
|
 |
|
« La recherche d’un avenir meilleur doit être complémentaire et non plus
antagoniste avec les ressourcements dans le passé. Tout être humain, toute
collectivité doit irriguer sa vie par une circulation incessante entre son
passé où il ressource son identité en se rattachant à ses ascendants, son
présent où il affirme ses besoins et un futur où il projette ses aspirations
et ses efforts. »
Edgar Morin,
Les sept
savoirs nécessaires à l’éducation du futur,
Le Seuil, Paris, 2000.
|
Quels que soient les écarts ou les proximités entre nos
rêves ou utopies et les réalités présentes ou en devenir relatives à
l’École, en France, des problèmes ardus demeurent en effet. Il est
indéniable que l’enseignement est devenu plus difficile, plus complexe,
pour les enseignants. Il est également de plus en plus chargé, sinon
stressant, pour les élèves. Mais il est aussi plus préoccupant pour les
familles, et plus pesant pour la société.
Les poussées de différenciation et de mondialisation,
l’accélération des conquêtes technologiques, l’ampleur des développements
scientifiques et des urgences culturelles contraignent trop, évidemment,
sans perdre les liens profonds aux élaborations humanistes acquises par le
passé, à mettre au point des ajustements appropriés aux temps nouveaux :
non des adaptations serviles.
Il ne peut s’agir cependant de tout bousculer pas plus que
de tout maintenir. Il ne peut être question non plus de trouver des
solutions parfaites et définitives. Je ne puis oublier les propos en
mathématiques et au-delà, de mon maître Jacques Hadamard : «
Il n’y a pas de problèmes
résolus. Il y a des problèmes plus ou moins résolus.
» Il faut bien nous garder de toute
prétention absolutiste, de toute recette infaillible : comme de toute
imprécation passionnelle. Pouvons-nous nous rapprocher d’une rigueur
expérimentaliste, mesurée et audacieuse, souhaitée par nos prix Nobel de
physique ?
Je plaide pour une vision modeste de l’évolution de notre
École et de ses missions, adaptées à des applications aussi bien élevées
que pratiques nous gardant de tout perfectionnisme, afin de sauvegarder
des possibilités renouvelées de perfectionnement tenace. Albert Camus nous
encourageait à une telle « pensée de Midi », vers la lumière d’Ithaque : «
Nous choisirons
Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l’action
lucide, la générosité de l’homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste
notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même
ciel que nous, la justice est
vivante.
»
(1)
Ithaque nous rappelle, aussi bien, par la grâce fidèle de
Pénélope, qu’il est toujours opportun et raisonnable de faire et défaire
sans fin une tapisserie, qui ne saurait être que celle de l’éducation et
de la pédagogie ! Il s’agit toujours de résister aux « prétendants » (ou
prétentieux !), pour garder leurs justes places à Ulysse et à Télémaque
(fils élève et modèle !). Car il convient à tous les acteurs, enseignants
et jeunes, naviguant dans les flancs et sur les ponts de l’institution
culturelle et scolaire, de s’inspirer de la sagesse rusée dont Ulysse nous
a apporté l’exemple, depuis l’Iliade
jusqu’au terme de son
Odyssée. Celle-ci, mouvementée, affrontée aux remous des «
courants et contre-courants
» (1),
fut bien une quête de la connaissance et des savoirs pratiques, échappant
à des obstacles incessants et à de fallacieux enchantements (ou
désenchantements !). Mais elle fut aussi rejointe par la quête de la
vérité suivie par Télémaque à la rencontre de son père et des
apprentissages...
Proposons-nous, selon ces exemples « épiques », de
travailler à « illuminer » (est-ce possible ?) la genèse et le devenir de
nos institutions culturelles et enseignantes, pour une première étape (ou
partie). Il nous reviendra d’explorer, dans une suite (et seconde partie),
au-delà des entraves et des mythes, par-delà les chants des sirènes et les
sortilèges de modernes Polyphème, les problèmes de qualité, de
dimensionnement et d’organisation qui sont inhérents à l’éducation et aux
savoirs.
Nous essaierons dès lors, en bonne compagnie, de nous
placer hors de portée des flèches de ces « chevaliers de l’anathème et du
mépris » qu’observait déjà, il y a cinquante ans, Emmanuel Mounier, en
analysant « la petite peur du
XXe
siècle »
(2). Nous
optons pour une « petite espérance » dans le
XXIe
siècle !
(3)
(1) Voir l’éclairant ouvrage de Daniel Hameline,
Courants et Contre-courants
dans la pédagogie contemporaine,
Odis, Sion, 1986, p. 7 : «
La métaphore du “courant”
avec “contre-courant”, son antonyme, est usuelle dans notre langue, on le
sait, pour désigner les états de l’opinion. Il est extrêmement difficile
en effet d’imaginer ces derniers comme quelque chose de stable et d’inerte.
» Mais, p. 13, « les
institutions humaines déroulent une histoire plus lente que celle des
événements... les idées, fussent-elles justes, ne mènent pas le monde
». Pour le mouvement de
l’éducation nouvelle, p. 14, «
À l’histoire lue comme une
série de ruptures fracassantes, se substitue une histoire lue comme une
évolution plus génétique. »
(2) E. Mounier,
La Petite Peur du XXe siècle,
La Baconnière, Neuchâtel et Seuil, Paris, 1948, p. 150.Voir p. 20 : «
Ces prophètes bilieux
ou farouches, antimodernes par système, ont parfois le talent de plaquer
sur cette expression de leurs humeurs et de leurs échecs secrets une suite
impressionnante d’indices historiques ou d’enchaînements logiques. Ils
n’expriment cependant que leur propre situation dans le monde.
» Voir p. 155 : «
Ce romantisme orgueilleux de
l’histoire, ce besoin d’avilir en mélodrame notre drame collectif, ce goût
des grandes ombres de la peur, qu’on les barbouille de mysticisme ou de
désespoir, je voudrais que mon époque les débarrasse de leurs mensonges et
lucidement, modestement, y reconnaisse les signes d’une âme et d’un corps
malades. »
(3) Voir D. Hameline,
op. cit.,
p. 39 : « Or, espérer
est un sentiment constitutif de l’acted’enseignement.
»
|
|
(1) Rabelais,
OEuvres,
colligées et présentées par Pierre d’Espezel, éd. À l’enseigne de la Cité
des livres, 1927, tome 1, livre II, p. 262.
(2) Montaigne,
Essais,
coll. « La Pléiade », Gallimard, Paris, 1953, ch. XVI, « De l’institution
des enfants », pp. 182 et 177. Également : «
Fâcheuse suffisance, qu’une
suffisance pure livresque »,
p. 185. Également : «
Prenez les simples discours de la philosophie, sçachez les choisir et
traiter à point : ils sont plus aisez à concevoir qu’un conte de Boccace. Un
enfant en est capable, à partir de la nourrisse, beaucoup mieux que
d’apprendre à lire ou à écrire. La philosophie a des discours pour la
naissance des hommes comme pour la décrépitude
», p. 197.
(1) J. Delumeau,
La Civilisation
de la Renaissance,
Arthaud, Paris, 1967, p. 40.
(2) Luther insista sur «
l’ordure universelle »,
précisant « Scatet totus
orbis », cité par Norman
Brown in
:
Eros et Thanatos,
Julliard, Paris, 1960, p. 274.
(3)
Ibid.,
p. 257.
(1) P. Hazard,
op. cit.,
p. 3.
(2)
Ibid.,
p. 471. Également, voir p. 470 : «
Dès que le classicisme cesse
d’être un effort, une volonté, une adhésion réfléchie, pour se transformer
en habitude et en contrainte, les tendances novatrices, toutes prêtes,
reprennent-elles leur force et leur élan ; et la conscience européenne se
remet à sa recherche éternelle. Commence alors une crise si rapide et si
brusque, qu’elle surprend alors que, longuement préparée par une
tradition séculaire, elle n’est en réalité qu’une reprise, une continuation.
»
(1) P. Bourdieu,
La Distinction, critique
sociale du jugement, Minuit,
Paris, 1979. |
2
La querelle des
anciennetés
Il serait tentant, à défaut de remonter jusqu’à
l’Antiquité, de reporter nos conflits sans fin aux grandes disputes du
Moyen Âge, entre scolastiques et aristotéliciens, ou plutôt, à celles de
la Renaissance, entre dogmatiques et humanistes, entre théologiens et
praticiens des sciences médicales et libérales, entre Sorbonne et Collège
de France. Cette dernière institution fut créée contre celle-là par
François Ier, sous le signe
universaliste d’une triple (ou quadruple) culture : grecque, hébraïque,
latine (ainsi que chaldaïque,
c’est-à-dire arabe).
Tête bien faite? Optimisme ou pessimisme?
Érasme et Pic de La Mirandole ont marqué cette époque.
Dans la grande exaltation de celle-ci, recréant du nouveau à partir du
plus ancien retrouvé, nous ne pouvons oublier la lettre de Gargantua à son
fils Pantagruel et ses avis contrastés : «
Que je voie un abîme de
science », mais en alerte, «
science sans conscience n’est
que ruine de
l’âme
»
(1).
Plus tard, Montaigne nous conseillerait – par le relais de Diane de
Foix ! – d’enseigner de façon précoce la philosophie tolérante et de
choisir, en fait de
conducteur ou d’enseignant, une
tête bien faite
plutôt que « bien pleine
», tant la frénésie d’érudition risquait de faire oublier
l’individu au profit des savoirs au point de n’en laisser retenir «
qu’un général et informe visage
: un peu de chaque chose, et rien du tout, à la
françoise
»
(2).
L’avertissement vaut encore pour aujourd’hui, pour la
formation des professeurs et leurs enseignements ! Alerte aux censeurs des
centres de formation... En fait, au-delà des discussions au sujet du
dogmatisme et du volume des connaissances à faire acquérir, le profond
conflit qui divisait jusqu’à la violence des esprits dès cette époque
était fondé sur une opposition entre les partisans d’une conception
optimiste de l’homme et de son libre arbitre (ou développement) et les
tenants d’un pessimisme plus ou moins radical à leur sujet. «
Lorsque le
XVIe
siècle se termina,
note Jean Delumeau, deux
grands courants s’opposaient au sujet de la liberté de la personne. Le
synode réformé de Dordrecht (1619) et le jansénisme continuèrent dans le
sillage de Luther et de Calvin. Ils rabaissèrent l’homme pour grandir
Dieu. La théologie optimiste des jésuites reprit au contraire le message
érasmien.
»
(1)
Confiance dans l’individu et dans la vie ou préoccupation
insistante à propos du mal et du
péché(2),
il est vrai que les esprits et les moeurs avaient pu être
bouleversés, jusqu’à la satiété, par les vicissitudes de leur temps : la
révolution scientifique moderne amorcée par Copernic avait déstabilisé les
croyances trop assurées, même s’il en résultait de grandes découvertes ;
d’admirables créations artistiques ne cessaient de se manifester, en même
temps que se développaient les conquêtes coloniales avec leurs
conséquences destructrices ; épidémies de peste, exactions et disettes
incessantes, la succession des maux pour les peuples était encore aggravée
par la férocité des guerres de Religion et les désordres des institutions
religieuses mais aussi, comme l’indiquait Huisinga au sujet du
XVe, «
par l’obsession de l’approche de
la fin du monde, par la crainte de l’enfer, des sorcières et des
démons
»
(3) ou, pour
Luther, du diable.
Classicisme et baroquisme
Au début du XVIIe
siècle, toutefois, dans la lassitude des complications, une phase
temporaire d’apaisement put s’établir : les options opposées se
stabilisèrent dans la forme tempérante du classicisme. «
L’esprit classique en sa force,
commente Paul Hazard, aime la
stabilité. Après la Renaissance et la Réforme, grandes aventures, est
venue l’époque du recueillement. On a soustrait la
politique, la religion, la société, l’art aux discussions interminables, à
la critique
insatisfaisante...
» (1)
La pause socio-culturelle fut cependant de courte durée :
elle ne servit qu’à faire repartir de plus belle et à exaspérer les
disputes d’idées, provoquant entre 1680 et 1715, dans la seconde partie du
règne du Roi-Soleil, un siècle avant les Lumières et la Révolution, « la
crise de la conscience européenne » qui n’a pas encore fini de nous
agiter. Leibniz nous a avertis : « Finis sæculi novam faciem apparuit,
dans les années finissantes du
XVIIe
siècle, un nouvel
ordre des choses a
commencé.
»
(2)
Cet ordre, baroque, réagissant à l’affadissement en
académisme de l’inspiration classique, fut, dès l’abord, marqué par de
nouvelles complications, des contrastes vifs, des violences et des
désordres : guerres européennes et dévastation du Palatinat ; en 1685,
dramatique révocation de l’édit de Nantes suivie des dragonnades et de
l’exil de nombreux protestants français.
C’est dans les
Riches Heures de cette époque de faste et de misère, parmi
les débats furieux entre les
rationaux et les
religionnaires, les
libertins et les
gallicans (qui préfiguraient avec une âpreté oubliée les
remises en cause révolutionnaires), qu’éclate la mémorable «
querelle des Anciens et des
Modernes ».
Nierons-nous qu’en toute occasion, nous nous prenons à
perpétuer celle-ci ? Tant, chez nous, chaque innovation ou réforme
(d’orthographe ! de programmes scolaires ! de formation des enseignants !
d’organisation des enseignements supérieurs !), ou même chaque entreprise
neuve sont l’objet instantané de dénonciations et de fureurs au nom des
Anciens. Quand
bien même ne seraient-elles que bénignes, apparemment : mais nos soupçons
remontent loin. À suivre, donc!
L’imbroglio des Anciens et des Modernes
En cette querelle, qui fut et reste inexpiable, il est
piquant de songer que c’est le charmant Charles Perrault, l’auteur du
Petit Poucet et de
Cendrillon, qui
mit le feu aux poudres et à l’Académie française, où il fit la lecture, en
1687, d’un poème sur « Le
siècle de Louis le Grand » dont il louait la grandeur
surpassant (sinon effaçant) celle des temps de Périclès et d’Auguste.
À cet outrage fait aux Anciens, jugés indépassables, La
Fontaine répliqua sans tarder par une
Épître à M. Huet,
et se vit soutenu par Boileau et Racine, cependant que Fontenelle (neveu
de Corneille qui s’était vu censuré pour les libertés qu’il avait souhaité
prendre, par le Cid,
vis à-vis des modèles anciens) venait à la rescousse de Perrault,
notamment par son discours de réception à l’Académie, en 1693, que
contredit sans tarder La Bruyère en 1694 dans son propre discours devant
la même Académie (qui semble moins conflictuelle de nos jours !).
L’action était dès lors placée sur la scène incessante de
nos passions et de leur imbroglio. En culture et en création, pour
certains, la référence stricte et la révérence aux Anciens sont de rigueur
; pour d’autres, il importe que fierté et chances d’innovation soient
reconnues aux Modernes.
En instruction et en éducation, le primat du latin et du
grec (et, plus généralement, du
classique ainsi que de l’enseignement
général ou
littéraire) est
opposé avec morgue à l’émergence ou prééminence du français et des
disciplines scientifiques ou même techniques.
Il s’ensuit que sont prônées, par les uns, les vertus de
l’imitation et de l’obéissance avec
distinction, au
sens de Bourdieu(1),
alors que pour d’autres sont requises les qualités d’invention et
d’indépendance d’esprit ainsi que la maîtrise de technologies.
Plus généralement, le passé est définitivement établi en
âge d’or, consacré
par une prise de distance ou de hauteur ; à l’opposé, le traditionalisme
est récusé à la mode d’une
table rase réinstaurée par Descartes alors que le présent et
l’avenir sont reconnus comme porteurs de
progrès et donc
dépassant les excellences
d’antan.
Tradition et modernité
Il nous faut admettre que ces deux inspirations
contrastées, en tradition ou en modernité, sinon (plus raidies) en
conservatisme ou en progressisme, sont toujours là, divisant nos opinions
et, davantage encore, nos intellectuels et les concepteurs qui tentent de
décider de notre culture et de nos institutions éducatives. Elles
alimentent, dans nos désaccords et dans nos débats parfois furieux,
une radicalisation en tout
ou
rien
qui préserve amoureusement leur
pérennisation, à la façon des
deux nigauds
ci-dessus cités.
Car il s’agit toujours de choix exclusifs, de préférences
sans concession. Le passé, quel qu’il soit, pour certains a toujours
raison, et les modalités ou références qu’il offre demeurent
intouchables
(1).
Ou bien, pour d’autres, le passé (et d’autant plus qu’il aurait été
fécond) a fait son temps, et la modernité rend obsolètes ses arrangements.
Des esprits qui appuient leur autorité ou leur promotion
sur le passé s’exclament à propos du
déclin,
du désenchantement consubstantiels à la situation présente (de n’importe
quoi, et donc, aussi, de l’éducation !) et ils parent un passé (choisi,
même récent, parfois même antérieurement contesté par eux-mêmes) de toutes
les grâces (ou menaces, à la mode d’une statue du Commandeur revêtu d’un
masque de Jules Ferry, notamment, comme on l’a vu !).
À l’opposé, d’autres esprits, aventureux, voient
obstinément les choses autrement, jugent le présent encombré de
désuétudes, et parient ou s’échauffent sans fin pour des mesures
radicalement nouvelles, de nature à procurer un progrès.
Un mouvement perpétuel est de la sorte institué (les
secrétaires également ne sont-ils perpétuels dans les doctes académies ?)
en vue de préserver un équilibre d’immobilisme en surchauffe, par une
noble et inutile dépense d’énergie, franco-française, oscillant entre des
exécrations pessimistes ou des assertions d’optimisme, comme entre des
intégrismes littéraires ou des aventurismes scientistes. Nous avons
symbolisé ces oppositions et oscillations par le graphe n o
1 de la page suivante
intitulé « Oppositions oscillantes » !

Entre parenthèses, je ne peux que m’étonner de la naïveté,
de l’inculture historique de ceux qui s’adonnent, avec quelques fougues et
passions, aux indignations et aux réquisitoires portés sur l’état de
l’École, présentement. À qui se réfèrent-ils, consciemment ou non ? Je
pensais que les « barbares », étymologiquement (!), historiquement, sont
ceux qui répètent, qui bégaient !... Est-il de bon ton de bégayer ?
Oui, si on accepte les différences !...
(1) À l’époque où se manifesta la querelle des Anciens et
des Modernes, Bossuet écrivait au pape, à propos de l’éducation du Grand
Dauphin, dont nous reparlerons, que «
tous les novateurs se
perdaient infailliblement »
– maxime à portée plus générale que le domaine de la lecture de l’Évangile
où il était censé s’appliquer.
In
:
Lettres sur l’éducation du
Dauphin, introduction et
notes de E. Levesque, collection des « Chefs-d’oeuvre méconnus », Paris,
1921, p. 47.
|
|
(1) Cité
in
:
Lettres sur l’éducation du
Dauphin, suivies de
Lettres au maréchal de
Bellefonds et au roi,
introduction et notes de E. Levesque, collection des « Chefs-d’oeuvre
méconnus», Paris, 1921, p. 13. Également : «
La règle de faire travailler
d’une façon continue, sans aucun jour de relâche
édictée par Louis XIV],
a été l’objet de critiques.
Philibert de La Mare, qui à Dijon en 1674 vit le Dauphin, prétend que cette
continuité ne servait qu’à lui donner du chagrin et du dégoût.
» p. 217.
(2)
Op. cit.,
pp. 127 et 128.
(3)
Ibid.,
p. 131.
(1)
Ibid.,
p. 210.
(2)
Ibid.,
p. 214.
(3)
Ibid.,
p. 15.
|
3
Absolutisme et
quiétisme
Pour notre instruction (ou notre bon plaisir), au corps à
corps même de notre procès dans la crise de la conscience européenne,
d’autres couples de contradictions ou d’incompatibilités sont venus se
greffer, réunissant ou séparant les ténors d’hier, mais aussi de toujours
et d’aujourd’hui. Là encore, il nous est propice de regarder de près.
Bossuet et Fénelon étaient ainsi en accord à propos de
leur révérence aux Anciens, ils étaient de même relativement réunis sur
une forme d’optimisme qui les mettait à distance du pessimisme reconnu en
Port-Royal ou en certains calvinistes et en leurs variations.
Cependant l’option pour l’absolutisme
adoptée par Bossuet devait l’opposer radicalement au
relativisme ou quiétisme
choisi par Fénelon, de même que la confiance dans la
raison chez l’un
excluait le consentement au
sentiment chez l’autre. En ces conditions, un conflit
inexpiable allait les séparer, en raison de deux options adverses en
éducation : l’une autoritaire (et plus ou moins aveugle), l’autre libérale
(et plus ou moins lucide). Leur controverse au sujet de l’instruction des
enfants de la Maison de France, comme on le verra ci-après, conserve bien
de l’actualité pour celle de tous les enfants de France !
De l’autoritarisme
Bossuet (au fait, il signait souvent de son second prénom
: Bénigne !) fut dès 1670 le précepteur du Grand Dauphin, fils de Louis
XIV, et âgé alors d’une dizaine d’années. Il écrasa cet enfant, de coeur
avec le terrible duc de Montausier, gouverneur du prince. Monseigneur
Dupanloup, dans un ouvrage sur l’éducation, put écrire au
XIXe siècle : «
L’éducation fut nulle... le
Dauphin n’avait senti la présence de cet immense génie qu’à la lassitude
et au malaise qu’en éprouvaient ses premières années et sa débile nature.
Le trop puissant instituteur n’avait fait que le fatiguer et l’abattre.
[...] Tel fut le résultat d’une éducation
où, selon l’expression du
cardinal de Bausset, le précepteur était tout et où l’élève n’était
rien
»
(1). Je gage
que pas mal de doctes remontrances sur l’enseignement et l’éducation se
réfèrent encore de nos jours à une telle distinction, selon laquelle le
programme peut être tout et les différences de tempérament ou de rythme
entre les élèves rien, malgré leurs protestations et celles de leurs
parents.
On peut comprendre comment ce surplomb pédagogique put
entraîner la ruine de la jeune personnalité qu’il était censé affermir,
par l’extension extrême d’un surmoi menaçant, en lisant le début d’une
interminable admonestation au Dauphin à propos de l’inattention.
« Ne croyez pas, Monseigneur,
précisait Bossuet,
qu’on vous reprenne si sévèrement pendant vos études, pour avoir
simplement violé quelques règles de la grammaire en composant. Il est sans
doute honteux à un prince, qui doit avoir de l’ordre en tout, de tomber en
de telles fautes ; mais nous regardons plus haut, quand nous en sommes si
fâchés : car nous ne blâmons pas tant la faute elle-même, que le défaut
d’attention qui en est la cause. Ce défaut d’attention vous fait
maintenant confondre l’ordre des paroles ; mais si nous laissons vieillir
et fortifier cette mauvaise habitude, quand vous viendrez à manier, non
plus les paroles, mais les choses mêmes, vous en troublerez tout l’ordre.
»
Et la menace se renforce : «Vous
parlez maintenant contre les lois de la grammaire; alors vous mépriserez
les préceptes de la raison. Maintenant vous placez mal les paroles, alors
vous placerez mal les
choses.
»
(2)
La remontrance impitoyable se poursuit longuement, ponctuée par
l’extravagante apostrophe : «
Que tardez-vous donc,
Monseigneur, à prendre votre
essor !
»
(3)
Que diable tardait-il à prendre son essor, cet enfant
traqué, anéanti par les références incessantes à Dieu ou à son père,
Roi-Soleil, glorifié à tout instant. Au lieu d’être soutenu, il se voyait
accablé, débilité par une évaluation judicative, centrée sur les
fautes, menaçante
et décourageante : de telles caractéristiques se retrouveraient, hélas
!encore de nos jours, dans les comportements de nombre d’éducateurs ou
d’enseignants, bien de chez nous. Tant il est tentant d’être autoritaire
et péremptoire, ou d’extrapoler indûment des étourderies présentes à des
catastrophes futures. Ô difficulté de l’orientation
!
Il est bon de noter que, dans le même temps où il
réduisait les chances de réussite et de confiance en lui de son royal
pupille, Bossuet se donnait l’élégance de multiplier des lettres, serviles
malgré les fioritures du style, adressées au roi et à la reine, et où il
vantait les progrès du Dauphin. Louis XIV, après la prise de
Condé-sur-Escaut, en avril 1676, put alors écrire : «
Monsieur l’évêque de Condom, si
ce que j’ai fait en ce pays vous a donné de la joie, vous me l’avez bien
rendue en m’assurant des progrès de mon fils. Continuez à profiter de
l’attention qu’il prête à vos
instructions...
»
(1) Quelle
attention, diantre ! La reine Marie-Thérèse, de son côté, exprimait sa
satisfaction, en 1678, à Lille : «
Je suis très aise que vous soyez
content de mon fils : les soins que vous y donnez n’y contribuent pas
peu.
»
(2)
Pas peu ! Parbleu : autoritarisme envers les subordonnés
ou les collègues et flatterie envers les notables, le pouvoir central ou
les grands ne vont-ils pas de pair ? On a pu en voir d’autres exemples,
dans des formes contemporaines, avec des comportements péremptoires ou
dédaigneux de certaines personnes, en conseil de classe, par exemple, mais
en grande prévenance pour des membres des corps d’inspection ou des
mandarins ! Quant
à certains « intellectuels »...
D’une
économie de l’effort
À l’opposé de cette conduite, Fénelon eut la charge, dès
1689, d’éduquer Louis de Bourgogne, fils de l’infortuné Grand Dauphin, né
en 1682 et réputé de caractère difficile. Il multiplia pour son élève des
leçons indirectes et attrayantes, proposant des contes, des fables ou des
dialogues pour illustrer l’Antiquité : il écrivit pour lui
Télémaque. Brémond
a pu dire : « Fénelon fait de
ses élèves tout ce qu’il
veut.
»
(3)
Il faut voir comment : en recourant à des procédures
encourageantes et différenciées, portant attention à l’élève qui n’est
plus un « rien » mais qui devient un partenaire pris au sérieux. «
J’abandonnais l’étude,commente
Fénelon, toutes les fois
qu’il voulait commencer une conversation où il put acquérir des
connaissances utiles. C’est ce qui arrivait assez souvent ; l’étude se
retrouvait assez dans la
suite.
»
(1)
Il faut noter que Fénelon avait été appelé à son poste par
le gouverneur des enfants du Grand Dauphin, Monsieur de Beauvilliers, qui
avait pressenti ses qualités de bon sens et de sensibilité, par la
connaissance de son Traité
d’éducation des filles, écrit à la demande de sa femme. On a pu
dire qu’il y emprunta inconsciemment au réalisme libertin son grand
principe pédagogique : «
suivre et aider la
nature
»
(2).
Son souci de liberté et son option régionale le mirent aussi en
position de refuser l’esprit de clientèle courtisane. Dans son
Télémaque, il
n’hésita pas à critiquer chez la jeune Idoménée l’amour de la flatterie à
l’égard des notables.
Il dénonçait également l’autoritarisme soupçonneux : «
Vouloir examiner tout par
soi-même, c’est défiance, c’est petitesse, c’est une jalousie pour les
détails médiocres qui consument le temps et la liberté d’esprit
nécessaires pour les grandes choses ; [...]
un esprit épuisé par le détail
est comme la lie du vin qui n’a plus de force ni de
délicatesse.
»(3)
Ces propos à l’intention d’un dauphin royal ne pouvaient
manquer d’apparaître comme une critique directe de Louis XIV. Malgré son
indépendance, Fénelon dut désavouer la parution du
Télémaque dont la
diffusion fut même un temps interdite. Il reste qu’en sa pédagogie
apparaît la volonté d’une formation de la personne dans sa globalité et
son originalité, avec un principe d’économie refusant les
détails médiocres
et les surcharges pseudo-encyclopédiques ou tatillonnes.
Universalité et relativité
On peut ici encore schématiser les oppositions et les
oscillations qui vinrent compliquer la querelle des Anciens et des
Modernes, selon un jeu orthogonal de lutte inexpiable (en commençant par
le plus bas de notre graphe no
2) entre des tenants d’une
universalité
(bientôt raidie en
absolutisme justifiant des dispositions autoritaires) et des
partisans d’une relativité
mesurée (aboutissant cependant à quelque
quiétisme, quoique
portée vers une économie en tout effort ou moyen).
|
|
(1) J. Bédier et P. Hazard,
Histoire
de la littérature française,
Larousse, Paris, 1924, p. 51.
(2)
Op. cit.,
p. 50.
(3)
Op. cit.,
p. 51.
|

Cet axe absolutisme/quiétisme,
oscillant sur lui-même, pouvait susciter, comme le suggèrent l’antagonisme
des conduites entre Bossuet et Fénelon, des révérences marquées envers les
notables,
renfermés dans leurs titres, ou le respect de chaque
personne globale,
reconnue dans ses droits, de même qu’une inclination à un
centralisme
unificateur (ultérieurement jacobin) ou bien à un
régionalisme plus
ou moins tempéré (et qui pourrait être girondin). Nous nous y retrouvons
encore ! |
| |
4
Ordre et liberté
Avec le XVIIIe
et le XIXe siècles, ces couples
d’oppositions orthogonales
tradition-modernité (du chapitre 2) et
universalité-relativité (du précédent) allaient pouvoir développer leurs
intrications contradictoires, diversifiées encore selon d’autres
antagonismes diagonaux, qui pourraient se modérer ou s’exacerber entre des
conceptions de l’ordre
lié à une légitimation
et les aspirations de
liberté s’associant à la
laïcité ; entre un
retour à la nature
rejoignant une éthique
et le développement des
techniques
couplées à la recherche,
et préparant l’industrialisation. La complexité s’accroissant,
concédons-nous encore la prothèse de graphes !
État ou raison, peuple ou sentiment
Sous la pression des idées et en raison de l’évolution des
moeurs, le XVIIIe siècle
aidant, l’axe diagonal ordre-liberté oscillerait, en effet, entre des
préférences accordées à l’État
ou au peuple,
ou entre le primat assuré à la
raison ou au
sentiment. De même, l’axe nature-techniques pouvait vibrer
entre une importance accordée à la
psyché
individuelle ou une attention concentrée sur les
comportements
observables, ou également entre une accentuation des
relations
existentielles opposées à la rigueur des
savoirs.
À la faveur des débats (ai-je besoin de rappels
descriptifs ?), les polarisations pouvaient enfin se fixer en antagonismes
durs : cléricalisme- laïcisme,
pour l’axe ordre-liberté ;
moralisme-scientisme, pour l’axe nature-techniques. Ces remous
d’oppositions sont symbolisés dans le graphe no
3, intitulé « Oppositions oscillantes et croisées». Et
cependant, « elles tournent » !... Et nous ?
|
| |
 |
| |
|
| |
Mais il nous est possible, avant de nous reporter aux
justifications et illustrations historiques (comme nous l’avons fait
précédemment avec Bossuet et Fénelon), de schématiser encore les voies
moyennes des couples d’oppositions et celles de leurs extrémismes selon
deux octogones : dans le souci d’éclairer l’imbroglio des conflits où nous
excellons et qui s’enchevêtrent habituellement dans nos mouvements
d’opinion (selon le jeu d’une « Roue de la fortune » ?).
Allons-y avec les premiers octogones, au graphe no
4. En jouant avec lui, il faudra nous résoudre à observer la
croissance complexe de nos contradictions et l’émergence simultanée de
vrais et faux conflits, comme de leurs effets bénéfiques ou pervers :
ceux-ci et ceux-là sont d’autant plus majorés que les positions des
acteurs multiples ont été ou sont davantage extrémisées. Et il nous faut
toutefois observer qu’en notre doux pays, il y a toujours autant de
chances pour l’expression d’extrémismes qu’il y a de grâces pour maintenir
un équilibre moyen mais provisoire, incessamment menacé ou, à tout le
moins, vilipendé ! |
| |
 |
| |
|
|
(1) G. Snyders,
La Pédagogie en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles,
PUF, Paris, 1965,
p. 420.
(2)
Ibid.,
p. 282.
(3)
Ibid.,
p. 282.
(4) D. Hameline,
Courants
et Contre-courants dans la pédagogie contemporaine,
op.
cit. ,
pp. 16 et 17.
(1)
Ibidem,
p. 17.
(2) G. Snyders,
op. cit.,
p. 174.
(3)
Ibid.,
p. 192.
(4)
Ibid.,
p. 277.
|
Aujourd’hui comme hier
Égalitarisme versus
élitisme
Si nous revenons aux débats (ou ébats) historiques,
Georges Snyders nous fait observer, en ce qui concerne l’axe de la
référence conflictuelle Anciens-Modernes et ses fluctuations multiples,
notamment pessimisme-optimisme : «
Le thème autour duquel a semblé
se centrer toute l’éducation traditionnelle, c’est la corruption du monde
– d’où ces institutions de défiance, de surveillance, d’isolement sur
lesquelles nous avons si longuement insisté. L’éducation nouvelle veut
faire confiance à la nature, à la société et à
l’enfant
»
(1),
et donc à la liberté.
En méfiance et fermeture ou ligatures sociales plus ou
moins radicales d’un côté, ou en confiance à la modernité et adhésion aux
Lumières d’un autre, l’enjeu pessimisme-optimisme allait se prolonger et
se signifier multiplement au XVIIIe
siècle. Le mouvement des idées, en phase avec les encyclopédistes,
poussait à rejeter les visions négatives portées sur l’homme et sa nature
peccamineuse. « Non,la nature
ne nous fait pas méchants »
(2), put écrire
Diderot à Sophie
Volland.
Voltaire, pour sa part, dans le
Dictionnaire philosophique,
à l’article « méchant », assura : «
L’homme n’est point né
méchant ; il le devient, comme il devient malade », ajoutant
que « ceux qui sont à la
tête, étant pris de la maladie, la
communiquent
»
(3).
Où l’on voit qu’il ne s’agissait pas de laisser imputer la
faute à Voltaire,
comme dans la chanson, mais plutôt au
pouvoir, et donc
bientôt aux notables
et à l’État
opposés aux personnes et au peuple.
Toutefois, Daniel Hameline peut souligner, du côté du
pouvoir, une tentative de mesure optimiste, en vue d’une « révolution »
sociale, émancipatrice, mais tout autant restrictive ! en 1775. À cette
date, Turgot, ministre de Louis XVI, lui remet un mémoire où il réclame,
de manière pressante, l’établissement d’une Éducation nationale, couvrant
l’ensemble du territoire français de l’époque et toutes les classes de la
société : « Je crois ne
pouvoir rien vous proposer de plus avantageux pour votre peuple que de
faire donner à tous vos sujets une instruction qui leur manifeste bien les
obligations qu’ils ont à la société et à votre pouvoir qui les protège,
les devoirs que ces obligations leur imposent, l’intérêt qu’ils ont à
remplir ces devoirs pour le bien public et le leur
propre.
»
(4)
Optimisme ouvert donc, mais contrôlé par les obligations
et devoirs bien cadrés, en respect aux
notables et à l’État.
« La vocation moderne
d’instruire naît donc, constate Hameline,
dans l’équivoque
du double langage de la modernité.
Le surcroît d’émancipation que
les modernes vont passionnément et obstinément requérir, a partie liée
avec le surcroît d’encadrement dont ils se montreront les inlassables
organisateurs.»
(1)
Égalitarisme ? Encadrement ?
Au travers et au-delà de la nuit du 4 août et de la
proclamation des droits de l’homme, les objections et dénégations
réciproques se cristalliseraient progressivement dans la controverse entre
les pôles élitisme
et égalitarisme
qui se perpétuerait de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours,
comme on le verra ci-après.
Pluralisme
versus
identitarisme
Mais dans la mesure où l’homme était reconsidéré dans son
individualité, au sein d’une nature respectée dans sa diversité régionale
et mondiale (La Fayette, Chateaubriand), l’enfant a pu être aussi
réhabilité. Il était temps !
À l’encontre des propos du sage Bérulle, au
XVIIe siècle, identifiant
chaque enfant à un « état le
plus vil et le plus abject de la nature humaine, après celui de la
mort
» (2),
au rebours des assertions méprisantes de La Fontaine («
Je ne sais bête au monde pire
que l’écolier, si ce n’est le
pédant
»
(3)),Voltaire
affirmerait : « Assemblez
tous les enfants de l’univers, vous ne verrez en eux que l’innocence, la
douceur et la
crainte.
»
(4)
Et Diderot, soucieux de
pluralisme, put
renchérir, louant dans l’enfance un élan direct de la nature : «
Sortis des mains de la nature,
ils doivent rester divers et garder l’empreinte de leur originalité
propre.
»
(4)
Cette justice rendue à l’enfance pourrait apparaître
définitive : mais il restait la reconnaissance en chacun de sa
singularité. Celle-ci ne fut pas toujours prise en compte, en raison d’une
tendance à réduire la variété des jeunes personnalités par une sorte d’identitarisme
(plus ou moins jacobin) en opposition à un
pluralisme
(quelque peu girondin). On verra que le conflit entre ces deux positions,
qui fut souvent souterrain, a pu apparaître de plus en plus décisif de nos
jours, notamment en matière d’éducation, interférant sur la polémique
confusionnelle entre égalitarisme et élitisme : dans la mesure où
l’égalité (dans les attentes, les exigences et les contraintes opposées
aux individus) fut souvent interprétée de façon restrictive en terme
d’identité modèle, escamotant les différences entre les élèves au bénéfice
de quelques happy few,
et créant par suite une catégorie d’individus non conformes, voués en
conséquence à l’échec,
à l’exclusion.
De la sorte, le futur « différentialisme », c’est-à-dire
le pluralisme des
possibilités ouvertes aux individus, aux jeunes en particulier, comme aux
régions, était dès le départ largement contredit et combattu: au bénéfice
de la sélection reproductrice
d’élites conformes. Définir de façon accentuée des
identités revint
nécessairement à séparer de façon plus ou moins catégorique, en
absolutisation, des catégories distinctes, complètement séparées les unes
des autres, et hiérarchisées aux dépens d’une égalité des chances et des
prises en considération. Et de nos jours !...
|
|
(1)
Rapport et
Projet de décret sur l’organisation générale de l’Instruction publique,«
OEuvres », tome VII, p. 451.
(2)
Ibid.,
p. 452.
(1)
Ibid.,
p. 453.
(2) Il précise dans ses
Moyens
d’apprendre : «
Il faudra exercer les élèves
sur un certain nombre d’exemples, et leur faire ensuite observer eux-mêmes
ce principe général qui est commun à chaque exemple particulier, afin qu’ils
le découvrent en quelque sorte par leur propre réflexion. Ensuite on les
conduira à l’énoncer eux-mêmes
», « Induction, sens »,
in
:
Écrits sur l’Instruction
publique,
I, Edilig, Paris, p. 283.
(3) Cité par A. Prost,
Histoire
de l’enseignement en France (1800-1967),
Armand Colin, Paris, 1968, p. 13.
(1) Napoléon,
Vues
politiques, présentées par A.
Dansette, Fayard, Paris, 1939, p. 196. Voir également, p. 208 : «
Pour faire prospérer les
manufactures nationales, il faut les protéger par des lois prohibitives :
beaucoup de lois, encore plus de règlements, voilà les moyens de gouverner.»
(2)
Ibid.,
pp. 23 et 24.Voir, en écho, les propos de Talleyrand en 1791 : «
La langue de la Constitution et
des lois sera enseignée à tous : et cette foule de dialectes corrompus,
derniers restes de la féodalité, sera contrainte de disparaître
», cité
in
Dominique Julia,
Les Trois Couleurs du tableau
noir. La Révolution, Belin,
Paris, 1981.
(1)
In
:
Émile ou De l’éducation,
introd. et notes par F. et P. Richard, Garnier, Paris, 1961, p. 26.
(2)
Ibid.,
p. 26.
(3)
Ibid.,
p. 21.
(4) Voir P. Chaunu,
La Civilisation
de l’Europe des Lumières,
Flammarion, Paris, 1982, p. 303 (1re éd., 1971).
(1) Cité par Marion Coulon
in
:
L’Éducation telle qu’elle fut,
ministère de l’Éducation nationale et de la Culture, Bruxelles, p. 369.
(2) E. d’Ors,
Du baroque,
Gallimard, 2e éd, 1968, p. 48.
(3) E. d’Ors,
op. cit.,
p. 50.
4) H.Wölfflin,
Renaissance et
Baroque,
trad. en « Livre de Poche », p. 143.
(5)
Ibid.,
p. 159.Voir également, Germaine Bazin, notant le besoin d’une sorte de vol
dans l’imaginaire « en
contraste avec le progrès fait avant le XVIIe et le XVIII e siècles par le
positivisme dans les sciences exactes – et bientôt aussi dans les sciences
morales ». Et l’auteur de
Baroque et Rococo
ajoute : «
Aucune civilisation artistique
n’a été aussi fertile en contradictions, en paradoxes.
» Trad. de l’anglais
Baroque and Rococo,Thames
and Hudson, 2e éd. Londres, 1985, p. 10.
1) V. Hugo,
Cromwell,
Flammarion, Paris, 1968, p. 69.
(2)
Ibid.,
p. 79.
|
5
École des
notables et École du peuple
C’est ce que l’on voit apparaître, dès la Révolution, dans
les positions opposées défendues, à quelques années de distance, par
Condorcet en 1792, dans son
Rapport et Projet de décret sur l’organisation de l’Instruction publique
à l’Assemblée nationale, d’une part, et par Destutt de Tracy,
chef des idéologues (dont faisait partie Cabanis), pour le Comité de
l’Instruction publique, sous le Directoire.
Égalité et pluralisme
Le Rapport
de Condorcet contient des vues équilibrant le principe
d’égalité et celui de pluralisme, marquant ainsi les évolutions qui se
sont effectuées de nos jours, en dépit de tous les débats. «
Nous avons pensé que notre
premier soin devait être de rendre d’un côté l’instruction aussi égale que
possible, aussi universelle, de l’autre aussi complète que les
circonstances pouvaient le permettre ; il fallait donner à tous également
l’instruction qu’il est possible d’étendre sur tous : mais ne refuser à
aucune portion des citoyens l’instruction plus élevée qu’il est impossible
de faire partager à la masse entière des
individus.
»
(1)
Le pluralisme conjugué à l’égalité est, encore renforcé
par son application à tous les âges, dans la voie d’une prémonitoire
formation continue : « Nous
avons observé que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au
sortir de l’école, qu’elle devait embrasser tous les âges, qu’il n’y en a
aucun où il ne fut possible et utile
d’apprendre.
»
(2)
Rejetant toute ségrégation en raison des origines sociales
et culturelles, Condorcet précise encore : «
Nous avons cru que la
puissance publique devait dire aux citoyens pauvres :“Si la nature vous a
donné des
talents, vous pouvez les
développer, ils ne seront perdus ni pour vous, ni pour la
patrie”...
» (1)
Condorcet donne l’exemple : grand mathématicien, il rédige une méthode
simple pour initier les débutants, sous le titre
Moyens d’apprendre à compter
sûrement et avec facilité (édité posthume en 1799, réédité
récemment par les éd. ACL). Il faudra deux siècles (seulement ?) pour que
soient réalisées ses vues égalitaires. Partiellement ! Et sa prise de
position pour un courageux didactisme sera oubliée par ceux mêmes qui se
réclament de lui !
(2)
Élitisme et identitarisme
En revanche, la discrimination socio-économique est
invoquée par Destutt de Tracy pour distinguer irrévocablement
deux systèmes complets
d’instruction qui n’ont rien de commun l’un avec l’autre. La
conception conservatrice de ces deux systèmes, par une identification
rigide des individus à deux
classes d’hommes, pérennise les inégalités et dégrade les options
pluralistes : « Les hommes de la
classe ouvrière ont bientôt besoin du travail de leurs enfants ; et les
enfants eux mêmes ont besoin de prendre de bonne heure la connaissance et
surtout l’habitude et les mœurs du travail pénible auquel ils se
destinent... Il faut qu’une éducation sommaire, mais complète en son
genre, leur soit donnée en peu d’années et que bientôt ils puissent entrer
dans les ateliers ou se livrer aux travaux domestiques ou ruraux... Ceux
de la classe savante au contraire peuvent donner plus de temps à leurs
études ; et il faut nécessairement qu’ils en donnent davantage ; car ils
ont plus de choses à apprendre pour remplir leur destination, et des
choses que l’on ne peut saisir que quand l’âge a donné à l’esprit un
certain degré de développement...Voilà des choses qui ne dépendent
d’aucune volonté humaine ; elles dérivent nécessairement de la nature même
des hommes et des
sociétés.
»
(3)
Nature intangible, nécessité durcie, élitisme clos par la
pulsion identitaire, ordre ségrégatif : ces référents se retrouvent,
explicitement ou implicitement (sinon cachés...), dans des propos
contemporains, après avoir traversé le
XIXe siècle, renforçant une position de
légalisme ou
républicanisme, qui
entrerait en conflit ouvert avec le développement d’un
démocratisme, lequel
s’appuierait aussi bien sur l’expansion des savoirs que sur les
aspirations de liberté ! Il est suggestif que les propositions de Destutt
de Tracy aient été formulées au temps du Directoire, an
IX.
Légalisme et classicisme
Car le terme de
Directoire est déjà significatif. Au sortir des péripéties
révolutionnaires, une urgence de légalité unificatrice s’était faite
sentir. Elle trouva ensuite en Napoléon son accomplissement : il en
fixerait les idées.
Dans une lettre à Villemain sur l’enseignement de
l’histoire, en 1812, il préciserait : «
Il faut faire remarquer le
désordre perpétuel des finances, le chaos des assemblées provinciales, les
prétentions des parlements, le défaut de règle et de ressort dans
l’administration, cette France bizarre, sans unité de lois et
d’administration, étant plutôt une réunion de vingt royaumes qu’un seul
État : de sorte qu’on respire en arrivant à l’époque où l’on a joui des
bienfaits dus à l’unité des lois, d’administration et de
territoire.
»
(1)
On respire ! L’empereur justifierait plus clairement
encore, à Sainte-Hélène : «
Même organisation judiciaire, même organisation administrative, mêmes lois
civiles, mêmes lois criminelles, même organisation d’impositions : le rêve
des gens de bien de tous les siècles se trouve
réalisé.
»
(2) Le rêve, en
direction du démocratisme,
de quelqu’impérialisme
tempéré !
Centralisation, unité, poussées identitaires (mêmes),
élitisme (les gens de bien),
ordre jacobin et recherche de légitimation, le pôle du
légalisme ainsi
situé s’opposa de façon obvie au pôle du
démocratisme qui
requiert le pouvoir d’assemblées
provinciales, des libertés
parlementaires,
des solutions pluralistes.
À mi-chemin entre légalisme et démocratisme, en quelque
centre, mais oscillant d’aventure vers le légalisme, sans doute
trouverait-on le palier d’un
républicanisme. Mais le
démocratisme
porterait plus vivement vers une prise en considération véritable du
peuple et des sentiments qui le traversent. On retrouve bien, de nos
jours, de telles oscillations !
Cependant, la mise en valeur de ces sentiments mêmes avait
déjà tellement animé la fin du XVIIIe
siècle qu’il en était résulté un trouble profond, typique de nos
hésitations incessantes, et qui apparaît de façon étrange à propos de
Rousseau et du mouvement d’idées qui s’accomplira dans le romantisme.
Sensibilité et baroquisme
Si nous revenons, en effet, à l’auteur du
Discours sur l’origine de
l’inégalité et du
Contrat social mais aussi de l’Émile
ou De l’éducation, on sait que cette dernière oeuvre fut
condamnée dans toutes les grandes villes et fut accueillie par une
hostilité générale, même de la part des encyclopédistes.
Ceux-ci lui reprochèrent de remplacer les
Lumières par les
puissances affectives
et les effusions mystiques. Diderot regrettait le galimatias de la
Profession de foi du vicaire
savoyard au coeur de l’Émile,
et il devait traiter son ancien ami d’homme «
excessif, ...
ballotté de l’athéisme au
baptême des
cloches
»
(1).
Madame du Deffand s’indigna : «
Jean-Jacques m’est
antipathique ; il remettrait tout dans le chaos ; je n’ai rien vu de plus
contraire au bon sens que son plat
Émile.
»
(2) Plus
conciliante, Madame de Staël écrirait en 1788 : «
On serait heureux d’avoir Émile
pour fils
»
(3),
tout en faisant plus tard des réserves sur l’éducation
négative préconisée paradoxalement par Rousseau...
Il faut dire que celui-ci avait déjà l’expérience de
quelque irruption sur la scène des conflits contre la tradition et les
rationalités plus ou moins classiques, ayant notamment déclenché par sa
Lettre sur la musique
française, en 1753, ce qu’on convint d’appeler la
querelle des
Bouffons
(4).
Les contrastes et les paradoxes qu’il mettait en vive
lumière contredisaient trop directement les valeurs apaisantes et
rémanentes du classicisme, toujours insistantes, et abondaient du côté
d’un renouveau de baroquisme qui se développerait avec le romantisme.
En préparation de celui-ci, dès 1784, Bernardin de
Saint-Pierre, auteur célèbre de
Paul et Virginie, qui parut en 1789, évoquait à son tour une
école qui soit « un lieu
charmant comme leur âge ». Celle-ci serait ouverte à tous les
enfants sans exception ; on en exigerait seulement la plus grande
propreté, « ne fussent-ils
d’ailleurs revêtus que de lambeaux recousus. On y verrait l’enfant de
l’homme de qualité, conduit par son gouverneur, arriver en équipage, et se
placer près de l’enfant d’un paysan, appuyé sur son bâtonnet, vêtu de
toile au milieu même de l’hiver... Ils apprendraient alors l’un et l’autre
à se connaître avant de se séparer pour toujours. L’enfant du riche
s’instruirait à faire part de son superflu à celui qui est souvent destiné
à le nourrir toute sa vie de sa propre
nécessité
»
(1).
Contrastes accueillis ! Et ferveur donnée au sentiment. Lycée «
light »?
Dans son essai sur le baroque, l’Espagnol Eugenio d’Ors
observait « Combien a
été décisive l’influence exercée un jour par le roman Paul et
Virginie sur la sensibilité
et sur la sensualité de ses
contemporains.
»
(2)
Paradoxalement « la valeur
attribuée aux descriptions botaniques du roman fut si grande, qu’elle put
bientôt porter l’auteur à l’Académie des sciences et à la direction du
Jardin des plantes. Tout le monde se grisait de ces élixirs d’amour et de
paysage, de pureté virginale et d’enfance morbide. [...]
Le peintre Horace Vernet
trouva dans cette lecture le secret du sentiment du paysage.
[...] Les mêmes esprits qui,
moins disposés ou plus froids, avaient résisté à la prédication
philosophique de Jean-Jacques, se virent enfin vaincus dans leur coeur par
ce prêche plus dissimulé, et en même temps plus
accessible.»
(3) Un
tel effet culturel et social s’explique dans la conception du baroque du
Suisse alémanique Wölfflin : «
Le baroque n’offre nulle part
achèvement, apaisement ou quiétude de l’être, mais il apporte toujours
l’inquiétude du devenir, la tension de
l’instabilité.
»
(4) Et il
précise encore : « Le baroque
ne craint ni les proportions impures ni les dissonances dans l’accord des
formes.
»
(5)
Effet de masse, accélération du mouvement,
poussée vers le haut
justifiant des élans de sublimation, mise en porte à faux des
régularités, renforcement de l’expression plus libre, fantaisies copiées
sur une certaine perception de la
nature, gratuité,
imagination, éventuellement
trompe-l’oeil, les caractéristiques du baroquisme seront
synthétisées en 1827 dans le « Manifeste du romantisme » que fut la
célèbre préface de Cromwell,
par Victor Hugo : la poésie «
se mettra à faire comme la
nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l’ombre à
la lumière, le grotesque au sublime, en d’autres termes, le corps à l’âme,
la bête à
l’esprit
»
(1),
se situant ainsi dans «
l’harmonie des
contraires
»
(2).
Classicisme
versus
baroquisme
On sait assez que les classiques conçurent les propos
romantiques, notamment à l’occasion de la bataille d’Hernani,
comme une déclaration de guerre. Il y eut de vraies luttes.
Les aspects libertaires et l’esprit de contradiction, sur
lesquels se fondait le romantisme, comme forme du baroquisme, paraissaient
mettre en péril le monarchisme classique, dès le 21 février 1830, comme
cela s’actualisa pendant les journées de Juillet (et ultérieurement...).
Celles-ci ouvraient alors la voie au « palier » du
parlementarisme ou
oligarchisme,
lequel, avec ses soubresauts et ses volutes conflictuels, pouvait
provoquer en retour la croissance du pouvoir étatique vers le
républicanisme pur
et dur. Celui-ci, appuyé sur le légalisme, devait entraîner, au passage, à
établir une institution d’éducation et d’instruction qui ne relevât que de
lui seul : il ne pouvait s’ensuivre qu’une compétition de plus en plus
vive entre milieux intellectuels ou rationalistes et milieux cléricaux,
souvent bizarrement réunis ou opposés selon leurs choix en faveur des fils
de notables ou des enfants du peuple.
Mais ce républicanisme pouvait à son tour basculer sur un
impérialisme :
comme Napoléon III, féru de ce qu’il appela le « césarisme démocratique »,
nous en fit la preuve, en deux coups d’État successifs du 2 décembre
(1851-1852) ! Victor Hugo partit... Plus tard, la République de Weimar
confirma...comme on l’a vu au cours du
XIXe siècle, jusqu’à nous !
Mais il serait possible, avant de
continuer notre parcours exploratoire (initiatique ? !), de réunir dans un
troisième octogone les pôles d’opposition des deux rectangles que nous
venons de voir émerger : pluralisme et égalitarisme face à élitisme et
identitarisme d’une part ; légalisme et démocratisme, avec classicisme et
baroquisme d’autre part, en observant qu’ils se placent naturellement aux
sommets de deux carrés (légalisme, égalitarisme, démocratisme, élitisme ;
classicisme, pluralisme, baroquisme, identitarisme) dont les diagonales
expriment les plus fortes oppositions. |
| |
|
| |
 |
| |
|
| |
La régularité des dessins ne doit pas nous masquer les
torsions et distorsions possibles dans l’équilibre des antagonismes mis en
flèches sur ces dites diagonales, non plus que les disruptures (violences,
guerres) qu’ils peuvent provoquer. Au cœur de l’octogone, il nous a donc
fallu situer un rectangle de concentration des tensions qui viennent,
comme on l’a rappelé, se signifier en
monarchisme,
parlementarisme
(ou oligarchisme),
républicanisme, et
impérialisme (ou
dictature) : à quelque mi-chemin entre les sommets de l’octogone
(légalisme et démocratisme ou classicisme et baroquisme).
En ce rectangle symbolique, on se place loin de «
l’harmonie des contraires » ! Et en son centre noir, on peut situer le «
trou noir » des totalitarismes, en dégénérescence extrême mais
tendancielle, comme nous l’a douloureusement appris l’histoire tragique
qui s’est imposée au monde depuis le milieu du
XIXe siècle jusqu’au milieu du
XXe siècle.
Nous ne pouvons oublier, en jetant un coup d’oeil sur ce «
mandala» simpliste, comment, rapprochées, concentrées, les oppositions se
sont durcies. La compression extrême de leurs antagonismes n’a trouvé sa «
détente » que dans l’explosion de violences, de haines, de guerres.
Car l’identitarisme s’est suraccentué en la forme de
nationalismes
belliqueux et de l’antisémitisme. L’élitisme s’est rassuré dans le soutien
du colonialisme et
des répressions. L’égalitarisme a pu se durcir dans une dictature du
prolétariat et la poursuite de la
lutte des classes.
Le pluralisme a pu se perdre dans quelque anarchisme ou
extrémisme ; le
classicisme s’inversa en xénophobie ou en style imposé (kitsch !). Ce
siècle, fait de deux demi-siècles, a été « le siècle classique de la
guerre », prophétisé par Nietzsche, mais hélas ! aussi celui du « génocide
» et de « l’univers concentrationnaire ».
Au-delà de ce temps extrême de fer et de sang, cet
octogone et ses contractions suggérées nous incitent, cependant, à faire
une récapitulation des chances de polémique et de discorde qui ont culminé
en lui (et que les graphes successifs avaient provisoirement fixées).
La multiplicité de nos positions possibles se dispose en
France, si vous en acceptez la complicité, sur une vibrante roue de nos
antagonismes (graphe no 6),
laquelle peut osciller et tourner à notre gré : selon les occasions et,
comme le fait bien savoir notre actualité, suivant la persistance de nos
humeurs, plutôt amères qu’amènes !
|
| |
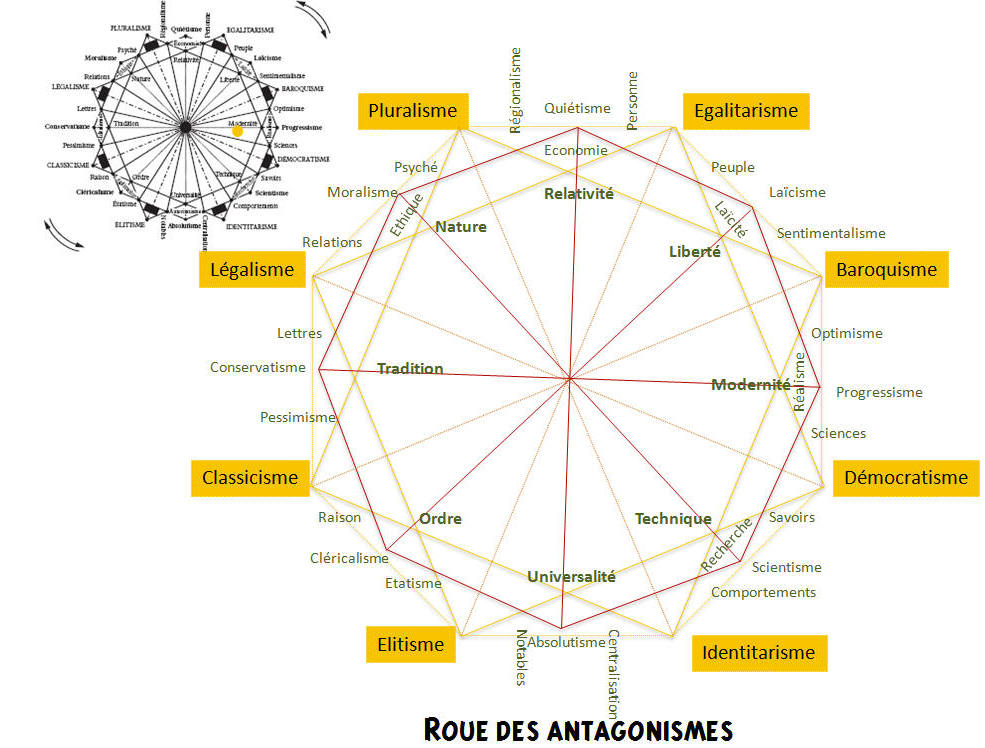 |
| |
|
| |
Je risque l’hypothèse que certains lecteurs y trouveront
de l’intérêt ou du moins de l’amusement, en forme de pause avant la
reprise de nos considérations austères.
Ne peut-on, en effet, sur cette roue animée de mouvements
ou oscillations aléatoires, situer l’imbroglio des positions antagonistes
prises par les divers acteurs de la vie sociale, éducative, philosophique
ou politique, à tout le moins, de notre pays ? Les mêmes qui se drapent
dans une idéologie dite de gauche, se trouveront en passion de laïcisme ou
de scientisme mais en même temps, et contradictoirement, en obsession
d’élitisme et d’absolutisme ou d’identitarisme. D’autres, réputés de
droite et cléricaux, se préoccuperont, d’aventure, de pluralisme et
d’innovations progressistes, d’égalitarisme et d’optimisme. On trouvera,
en France, des défenseurs du classicisme et du légalisme à gauche,
conservateurs et pessimistes quoique en flirt avec le républicanisme, de
même qu’au centre ou à droite des adeptes du démocratisme et du
baroquisme, progressistes et joyeux. Ne peut-on même attendre n’importe
quel mélange ? N’en avez-vous pas trouvé ?
Et vous-même, en quels secteurs disjoints et
contradictoires vous placeriez-vous ? Plus encore, ne pouvons-nous suivre,
dans leurs remous et méandres, le cours de nos élans et de nos stagnations
ou restaurations ? ! Mais que d’« ismes » !
|
|
(1) L’adjectif revient au verbe
agressif de Léon Daudet qui en fait l’argument d’un livre paru en 1922 et
relance ou amorce la complainte de la déploration, familière à nombre
d’intellectuels de toutes tendances : «
Quelle est la part de la
Renaissance, dans l’esprit et le corps du XIXe siècle français ? Presque
nulle. L’ignorance s’y répand largement par la démocratie et elle gagne
jusqu’au corps enseignant, par le progrès de la métaphysique allemande, si
bien que le primaire finit par influencer le supérieur, ce qui est le signe
de toute déchéance »
in
:
Le Stupide XIXe siècle,
Nouvelle Librairie nationale, Paris, 1922, p. 20.
(2) Cité par R. Jacquenod,
in
:
Promotion 2000,
Sylvie Massinger, Paris, 1983, p. 159.
(1) Antoine
Prost a observé dans une étude dense, parue en 1986, deux phases dans la
démocratisation : « Je
crois avoir montré que la démocratisation a progressé jusqu’au début des
années 1960, dans une structure scolaire pensée par des conservateurs avec
une volonté proprement réactionnaire de défense et illustration des
humanités, alors qu’au contraire, les réformes de 1959, 1963 et 1965, qui
voulaient assurer l’égalité des chances devant l’École et la démocratisation
de l’enseignement ont, dans les faits, organisé le recrutement de l’élite
scolaire au sein de l’élite sociale
»,
in
:
L’Enseignement s’est-il
démocratisé ?, Seuil, 1986,
p. 201. Six ans plus tard, Antoine Prost mettra en évidence, à partir de ces
mêmes années 1960,l’enlisement des orientations gaulliennes et leur
inversion sous l’effet de ralentissement de la conduite des affaires de la
France par Pompidou (Éducation,
Société et Politiques, Seuil,
1992, p. 104). La démocratisation néanmoins a pu repartir.
(1) Jean-Noël Luc,
La Statistique
de l’enseignement primaire, XIXe-XXe siècles,
Économica- INRP, Paris, 1985, p. 130.
(2) D’après Jean-Noël Luc,
ibidem, p. 179 – Paul Gerbod
donne même, pour 1900, des chiffres plus élevés (intégrant sans doute les
effectifs de jeunes enfants dans les salles d’asile ?).
(1) P. Albertini,
L’École
en France, XIXe-XXe siècle,
Hachette, Paris, 1992, p. 8. L’auteur ajoute en dépit des vicissitudes : «
Le XIXe siècle est dans
son entier le siècle de l’alphabétisation féminine.
»
(2) A. Prost,
Éducation,
Société et Politiques,
Seuil, Paris, 1992, p. 49.
(3) Cité par J. Georges, « Généalogie
des collèges »,
in
:
Des outils pour réussir au
collège,
CRDP, CRAP, 1986, p. 76.
(4) A. Prost,
Histoire de
l’enseignement en France,
Armand Colin, Paris, 1968, p. 32.
(5) Voir P. Gerbod,
La Vie
quotidienne dans les lycées et collèges au XIXe,
Hachette, Paris, 1968, pp. 96-97.
(1) F. Mayeur,
Histoire
générale de l’enseignement et de l’éducation en France,
tome III : De la
Révolution à l’École républicaine,
Nouvelle Librairie de France, Paris, 1981, p. 465.
(2) Cité
ibid.,
p. 470. Voir également, cité par P. Albertini
in
:
L’École en France, XIXe- XXe
siècle, Hachette, Paris,
1992, p. 56, le discours de V. Hugo à l’Assemblée en janvier 1850 contre la
loi Falloux : « Je ne
veux pas vous confier l’enseignement de la jeunesse, l’âme des enfants...
»
(3) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 96.Voir également, F. Mayeur,
op. cit.,
p. 158, qui note qu’en 1930 les effectifs féminins dans le second degré
atteignaient seulement la moitié de ceux des garçons.
(4)
Ibid.,
p. 122.
(1)
Ibid.,
p. 122.
(2) Voir Jean-Noël Luc,
op. cit.,
pp. 12-14.
(1) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 128.
(2) F. Mayeur,
Histoire
générale de l’enseignement et de l’éducation en France,
op. cit.,
pp. 641-643.
(3) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 128.
(4) Voir P. Gerbod,
op. cit.,
p. 128.
(5) Voir P. Gerbod,
op. cit.,
p. 135.
(6) A. Prost,
Histoire de
l’enseignement en France,
Armand Colin, Paris, 1968, p. 56.
(7) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 128.
(1) F. Mayeur,
op. cit.,
p. 508.
(2) P. Gerbod.,
op. cit.,
p. 129.
(3) F. Mayeur,
op. cit.,
tableau p. 511.
(4)
Ibid.,
p. 510.
(5) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 136.
(6) Même s’il fallait avoir le bac ès lettres pour
s’inscrire au bac ès sciences.
(1) Gerbod,
op. cit.,
p. 141.
(2)
Ibid.,
p. 137.
(3) Cité par A. Prost,
op. cit.,
p. 223. Ibidem,
p. 227, l’auteur note que le véritable enseignement scientifique «
se donne à Polytechnique,
réorganisé sous le Consulat, au Muséum ou au Collège de France.
»
(4) Voir la passionnante étude faite
par C. Nique, dans
L’Impossible Gouvernement des
esprits, Nathan, Paris, 1991,
pp. 109 et sq.
(1) Voir Madame Guizot : «
L’enseignement mutuel est le régime constitutionnel introduit dans
l’éducation ; c’est la charte qui assure à l’enfant la part de sa volonté
dans la loi à laquelle l obéit.
» A. Prost,
Histoire de l’enseignement en
France,
op. cit.,
p. 217. Également, a
contrario, l’abbé Affre,
vicaire général d’Amiens : «
Nul rapport de respect et de
reconnaissance de la part de l’enfant : rien qui puisse lui inspirer ces
sentiments envers le maître, car ce maître ne lui apprend rien, ne lui donne
rien ; l’instruction est donnée par d’autres enfants. Il n’obéit qu’à ses
pairs...
Il est facile de voir combien
une telle méthode est vicieuse...
Quoi de plus propre à
nourrir leurs dispositions à l’ambition, à l’orgueil, à l’indépendance...
» (ibid.,
p. 126).
(2) P. Albertini,
op. cit.,
p. 21.
(1) A. Prost,
ibid.,
p. 119.
(2) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 124.
(3)
Ibid.,
p. 127.
(4)
Ibid.,
p. 125.
(1) A. Prost,
Histoire
de l’enseignement en France,
op. cit.,
p. 184.
(2) P. Gerbod,
op. cit.,
p. 125.
|
6
Le
stupide XIXe
siècle
Sur cette roue ou rose des antagonismes, au-delà du
romantisme, nos aïeux des bons (ou des
stupides
(1))
XIXe et
XXe siècles joueront, à leur
tour, la fortune de la France selon la permanence-alternance des conflits
et dépits nationaux, en matière de vie politique aussi bien qu’en formes
d’éducations. En douteriez-vous ?
Car les oscillations redoutables de nos humeurs nationales
se succèdent sans relâche, au long de notre histoire : balançant entre des
phases de réformes, amorcées par des fièvres extrêmes de mécontentement
(critiques ou révolutionnaires) touchant alternativement les élites ou les
masses excédées, suivies inéluctablement par des retouches sur des
restaurations (lesquelles s’accommodent, dans la France moyenne,
d’explosions démographiques ou d’opportunités économiques). «
La France ne vaut que par les
extrêmes, soupira Valéry,
mais ne dure que par les
moyens.
»
(2)
Nous savons, de la sorte, alterner des pulsions de liberté
ou d’innovation avec des rappels à l’ordre, des virulences progressistes
avec des véhémences traditionalistes (et isolationnistes ou xénophobes),
opposant, comme on le verra, les lettres et les sciences, les langues
anciennes et les langues vivantes ou la philosophie, l’élitisme ou
l’égalitarisme, mais également les options cléricales ou laïques. Il en
résulte une évolution aux temps nouveaux qui reste contenue, ralentie,
avec des pas en avant et des pas en arrière au rythme de quelque tango,
intégré dans notre génie latin, conservateur et rageur ! En politique et
en éducation, toujours quelque passion ! Mais jusqu’où ?
L’histoire accélérée des régimes, en France
Sans doute se souvient-on mieux (?) de l’histoire
alternative de nos régimes ou propositions politiques entre impérialisme
et monarchisme, parlementarisme et républicanisme. Après l’Empire, la
Restauration de 1815 a bien été surprise par la révolution de Juillet
1830, celle-ci ouvrant la voie à une ère philipparde et bourgeoise mais
interrompue (subséquemment!) par la révolution de 1848 et la courte IIe
République. Icelle République fut suspendue par l’avènement du
Second Empire, renversé aux temps dits par les revers et soubresauts de
1870 (guerre franco-allemande d’une part, Commune et répression de M.
Thiers de l’autre), faisant le lit de la IIIe
République. Avec l’intermède des Cent-Jours, sept changements de
régime (et même huit, en comptant le Consulat) en un siècle. Virtuosité
française !
La longévité précaire de la IIIe,
secouée par les Affaires et deux guerres mondiales, outre les expéditions
multiples, offrit une piteuse chance à une restauration, en 1940, par la
forme de l’État français, corrigée derechef, en 1944, par l’effet d’une
Résistance, d’où sortit une IVe
République bien parlementaire. Las! celle-ci fut vite altérée par une
instabilité ministérielle suraccélérée et une crise d’atermoiement
réactionnaire au mouvement inexorable de la décolonisation (au-delà d’un
Empire).
Advint, après celle de l’Indochine, la guerre (reconnue
comme telle ?) d’Algérie, entraînant le retour, dès 1958, du général de
Gaulle, instituant une Ve
République, plus présidentielle, mais ouverte au progrès social et
culturel. Néanmoins, la prospérité venue, une protestation indignée revint
par les événements (par nature, inattendus ; mais par sensibilité
nationale, inévitables ?) de 1968 : portée par les dérives conservatrices
du gouvernement Pompidou, une phase régressive s’imposa, réduisant la
démocratisation en éducation ou en partage de richesses, au bénéfice d’un
élitisme social
dominant(1).
Cela se fit en sorte que, par un juste retour du pendule, le pouvoir
revint en 1981, pour un temps et à un intermède près, au parti du
Mouvement, réputé égalitaire, et à la gauche solidaire mais bientôt
redivisée. En sorte que la « mi-temps » des années 1990 vit refleurir la
droite avant que le pendule ne se reporte vers la gauche pour la fin du
siècle...
Le pendule de nos oscillations continuerait-il à nous
porter en d’autres voies ? Normalement, reconnaissons que la France
fluctue selon la devise de son jacobinisme parisien, mais qu’elle a de
surprenants rétablissements (et donc pas de
mergitur) : autant
dire que Marianne a des hanches superbes assurant ses redressements, aidée
il est vrai par sa fidèle Madelon que d’aucuns appellent Administration et
d’autres Éducation !
Revenons dès lors à celle-ci et aux sinuosités serrées de
ses progressions, réformes et régressions, réciproquement provisoires.
Croissances et controverses dix-neuvièmistes
Le profil du XIXe
siècle est exemplaire en éducation. S’il contient la perpétuation
des controverses ainsi que des lenteurs dans les adaptations, il amorce
les explosions, quantitatives et qualitatives, du
XXe siècle. Quelles que soient,
en effet, les difficultés rencontrées pour traiter les statistiques alors
que le territoire national s’accroît (Nice et la Savoie, 1860) ou se voit
amputé (Alsace-Lorraine, après la défaite de 1870), mais aussi en raison
de l’instabilité saisonnière des élèves ruraux (pouvant donner lieu à une
double inscription annuelle) ou des âges d’accueil dans les écoles
(variables ou affectés par le travail souvent précoce des enfants de cités
ouvrières), les effectifs, au long du siècle, se sont multipliés en raison
d’une « demande sociale
accrue d’instruction, et la proportion d’enfants scolarisés augmente
irrégulièrement, mais
incontestablement »
(1).
Les effectifs arrondis des écoles publiques et privées
sont éloquents dans le premier degré : en 1830, 1400000 élèves ; en 1840,
2900000; en 1850, 3300000; en 1861, 4300000; en 1872, 4700000; en 1880,
5000000; en 1900, 5400000.
(2)
La démocratisation complète est pratiquement assurée au
début du XXe siècle dans le
premier degré : pour les garçons, et même en dépit des conflits, pour les
filles, avec un retard de
moins en moins marqué pour celles-ci. Dans son fameux discours
de la salle Molière, le 10 avril 1870, Jules Ferry donnait le ton : «
Il faut choisir, citoyens : il
faut que la femme appartienne à la science ou qu’elle appartienne à
l’Église.
»
(1)
Il n’en a pas été de même en fait de démocratisation pour
le second degré, en dépit des changements qui fondent l’École
républicaine.
Car, ainsi que l’observe, pour la fin du
XIXe siècle, Antoine Prost : «
Seule école, parce que
destinée à forger l’unité idéologique de la nation, l’école primaire de
Jules Ferry n’était pourtant pas l’école de tous. Une autre école existait
qui demeure payante quand celle-ci devient gratuite et qui accueille
surtout les enfants des classes supérieures de la société : l’enseignement
secondaire avec son école élémentaire. Jules Ferry hérite de cette
situation, mais il ne la modifie
pas.
»
(2)
Bien plus, il disjoignait la scolarisation des milieux
populaires et celle des enfants de notables et confirmait ce qu’avait
énoncé, au siècle précédent, Destutt de Tracy, dans un discours prononcé
un 13 juillet 1880, à la tribune de la Chambre des députés. «
Le devoir de l’État, en
matière d’enseignement, est absolu, il le doit à tous...
Mais, quand on arrive à
l’enseignement secondaire, il n’y a plus la même nécessité et la
prétention ne serait plus admissible si l’on disait : tout le monde a
droit à l’enseignement secondaire. Non, ceux-là seuls y ont droit qui sont
capables de le recevoir et qui, en le recevant, peuvent rendre service à
la
société. »
(3) En
fait, la fortune des familles ferait la sélection : ce qu’on a cherché à
pérenniser ?
L’enseignement secondaire ne cessa néanmoins de se
développer tranquillement au cours du
XIXe siècle. « Vers 1810 l’enseignement secondaire touchait entre
50 et 60 000 enfants : il en regroupe plus de 150 000 en
1880 »
(4),
et 250 000 à la fin du
siècle
(5).
Ces chiffres contiennent les effectifs de l’enseignement privé, à
dominante confessionnelle, qui se mesurent presque à égalité au long du
siècle, quoi qu’avec de fortes fluctuations en raison des vicissitudes
politiques, et avec ceux de l’enseignement public.
On peut deviner, en effet, si on l’avait oubliée, la
violence des oppositions suivant lesquelles s’affrontèrent les tenants de
la laïcité et les cléricaux au cours du siècle, ces derniers réclamant la
liberté de l’enseignement
pleine et
entière
(1) face à
Guizot en 1836 pour obtenir, en mars 1850, par la loi Falloux, partielle
satisfaction. « L’université,
écrivit l’historien Ernest Lavisse, ne fut ni détruite, ni soumise à
l’Église, mais l’Église, en possession de nouvelles écoles privées, devint
la rivale de l’université. Elles allaient se disputer la jeunesse
française, se la partager et la couper en deux masses orientées en deux
directions opposées. Alors on comprit en France que la loi Falloux avait
été un des événements décisifs du
XIXe
siècle.
»
(2) On ne
l’oublierait pas un siècle et demi plus tard, comme on le verra ci-après.
La revanche du mouvement laïque se marquerait par les lois
de Jules Ferry, et surtout par celle de la séparation des Églises et de
l’État en 1905. Mais le conflit se perpétuerait au
XXe siècle, animant encore
notre vie publique. En fait, le taux de scolarisation dans le second
degré, malgré sa croissance, resta faible, allant du cinquantième au
vingtième des effectifs du primaire ; il fut inégalitaire, ne serait-ce
qu’entre les garçons et les filles, même si, pour celles-ci «
les établissements féminins, en
vingt ans, de 1889 à 1909, voient leurs effectifs
tripler
» (3).
Il est, d’autre part, très irrégulièrement assuré, plus élevé dans le
département de la Seine (où la proportion est du onzième des effectifs du
premier degré), mais presque dix fois plus faible dans les départements
pauvres ou isolés, sous la monarchie de Juillet mais aussi ultérieurement.
De la sorte on observera longtemps encore une alternance de «
classes pléthoriques et
squelettiques
» (4),
avec des effectifs de moins
de cinqélèves
ou de cinquante à plus de quatre-vingts élèves à Paris en
rhétorique (et ce, jusqu’en
1912)(1).
Paul Gerbod note même le comportement (conservateur ?
centralisateur ?) des enseignants requérant des grands nombres d’élèves «
pour ne pas abandonner une
partie de leur “salaire” éventuel à leur suppléant ou au professeur
divisionnaire
» (1).
Nous n’en sommes plus là! Même si certains professeurs s’affectent encore
à chaque mesure nouvelle sur les programmes d’un risque d’une diminution
de leurs ouailles, tout en se plaignant, entre-temps, de classes toujours
trop nombreuses.
Toutes ces expansions ou explosions s’effectuent selon une
sorte d’émulation emphatique entre les régimes successifs de ce siècle
tourmenté, « attachés à
généraliser le bienfait de l’instruction » (Salvandy, 1837), à
« répandre l’instruction dans
tous les rangs de la société » (Fourtoul, 1855), à «
propager, étendre et
améliorer l’éducation populaire » (Commission Levasseur,
1889)(2),
sans oublier Jules Ferry et Victor Duruy. Dans leur projet continu,
ces généralisations, extensions et améliorations seront accompagnées et
perturbées sans trêve, comme nous le préciserons, par un débat incessant,
non seulement entre cléricaux et laïcs, mais aussi, suivant notre
imbroglio perpétué, entre classiques et modernes, centralisateurs et
régionalistes, littéraires et scientifiques, conservateurs et
progressistes, républicains et monarchistes (légitimistes ou orléanistes),
entre élitistes et différentialistes, entre républicains et démocrates. En
sommes-nous sortis ?
Programmes en sempiternels remaniements
Le XIXe siècle,
stupide ou non, a
donné un bel exemple d’atermoiement et de remords au
XXe siècle. «
Vingt fois sur le métier...
» Ah ! classicisme.« Depuis
1815, observe Paul Gerbod dans une page d’anthologie,
il n’est guère d’année où
l’administration centrale n’édicte quelque modification du plan d’étude de
1802. » Nous connaissons aussi une telle persévérance
réformatrice de nos jours, sans que les modifications prescrites se
stabilisent, tant, aussitôt imposées, elles sont déjà contredites ou
obsolètes ! « La Restauration
refoule l’enseignement des sciences dans les classes supérieures, laisse
s’introduire celui de l’histoire en 1818, mais fait du cours de
philosophie, donné désormais en latin, le complément de la
rhétorique. »
(1) Ce qui
laisse à penser. On ne s’étonnera pas, dès lors, de constater que
l’agrégation de philosophie créée en 1828 soit supprimée ultérieurement
pour n’être rétablie qu’en 1863 par Victor Duruy; de même l’agrégation
d’histoire, créée en 1830, fut supprimée par Fortoul en 1853 pour être
remise en vigueur par Rouland, en
1860(2).
Les vicissitudes de l’histoire et de la philosophie ne
peuvent faire oublier celles des sciences, exécrées pour leur modernisme,
ni celles des langues vivantes. «
Les hommes du mouvement
reprennent l’avantage en 1829 :Vatimesnil nomme, à cette date, une
commission chargée de rechercher le moyen de simplifier et d’abréger sans
l’affaiblir l’enseignement des langues anciennes, fortifie les disciplines
scientifiques, développe la part des langues
vivantes.
»
(3)
La révolution philipparde faite, «
à partir de 1830, tandis que
Victor Cousin renforce le rôle de la philosophie – pour un éclectisme
pluraliste –, est posé le problème d’un enseignement secondaire moderne
(après différentes tentatives avortées, celui-ci ne sera en
fait fondé sérieusement qu’au début du
XXe siècle). Mais le
règlement du 25 août 1840 sacrifie la science aux lettres. C’est un retour
en
arrière »
(4).
Les horaires parlent d’eux-mêmes : «
En 1843, une seule heure
hebdomadaire est réservée à l’arithmétique et à la géométrie en Troisième,
Seconde et Rhétorique. Les élèves n’abordent les sciences physiques et
naturelles qu’en philosophie et en mathématiques
élémentaires.
»(5)
Quant aux langues vivantes, «
elles sont limitées aux trois
classes de Quatrième,Troisième et
Seconde
»
(6).
Mais la valse, ou plutôt le tango entre lettres et
sciences, entre le traditionalisme et le progressisme, retrouve son
rythme. « L’offensive reprend
sous Salvandy en faveur des disciplines modernes (langues vivantes et
sciences) ; elle se poursuit à travers la crise de 1848 et aboutit en 1852
au système de la bifurcation, fondé sur l’égalité entre les sciences et
les
lettres. »
(7)
Après la Quatrième, deux sections sont ainsi ouvertes aux
élèves par Fortoul : l’une littéraire, l’autre scientifique, plus
exactement latingrec et latin-sciences. Bien qu’elle renforçât la culture
littéraire, « labifurcation
n’en fut pas moins impopulaire », note Françoise
Mayeur
(1).
Et elle ne dura qu’une dizaine d’années.Toute une conspiration s’organisa
contre ce qu’on dénonçait comme
la mort des humanités : excès de langage, et par des
humanistes (nous connaissons toujours cette contradiction) ! Victor Duruy
fut conduit à supprimer progressivement, puis définitivement en 1864, la
bifurcation, « système
abhorré par l’ensemble du corps
enseignant
» (2).
Il rétablit la classe de philosophie, fortifia de nouveau les humanités
annoncées en péril.
En fait, celles-ci triomphent encore sous l’ordre
moral (que nos rétrogrades gauchistes y songent !). Et au-delà
: en 1880, l’addition des horaires des classes, de la Sixième à la
philosophie, assure encore trente-neuf heures au latin et vingt heures au
grec, contre vingt et une heure au français et dix-huit heures aux langues
vivantes, vingt-huit heures en sciences (avec une dominante pour les
mathématiques) et vingt-quatre heures à
l’histoire-géographie
(3).
En Sixième et Cinquième, les élèves font dix heures hebdomadaires de latin
contre trois heures en langues vivantes, sciences et histoire-géographie
(soit neuf au total !).
« Mieux,
remarque Françoise Mayeur,
les modifications d’horaires qui
surviennent en 1880, 1885, 1890, opérées pour alléger le travail des
élèves tout en diversifiant les objets de connaissance, se font au
détriment des disciplines scientifiques surtout, tandis que le latin et le
grec exercent une royauté
incontestée.
»
(4)
Paul Gerbod, pour sa part, observe qu’«
en 1890, en Première, les
sciences n’ont qu’une heure et
demie
(5)
».
Qui plus est, « la
réforme de 1902 libère pratiquement des sciences les sections latin-grec
(A) et latin-langues (B) ; les mathématiques et les sciences physiques se
trouvent rejetées dans les sections C (latin-sciences) et D (sciences-langues).
»
(5)
Mais les chiffres parlent toujours : s’il n’y a en 1830
que 34 bacheliers ès
sciences (6)
pour 2 816 littéraires, en 1914 on n’en trouve encore que 2 972
pour 4 824 bacheliers de philosophie.
Il est vrai que la propension à obtenir le baccalauréat
restait faible : de 1830 à 1900, la proportion des élèves de
l’enseignement secondaire public et privé admis au baccalauréat reste
inférieure à 4% (3,5 à
3,7) (1).
Mais le fort en thème
l’emporte encore sur celui qui a
la bosse des maths
! Et Gerbod peut conclure sur cet enseignement secondaire du
XIXe siècle, parfois vanté pour
blâmer le temps présent : «
Programmes alourdis, horaires morcelés et capricieux, usure des maîtres et
dégoûts des élèves se conjuguent pour rendre plus diverses et changeantes
les liturgies
quotidiennes.
»
(2) Rien de
changé sous le soleil de France ? Si !
Mais, là, portion congrue pour les sciences, jusqu’au
renversement en leur faveur vers 1950. Il faut attendre ! Car
l’enseignement supérieur n’est pas mieux servi : «
Qui voudra me croire,
proteste Pasteur en 1858,
quand j’affirmerai qu’il n’y a pas au budget de l’Instruction publique, un
denier affecté au progrès de la science par les
laboratoires
(3)
».
Méthodes en voltes successives
Les méthodes d’enseignement dans le premier comme dans le
second degré, même en évoluant lentement, ont aussi fait l’objet de
conflits virulents et incessants entre traditionalistes et novateurs,
comme entre partisans d’une méthode unique ou tenants d’une liberté
pédagogique.
Pour le premier degré, la formation des maîtres a fait
l’objet de conflits violents entre laïcs et cléricaux, ceux-ci souhaitant
des Écoles normales, créées en 1833 par Guizot et vivement menacées dans
les années 1850, malgré le soutien que leur apportait Napoléon III.
L’histoire de ces conflits reste instructive : elle semble renaître dès
que des institutions nouvelles de formation sont créées, comme cela est
visible avec les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
dont nous reparlerons
(4).
« Pour réaliser les objectifs
sommaires qui lui sont fixés, note PierreAlbertini,
le maître d’école dispose
approximativement, dans les années
1800-1880, de trois méthodes :
la méthode individuelle, la méthode mutuelle, la méthode
simultanée.
»
(1)
La première, traditionnelle, convenait à des écoles
rurales à faible effectif : l’enseignant interrogeait ou faisait réciter
et lire chaque élève à tour de rôle.
La deuxième a été recommandée par Lazare Carnot pendant
les Cent-Jours. Les classes, nombreuses, étaient organisées en petits
groupes auxquels, sur de petites estrades latérales, des élèves plus
avancés faisaient cours, sous la conduite du maître, enseignant l’un la
lecture, l’autre l’écriture, un autre enfin le calcul, en apprentissage
conjoint (ce qui était en opposition à la tradition qui imposait de savoir
lire avant de commencer à écrire). L’enseignement mutuel mit en service en
nombre restreint des manuels uniformes ainsi que les tableaux muraux et
les ardoises – ce qui était nouveau. Économe en enseignants formés, il se
développa dans les villes, soutenu par les libéraux et en dépit des
critiques virulentes formulées à son propos par certains évêques et par
les frères des Écoles
chrétiennes (2).
Ceux-ci avaient depuis longtemps mis au point le mode
simultané d’enseignement
en voie magistrale, par classes d’âges et de niveaux, poussant les élèves
à progresser du même pas dans chaque classe.
Le débat entre les trois modes, vif à Paris, se termina
par la décision d’Octave Gréard d’interdire l’enseignement mutuel. Les
Écoles normales s’étaient développées : l’entretien de celles de filles
était devenu obligatoire en 1879 ; il y avait désormais suffisamment
d’enseignants formés. Cet état des choses permit à Gréard d’imposer une
division de l’enseignement simultané en trois cours et une méthodologie
concentrique (on
reprenait chaque année les mêmes programmes mais en les approfondissant).
Il développa ainsi, avec Ferdinand Buisson, un projet d’enseigner
tout le savoir pratique,
poussant à quelque tendance faussement encyclopédique (que nous
connaissons toujours !) et cherchant par suite à réduire les effectifs
pléthoriques des classes.
Au-delà de ces péripéties, «
pour l’enseignement de la
lecture, de l’écriture, et sans doute aussi du calcul, il semble bien, en
effet, que le milieu du
XIXe siècle enregistre
une véritable révolution. Nous vivons encore, pour l’essentiel, sur
l’acquis de cette
époque
»
(1).
En fut-il de même pour le second degré, où les cours se
font ex cathedra,
souvent dictés, face à des élèves passifs qui
prennent au vol la parole
magistrale et alors que
les queues de classes sont
abandonnées à elles mêmes et que, en raison d’un règlement du
25 août 1840, les langues vivantes
doivent être traitées comme
des langues mortes (dont «
les méthodes ont fait leur
preuve »
assure-t-on) (2)
? Ces méthodes n’ont-elles pas duré plus d’un siècle ? Et de nos
jours...Traditionalisme, quand tu nous tiens !
Les tendances centralisatrices et autoritaires étaient, il
est vrai, en honneur. Fortoul, en 1854, édictait des instructions
minutieuses pour régler, minute par minute, le déroulement des cours. Il
songeait ainsi à corriger l’absence d’une formation chez les professeurs :
jusqu’en 1870, le seul livre de chevet des futurs maîtres est le
Traité des études
du chanoine Rollin publié en 1725 et réédité en
1809!
(3)
Mais, contre ces tendances réductrices, des courants plus
modernistes et décentralisateurs se manifestent. À partir de 1856, la
Revue de l’Instruction
publique fait, en effet, campagne pour un retour à la liberté
des méthodes pédagogiques, de même qu’en 1857, Bersot dans ses
Lettres sur l’enseignement,
parues chez Hachette, plaidait en faveur d’une refonte des programmes et
d’une réforme du baccalauréat.
Duruy, entre 1863 et 1869, se fait le champion d’une
révolution pédagogique supprimant le cours dicté et les interrogations
fréquentes. Rompant avec les velléités encyclopédiques du baccalauréat, il
désigne à celui-ci l’objectif de déceler «
des aptitudes réelles à
raisonner, à écrire et à parler, formées au contact des grandes oeuvres de
l’esprit humain et des méthodes de la
science
»
(4).
Défaite et responsabilité de l’École
La défaite de 1870 entraîne de vives polémiques sur un
enseignement hostile à la géographie, aux sciences, aux langues vivantes
et à la gymnastique : « Pour
les républicains la cause de la défaite est l’insuffisante instruction du
peuple : c’est l’instituteur prussien qui a gagné la guerre. Le
redressement national passe donc par l’école gratuite et obligatoire. Pour
les catholiques, la France a été battue parce que déchristianisée, l’école
confessionnelle est plus que jamais
nécessaire.
»
(1)
Au milieu des luttes, des pétitions et des manifestations
massives, Jules Simon en 1872, dans une circulaire du 26 septembre,
propose « de transformer des
méthodes qui ont vieilli et d’abandonner des exercices dont l’inutilité
est universellement
reconnue
»
(2).
Il décide la suppression du vers latin ; celui-ci est rétabli dans
le plan d’études de 1874 : les classiques veillent ! Comme aujourd’hui...
Cependant, en 1880, Jules Ferry entreprend une nouvelle
offensive contre « les
routines, les analyses à outrance [...]
et tous les exercices
mécaniques et surannés ». Des pionniers de la pédagogie
nouvelle se lèvent, la Sorbonne crée enfin en 1883 une chaire de pédagogie
inaugurée par Henri Marion. Les épigones de Jules Ferry l’ont-ils oublié ?
En dépit des lois laïques et de ces initiatives
novatrices, le corps enseignant résiste. En 1899, une commission
parlementaire enquête sur l’instruction secondaire et constate la gravité
du retard pédagogique.
Le problème de la formation des maîtres, posé dès 1850,
n’est pas traité, comme s’en indigne en 1905 Charles-Victor Langlois,
professeur à la Sorbonne, dans un ouvrage consacré à la
Préparation professionnelle à
l’enseignement secondaire. Déjà!
Il faudra encore un siècle pour y procéder un peu mieux :
mais encore avec quelles controverses à propos d’épreuves
professionnelles
dans les concours de recrutement imposés à partir de la création des
Instituts universitaires de formation des maîtres, connus sous le sigle d’IUFM,
et qui reviennent au premier plan. Honni soit le professionnalisme ?
Au bout du XIXe
siècle, ces critiques envers le système scolaire, mêlées aux grandes
querelles entre les républicains et les cléricaux, puis entre dreyfusards
et anti-dreyfusards, poussèrent à l’intervention d’une commission
d’enquête parlementaire, puis à une réforme novatrice en 1902, laquelle
n’était pas encore passée dans les moeurs des enseignants en 1914, ni plus
tard, comme on le verra dans un prochain chapitre. Le débat demeurait
entre conservateurs et réformistes, entre partisans de l’élitisme et
tenants de l’égalitarisme : jusqu’à nos jours ?
|
|
(1) Cité par A. Prost,
Histoire
de l’enseignement en France,
op. cit.,
p. 58.
(2) P. Albertini,
op. cit.,
p. 52.
(1) Cité par A. Prost,
Histoire
de l’enseignement en France,
op. cit.,
p. 292.
(2) Par J. Carcopino, ministre de « Vichy » ! Voir
ci-après.
1) Cité par Zeldin,
op. cit.,
p. 230.
(2) P. Albertini,
op. cit.,
p. 27.
(3) Comte de Gobineau,
Essai sur l’inégalité des races humaines,
Firmin-Didot, Paris, 1853,
in :
Morceaux choisis,
Gallimard, Paris, 1937, p. 32.
(1)
Ibid.,
p. 37.
(2) E. Renan,
La Réforme
intellectuelle et morale,
Calmann-Lévy, 13e éd., 1939, p. 98.
(3)
Ibid.,
p. 93.
(4)
Ibid.,
p. 49.Voir également : «
La fin de l’humanité, c’est de produire des grands hommes ; le grand
oeuvre est accompli par la science, non par la démocratie. Rien sans grands
hommes ; le salut se fera par des grands hommes
»
in
« Souvenirs de jeunesse et d’enfance »,
Dialogues et Fragments
philosophiques.
(5) Drieu La Rochelle,
Notes
pour comprendre le siècle,
Gallimard, Paris, 1941 p. 181
(1) R. Guenon,
La Crise
du monde moderne, Gallimard,
Paris, ch. VI : « L’avis
de la majorité ne peut être que l’expression de l’incompétence
».
(2) L. Daudet,
Le
Stupide XIXe siècle,
op. cit.,
p. 217.
(3) J.Touchard,
Histoire des
idées politiques,
PUF, Paris, 1959, 5e éd., 1970, p. 808.
(4)
Ibid.,
p. 809.
(5)
Ibid.,
p. 819.
(6) P.Valéry,
Vues,
La Table ronde, Paris, 1948, p. 32.
(7)
Ibid.,
p. 10.
(1) L. Schwartz,
in
la revue
Esprit,
mai 1991, p. 104 et suivantes. Prônant la sélection, hostile à l’article 14
de la loi Savary de 1984, ce grand mathématicien soutient qu’on prend «
prétexte de l’existence
d’élèves qui ont des difficultés pour freiner ceux qui le peuvent et le
veulent » et qu’on blâme «
toute tendance à la
compétition » (p. 105), ce
qui contredit son affirmation que «
l’égalitarisme approfondit les
inégalités » (p. 111), d’une
façon inquiétante. Il assure que les «
appareils syndicaux
» de la Fédération de l’Éducation
nationale ont pour but «
moins la défense des enseignants et de l’enseignement que la conquête
d’un pouvoir ces appareils syndicaux sont (de ce point de vue
seulement) peu distincts des apparatchiks des pays de l’Est européen
» (p. 117), quitte à remarquer,
p. 119, qu’« il serait
un peu absurde d’employer le mot
totalitaire
ou le mot
apparatchik
pour des syndicats qui, par
ailleurs, défendent les libertés d’un pays démocratique et s’intéressent aux
causes justes en France et dans le monde
». Contradictions
ici ou là ? Précautions d’intellectuels ? Imbroglio ?
(2) J. de Romilly,
L’Enseignement
en détresse,
Julliard, Paris, 1984, p. 158.
(3)
Ibid.,
p. 158.
(4)
Ibid.,
p. 91.
(5)
Ibid.,
p. 121.
(6)
Ibid.,
p. 157.
(7)
Ibid.,
p. 39.
(8)
Ibid.,
p. 140.
(9)
Ibid.,
pp. 23 et 24.
(1)
Ibid.,
p. 151.
(2) Cité par J. Basile,
in
:
La Nouvelle Formation
culturelle,
Braine-l’Alleud, 1991, p. 105.
(3) Milner,
De l’École,
Seuil, Paris, 1984, p. 75.
(4) Milner,
op. cit.,
p. 98.
(5)
Ibid.,
p. 113.
(6)
Ibid.,
p. 12.
(7)
Ibid.,
p. 30.
(8)
Ibid.,
p. 142.
(1) Ch. Péguy,
Notre jeunesse,
Gallimard, Paris, 1933, p. 14.
(2)
Ibid.,
p. 48.
(3)
Ibid.,
p. 215. |
7
Élitisme ou démocratie
Une certaine sauvegarde des élites sociales avait été
assurée par la domination du latin et, à moindre titre, du grec, au sein
d’un enseignement secondaire payant. On se préoccupa néanmoins, au
XIXe siècle d’étendre vers
d’autres couches de la population des formations plus approfondies que
celle prodiguée dans l’école primaire. Et ce furent des tentatives
successives, suivies de repentirs !
Des essais d’enseignement professionnel
Vatismesnil crée en 1829 des cours spéciaux de deux ans
dans les collèges afin que soient étudiées «
les sciences et leur application
à l’industrie, les langues vivantes, la théorie du commerce, le
dessin
» (1).
Mais, en 1833, Guizot croit bon de créer en surcroît, dans toutes les
communes de plus de 6 000 habitants, des Écoles primaires supérieures en
vue d’établir un enseignement intermédiaire entre le primaire et le
secondaire pour les fils de cultivateurs et d’artisans.
La prééminence du second degré pourtant fait obstacle à ce
projet « Par manque
d’élèves motivés, de maîtres qualifiés et de prestige social, le projet
fait long feu : après 1841, les EPS sont annexées aux collèges ; beaucoup
vivotent puis
disparaissent.
»
(2) Néanmoins
certaines résistent, comme à Nantes, en prenant en compte les besoins de
l’économie locale.
En revanche, en 1847, Salvandy consacre les cours spéciaux
et institue un enseignement
spécial de trois ans qui commence après la Quatrième : un
cycle court
prenait place. En 1865, dans la continuité, Victor Duruy, par une loi du
21 juin, créait officiellement l’enseignement
secondaire spécial de quatre ans, étayé, pour la formation de
ses enseignants, sur une
École normale à Cluny et sur une agrégation spéciale. Malgré
son succès (41 % des élèves du public en 1876), mais minimisé par le
prestige de l’enseignement classique, cet enseignement dériverait du
spécial (faisant
sa spécificité professionnelle) vers le
moderne inséré
tant bien que mal dans la hiérarchie des lycées et collèges.
Mais la place laissée libre redonnait des chances aux
Écoles primaires supérieures. Celles-ci, relancées par un arrêté du 15
janvier 1881 et surtout par la loi Goblet de 1886, se revoyaient dotées
d’un statut juridique et de programmes concentriques conçus sur trois
années précédées d’une année préparatoire. À côté d’elles sont établis des
Cours complémentaires
annexés aux écoles élémentaires pour une scolarité d’un an
seulement.
Quoique maintenues, par les soins de Gréard, à l’écart de
l’enseignement secondaire et de «
sa culture désintéressée
», la plupart des EPS dérivèrent vers un enseignement plus général
que professionnel : elles préparaient aux concours administratifs et aux
fonctions d’employé, pour des carrières ne requérant pas des études
secondaires, donnant, selon les termes de Gréard, «
satisfaction aux ambitions
légitimes, sans surexciter les prétentions aveugles, aussi décevantes pour
les individus que fatales à la
société
»
(1).
En fin de compte, l’enseignement primaire supérieur finit
par devenir un enseignement moderne, analogue au premier cycle des lycées
et collèges, comme le notait, en 1922, Paul Lapie. Il en adviendrait leur
intégration pure et simple au secondaire en
1941(2).
Laborieusement, dans le vide apparent d’une formation adaptée aux
attentes des milieux populaires, l’enseignement technique, multiforme,
notamment dans le cadre des Écoles pratiques d’industries et de commerce
(EPIC), devrait se frayer un chemin difficile.
Latin
versus français
Il n’était pas facile d’établir des voies raisonnables,
pour le développement des individus et leur formation professionnelle ou
générale, dans l’imbroglio des positions et oppositions auxquelles se
complaisaient les diverses couches de la population française.
L’opposition violente entre laïcs et cléricaux s’était
cependant stabilisée autour du maintien du latin, alors que celui-ci
protégeait d’une croissance du français en lutte contre les patois et les
régionalismes. Duruy pouvait écrire, en 1866, que «
les ecclésiastiques se font un
cas de conscience de combattre le français comme la langue de
l’impiété
»
(1).
Mais, pour d’autres, la survivance de la rhétorique latine maintenait une
austérité de bon aloi : « On
préfère l’ascèse au naturel », observe Pierre
Albertini
(2),
ou le détour et l’abstraction au direct et au concret.
Il faut encore ajouter que, même pour des esprits
républicains, le souci de préserver les équilibres sociaux pouvait
conduire à des positions justifiant des
vues élevées, des
séparations claires,
des différences assurées par des titres de haut niveau pour quelques
happy few.
C’est donc tout juste si on supporte en 1865 la création
marginale d’un enseignement basé sur le français et sans latin qualifié de
« spécial» (hors comparaison avec l’enseignement « général »), pour être
populaire. Quant aux esprits libéraux, ils pouvaient au surplus garder
quelque doute sur les chances d’une instruction populaire ou plutôt sur
l’utilité d’un enseignement pour les masses.
Libéraux et élitisme
On ne peut, en effet, oublier le climat élitique de
l’époque. Gobineau, qui fut chef de cabinet d’Alexis de Tocqueville en
1849, nous le rappelait, avec un élégant plaidoyer de 1850 : «
J’ai vu, et toutes les
personnes qui ont habité la province l’ont vu comme moi, les parents
n’envoyer leurs enfants à l’école qu’avec une répugnance marquée, et taxer
de temps perdu les heures qui s’y passent...
; et quand, une fois que
l’école est quittée, le jeune homme n’a rien de plus pressé que d’oublier
ce qu’il y a appris...
J’approuverais donc, avec plus
de tranquillité d’âme, tant d’efforts généreux vainement dépensés pour
instruire nos populations rurales, si je n’étais convaincu que la science
qu’on veut leur donner ne leur convient pas, et qu’il y a au fond de leur
nonchalance apparente un sentiment invinciblement hostile à notre
civilisation.
»
(3)
L’auteur de l’Essai
sur l’inégalité des races humaines pouvait affirmer : «
Je n’ai pas besoin d’ajouter
que ce mot d’ honneur
et la notion civilisatrice qu’il
renferme sont également inconnus aux Jaunes et aux
Noirs.
»
(1)
Ce point de vue impertinent, raciste, serait aussi celui
d’un libéral tel que se définit Ernest
Renan(2)
qui écrivit au lendemain de la défaite de 1870, justifiant la
colonisation : « La conquête
d’un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s’y établit pour
le gouverner, n’a rien de choquant...
La nature a fait une race
d’ouvriers, c’est la race chinoise, d’une dextérité de main merveilleuse,
sans presque aucun sentiment d’honneur ; gouvernez-la avec justice...
elle sera satisfaite ; une
race de travailleurs de la terre, c’est le nègre ; soyez pour lui bon et
humain et tout sera dans l’ordre ; une race de maîtres et de soldats,
c’est la race
européenne.
»
(3)
On ne s’étonnera pas que ce même auteur de la
Prière sur l’Acropole
ait pris une position sans ambiguïté en matière d’élitisme : «
L’égoïsme, source du socialisme,
la jalousie, source de la démocratie, ne feront jamais qu’une société
faible, incapable de résister à de puissants voisins. Une société n’est
forte qu’à condition de reconnaître le fait des supériorités naturelles,
lesquelles au fond se réduisent à une seule, celle de la naissance,
puisque la supériorité intellectuelle et morale n’est elle-même que la
supériorité d’un germe de vie éclos dans des conditions particulièrement
favorisées.
»
(4)
Supériorités naturelles. Hiérarchies. Rejet du principe d’égalité et de la
rationalité. Nietzsche...
Douterait-on de l’imbroglio français qui ferait encore
dire à Drieu La Rochelle, en juin 1940, selon une déclaration sinistre : «
Que peut-on sur un peuple
abruti par deux siècles d’enseignement rationaliste et individualiste,
enseignement qui a anéanti toute résonance de l’univers dans l’homme, qui
a privé les Français de leur âme et de leur
corps
»
(5)
?
On a vu les conséquences de telles propositions avec les
dictatures du XXe siècle et
l’éducation hitlérienne ! Et pourtant, traitant de la
Crise du monde moderne,
René Guénon, inspiré de sagesse orientale, devait assurer, un demi-siècle
plus tard : « Le rôle d’une
véritable élite et son existence même [...]
sont radicalement
incompatibles avec la démocratie, qui est
intimement liée à la conception
égalitaire, c’est-à-dire à la négation de toute
hiérarchie.
»
(1)
À quoi faisaient chorus les déclarations de Léon Daudet,
au moment où naissait le fascisme en Italie : «
Le suffrage universel institue,
dans le pays où il sévit, un désordre et un désarroi permanents, qui
favorisent la violence au lieu de
l’atténuer.
»
(2)
Dans son
Histoire des idées politiques, Jean Touchard observe avec
pertinence que « le fascisme
et le national-socialisme affirment la primauté de l’irrationnel...
Cet irrationnel s’accompagne
naturellement d’une conception anti-égalitaire de la
société
»
(3).Tiens,
tiens, tiens !... pour notre présent!
Cet auteur ajoute : «
Aussi apparaît au premier plan
le thème de l’élite. Ni Mussolini, ni Hitler ne s’interrogent longuement
sur l’origine des élites, ni sur leur formation. Elles existent, c’est
l’essentiel.
»
(4) Après avoir
noté que, depuis le début du XXe
siècle, le thème de la décadence est à l’ordre du jour, Jean
Touchard fait alors constater que«
les méditations sur la
décadence s’accompagnent souvent d’une réflexion sur les élites
». Et il
ajoute, nous le voyons encore aujourd’hui, que «
le recours aux élites n’est pas
propre, en effet, à l’Italie de Mussolini ou à l’Allemagne
hitlérienne
»
(5).
Ces rappels, si succincts soient-ils, mais hélas ! trop confirmés
historiquement et littérairement, devraient inciter à quelques réserves
les censeurs impénitents d’une prétendue décadencede l’enseignement
français et d’une défense des élites (qui n’ont jamais été menacées, comme
cela a été dit et comme on le verra ci-dessous) : s’ils entendent ne pas
se laisser entraîner à quelque collusion naïve !
Plus près de nous
Mais, quoi ! alors même que Paul Valéry souligne que «
les véritables élites se
dégagent
d’elles-mêmes
»
(6) et que «
la France fait les Français
» (tant il lui «
apparaît que le racisme est une expression de faiblesse et de
crainte
»
(7)),
on constate que des esprits de qualité se laissent encore
aller à prétendre «
la France malade de son
égalitarisme
»
(1) et que
l’enseignement y serait en déclin ou «
en
détresse
»
(2) !
Jacqueline de Romilly, dans son ouvrage l’Enseignement
en détresse, dénonce en 1984, par exemple, «
le déclin de notre langue
» qui « accuse une
chute vertigineuse, dont nos classes sont le reflet et qu’elles
contribuent à précipiter », ajoutant : «
Et voilà ! Rien que pour écrire
cela, je vais passer pour
réactionnaire.
»
(3) C’est vrai
!... Ah! Mais traitant de l’égalitarisme
entre l’émulation et la sélection, elle juge, contre un «
on » indéfini,
qu’« on n’est pas contre la
qualité, on est contre l’élitisme et cette haine est si violente qu’elle
entraîne dans son sillage la ruine de la qualité de
tous.
(4)
»
Aussi, « les
défaillances en apparence bénignes de notre enseignement secondaire nous
mènent sans faute vers le totalitarisme. Depuis la recherche la plus
poussée jusqu’à la leçon de lecture, le péril est
partout
»
(5).
D’ailleurs, «
l’Université craque de
partout
»
(6).
« Las, où est notre Sorbonne
d’antan ?
»
(7) L’élitisme,
protection contre le totalitarisme ? La qualité de
tous, partout,
partout.
On ne s’étonnera pas du souci pédagogique émouvant,
manifesté par la constatation : «
On peut donner le sujet le
plus concret qui soit – disons, par exemple,
les animaux dans le théâtre
d’Euripide...
(8)
! Et quoiqu’il y ait tant de
moutards ignares,
de petites pimbêches
et de garçons
brutaux
» (9),
on aimera comprendre que «
peu importe que les jeunes, au sortir de l’Université, soient un peu hors
du temps, un peu trop entourés d’amis tels que Socrate ou Descartes,
Antigone ou
Ruy Blas, Virgile ou
Rimbaud : la télévision, la radio, le cinéma rétabliront bien assez vite
l’équilibre»
(1).
Faut-il démêler ici où sont l’optimisme et le pessimisme ? Le réalisme et
la candeur ? À nouveau l’imbroglio !
Encore plus, alors que Valéry, toujours, quelques jours
avant sa mort a pu écrire que «
toutes les chances d’erreur, pis
encore, toutes les chances de mauvais goût, de facilité, de vulgarité sont
avec celui qui
hait
»
(2),
on voit trop souvent des intellectuels, opposants à des mesures ou
des positions en éducation ou en enseignement, projeter en toute
tranquillité sur leurs adversaires des dénonciations de
haine à l’encontre
des savoirs et des accusations de
persécution. Tel
professeur d’université, réputé de gauche et républicain (se réclamant de
Robespierre), pointe du doigt une cabale ourdie par de
petits énarques et
des petits syndiqués,
sans compter des «
journalistes missionnaires dont la plume bave si
souvent
»
(3).
Et cette cabale de
réformateurs pieux
(encore le piétisme dénoncé !) viserait selon lui à transformer
l’École française en caniveau
pour
immigrés (4),
sans compter une profession avec «
distorsions pédophiliques du
pédagogisme
»
(5)
! Pas moins... De la sorte Pol-Pot et ses Khmers rouges auraient
pris position contre l’École de France, militants syndicalistes du SGEN ou
du SNI, dont certains seraient «
des individus prêts à toutes les
contraintes
»
(6).
Ainsi, « les réformateurs
sont
impardonnables
»
(7).
Et les détracteurs ? Jean-Claude Milner va même jusqu’à assurer : «
Il n’y a pas de puissance plus
dangereuse pour les libertés que l’opinion – qu’il s’agisse de l’opinion
brute ou de l’opinion
médiatisée.
»
(8)
À la virulence de ces propos qui ont eu un succès
d’édition, et à l’emploi incessant du terme de
haine, on peut
voir qu’au nom du républicanisme la confusion des oppositions entre
pessimisme et optimisme, élitisme et égalitarisme, légalisme et
démocratisme se manifeste encore chez nous périodiquement. Jusques à quand
?...
Péguy nous avait pourtant avertis au début du siècle, à
propos de « ceux qui savent,
de ceux à qui on n’en remontre pas...,
de ceux qui font les
malins »
(1) ; dénonçant
« tout le fatras des propos
et des conversations, les embarras, les apparentes contradictions, les
embroussaillements, les inextricables difficultés de jugement, les bonnes
fois contraires et les mauvaises fois
entrelacées
»
(2).
Par rapport à cette confusion, le poète d’Ève nous avait prévenus :
« La dérision et le sarcasme
et l’injure sont des barbaries. Ils sont même des barbarismes. On ne
fonde, on ne refonde, on ne restaure, on ne restitue rien sur la
dérision.
»
(3)
Avis à ceux qui, se référant benoîtement à Péguy,
s’empressent de prendre à partie, de couvrir de sarcasmes, de « diaboliser
» les « réformateurs », les « pédagogues » : avec les répétitions d’un
harcèlement médiatique. Bégaiement, barbarie : même étymologie, on le
sait... Mais il y a des limites !
|
|
|
(1) Cité
in
Martine Jey,
La Littérature au lycée :
invention d’une discipline (1880-1925),
Université de Metz, 1998, p. 95. Nous nous appuierons volontiers sur cette
étude approfondie dans ce qui suit.
(2) Voir A. Chervel,
La
Composition française au XIXe siècle,
INRP-Vuibert, 1999.
(1)
Ibidem,
p. 182 : « Dans la
Revue universitaire,
une manière de rubrique paraît avec une certaine régularité jusqu’en 1925 et
porte ce titre ».
(2) En tant que «
valeur
consensuelle laïque, par laquelle la République ravit à l’Église son
directoire des âmes et des intelligences
», notent Anne-Marie Chartier et Jean
Hébrard, in
:
Discours sur la lecture
1880-1890,
BPI, Paris, 1989.
(3) Cité par Martine Jey,
op. cit.,
p. 36.
(4) Cité
ibidem,
p. 38.
(1) Martine Jey,
op. cit.,
pp. 191 et 192.
(1) Cité
ibidem,
p. 193.
(2)
Ibidem,
p. 196.
(3)
Ibidem,
p. 199; opinion de M. Santiaggi.
(1)
Ibidem,
p. 202.
(2) M. Jey,
ibidem,
p. 203.
(3)
Ibidem,
p. 203. Révision ? Retour en arrière...
(4)
Ibidem,
p. 200.
(5) M. Jey,
op. cit.,
pp. 200-201.
(6)
Ibidem,
p. 201.
(7) Voir les propos tenus en 1992 au centre Galilée, au cours d’un colloque
où s’opposaient Finkielkraut et A. Prost, par un intervenant, professeur de
préparatoire : « Dix à
treize pour cent des candidats à l’École polytechnique sont pratiquement
illettrés. » Illettrés : on
va fort ! Des professeurs saisis par l’outrance ? Inculture ?
In
:
Quels enseignants pour quelle
école ?,
op. cit.,
p. 79.
(1) Encore en 1945 ! Il y avait, en
chiffres arrondis, 20000 bacheliers du bac philo, mais moins de 3 000 en «
math-élem
», et 7 000 en «
sciences
».Voir Antoine Prost,
in
:
L’Enseignement et l’Éducation
en France,
tome IV, Nouvelle Librairie de France, 1981, p. 232.
(2) Martine Jey,
op. cit.,
p. 207.
(1) Cité
ibidem,
p. 212.
(2) Dont on ne peut oublier la
définition de la culture : «
ce qui reste
quand on a tout oublié
». Vision de pessimisme pour ce qui se passe entre
collègues ou invitation à la modestie affable et à un « habitus »
d’ouverture ?
(3) A. Prost,
in
:
L’Enseignement et l’Éducation
en France,
op. cit.,
p. 231. |
8
Intermède d’une
« étude de cas » : la « réforme » de 1902 (avant, pendant, après)
Il peut être avisé, en ce point de nos nationales
anamnèses et continuités, de revenir paisiblement (à titre d’une
illustration typique de nos imbroglios passionnels et de nos controverses)
sur le conflit qui s’est étendu à la jointure des
XIXe et
XXe siècles, entre 1890 et 1902
puis au-delà : à propos du latin et du français « moderne » (et aussi en
raison des oppositions entre cléricaux et laïcs, permanentes...).
Place au français
La IIIe
République, Jules Ferry en tête, avait déjà amorcé le recul du latin. Dès
1880, le discours latin disparaît du Concours général, la composition
latine est supprimée au baccalauréat, en aboutissement de débats
virulents. Et c’est Jules Ferry (moderniste ?) qui « salue » à son « tour
» « cette royauté
universitaire qui disparaît. Pour la dernière fois, la période
cicéronienne a dit son dernier mot. Le discours latin a vécu. Il avait
longtemps régné sans partage sur le monde scolaire. Des générations de
maîtres et d’élèves s’étaient formées à son image. Si le sacrifice est
juste, s’il était nécessaire, il a sa solennité, j’oserais presque dire :
sa
mélancolie.
»
(1) «
Si le sacrifice est juste...
», les conséquences furent importantes. La «
composition française
», la « dissertation
française », nées au début du siècle (avec quelques autres
épreuves), vont
triompher(2).
Mais la discorde entre conservateurs et modernistes ne fait que
rebondir.
Et elle se voit réattribuer le titre de « querelle des
Anciens et des
Modernes » (1).
À deux siècles près ! Il est vrai que le motif d’antan (ci dessus
rappelé) avait fait l’objet d’une transaction : le siècle de Louis XIV
avait été « classé » à l’égal des siècles d’Auguste et de Périclès ! Il
fallait un nouveau motif d’antagonisme et de querelle : ce fut donc
l’opposition faite, par les « classiques », aux « romantiques » et «
contemporains ». Cela n’est pas complètement nouveau... ni obsolète !
Plus souterrainement, l’étude d’un «
petit noyau »,
bien choisi, de « classiques»,
et imposé en littérature face au latin, rallierait les «
laïcs » (face aux
« cléricaux
»)
(2).
Mais les contemporains ? Brunetière put écrire, dans la
Revue des Deux Mondes
en 1883 : « Si haut
que se soient élevés les Lamartine, les Musset, les Hugo, eux non plus ne
sont ni ne seront jamais classiques ; trop éloignés de l’époque de la
perfection de la langue, les littératures étrangères ont trop profondément
déteint sur
eux.
»
(3) Ah!
l’étranger... Et le péremptoire...
L’âge d’or, celui de la « perfection », est naturellement
le XVIIe siècle, porté aux nues
(à l’envers, on s’en souvient, des anciens « Anciens » rejetant, par
défense de celui de Périclès, ce siècle de Louis XIV!). La littérature
dix-septièmiste, assurera encore en 1900 Petit de Julleville, auteur
important en son temps, « est
assurément le plus beau fruit qu’ait donné lagreffe antique insérée dans
la tige moderne et
chrétienne
(4).
»
Peut-on oublier aujourd’hui, dans nos émois et
interrogations sur les programmes de lettres, que le
XVIe siècle aussi bien que le
XVIIIe restèrent longtemps au
purgatoire ? Montaigne n’entrait au programme de Seconde qu’en 1880, à
celui de Rhétorique seulement en 1895. Et Gustave Lanson, auteur d’une
célèbre Histoire de la
littérature française, resta longtemps réticent à l’égard du
XVIIIe siècle. Sans doute les
philosophes, les écrivains des « Lumières » furent suspects au
XIXe siècle : réaction... Et
puis, on évolue, lentement, doucement...
Mais les vrais problèmes des courroux jugés indispensables
vont se situer dans les rivalités successives : entre les conservateurs
défendant la primauté du latin et les réformateurs soutenant la promotion
du français (oui, du français ! par la littérature) ; puis, entre les
littéraires (latinistes et tenants du français « moderne » apparemment
réconciliés) et les hérauts de la science ; mais aussi entre les «
humanistes » désintéressés et les « utilitaristes » (les enseignements
pratiques, professionnels, n’ont pas la cote) ; ou encore entre défenseurs
des « hiérarchies » et zélateurs d’une dignité reconnue
égalitairement à
leurs disciplines ou cursus.
Le latin ou la vie !
Car l’acmé des controverses va se situer à l’occasion de
la réforme de 1902, réorganisant l’enseignement secondaire en y
réincorporant l’enseignement « spécial ». Quatre « sections » sont alors
constituées, en égale dignité (?) : latin-grec (A), latin-langues (B),
latin-sciences (C), langues-sciences (D). La loi promulguant cette réforme
« accorde l’égalité des
sanctions et permet, comme le dit Louis Liard, alors directeur
des Enseignements supérieurs, de réaliser
l’unité dans la diversité
». Assertion « différentialiste » ! Ou référence à Leibniz ?
Martine Jey cite à cette occasion les propos rassurants du
ministre Georges Leygues, donnant un double rôle à l’enseignement
secondaire « Nous
devons [...]
préparer une élite éclairée et libérale, une aristocratie d’esprit qui,
s’élevant au-dessus du réalisme utilitaire, se voue aux recherches
désintéressées, aux hautes spéculations et sauvegarde les intérêts
permanents et supérieurs du pays. Nous devons, d’autre part, constituer
fortement l’armée du travail, lui donner un état-major et des
cadres.
»
(1)
Il y a bien de quoi rassurer ! L’«
aristocratie d’esprit
» est reconnue (et soutenue) pour l’élite (républicaine ?). «
L’état-major » est
promis et préparé pour encadrer les populations actives («
l’armée du travail
» !). Ceci en pleine querelle anticléricale : Émile Combes,
président du Conseil, va faire fermer en 1902, justement, toutes les
écoles non autorisées dirigées par les congrégations (en attendant plus).
Le conflit entre cléricaux et laïcs attisé, la protection
tutélaire de l’armée requise pour un second degré sans latin, ces
précautions de diversion ne suffisent pourtant pas pour calmer le jeu des
controverses républicaines, soulevées par la réforme de 1902. Une seule
section sans latin ? C’en est trop ! Les latinistes crient
aussitôt à la mort
des humanités. « Alea jacta
est ! » titre un article de la revue
L’Enseignement secondaire,
signé Bourdhors : « Le Sénat
a jeté la suprême pelletée de terre sur cet enseignement secondaire qui
distingua la France du
XIXe siècle.
Il n’y a plus d’ humanités.
Quatre enseignements
diversement spécialisés mènent également
» (Ah! l’égalité...) «
à toutes les carrières.
J’oubliais un cinquième : l’enseignement
primaire supérieur
qui en pourra ouvrir l’accès
plus prompt par un chemin plus
court
»
(1)
(au lieu du « détour » distingué).
L’indignation des humanistes n’empêche pas la vive
réaction, symétrique, de certains partisans du « moderne », déçus à titre
« égal ». Olivier Billaz, dans le cadre de la Société des amis de
l’Enseignement moderne, s’indigne : «
Jamais peut-être, en effet,
depuis vingt ans, nous ne fûmes plus éloignés de voir se réaliser des
lettres modernes, de l’enseignement secondaire sans grec ni latin, et
pourtant intégral, de l’éducation véritablement nationale, républicaine,
démocratique.
»
(2)
On retrouve ici la difficulté de trouver une mesure qui
puisse satisfaire, un peu, au
moins une des deux parties directement en cause dans une
controverse française, ni qui puisse modérer les annonces de catastrophes
(nous connaissons !). Pire : on craint un tiers larron (à défaut du «
Tiers-Instruit » de Michel Serres), à savoir le camp des scientifiques
(futurs nouveaux « Modernes »). Et, face à ce danger, les « modernes »
littéraires appellent sans retard les partisans des langues anciennes à
faire cause commune avec eux pour garder la suprématie des lettres :
glissement sensible de la querelle des Anciens et Modernes, version
français-latin (ou latine !), à une querelle perpétuée mais, cette fois,
version lettres sciences (on connaît encore !).
La crise du français (sempiternelle ?)
Tout juste ! La crise du français est bientôt annoncée,
dénoncée, redénoncée : et ce sera la faute « à » la réforme de 1902,
accusée d’entraîner « la
décadence de la langue », l’affaiblissement du «
sens littéraire »,
et déjà, en 1907, « le
formidable déclin de la composition
française
»
(3).
Déjà! La réforme, voilà l’ennemie...
On verra ci-après la dramatisation des faits explicitée en
1910 par Émile Faguet, pour qui il y aura « deux langues » et «
quatre causes à la crise :
l’abandon du latin, les programmes encyclopédiques des lycées, la
spécialisation hâtive entraînée par les quatre cycles, la lecture des
journaux
substituée à celle des
livres
»
(1).
Étrange actualité de ces incriminations et de leur déchaînement
irrationnel, passionnel ! Les programmes « encyclopédiques»... «
La
“crise”
prenant de l’ampleur, en 1911,
Paul Crouzet parle d’une nouvelle affaire
Dreyfus.
»
(2) Rien de
moins... On voit jusqu’où les passions sont allées. Et hommes de lettres,
académiciens (A. France, E. Faguet, H. Poincaré, J. Richepin !) viennent à
la rescousse et signent une pétition : «
Nous avons l’honneur d’attirer
votre attention sur une révision des programmes de l’enseignement
secondaire, élaborés en 1902, lesquels ont à peu près aboli l’étude du
latin dans les lycées et en même temps affaibli déplorablement l’étude du
français.
»
(3)
La vivacité des rumeurs incessantes avait incité à opérer
une enquête nationale en 1909, en vue de comparer les copies des élèves à
vingt ans d’intervalle. Paul Crouzet, dans la
Revue universitaire,
constate, pour le lycée Charlemagne : «
Le résultat a été nettement en
faveur des élèves de 1909. On remarque seulement en 1909 la disparition
des notes
moyennes.
»
(4) Mais à quoi
bon les faits ! Enquête en 1910 sur tous les lycées de l’académie de Paris
: « Pour le sénateur Couyba,
rapporteur du budget de l’Instruction publique, les résultats
“ne justifient
pas le nom de crise” et
son rapport se termine par une formule qui se veut apaisante :
“la conclusion,
c’est que, de tout temps, l’art de composer et d’écrire n’a jamais été que
le privilège des élèves les mieux doués.”
Mais la rumeur
perdure
(5)
». Eh oui !
Madame Jey cite alors, avec humour (et avec pertinence
pour nos esprits d’aujourd’hui), une argumentation belliqueuse de 1911 : «
Le Comité des Forges, par
l’organe de son président, vient de partir en guerre contre les réformes
de 1902 et pour la restauration des humanités grécolatines. Il paraît que,
depuis cette époque funeste, les ingénieurs sont devenus subitement
incapables “d’utiliser leurs connaissances techniques et de présenter
leurs idées dans des rapports clairs et bien
rédigés”.
»
(6) L’antienne
continuera aussi
(7) :
mais on peut remarquer l’aspect « magique »dénoté par le « subitement» !
Croyances, dénonciations de coupables, irréalismes...Tout était-il perdu ?
Il n’en était rien! Le latin et les lettres continuèrent
longtemps à être
dominants ! (1)
Mais la « réforme » est toujours malvenue, chez nous, suspectée !
Et l’antagonisme des deux
nigauds est toujours requis. Le passé, ancien, est donc
idéalisé ; le passé récent est diabolisé. Le devenir proche est condamné ;
le devenir lointain est dévolu à des « lendemains qui chantent ». Suivant
les uns et les autres, sans position médiane possible. Pourtant, le «
français moyen » est discerné par Édouard Herriot ! Alors ?
Dilemme
Gustave Lanson avait pu dire en 1909 au cours d’une
conférence au Musée pédagogique : «
Si nous estimons que
l’enseignement du français doive consister dans la communication d’une
culture raffinée, d’une délicatesse extrême du goût, dans l’apprentissage
des jouissances les plus fines de la littérature, [...]
alors il nous faut demander
[...] que cet
enseignement, qui n’est bon en tout cas que pour une élite, nous ne le
donnions plus qu’à une
élite.
»(2)
Insupportable dilemme, encore actuel : l’enseignement ou l’élève ? la
culture unique et raffinée ou la démocratie ? l’élite ou le peuple ? la
qualité ou l’exclusion ? On le sent, querelles et diatribes auront encore
« du grain à moudre » !
Surprendrait-on alors quelque âme sensible, en précisant
qu’après la pause due à la « Grande Guerre », les « Anciens » et les «
Modernes » revinrent fièrement à leur querelle ? (À la charge !...) Les
premiers revendiquent derechef le recours obligatoire au latin pour
l’enseignement secondaire ; et ils dénoncent l’invasion de ses
établissements par les « barbares » venus du primaire : «
Il nous vient en Sixième des
éléments qui n’ont rien fait de bon dans le primaire et qui notoirement
n’ont rien de ce qu’il faut pour entreprendre des études secondaires. Ils
paralysent les classes, dont ils constituent la majorité. Quelques-uns de
ces poids morts, de ces non-valeurs, éléments inertes ou éléments de
désordre, arrivent sans grande conviction. [...]
Mais la plupart de ces
indésirables se cramponnent. Nous les traînons de classe en classe, et
tout notre effort
consiste à les éliminer
progressivement.
»
(1) Ah! ces
indésirables ! ces nonvaleurs ! Quelle franchise ! Cette vertu,
aujourd’hui, serait-elle cachée chez les actuels contempteurs de l’École ?
Et que faisaient donc les « hussards noirs », instituteurs d’alors, tant
loués, de ces élèves ? Mystère...
De leur côté, les Modernes, notamment les « compagnons »
universitaires (instruits par la guerre), relancent intrépidement
(prématurément?...) le débat sur l’École
unique, concevant la suppression des écoles primaires
supérieures. Il leur faudra patienter. Les Anciens l’emportent en 1923.
Les dispositions de 1902 sont (enfin !) annulées, au terme de vives
polémiques, parlementaires et publiques. Léon Bérard rend, en effet, le
latin obligatoire
dans les lycées, « unifiant
» les enseignements en une sorte de «
tronc commun »
jusqu’en Troisième et réduisant ensuite à deux les «
sections ».
Succès, de courte durée.
Dès 1927, les Modernes reviennent à la charge avec Édouard
Herriot
(2)
: le latin perd à nouveau son statut obligatoire ; le français se
reprend ; les controverses continuent. Mais la
gratuité va être
accordée dans le second degré, dans les années 1930, entrouvrant les
portes aux milieux modestes.
Et puis viennent la Seconde Guerre mondiale, l’occupation
de la France, et le gouvernement de Vichy. En 1941, Jérôme Carcopino va
jouer un jeu de bascule contre les mesures équitables d’Édouard Herriot. «
Carcopino voulait en effet
renforcer les humanités classiques, commente Antoine Prost.
On retrouve, dans le ministre,
le professeur d’histoire romaine en Sorbonne. C’est pourquoi il rend le
latin obligatoire dans toutes les sections des lycées, comme Léon Bérard
en 1923. Du coup, il devient difficile de maintenir dans toutes les
sections littéraires le même niveau d’exigence scientifique que dans les
sections scientifiques. Carcopino renonce donc à l’égalité des programmes
établie en 1927 par Herriot contre la politique de Léon
Bérard.
»
(3) Et la
boucle est une fois encore bouclée.
Exit l’égalité !
Est-il besoin d’ajouter : pas pour longtemps ! La
Libération, dès 1944-1945, ramène une volonté d’ouverture. Les « Modernes
» reviennent naturellement au premier plan, avec les «
classes nouvelles
» de Gustave Monod. Les réflexions, au coude à coude, dans les solidarités
des maquis et des camps, se fédèrent dans le plan Langevin-Wallon dès
1947. Dans son esprit, l’«
École unique » va s’amorcer en 1959, se préciser en 1976, se
développer depuis lors, comme on le verra ci-après : dans le tumulte des
inépuisables conflits, passions et controverses. L’École française
pourra-t-elle convenir à notre temps et à nos contradictions ? |
| |
|
| |
|
|
En complément,
la banque des graphes et des schémas
en éducation et en formation
Quelques pages lui sont plus
particulièrement dédiées:
l'arbre des
différenciations potentielles
les
8 paradigmes en pédagogie
les 30
compétences de l'enseignant moderne
pédagogie des
rôles et responsabilisation
variété des
groupements
alterner les
temps et les rythmes
|
PARTIE 2:
L’École française peut-elle convenir à notre temps ?
HAPITRE
9: L’imbroglio perpétué ?
C HAPITRE
10: Le mythe identitaire
.
C HAPITRE
11: Stagnation sur un
demi-siècle .
C HAPITRE
12: Évolutions et
transvaluations .
C HAPITRE
13: Explosions scolaires et
universitaires
C HAPITRE
14: Grandes manœuvres (ou
l’imbroglio retrouvé ?)
C HAPITRE
15: La revanche des adultes et
des clercs
C HAPITRE
16 : Cohabitation et
manifestations
|
|
Bibliographie |
une
interview exclusive sur le sens des
nouvelles réformes et l'évolution du métier |
| |
|
|
