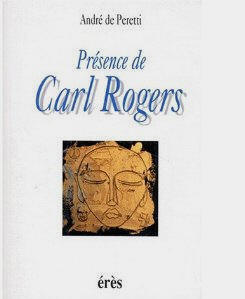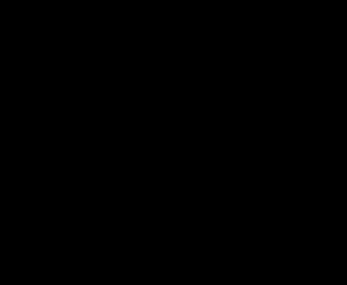|
Introduction
Chapitre XI. Positions et
subjectivité
Etre vraiment soimême
S’écouter, s’accepter soimême
Limitation et négation hégélienne
Se permettre de comprendre et d’accepter autrui sans arrangement....
Constatation et évolution
L’expérienceguide
Expérience et autorité
Expérience et objectivité
Le plus personnel et le plus général
L’orientation positive
Chapitre XII. Propositions et
hypothèses théoriques
Une espèce sociale
Indépendance et directionalité
L’homme est organisme
Régulation de stabilisation et de disponibilité
Fonctionnement par disponibilité et théorie du « champ"
La rupture du fonctionnement « optimal ».
L’émergence du moi (self) et l’extension de la conscience
Régulation et conscience
La « scène primitive ».
Schémas d’approche
Une seconde analogie
Troisième analogie
Défenses et crispation de soi
Chapitre XIII. Dispositions
techniques et pratiques
Fonctionnement optimal et paradoxe d’une aide
Des conditions attitudinelles nécessaires et suffisantes
Réalisme et congruence (Realness, Congruence, or
Authenticity,
Genuineness)
Congruence et transparence
Congruence et réserve
La considération positive inconditionnelle (Unconditional
Positive Regard)
Considération et sollicitude
Considération et négativité
L’empathie (Accurate Empathic Understanding)
Empathie et différence
Empathie et expression
Dialectisation des « conditions »
Le processus de l’évolution
Chapitre XIV. Le développement de la
recherche
sur la thérapie et les relations humaines
Méthodologie objective et enregistrement..
Critères structurels de mesure.
Critères structurels de mesure propres à la conduite du thérapeute..
Critères structurels de mesure appropriés au client..
La corrélation interpersonnelle ou la technique du Qsort...
Des études nouvelles sur le comportement des thérapeutes
d’écoles différentes.
D’autres études sur le comportement des thérapeutes.
Nouvelles recherches « du côté » du client...
Les plans méthodologiques.
Les variables de la perception de soi.
Les variables relatives à l’adaptation (adjustment).
Les variables relatives aux attitudes face à autrui..
La maturité émotionnelle..
Les recherches sur le processus de la thérapie...
Les recherches sur les schizophrènes..
Les groupes et les systèmes pédagogiques...
Recherches en éducation....
Chapitre XV. Relief et paradoxes....
L’alerte centrale.
Limites.
Retenue ?..
Lourdeur ou providentialisme.
Un nouveau point de vue..
Simultanéisation et sens des paradoxes existentiels..
La philosophie du non et le néopersonnalisme.
Indications bibliographiques.
Index...
|
Introduction
Rogers a eu le souci permanent de
s’expliquer sur son « apprentissage fondamental », c’estàdire sur les
enseignements stabilisés ou les positions pratiques qu’il a tirés de
toutes ses expériences, non seulement au travers de « rencontres »
stimulantes (la Chine, Kilpatrick et Dewey, Rank, Kierkegaard et Buber,
Tillich, Polanyi), mais surtout au cours des milliers d’heures « passées
à travailler dans l’intimité d’individus en détresse ».
Il a insisté sur l’aspect personnel
de ses réflexions : « Ce sont des enseignements qui ont une
signification pour moi. J’ignore s’ils seraient valables pour vous. Je
n’ai nullement l’intention de présenter des recettes, mais je sais pour
ma part que, chaque fois qu’une autre personne a bien voulu me parler de
ses options personnelles, j’y ai gagné quelque chose, ne seraitce que le
fait de constater la différence qu’elles présentent avec ma propre
orientation ».
Et il précisa avec soin que ses expériences et l’usage qu’il en fit ne
sont pas figés mais changent d’importance ou de priorité dans les
positions méthodologiques qu’il adopta successivement.
Ces positions de plus en plus
amples, se répartissent sur un espace cohérent et fibré où elles
contrastent mais s’étayent et se fortifient réciproquement, sans
toutefois se bloquer ou se réduire. Hypothèses foncières sur lesquelles
reposent les finesses et les sécurités de sa pratique clinique, ou
logiques conceptuelles susceptibles d’être validées par des recherches
expérimentales rigoureuses et originales, ses conceptions se renforcent,
s’accompagnent, se servant de tuteurs réciproques, ou s’hybridant de
façon germinative. Avec toujours un double souci d’économie et
d’élégance.
Il est intéressant de noter selon
quels ordres variés Rogers effectue la présentation de ses positions.
Dans certains cas, il part de vues naturalistes relatives à l’espèce
humaine, et il aboutit à des aperçus personnels sur sa perception de
l’humain ou sur sa pratique.
Semblablement, dans une étude publiée en 1959,
Rogers expose de prime abord ses positions relatives à la raison d’être
de la recherche scientifique et de l’explication théorique ; il chemine
ensuite en analysant la phénoménologie des sciences (observée comme
« processus de développement » incessant) puis leurs stades différents
d’avancement, notamment pour la psychologie par rapport aux sciences
physiques, et il progresse en manifestant « la conscience aiguë du
caractère essentiellement provisoire de la connaissance scientifique »
comme « exigence primordiale de l’attitude scientifique » ; la théorie,
dans cette suite de conceptions, sert donc à stimuler la pensée
créatrice et non à la pétrifier ; elle peut « retenir » à l’infini mais
doit se souvenir de son niveau réel de validité ; à ce point Rogers
pose, par rapport à l’évaluation des théories, sa « foi inébranlable
dans la primauté de l’ordre subjectif ».
Mais en fait, dès le départ, Rogers avait assigné à la recherche
scientifique le but capital d’une « organisation cohérente d’expériences
personnelles significatives »,
en pionnier des plus modernes conceptions épistémologiques.
Ainsi, ordonnances objectives
ou expériences subjectives se balancent et s’équilibrent
dynamiquement dans sa pensée et son action. A aucun moment, il ne lâche
la rumination sur ses dispositions intérieures (étendues depuis les
révélations du Teachers College et de l’Institut de Child
Guidance), mais il ne cesse non plus d’inventorier les lieux
expérimentaux et les modalités de validation des hypothèses implicites
qu’il s’acharne à déceler et à formaliser (fidèle aux enseignements de
Columbia). Et cette validation s’exécute en évitant de séparer concepts
et vécu, idées et affectivité, critères objectifs et sentiment. Une
immédiateté de la communication, un « continuisme » interne et externe
de ses énergies multiples à tous les niveaux simultanément possibles,
sont obstinément tentés, par approximations successives. Et il étend
sans cesse, en spirales, à l’exploration de nouveaux domaines les
instruments élaborés.
Une telle texture serrée en
« trame » émotionnelle et en « chaîne » rationnelle croisées vaut d’être
approfondie et commentée tant dans ses positions fondamentales que dans
ses hypothèses théoriques ou dans ses dispositions affinées et
maîtrisées. Ne seraitce que pour éviter beaucoup d’erreurs
d’interprétation, et par suite un manque à gagner dans la communication
à la pensée et à l’œuvre de Rogers. Nous partirons successivement « du
côté de la subjectivité » puis nous irons « du côté de la procédure
scientifique ».
Chapitre XI
Positions et subjectivité
Nous avons reconnu chez Rogers une
accentuation volontariste de la subjectivité qu’il projette de dégager
et de soutenir en luimême et en autrui. Ces positions méritent un examen
attentif.
Ce n’est pas seulement l’option
d’un psychologue, attaché à l’importance de la conscience individuelle.
C’est également un point de départ incessant, fondé sur son expérience
mais aussi sur la philosophie de Dewey et, pardelà, sur la démarche
cartésienne. Car il s’agit d’un cogito élargi aux résonances
émotionnelles et affectives de l’être qui s’affirme (mais Descartes ne
traitaitil pas déjà des « passions de l’âme » ?) et qui articule son
désir d’exister.
En fait la notion de subjectivité
peut avoir une consistance variable. Elle peut dénoter la rigidité d’un
rapport à un motif de soi, définitif et fermé ; ou bien la mobilité
d’une identification diffuse des autres et de soimême ; mais elle peut
aussi désigner une structure de stabilisation des relations d’un
organisme humain en interaction, en harmonie mouvante, avec d’autres
personnes. Elle peut, d’autre part, con
noter une identité soutenue dans la durée par une mélodie étendue ; ou
bien une expérience en changement et, par suite, marquée par une
exigence d’immédiateté, d’accord, de « simplicité » (au sens de
Descartes) dans la perception de la conscience.
On pressent où iront les
déterminations actives de Rogers, proférées selon quatorze assertions
dans Le développement de la personne (et que nous avons rédigées
en italique).
Etre vraiment soimême
Le but de la vie, tel que Rogers le
discerne dans son travail et notamment dans ses rapports avec les
clients, lui apparaît au travers des mots de Kierkegaard : « Etre
vraiment soimême ».
Il ne s’agit pas ici d’un truisme, mais subtilement, d’un projet de
devenir, afin de peser dans le concert du monde et d’y établir sa note
personnelle, son octave (son quantum) de possibilités originales.
Cela est doublement ardu. D’une
part, être soimême revient à lutter pour se dégager des fausses
identifications, des fausses notes, des « façades »
que nous empruntons pour faire chorus à autrui : par habitude et par
calcul, en effet, nous présentons aux autres afin de résister à leurs
pressions transférentielles et déformantes (ou déplacées de leur lieu
réel) une ritournelle (une image) conformiste et contournée, biaisée…
Paraître à l’unisson des autres économise pour tous, en effet, des
incertitudes, des questions, des efforts d’ajustement ou des épreuves de
dissonance. Aussi les comportements de complaisance, de collusion sont
socialement recommandés et entretenus ; bien plus, le penchant naturel à
la facilité ou notre propre pesanteur nous portent à les soutenir au
lieu de maintenir notre tonalité propre ; et enfin on pourrait
volontiers croire à l’utilité de fixer devant autrui, par nos
comportements, une sonorité conventionnelle de soi, fiable parce que
constante et imperturbable. Il n’en est malheureusement rien. Toute
complaisance, toute inertie, toute fixité à un masque, à un indicatif,
entraînent des interférences de contradictions et des biais sans fin :
« Car je ne suis pas ce que je prétends être. De la sorte mes paroles
communiquent un certain message, mais je communique aussi d’une manière
détournée l’agacement que j’éprouve, ce qui crée une certaine confusion
chez l’autre personne et la rend moins confiante, bien qu’elle puisse
être inconsciente de ce qui crée la difficulté entre nous ».
L’unisson faux devient confusion.
Mais d’autre part, je ne puis me
dégager de façon simpliste. Si je veux échapper à l’ambiguïté, il me
faut constater mes ambivalences et, pour éviter le trouble, réaliser une
décantation des tendances dysharmoniques mélangées, qui sont en moi,
réellement. Il s’agit donc de ne pas me maintenir sur des attitudes
dépassées au moment même où elles se forment face aux autres et à leurs
influences, mais de me permettre une stabilisation provisoire des
sentiments naturellement évolutifs : ceuxci sont signifiants par la
nature de leur mobilité et leur rythme plus que par leur localisation
momentanée ; il faudrait les réunir avec leurs vibrations et leur
mouvement dans une forme reliée à mes profondeurs, à ma « tonique de
base ».
C’est là que se situe l’acte
essentiel (et contradictoire) d’une subjectivité. Celleci n’est pas
toute faite, toute donnée, toute unie mais en élaboration (ou épuration)
continue de son harmonie autonome et de sa densité de réalité. « Puisje
avoir une personnalité assez forte pour être indépendant de l’autre ? »
s’interroge Rogers. « Mon moi intérieur estil assez fort pour sentir que
je ne suis ni détruit par sa colère, ni absorbé par son besoin de
dépendance ni réduit en esclavage par son amour, mais que j’existe en
dehors de lui avec des sentiments et des droits qui me sont propres » ?
Comme un chanteur dans un chœur, un moi suffisamment fort dans sa
subjectivité s’affirme en se prémunissant contre les risques de
dépendance à autrui et les pressions d’altération (ou de conformité) :
il le fait non pas en rejetant la résonance aux autres, en se raidissant
défensivement, mais en se vérifiant sur luimême, sur sa note intérieure
profonde, pour sa fiabilité présente et à venir.
« Expérience » mûrement consultée.
Rogers établit donc comme règle initiale de sa conduite et des
directives qu’il se donne (on peut penser aussi à ces « règles pour la
direction de l’esprit », rédigées par Descartes pour ses trentedeux
ans) : « Dans mes relations avec autrui, j’ai appris qu’il ne sert à
rien, à long terme, d’agir comme si je n’étais pas ce que je suis ».
Cette position de « bon sens » signifie que s’il s’équilibre d’abord sur
luimême et sur ses mouvements ou sonorités profondes, s’il se garde des
compromissions et d’une défensivité réactionnelle, mais s’il conserve
cependant une distance ou une distinction sans excès visàvis d’autrui
(tout excès manifesterait une contredépendance, qui reviendrait à une
dépendance accrue), l’individu peut trouver un point d’appui, un « la »
fondamental en lui, et dans sa solitude même mais sans isolement. C’est
ce que Charles Morgan dénommait singleness of mind, c’estàdire
tout ensemble l’unité, la singularité, et la droiture de l’esprit : et
ce qu’on pourrait traduire par l’adhésion intégrale à soimême, ou encore
la participation à la houle profonde qui nous porte et nous unifie en
dessous même des clapotis insignifiants.
Mais le mouvement de présence à soi
(que j’appelle une « présenciation » par un néologisme inspiré de
l’autre terme de Berthold Brecht, « distanciation ») n’est guère acquis
une fois pour toutes, et il est rien moins que facile.
S’écouter, s’accepter soimême
Car il n’est pas commode de
s’accueillir, de s’écouter soimême. Une personne n’accède pas
nécessairement à toutes les informations, à toutes les harmoniques qui
l’habitent : elle peut différer ou disjoindre les prises de conscience,
les notes, qui tendent à émerger en elle ; elle peut établir des
préférences sur certains de ses sentiments ou de ses attirances et se
détourner partiellement de soi ou d’une part de soi, refusant par
exemple ses imperfections ou dissonances. Ce faisant, elle désintègre
partiellement le processus d’unification et de « résolution » ou
décision qui est à l’œuvre dans sa subjectivité, elle désaccorde sa « présenciation »
à ellemême, et elle diminue ses chances d’action et de relation : elle
diminue ses possibilités de « vérification » dans la rencontre
d’autrui ; elle diminue sa tension réelle, assourdissant sa « tonique ».
Alors que, note Rogers, « mon intervention est plus efficace quand
j’arrive à m’écouter et à m’accepter et que je puis être moimême ».
Intervenir sur les autres personnes
suppose au préalable, convenir de soi, et donc de ses défauts
et des limitations, de sa tessiture, en ce que cellesci sont
constitutives de l’articulation de notre subjectivité par rapport à
celles des autres. N’être que soi : Rogers reconnaît que les premiers
apprentissages signifiants, les premières règles qu’il institue,
pourraient être qualifiés de négatifs.
(Et il est intéressant que la règle ii
que Descartes se formule ait aussi ce caractère négatif : « Il ne faut
s’occuper que des objets dont notre esprit paraît capable d’acquérir une
connaissance certaine et indubitable ».
Soi, pour commencer, et sa finitude, dans une subjectivité maîtrisée.)
Il s’agit, en effet, non pas de se
laisser porter vers un moi idéal, vers des notes trop aiguës ou trop
graves, de se référer au diapason d’un surmoi, ou d’accéder à des
niveaux superficiels et bruyants d’inspiration et de fantasmes
indéfinis, mais de se réserver à soimême et à ses possibilités
provisoires, immédiatement perçues dans leur aire limitée.
Limitation et négation hégélienne
Limitation, négation, j’ai déjà été
amené, dans d’autres ouvrages, à propos du concept de nondirectivité, à
marquer leur importance comme point de départ, comme étape ou thèse
initiale de la démarche rogérienne, et sans doute de toute démarche.
Spinoza avait énoncé : « Omnis
determinatio est negatio », « Toute détermination est négation ».
Qu’on ne se méprenne pas cependant sur la portée exacte de cette
négation : elle n’est pas mutilation, réduction, mise en infériorité et
en sourdine ou en paralysie. Hegel, établissant le mouvement
dialectique, avait d’ailleurs corrigé Spinoza : « Spinoza en reste à la
négation comme détermination ou comme qualité ; il ne parvient pas à la
reconnaître comme vraiment absolue, c’estàdire comme négation se niant ».
Ce qui implique que la négation, si elle établit des distances entre des
impressions qui autrement resteraient confuses, est éprouvée cependant
dans les limites de sa propre délimitation : elle met donc en
communication ce qu’elle a distingué ; par suite elle provoque à élargir
harmoniquement les concepts et les perceptions, les formules et les
actes, les cultures et les civilisations.
Et de fait, il ne s’agit, dans la
conception rogérienne de la subjectivité, ni d’autointimidation, ni de
diversion, ni de rétrécissement du champ d’existence à une ronde
narcissique et infantile. La subjectivité, à laquelle il a recours,
n’est aucunement un solipsisme non plus qu’un perfectionnisme
paranoïaque. Elle est une démarche qui part continuellement d’un ici et
maintenant solidement resserré et saisi (« compris » et maintenu) pour
aller avec empirisme, à l’oreille, vers un « ailleurs et bientôt » en
accroissement incessant. C’est un accueil progressif (non
perfectionniste et crispé) de soi, retentissant en un développement de
la personnalité associé à un accueil plus harmonique et plus vigoureux
d’autrui.
Rogers précisera vers les années
1970 : « Lorsque je puis accepter d’avoir de multiples défauts et
lacunes, de commettre de nombreuses erreurs et d’être souvent ignorant
là où je devrais être bien informé, d’avoir souvent des préjugés là où
je devrais avoir l’esprit largement ouvert, d’éprouver fréquemment des
sentiments qui ne sont pas justifiés par les circonstances — alors, je
puis être beaucoup plus réel, plus authentique. De même, en ne
portant pas d’armure et en ne faisant rien pour me montrer différent de
ce que je suis, j’apprends beaucoup plus, même à partir des critiques et
de l’hostilité, je suis beaucoup plus détendu et je puis être beaucoup
plus proche d’autrui. En outre, le fait que j’accepte de me montrer
vulnérable entraîne chez les autres tellement plus de sentiments réels à
mon égard que j’en suis vraiment récompensé ».
La négation (niée) des
phantasmes (mais non de l’imagination et de la créativité) par le
contact vital des limites rend les relations à soi et à autrui plus
réelles et plus intenses. Les notes sont claires et se poussent à leurs
thématiques conjuguées. On comprend les conséquences cohérentes que
Rogers tire de ses positions, si on observe avec P. Morel — dans une
perspective hégélienne (mais aussi kierkegaardienne, en dépit des
oppositions) : « Plus l’individu s’accepte fini, plus reculent ses
limites, plus il apparaît comme un champ d’être toujours en expansion ».
Se permettre de comprendre et
d’accepter autrui sans arrangement
Non que cela soit aisé :
« M’accepter tel que je suis, permettre à l’autre personne de s’en
rendre compte, est la tâche la plus difficile que je connaisse et je n’y
réussis jamais pleinement. Mais le seul fait de me rendre compte que
c’est là ma tâche a été très enrichissant ».
Aussi bien, assuré fortement sur
luimême et sur le « risque » d’être soi dans ses limites, Rogers accède
à des relations interpersonnelles fortes : « J’attache une valeur énorme
au fait de pouvoir me permettre de comprendre une autre personne ».
Cette « permission » d’écoute qu’on
se donne à soimême n’est pas automatique, elle procède du même effort
pour se mettre en présence de soi, et elle consolide cet effort. Il y
faut du temps et procéder quelque peu selon la règle ix
de Descartes : « Il faut tourner toutes les forces de son esprit vers
les choses de moindre importance et les plus faciles, et s’y arrêter
longtemps, jusqu’à ce qu’on soit accoutumé à avoir l’intuition distincte
et claire de la vérité ». Dans ses perspectives de simplicité subtile,
rurale, Rogers découvre expérienciellement qu’il éprouve en luimême, de
façon incoercible, un enrichissement à progresser vers une
intersubjectivité très nucléaire, et pour cela, à « ouvrir des voies de
communication qui permettent aux autres de me faire part de leurs
sentiments et de leur univers tel qu’ils le perçoivent ».
Il a consacré une somme
considérable de réflexion et d’ingéniosité dans le domaine des
communications, à la recherche de voies opératoires pratiques et à l’exploration
de leurs aboutissements. Parce qu’il en a mesuré la difficulté et l’importance.
Consentir à la différence
manifestée par la subjectivité d’autrui, agréer des réactions nettement
opposées à ses projets, ne dissout pas la force du moi mais l’alimente.
Il se produit comme un renforcement des potentiels réciproques, des
tonalités respectives. Au niveau même du langage, c’est reconnaître la
relativité du « dit » : notre position n’est pas bloquée par ce que nous
disons dans l’instant. « Demain nous en dirons davantage » remarque
Hubert Nyssen dans des propos sur la sémantique générale : « Et dans la
minute même, pourquoi d’autres n’en diraientils pas plus et mieux que
nous » ?
Tant et si bien que Rogers peut déduire de son expérience la
constatation capitale : « Il est toujours extrêmement enrichissant pour
moi de pouvoir accepter une autre personne ».
« Toujours » : quand cela est rendu possible, car cette constatation ne
signifie nullement un état de consonance permanent, obtenu sans effort
ni sans délai, devant n’importe quelle personne ou dans n’importe quel
groupe. Et elle ne conduit nullement à un besoin impulsif d’accommodement
qui reviendrait à une complicité ou à une dépendance. Au contraire, pose
Rogers, « plus je suis prêt à reconnaître ce qu’il y a de réel en moi et
chez l’autre, moins j’ai le désir d’essayer d’arranger les choses ».
C’est que toute impatience, dans le domaine des communications
interindividuelles ou de groupes, entraverait les « complexités du
processus vital »,
les maturations naturelles au travers des dissonances, et elle pourrait
pousser à des identifications crispées, ou à des charivaris fusionnels,
par rupture d’équilibre harmonique entre présenciation et distanciation.
Et on courrait le péril de refuser l’aventure possible.
Au contraire, la subjectivité, si
elle est présenciation chaleureuse à soi et à autrui, doit être observée
avec pudeur, pour n’envelopper et ne capter quiconque, même soi. Les
distances, réduites au minimum, ne sont pas annulées par promiscuité,
par déport de notes, et fusions confuses. L’invitation à la subjectivité
ne saurait être vagabondage ou laisseraller sur un marais de « bons
sentiments » et de « bonnes intentions », mais bien un embarquement
délicat et risqué, où chaque rencontre et compagnonnage s’annoncent, en
soi et pour autrui, en tonalités de devenir. Par cet embarquement on
peut aboutir à Cythère (Rogers ne recule pas devant l’émergence des
sentiments positifs) mais aussi bien à l’antre de Polyphème (et à toutes
les menaces de l’agressivité). Mais, subtil et avisé (ou rusé) comme
Ulysse, Rogers entend ne pas se laisser perdre par les sirènes : il
n’oublie pas Ithaque, et l’attente, patiente comme sa propre démarche,
de Pénélope. « L’Odyssée » des relations humaines peut aboutir. Doiton
en douter, actuellement ?
Constatation et évolution ?
Rogers en vient alors à une
considération centrale et unifiante (au niveau de la subjectivité et des
relations interpersonnelles de groupe) : « Plus je suis disposé à être
simplement moimême dans toutes les complexités de la vie, plus je
cherche à comprendre et à accepter ce qu’il y a de réel en ma personne
et en celle de l’autre, plus il se produit de changements ».
Cette considération explicite le
lien logique, orchestral, qui gerbe en faisceau les faits et les
inductions recueillis au cours de trente ans de thérapie et d’un
demisiècle d’expérimentation et de recherche sur les relations
humaines : Rogers tente, comme nous le verrons ultérieurement, de lui
donner des formulations objectives sous forme d’hypothèses brutes ou de
loi générale. Néanmoins, il reconnaît l’aspect paradoxal de cette
considération : constater des délimitations et des différences entre soi
et autrui n’aurait pas pour conséquence de les fixer, mais au contraire
de permettre leur dépassement selon des résonances, des spires ouvertes
et croissantes. Alors que dénier et tenter de les transgresser les
bloquerait, selon des cercles vicieux où se dépenserait inutilement en
fantasmes et résistances infantilisantes l’énergie disponible pour la
transformation de soimême. Sa position revient à la pensée dynamique de
Dewey : « Nous sommes libres non du fait de ce que nous sommes
statiquement, mais dans la mesure où nous devenons différents de ce que
nous avons été ».
La liberté de devenir conduit à
vérifier que la délimitation évolutive de soi, c’estàdire l’accentuation
d’une subjectivité, est libératrice pour autrui : elle permet à un
interlocuteur de s’engager dans la voie de sa subjectivité propre, de
trouver sa note propre, et de conforter, par contrecoup, notre propre
subjectivité en train de se découvrir. On peut exprimer d’une autre
façon cette « évidence rogérienne » : elle impliquerait que
l’acceptation ou plutôt la constatation (de soi ou d’autrui) peut être
une variable croissante, soutenant une évolution de développement
positif.
On pourrait encore formuler cette
position en la forme pratique : si je puis me fier à moimême tel que je
suis et me fier à autrui tel qu’il est, avec ce que nous ressentons et
avec nos butées ou nos contradictions ou nos dissonances momentanées, en
accompagnant l’autre là où il se place, en constatant comment il se
considère et me considère dans l’instant, et si ma présence est
suffisamment intense et toutefois sans exercer de poussée sur lui pour
qu’il bouge de son lieu ou de sa direction (ni sur moimême pour me
forcer à bouger), loin de nous fixer, j’aurai accru nos possibilités
réciproques d’évoluer de concert au moindre coût selon nos orientations
positives propres.
Toutes ces conditions (ces « si »)
pourraient paraître illusoires : à force de subjectivité et d’instantanéisme.
Elles sont cependant susceptibles d’être réalisées par la vertu de l’expérience
propre : en ce que celleci est autant objective que subjective.
L’expérienceguide
Car cette position de « constatationévolution »
peut se référer à la mesure intérieure, obtenue grâce au vécu réel et
intégral de l’individu. « Je peux faire confiance à mon expérience »,
déclare Rogers.
Cette conviction ne se limite pas aux relations humaines : elle englobe
toute activité et elle s’établit, au fur et à mesure de la vie et de la
carrière de Rogers, dans une logique imperturbable.
Dans la face positive de cette
logique, Rogers note : « Chaque fois que j’ai fait confiance à un
sentiment interne et non intellectuel, j’ai découvert la sagesse de mon
action ».
C’est que cette confiance accordée en profondeur à ce que ressent et
pressent naturellement dans le moment un individu se relie à une
conception intense de l’expérience. Celleci n’est pas isolement ou
conduite d’abstraction pure ; au contraire, elle est explicitation des
connexions réelles, c’estàdire démarche, approche et acte volontaire
(orchestral) de transaction entre un individu et son environnement : en
quelque façon de « métacognition », selon un terme récent.
Sous le terme d’expérience (et même
d’experiencing) Rogers se réfère plus ou moins directement à la
pensée de John Dewey. Celuici a fondé sa philosophie, son « naturalisme
humaniste », sur l’expérience vécue en tant que recherche,
investigation existentielle (inquiry), c’estàdire en tant que
« transformation contrôlée ou dirigée d’une situation indéterminée en
une situation qui est si déterminée en ses distinctions et relations
constitutives qu’elle convertit les éléments de la situation originelle
en un tout unifié ».
L’expérience est ainsi génératrice
d’ordre (et Rogers peut subjectivement assurer : « J’ai du plaisir à
discerner un ordre dans mon expérience »). Car elle est
existentiellement la création d’« unités qualitatives », successives,
qui s’engendrent en créant des conséquences, de nouvelles relations, sur
lesquelles sera derechef recherchée une « mise en continuité », et cette
démarche s’effectue comme « l’équilibre en déséquilibre mouvant des
choses » (the moving unbalanced balance of things).
Dans cette progression oscillante,
« le sens de l’expérience comme premier plan (de la nature) est que le
premier plan est ainsi fait qu’il contient un matériel qui, lorsqu’on le
traite opérationnellement, fournit les indices qui nous conduisent droit
à l’arrièreplan ».
La vie est poussée par « l’expérience » dans un mouvement thématique
essentiel et constitutif. Ce qui revient pour Rogers à poser que « la
vie, dans ce qu’elle a de meilleur, est un processus d’écoulement, de
changement, où rien n’est fixe »,
mais ou des opérations positives sont possibles. Il n’y a donc pas
d’expérience en soi, mais une multiplicité continue d’expériences qui
font apparaître momentanément « des premiers plans et des arrièreplans,
des ici et des là, des centres et des perspectives, des foyers et des
marges ».
En fait, l’harmonisation, la réintégration fonctionnelle dans une
« continuité » des rapports entre un individu et son environnement avec
tous ses plans, sont au cœur des fonctions d’un organisme. On peut
penser aux conceptions « infinitésimales » de Leibniz.
L’unité de l’être humain provient
de l’intégration de l’organisme dans son environnement et « le moi perd
son intégrité intérieure quand il perd son intégration avec le milieu
dans lequel il vit ». Assurant que « la logique est naturaliste » (p. 81
de sa monumentale Logique), Dewey pose le postulat de la
continuité des activités et des formes, inférieures ou supérieures,
en excluant toute réduction des unes aux autres.
L’expérience est par conséquent une
recherche vécue des unifications qualitatives ressenties entre tous les
éléments de l’organisme et tous les éléments de l’environnement
(lesquels sont exclusivement les parts actuelles du monde naturel qui
entrent « directement ou indirectement dans les fonctions vitales »
par rapport à l’individu). L’organisation agie, comme mode fondamental
de l’expérience, est si présente à la philosophie de Dewey, hostile aux
dualismes, qu’il observe : « L’intégration est plus fondamentale que ne
l’est la distinction désignée par l’interaction de l’organisme et de
l’environnement. Cette dernière indique la désintégration partielle
d’une intégration antérieure, mais si dynamique qu’elle tend (aussi
longtemps que la vie continue) vers la réintégration ».
Et l’intégration, ce « sentiment
interne » dont parle Rogers, n’est pas le produit de l’intellect, mais
le fruit organique du besoin et du désir humains au centre de la
« matrice biologique » où naît incessamment la « logique » (ou la
musique). Car, ainsi que l’écrit Dewey en 1938 (moment décisif pour la
pensée de Rogers) « le désir, l’intérêt, accomplit ce que dans la
théorie traditionnelle on attribuait à un pur intellect inventé pour les
besoins de la cause. Des désirs de plus en plus vastes et des habitudes
de plus en plus variées et souples produisent des enchaînements de
pensée de plus en plus élaborées, et en fin de compte les harmonies, les
cohérences et les structures compréhensives des systèmes logiques ».
On conçoit que Rogers se soit
toujours senti à son aise, et encouragé, dans sa propre pratique, par le
contact de la pensée de Dewey. S’il observe comme une « caractéristique
de la manière dont une personne mûre apprécie son expérience personnelle,
[…] le haut degré de différenciation de cette expérience, ou comme on
dit en sémantique générale, le fait que cette expérience est considérée
en extension »,
c’est qu’il ressent l’importance de la finesse qualitative, de la
subtilité dans le vécu et le parcours « différentiel » de l’expérience.
Pour lui, comme pour Dewey, l’intégration, la continuité agie, se vit
dans la conscience subjective, laquelle coïncide avec la « totalité des
différences qualitatives immédiates actualisées ».
Et l’intégration s’effectue dans toute expérience, notamment, de façon
particulièrement visible dans l’art : « Dans l’art, comme expérience,
l’actualité et la possibilité ou l’idéalité, le nouveau et l’ancien, le
matériel objectif et la réponse personnelle, l’individuel et
l’universel, la surface et la profondeur, le sens et la signification
sont intégrés dans une expérience ».
Il ne saurait donc y avoir refus de
l’imagination, mais intégration dans la subjectivité, par l’expérience,
d’un imaginaire créateur, dépouillé des projections fantasmatiques.
Expérience et autorité
La logique de Rogers a une
contrepartie fermement négative : « Une expérience faite par autrui ne
saurait me servir de guide. Les jugements des autres, bien que j’aie le
devoir de les écouter et d’en tenir compte pour ce qu’ils sont, ne
pourraient jamais me servir de guides. C’est là une leçon que j’ai eu du
mal à apprendre ».
Critiques, préventions ou éloges
simultanés ont amené Rogers à admettre, malgré des hésitations et
peutêtre des remords, sa distance visàvis d’influences. Mais il est allé
plus loin, par rapport aux systèmes et aux connaissances, retrouvant la
proposition essentielle de Descartes sur la « table rase » et le recours
à « l’évidence ». « A mes yeux, l’expérience est l’autorité suprême… Ni
la Bible, ni les prophètes — ni Freud, ni la recherche — ni les
révélations émanant de Dieu ou des hommes — ne sauraient prendre le pas
sur mon expérience directe et personnelle ».
Cette position n’est pas aisée à tenir si on se souvient du climat
dogmatique qui entoure aussi bien la psychologie expérimentale que la
médecine et la psychanalyse. Et on ne peut manquer de faire le
rapprochement avec la règle iii
de Descartes : « Sur les objets proposés à notre étude, il faut
chercher, non ce que d’autres ont pensé ou ce que nousmêmes nous
conjecturons, mais ce dont nous pouvons avoir l’intuition claire et
évidente ou ce que nous pouvons déduire avec certitude. Car ce n’est
pas autrement que la science s’acquiert ».
Chacun doit construire sa « partition ».
C’est une position d’objectivité en
même temps qu’une position d’indépendance subjective ; et ces positions
sont établies sur le consentement à la mouvance renouvelée de
l’expérience. Quand Rogers affirme, fasciné par le devenir, qu’« il ne
peut y avoir pour moi aucun système clos de croyances et de principes
immuables »,
il retrouve dans un même combat la démarche délibérée (et politiquement
engagée sur une signification foncière de la démocratie) de Dewey :
« L’expérience… est la libre interaction des êtres humains individuels
avec les conditions environnantes et en particulier les environnements
humains, qui développe et satisfait le besoin et le désir en augmentant
la connaissance des choses comme elles sont. La connaissance des choses
comme elles sont est la seule base solide pour communiquer et partager ;
toute autre communication signifie sujétion de quelques personnes à
l’opinion personnelle d’autres personnes. Le besoin et le désir — dont
sont issues l’intention et la direction de l’énergie — dépassent ce qui
existe, et par suite la connaissance et la science. Ils ouvrent
continuellement la voie vers le futur inexploré et inaccompli ».
Qu’on ne fasse cependant pas
erreur. Ni Dewey, ni Rogers ne tombent dans un extrémisme anarchique. La
« libre interaction », le « désir », la dissolution des dogmatismes et
des rigidités, qui sont incluses dans leurs suites de positions, ne
signifient nullement une absolutisation de l’expérience individuelle, de
la tonalité individuelle, en tant qu’individuelle. Rogers met en alerte
sur ce point : « Ce n’est pas parce qu’elle est infaillible que mon
expérience fait autorité. Elle est la base de toute autorité parce
qu’elle peut toujours être vérifiée par des moyens primaires. C’est
pourquoi ses fréquentes erreurs — sa faillibilité — peuvent toujours
être corrigées ».
Expérience et objectivité
L’expérience est proposée dans sa
faillibilité, dans ses dissonances, selon une suite d’approximations et
de « résolutions » opérationnelles, dans ses rapports à soi et à autrui.
Elle est établie sur des tâtonnements, propres à réduire les écarts.
C’est une conception cybernétique de « conduite à vue » ou à l’oreille
et non « au juger » (en projet rigide) : elle est fondée sur la
recherche des significations secondaires qui dérivent des constatations,
des intégrations primaires. La masse même des événements observés, la
nature de la situation d’expérience, les erreurs également, déterminent
l’individu à organiser sa relation, sa transaction méthodique à l’environnement.
Car il paraît à Rogers « inévitable de rechercher une signification, un
ordre et une légitimité dans toute accumulation d’expériences ».
L’homme, organisme vivant, ne peut établir de connaissances
qu’organisées. Et il est bien mu par un « appétit de structure », comme
l’observe Eric Berne
par un besoin musical. Mais Descartes avait déjà prévenu, avec le
langage de son temps : « La méthode est nécessaire pour la recherche de
la vérité » (règle iv).
En ce point, Rogers explicite une
option visàvis de l’objectivité, visàvis de la prise de son activité sur
l’environnement : « Les faits sont des amis ».
Loin de considérer les éléments humains ou matériels auxquels il se
heurte (et qui émergent donc en événements ou faits) comme des ennemis
potentiels ou des obstacles (ainsi que cela se présente communément à
l’idée des individus, même chercheurs scientifiques), Rogers fait état
d’une conversion essentielle (aussi simple que subtile) : « J’ai sans
doute mis longtemps à comprendre que les faits sont toujours des amis.
Le moindre éclaircissement qu’on puisse acquérir dans n’importe quel
domaine nous conduit toujours plus près de la vérité. Or, s’approcher de
la vérité n’est jamais nuisible, ni dangereux, ni inconfortable ».
Cette position d’accueil
méthodologique, d’hospitalité, rejoint celle du géologue Pierre Termier
qui s’était donné comme règle : « Prendre pour objet premier de ma
réflexion toute objection qui m’est présentée ». Elle rappelle aussi le
précepte que Paul Claudel aimait à répéter : « Ne impedias musicam »,
« N’empêche pas la musique ». L’amitié reconnue dans les faits, et les
objections prises au sérieux dans les conflits, sont une précaution
contre les peurs et les angoisses qui éloignent de la vie, qui font
dévier de la présenciation à soi et au monde ; elles sont une règle
chaleureuse pour traiter les réactions superficielles qui nous
traversent et pour dominer les dépits de nos échecs. Il ne s’agit pas
d’une facilité, d’une rodomontade de commande ni d’un expédient. Audelà
des vexations, des rigidités défensives ou des chocs, Rogers a senti
l’utilité, la fécondité, de revenir laborieusement sur ses propres idées
et de les restructurer pour mieux s’accomplir… « J’ai fini par
reconnaître, dans une grande mesure et à un niveau plus profond, que
cette pénible réorganisation, est ce qui s’appelle apprendre et que,
aussi désagréable qu’elle soit, elle mène toujours vers une perception
beaucoup plus satisfaisante, parce que plus exacte, de la vie ».
Toute difficulté, tout désagrément
sont bienvenus (ou devraient l’être) : ils sont moins sauvages qu’on ne
l’imagine et peuvent être facilement apprivoisés, appropriés. Toute
négativité apparue au premier plan germe en positivité à l’arrièreplan.
Dewey avait déjà exprimé en termes d’éducation : « Pour que l’enfant se
rende compte qu’il a affaire à un problème réel, il faut qu’une
difficulté lui apparaisse comme sa difficulté à lui, comme un obstacle
né dans et au cours de son expérience propre, et qu’il s’agit de
surmonter s’il veut atteindre sa fin personnelle, l’intégrité et la
plénitude de son expérience propre ».
Le plus personnel et le plus général
C’est donc une expérience
courageuse, combative, de la subjectivité, de la personnalité tendue
vers la présence et l’objectivité, que Rogers place dans son activité
concrète. Et la tension subjectivitéobjectivité qu’il institue est
soutenue, entrecroisée, par une constatation décisive : « Ce qui est le
plus personnel est aussi ce qu’il y a de plus général ».
Dans ses relations, directes ou non, orales ou écrites, avec des
collègues ou des étudiants, avec des étrangers, Rogers constate : « J’ai
presque toujours découvert que le sentiment qui me paraissait le plus
intime, le plus personnel et par conséquent le plus incompréhensible
pour autrui, s’avérait être une expression qui évoquait une résonance
chez beaucoup d’autres personnes ».
Entre les individus, comme au cœur
d’une personnalité, il n’y a donc pas d’incommunicabilité, de béance
absolue. Les solitudes subjectives ne sont pas des insularités, des
isolements irrémédiables. Au contraire, comme dans la perspective
dialectique de Hegel, la singularité vécue permet de dissoudre ce
qu’avaient de cloisonnant les particularités (de rôle, de masque, de
strate, de classe ou de théorie) qui ont pourtant ellesmêmes le mérite,
à temps donné, de défaire les fausses façades, les conformismes
structurants qui emprisonnent l’universalité. Car celleci, établie dans
sa mouvance même en thèse positive de généralité est menacée par
l’inertie, la pesanteur des échanges (d’énergie) qui tendent à bloquer
les évolutions par des réactions de conformité (tous les citoyens sont
réputés égaux) ; les particularités apparaissent en négation
suffisamment grossie de cette thèse, en antithèse, pour désagréger les
fauxsemblants, les durcissements qui empâtent, alourdissent et figent
les processus d’intégration à l’unité (telle catégorie ou classe
sociale, dominée par exemple, n’est pas identifiable à tous les
citoyens, et sa différence de situation ne peut être cachée ni
réduite) ; mais les particularités à leur tour doivent être niées et les
singularités individuelles font éclater ce qu’elles auraient de
réducteur par rapport aux différences réelles (et subjectives) des
individus (moi, ouvrier ou patron, peu importe, je décide de courir les
risques de participer à la Résistance contre l’occupant) ; les personnes
sont autres que des rôles ou des appartenances et leurs choix propres
leur permettent de se retrouver dans une solitude, générale, mais où les
frontières (et les racismes) sont combattues et où le mouvement
incessant et menacé vers la synthèse (c’estàdire vers l’universalité)
est possible.
La singularité tonique assumée par
une personne résonne bien dans la singularité des autres et fait
retrouver les chances d’une intelligibilité universelle vraie. En ce
point, Rogers, qui cite parfois Einstein, aimerait que soit rappelé l’un
des propos de celuici : « Ce qu’il y a de plus incompréhensible, c’est
que le monde soit compréhensible ».
Il n’y a rien là de contradictoire.
L’intelligence, la compréhension supposent en effet non le pressage
impatient de systèmes tout faits sur une réalité qui serait forcée dans
des moules de saisie statistique, mais l’intégration de tous les
éléments qualitativement différents. C’est la perspective de Dewey et
celle que définit également Lewin en constatant que la psychologie
moderne doit s’éloigner des modes de penser « aristotéliciens »
(cloisonnant les objets selon des particularités rigides et abstraites)
et adopter des modes de penser « galiléens » : selon ceuxci, « il
importe de garder présent à l’esprit que la validité de la loi et le cas
concret de caractère individuel ne sont pas contradictoires et que la
référence à l’intégralité de la situation totale concrète doit se
substituer à la référence de la collection la plus étendue possible de
cas historiques de caractère fréquent ».
L’orientation positive
L’assertion d’une communication
d’intelligibilité universelle et progressive, dialectique, entre les
individus profondément singuliers et les faits euxmêmes amicaux et
singuliers ou généraux se conjugue, pour Rogers, à une autre assertion :
« Mon expérience m’a montré que, fondamentalement tous les hommes ont
une orientation positive ».
Sa référence à la subjectivité, au
plus personnel en chacun, n’est pas une prise de position en faveur de
la destructuration sociale, de l’anomie. La liberté offerte aux
individus ne connote pas pour lui la dérive vers une licence sans
limite, vers une irresponsabilité démonique. Au contraire : « J’ai été
frappé dans mon expérience de thérapeute, notetil, de constater que,
lorsque les personnes sont valorisées et qu’on leur donne la liberté de
sentir et d’être, certaines orientations apparaissent dans le choix des
valeurs. Ces orientations n’ont rien de chaotique, mais au contraire
surprennent par leur caractère convergent ».
Cette convergence explicite la rencontre du singulier et de l’universel.
Mais seraitelle produite par les précautions, par le projet
méthodologique même de Rogers ? Sa praxis n’entraînetelle pas chez ses
partenaires ou chez ses « clients », l’émergence attendue des directives
positives, encourageant progressivement la personne vers la maturité et
la socialisation ? Y auraitil tautologie ?
Rogers se pose la question sur le
caractère convergent des orientations qui apparaissent en thérapie et il
précise : « Celuici ne dépend pas de la personnalité du thérapeute :
j’ai en effet vu apparaître les mêmes orientations chez des clients
traités par des thérapeutes qui avaient des personnalités profondément
différentes. Ce caractère commun ne semble pas non plus dépendre de
l’influence d’une culture donnée, car j’ai retrouvé ces mêmes
orientations dans des cultures aussi différentes que celles des
EtatsUnis, des PaysBas, de la France et du Japon ».
Les individus, s’ils développent
leur singularité, ne font donc pas exploser la solidarité sociale, aux
yeux de Rogers. Loin de là. Mais cette considération optimiste estelle
le fruit d’une naïveté, d’une manie yankee ? Rogers ne s’abusetil pas ?
N’oublietil pas le tragique des oppressions sociales et des désordres
individuels ?
Rogers sait qu’il doit se défendre
contre les critiques d’angélisme ou de « vue naïvement optimiste sur la
nature humaine » (et qui pourrait n’être qu’une projection de son désir
propre). Inlassablement il a affronté les objections, les critiques, ou
les railleries, les doutes ou les incrédulités. S’abuseraitil ?
A ceux qui critiquent le large
accueil fait par lui aux sentiments positifs (et en conséquence à
« l’orientation positive » qui paraît être leur voie) parce que ces
sentiments seraient superficiels ou trompeurs, Rogers rétorque qu’il n’y
a pas que les impulsions « mauvaises », « socialement défendues », qui
soient profondes et qui seraient par suite objets de refoulement.
« D’après nos observations, cette conception du refoulement est
inadéquate. En effet, l’expérience clinique montre que, bien souvent,
les sentiments les plus profondément refoulés sont nos sentiments
positifs, d’amour, de bonté, de confiance ».
Et il fait remarquer que lesdits sentiments sont en fait redoutés parce
que leur expression ou leur réception met en position vulnérable et en
risque de dépendance. « Si je dis à quelqu’un : “Je vous aime”, je suis
vulnérable et je m’expose à être rejeté d’une façon effroyable. Si je
dis : “Je vous hais”, je m’expose tout au plus à être attaqué et là je
puis me défendre ».
A ceux qui le taxent de légèreté et
d’oubli des réalités criminelles ou morbides, Rogers réplique : « Je
suis tout à fait conscient du fait que, par besoin de se défendre contre
des peurs internes, l’individu peut en arriver à se comporter de façon
incroyablement cruelle, horriblement destructive, immature, régressive,
antisociale et nuisible. Il n’en reste pas moins que le travail que je
fais avec de tels individus, la recherche et la découverte des tendances
très positivement orientées qui existent chez eux comme chez nous tous,
au niveau le plus profond, constituent un des aspects les plus
réconfortants et les plus vivifiants de mon expérience ».
Mais sa parade essentielle tient,
avant même ses essais de validation expérimentale, dans sa problématique
objective. Il ne peut laisser sans structure de rationalité scientifique
ses intuitions, ses observations, ses constatations. Et il recourt à des
conceptions naturalistes, pour l’établissement d’une logique d’analyse.
Le caractère d’orientation positive qu’il évoque chez les individus,
« il aime à penser », il fait l’hypothèse qu’il « est dû au fait que
nous appartenons tous à une même espèce »
et dont les individus ont besoin de relations chaleureuses
pour vivre et survivre. Et il s’étonne des vues radicales telles que
celles de Karl Menninger, freudien avéré, considérant l’être humain
comme « mauvais de manière innée ». Et il s’était demandé alors si ces
vues négatives n’avaient pas quelque lien avec l’idée que « Freud, par
le fait qu’il s’était appuyé sur une autoanalyse, s’était privé de la
relation chaleureuse et acceptante nécessaire pour que les aspects
apparemment négatifs et destructeurs du moi, puissent être complètement
acceptés, comme ayant un sens et comme pouvant jouer un rôle
constructif ».
Chapitre XII
Propositions et hypothèses théoriques
L’une des analyses où Rogers expose
ses propositions théoriques et sa problématique de la façon la plus
ramassée a été publiée en 1965 dans un ouvrage collectif La science
et les « affaires humaines ». Il lui a donné pour titre « Une
conception humaniste de l’individu » (A humanistic Conception of Man).
Observant que chaque individu a quelque idée de ce qui est fondamental
dans la nature humaine, il essaya, au cours d’un voyage en mer, quand il
se rendait au Japon, de « griffonner quelque chose de ses vues »
sur cette « nature ». Il souhaitait exprimer une vue très large sur
l’homme, de contexture suffisamment générale pour embrasser ce qui
apparaît vrai en chaque homme : « Tâche formidable », si l’on n’exclut
ni les psychotiques, ni les pervers, ni les coolies, ni les génies comme
Einstein et les hommes de culture raffinée, ni les enfants débiles, ni
les primitifs d’Australie, et pas plus Gandhi qu’Hitler ou que le maître
japonais de la cérémonie du thé.
Une espèce sociale
La première observation que
présente Rogers est apparemment simple, voire simpliste, comme il en
convient, tout en considérant qu’elle est trop habituellement
sousestimée. « L’homme est une espèce », « l’homme est une des
nombreuses espèces d’organismes et comme tel a des caractéristiques qui
lui sont inhérentes et qui le mettent à part des autres espèces ».
Par cette considération, Rogers se
remet dans la continuité de Darwin, et de sa révélation scientifique sur
l’origine des espèces telle qu’elle lui avait été communiquée par
Kilpatrick. Et il pose une « nature » de l’homme, avec ses propriétés,
ses tendances, ses convergences et ses limites constatées
phénoménologiquement. Ce faisant, il prend par conséquent ses distances
visàvis d’un existentialisme à la Sartre, qui rejette toute essence et
toute limitation comme il l’assure dans le dialogue de la même époque
(mars 1965) avec Paul Tillich. Celuici relève d’ailleurs la
contradiction qu’il y aurait à nier que l’homme ait une nature en vue de
ne placer aucune limite à sa liberté : car ce serait dire qu’il a « la
nature de la liberté, que les autres espèces n’ont aucunement ».
Et Tillich propose d’opposer une nature « essentielle » (sa vraie nature
qui est « bonne »), et une nature « existentielle » temporelle,
« historique », en distorsion avec la première en raison de « la
caractéristique qu’a l’homme de devenir étranger à sa vraie nature ».
Par cette distinction, établissant un lieu du conflit existentiel,
Tillich souhaitait éviter des confusions, auxquelles n’auraient pas
échappé, à ses yeux, Freud ainsi que beaucoup de freudiens et de
thérapeutes.
Sa réflexion rejoint directement la
conviction de Rogers, approfondie au cours de sa carrière de thérapeute.
S’agissant de définir les caractéristiques de l’espèce humaine,
nommément visée, en naturaliste, Rogers prend d’emblée position, en se
plaçant non seulement loin de Sartre, mais selon lui au « pôle opposé de
Freud » par exemple, dont les vues semblent bien résumées dans
Malaise dans la civilisation, où il est parlé de « l’hostilité
primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres ».
Rogers cite, à la suite, le passage où Freud assure que « la
civilisation (la “culture”) doit tout mettre en œuvre pour limiter (par
des barrières) l’agressivité humaine. De là aussi cet idéal qui impose
d’aimer son prochain comme soimême, idéal dont la justification
véritable est précisément que rien n’est davantage contraire à la nature
humaine primitive ».
A l’opposé, Rogers pose, comme
résultat de ses observations, que l’homme est, d’abord, par nature en
tant qu’appartenant à une espèce particulière, « incurablement social ».
Aussi, nous n’avons pas à avoir peur d’être « seulement homo sapiens ».
Et Rogers fait au passage l’hypothèse que si l’évolution sur la terre
avait été dominée par le développement de la famille des chats ou des
félins, il en eût résulté des modes d’êtres moins sociaux que ceux qui
résultent du développement humain. Il allègue son expérience pour
constater que « l’homme a fondamentalement un désir violent (a
fundamental craving) de relations sûres, intimes, communicantes,
avec les autres, et qu’il se sent coupé, solitaire et incomplet quand de
telles relations n’existent pas. Cette tendance, comme d’autres, peut
être bloquée ou déviée, et il s’ensuit que beaucoup d’individus
s’isolent, et que beaucoup vivent avec les autres dans des relations
hostiles, distantes et incommunicantes. Cependant, la tendance la plus
profonde, la caractéristique la plus fondamentale, semble être la
tendance sociale : ainsi que l’indique le fait que, si une relation non
menaçante est offerte, comme en thérapie, et peut être perçue comme
sûre, les individus tendent invariablement à entrer en elle ».
La liberté existentielle de l’homme
est donc d’être davantage dans sa nature sociale essentielle et non pas
en dehors ou contre. Cette prise de position est radicale,
« révolutionnaire », compte tenu des attitudes souvent pessimistes ou
péjoratives sur lesquelles la plupart des épigones de Freud
s’établissent : pour ne pas se sentir dépassés par aucune surenchère de
lucidité sur la misère de l’homme ; et pour rivaliser de « soupçon » et
de virtuosité réductrice face aux tendances idéalisantes,
« angéliques », anthropocentriques. La sublimation est considérée avec
ambivalence, on en loue la démarche mais on démonétise facilement son
processus. Il n’y aurait pas de « cadeau », de gratification, à faire à
l’homme, espèce ou individu.
Rogers essaie d’expliquer la vogue
des conceptions pessimistes dont il indique qu’il a luimême mis très
longtemps à reconnaître la fausseté : « La raison, je crois, est qu’en
thérapie on dévoile continuellement des sentiments hostiles et
antisociaux, si bien qu’il est facile de supposer que ceuxci indiquent
la nature profonde et par conséquent la nature fondamentale de l’homme.
C’est seulement peu à peu qu’il est devenu évident que ces sentiments
sauvages et asociaux ne sont ni les plus profonds ni les plus forts, et
que le noyau de la personnalité est l’organisme luimême, dont
l’essence est de se conserver et d’avoir une vie sociale ».
Et il précise encore : « Sous la couche de comportement superficiel
contrôlé, sous l’amertume, sous la blessure, il y a un moi qui est
positif, et qui est sans haine. Telle est, je crois, la leçon que nos
clients nous enseignent depuis longtemps, et que nous, nous avons mis
longtemps à apprendre ».
Il est piquant de constater que
Rogers, homme solitaire, personnalité controversée, soucieux de
préserver la subjectivité, puisse estimer que l’homme soit
« incurablement social » et que cet Américain retrouve Aristote, et
quelques autres à cet égard, connaissant l’homme comme indissolublement
animal et social, viscéral et conscient.
Indépendance et directionalité
Cependant, si au versant social,
l’homme a un besoin dominant d’une sécurité, obtenue grâce à des
relations étroites, communicatives, avec les autres, au versant animal,
il manifeste des tendances naturelles à un développement, à une
différenciation, à une maturation aussi bien physiologiques que
psychologiques. Ces tendances, chez l’homme, sont beaucoup plus lentes à
apparaître que chez les autres espèces animales. On a souvent remarqué
combien le jeune être humain était beaucoup plus arriéré, plus impotent
ou impuissant qu’un jeune animal du même âge, quadrupède ou singe.
Mais la lenteur, la progressivité
d’émergence des tendances à la différenciation psychophysiologique et à
la distanciation sociale, ne doivent pas incliner l’environnement humain
à contrarier ou refuser stupidement la suite des prises décisives
d’autonomie. Car l’individu tend à passer lentement mais obstinément
d’une dépendance nécessaire à la fois dans les domaines physique et
psychologique au cours de son enfance étendue, à une indépendance dans
ces deux domaines, marquée (et bien audelà du niveau atteint dans les
autres espèces) de plus en plus fortement.
Il tend, dit Rogers, à développer
et différencier un système élaboré de renseignement (feedback)sensoriel
qui le rend capable de fonctionner d’une façon harmonieusement
autorégulante (selfregulating) à la rencontre immédiate (meeting)
de ses besoins ».
La généralité de l’espèce,
orientée à une « convivialité » étroite (pour reprendre le mot d’Illitch),
est donc liée de façon antagoniste à la singularité
psychophysiologique radicale de l’individu, en sorte que les
particularités sociales seraient mises en question si telles tendent
à réduire l’autonomie (au lieu de l’étayer) et à maintenir une
dépendance. En celleci, il faut entendre une « protection prolongée » :
le besoin de se référer à une autre personne, de se reposer sur elle en
se reniant soimême en sorte que persiste un « sentiment d’incapacité
pour affronter les épreuves de la vie ».
Pour Rogers, être capable est conséquent à la vie de la personne dans l’espèce.
L’individu ne s’y perd pas dans une imitation ou contreimitation
passives, mais s’y retrouve par son originalité, native et active.
Dans sa mise au point de 1965,
Rogers établit ses idées sur une proposition encore plus radicale et
plus opératoire : « L’homme est directionnel » ce que je traduirai par :
l’homme est par nature, autodirectionnel et non « réactionnel ». Il a,
en luimême, de quoi s’orienter de façon créatrice pour luimême,
indépendamment des poussées et guidages d’autrui ; il n’est pas un
« organisme vide »,
qui réagirait sur des réponses automatiques et des excitations purement
externes ; il pèse sur l’environnement selon une direction qui lui est
propre. Et cette direction d’accomplissement ne provient pas d’une
évaluation intellectuelle, toujours incertaine et sujette à erreur, mais
d’une impulsion profonde, explicite quand l’individu fonctionne
pleinement, de façon autonome et directe. « L’homme est plus sage que
son intellect »,
constate Rogers ; et il cite Einstein évoquant sa démarche vers la
formulation de la relativité : « Durant ces années il y avait un
sentiment de la direction, d’une marche directe vers quelque chose de
concret. Il est, bien sûr, très dur d’exprimer ce sentiment par des
mots ».
Au cours de son séjour à Paris, en
1966, Rogers évoqua en public la culture des pommes de terre. Même dans
une cave privée de lumière, cellesci ont tendance à germer et à
s’orienter. Pourquoi, disaitil, chaque homme ne disposeraitil pas, en
luimême, de possibilités de germination et d’adaptation ? Pourquoi
seraitil incapable de faire de luimême ce que réalisent des pommes de
terre, des potatoes ? « Des patates et des hommes » soustitrait à
ce propos, dans un article, René Lourau.
Rogers conçoit, par suite, que si
chaque individu a foncièrement les capacités pour trouver des solutions
à ses problèmes, il est prudent de ne pas infléchir mécaniquement, ou
réactionnellement, ce que cet individu ressent et élabore originalement
à l’intérieur de luimême. Plus on sait l’être humain fragile et
requérant de soin, ayant besoin de beaucoup de chaleur, plus il est
prudent de ne pas interférer par une directivité maladroite, excessive,
imprudente, sur cet aspect autodirectionnel, sur cette possibilité de
réalisation et d’organisation de soi. Il faut pourtant favoriser, par la
texture sociale, cette potentialité de croissance comme pour un arbre :
celuici dispose de directionalité car si on lui coupe une branche, il en
repoussera une autre si besoin est. Mais il a également besoin néanmoins
d’un certain humus.
De même, Rogers emploie d’autres
références empruntées à la vie biologique : les germes vivants se
développent incoerciblement de l’intérieur si on assure les
conditions de leur croissance autodirectionnelle. Il propose donc,
comme la meilleure analogie pour exprimer la psychothérapie (et plus
généralement les relations humaines) l’apport d’un « liquide amniotique
psychologique ».
Rank, pour sa part, avait discerné, dans la situation thérapeutique, la
reproduction de la vie intrautérine et « de la naissance presque dans
tous ses détails ».
Et Paul Claudel avait connoté le développement de l’intelligence et de
la destinée humaine, avec la « conaissance au monde et à soimême ».
Ces vues maïeutiques impliquent que
l’indépendance de l’organisme humain se défasse d’attachement altérant
ou de barrières extérieures (cordon ombilical sinon utérus matériels ou
culturels) ; et qu’elle se construise par une intégration harmonieuse
des besoins avec la réponse animale et chaude des sensations. Car
l’homme comme tous les organismes, tend à l’autoconservation et à
l’autovalorisation (self enhancing, autorehaussement),
même si ses conduites, sous des conditions particulières, tendent
corrélativement à préserver et à mettre en valeur son espèce, et à
assurer le « développement évolutionnaire » de celleci.
L’homme est organisme
La propension à la nondépendance et
à la « directionalité » de l’individu peut être précisée, aux yeux de
Rogers, par les caractéristiques des organismes. Cette notion
d’organisme, qu’il associe positivement à celle d’espèce, est devenue
pour lui analysable en termes de structure dynamique et de champ de
potentiel.
Rogers, en effet, se souvient
d’avoir bénéficié de l’impact que lui ont causé les observations de Kurt
Goldstein, dont le livre La structure de l’organisme (The
Organism) parut à New York en 1939. S’appuyant sur des travaux
réalisés au profit d’anciens combattants de la guerre au cerveau
dérangé, Goldstein notait : « La conduite normale correspond à un
changement continuel de la tension de telle sorte que soit à chaque
instant atteint l’état de tension qui rend capable et pousse l’organisme
à s’actualiser dans des activités ultérieures, suivant sa nature ».
Il a été impressionné, d’autre
part, par la déclaration d’Angyal, dans son livre Fondements pour une
science de la personnalité (Foundations for a Science of Personnality),
paru en 1941 : « La vie est un événement dynamique autonome qui prend
place entre l’organisme et l’environnement. Le processus de la vie ne
tend pas simplement à préserver la vie mais à transcender le statu quo
momentané de l’organisme, en se dépensant continuellement et en imposant
sa détermination autonome sur un domaine toujours plus étendu
d’événements ».
Rogers se souvient également de
l’insistance de Mowrer et Kluckhohn, en 1944, à noter « la basique
propension des choses vivantes à fonctionner en sorte de préserver et
d’accroître leur intégration ».
Et il rappelle que Sullivan, en 1945, soulignait que la « direction
basique de l’organisme est en avant (forward) ».
Assuré de l’accueil fait à ses
idées, par la publication de Counseling and Psychotherapy, Rogers
explicite luimême, dès 1946, en confirmation de ces points de vue par
son expérience clinique : « Chez la plupart, sinon chez tous les
individus, il existe des forces de croissance (growth forces),
des tendances à l’autoactualisation, qui peuvent agir comme une
motivation unique à la thérapie ».
La conception qu’il se fait dès lors de l’organisme humain est (dans la
même ligne que celle de Dewey) : non pas une structure rigide
subsistante en forme fermée, mais bien une organisation dynamique,
fluide, une forme (ou Gestalt) établie essentiellement sur une
tendance vers le devenir, sur un élan d’accomplissement de ses
virtualités latentes par des relations à un environnement de plus en
plus étendu.
Il exprime, en 1959, cet élan par
l’expression d’un « postulat fondamental » : « Tout organisme est animé
d’une tendance inhérente à développer toutes ses potentialités et à les
développer de manière à favoriser sa conservation et son enrichissement ».
L’organisme est, en quelque sorte,
un nœud structuré (un nexus) d’énergies, de potentialités, en
train de se développer, de se déployer, entrant en tension d’échanges,
d’interaction, avec de multiples éléments de l’environnement. Mais ces
énergies nouées, interconnectées, restent, par continuité, en régime
stable (ou « quasistationnaire », comme l’exprime Lewin), d’échanges
avec les incitations et les forces externes, ellesmêmes en variation
légère si elles sont relativement proches : la tension change
incessamment pour maintenir un statu quo momentané d’ajustement au tissu
mobile des forces extérieures (par « accommodation » selon le terme cher
à Piaget) ce qui évite des sauts de niveau, et donc réduit le risque
d’échanges tourbillonnaires.
Cependant les échanges, le statu
quo, ne se résolvent pas en un équilibre seulement « stable ». Il y a
directionalité de l’organisme humain, c’estàdire bascule en avant, par
équilibre relativement « indifférent », c’estàdire accroissement
(incoercible) des éléments ou événements pris en interaction suivant des
expériences nouvelles et plus lointaines. Il en résulte un remaniement
général des relations externes mais par contrecoup des relations
internes. D’un côté, il y a évolution des énergies de l’individu en
transaction vers des régions de plus en plus lointaines ou indirectes
voire « détournées » de l’environnement (c’estàdire de moins en moins
probables comme incidence directe). D’un autre côté, il y a involution
corrélative de ces énergies, par retentissement intérieur, c’estàdire
par serrage de plus en plus fin, de plus en plus différenciant, de leurs
rapports de tension internes. Et ce serrage (cette intégration), ce
contrôle réciproque au travers de la « conscience » (Piaget dirait cette
« assimilation ») doit néanmoins préserver la plasticité de sa
structure, pour qu’elle reste apte à intégrer le retentissement
d’éléments et d’événements de plus en plus inattendus, de plus en plus
improbables, de plus en plus déstabilisants, c’estàdire le traitement
des informations de plus en plus inhabituelles.
Evolution et involution
fonctionnent donc ensemble, en réciprocité ou même en réversibilité :
pour assurer le statu quo et son dépassement, la maintenance de l’organisme
et pourtant son accroissement directionnel, elles interfèrent suivant l’ajustement
d’une régulation qui se dégage incessamment et qui agit sur la
stabilisation du comportement mais aussi sur la modification de la
structure interne de l’organisme.
Max Pagès a noté profondément
comment l’hypothèse rogérienne du growth comportait ainsi un
double aspect : l’organisme, d’une part, poursuit des fins qui lui sont
propres, liées à sa conservation et à sa directionalité, mais d’autre
part il se développe « une capacité de régulation de l’organisme par
luimême, qui le met à même de modifier sa propre structure interne pour
atteindre ses fins ».
Régulation de stabilisation et de disponibilité
On comprend que la régulation qui
intervient sur le déploiement et le reploiement des énergies nouées dans
l’organisme humain se dédouble de façon croissante, suivant des
mécanismes de stabilité d’une part, et des processus
« d’indifférence » ou « d’inconditionnalité » d’autre part, ou d’« irréversibilité »
et d’« improbabilité », selon les termes de Prigogine et de la
science moderne.
Car, comme le remarque Berlyne en
réflexion avec et sur Piaget : « Bien que l’organisme ait besoin d’un
équilibre stable sur le plan physiologique, c’est l’équilibre
indifférent, allié à la cohérence qu’il lui faut sur le plan de la
pensée. Comme Ashby (1956) l’a bien montré, les mécanismes qui assurent
la stabilité, y compris tous les mécanismes de contrôle à feedback
négatif, sont des dispositifs pour bloquer la transmission
d’information. Si l’homéostasie est parfaite, aucune information
sur les perturbations qui menaceraient le bienêtre d’un organisme ne
parvient jusqu’aux processus vitaux ».
Il n’y aurait pas non plus d’information pour correspondre au plusêtre
directionnel (ce growth incoercible, cette libido
« indifférente » et non plus menaçante ou suspecte) qui est requis pour
le bienêtre même ou le « plein fonctionnement » de l’homme.
Pour Berlyne, la pensée doit en
conséquence refléter fidèlement toutes les combinaisons possibles des
incitations présentes et des expériences passées, en vue de trouver
celle dont elle pourra assurer le passage le plus vif dans la tension
des échanges énergétiques : « Aussi exigetelle l’équilibre indifférent
de l’ascenseur, qui passe librement de n’importe quel étage à n’importe
quel autre et qui demeure immobile où qu’il soit arrêté ».
Et il cite une description de l’équilibre psychologique par Piaget,
« comme un état où la somme algébrique des mouvements virtuels est
nulle ».
J’aime à comparer cette réflexion
sur l’équilibre indifférent et la pensée de Piaget (à propos duquel on
se souviendra que Rogers a écrit : « Notre travail (work) a été
semblable en propos (interest) à celui de Piaget, par exemple,
plus qu’à celui de la plupart des psychologues américains »)
à la conception théorique de Rogers sur la « vie pleine ». Il dit en
effet de celleci qu’elle est, d’après son expérience, « le processus de
mouvement dans une direction que choisit l’être humain, quand il est
libre intérieurement de se mouvoir dans n’importe quelle direction »,
ajoutant que « les traits généraux de cette direction choisie semblent
avoir une certaine universalité ».
Et il prend soin, au surplus, dans une « description négative » de la
vie pleine, de préciser : « Pour parler en termes de psychologie, ce
n’est pas un état de réduction d’impulsions, de réduction de tensions,
d’homéostase ».
L’homéostasie « parfaite » comme dit Berlyne, rend rigide l’organisme et
contrevient à sa tendance d’actualisation de potentialités : on notera
ici le rejet du « parfait » et donc le nonperfectionnisme, par suite la
visée de souplesse et de tâtonnement (ou de probabilisme) incluse dans
les hypothèses rogériennes.
On retrouve également la notion
d’équilibre indifférent dans le concept de « considération positive
inconditionnelle » dont nous reparlerons plus loin, et où il est clair
que le terme « inconditionnelle » vise un non blocage de l’information
reçue quelle qu’elle soit et à quelque niveau qu’elle se trouve
(« l’ascenseur »). D’elle relève également la notion de disponibilité
d’accès à la conscience (de présenciation) pour des sensations, des
perceptions, des souvenirs ou des idées « éveillées » ou évocables dans
la situation immédiate où vivrait « pleinement » un « sujet hypothétique » :
« L’être pleinement ouvert à son expérience aurait accès à toutes les
données possibles de la situation, pour fonder sur elles sa conduite :
les exigences de la société, ses propres besoins complexes et peutêtre
contradictoires, ses souvenirs de situations similaires, sa perception
du caractère unique de cette situation, etc. Les données seraient en
fait très complexes. Mais il pourrait permettre à son organisme total,
avec la participation de sa conscience, de pondérer chaque excitation,
chaque besoin et chaque exigence, leurs intensités et importances
relatives, et, à partir de cette estimation et de ce calcul délicats,
découvrir l’attitude qui serait la plus appropriée à satisfaire tous ses
besoins dans cette situation ».
Dans sa réflexion théorique et
naturaliste sur les modèles dynamiques, à régulation, Rogers va jusqu’à
la comparaison : « On pourrait comparer cet individu à une gigantesque
calculatrice électronique. Du moment qu’il est ouvert à l’expérience,
toutes les données venant de ses impressions, de sa mémoire, de son
expérience acquise, de ses états viscéraux et internes, sont introduites
dans la machine. La machine tient compte de toutes ces tendances et de
toutes ces forces qui lui sont données et calcule rapidement l’action
qui serait le vecteur de satisfaction des besoins le plus économique
dans cette situation existentielle ».
Dans un autre essai de précision, Rogers, parlant de la liberté du
sujet, dit qu’il « veut ou choisit la ligne de conduite qui représente
le vecteur le plus économique par rapport à toutes les excitations
internes et externes ». Et on pourrait connoter cette double référence
de « vecteur économique » et ce calcul « rapide » d’ordinateur, avec la
notion d’aise, de « souplesse », de « fluidité », qu’il introduit
fréquemment dans sa description d’une démarche « organismique ».
Fonctionnement par disponibilité et théorie du « champ »
On notera qu’une telle conception
implique une fluidité de circulation pour l’information et
corrélativement une rapidité d’interaction de l’organisme avec son
environnement total, sans retard ni « frottements » ou complications, c’estàdire
sans dissipation inutile et dispendieuse d’énergie et de temps. C’est
une formulation de la présenciation (que nous venons d’évoquer) qui est
naturellement accordée à une théorie du « champ », dont on sait
l’importance qu’elle a prise dans la pensée scientifique.
Selon celleci en effet, comme Lewin
l’a fait observer, la situation expérientielle est neuve à chaque
instant, « unique » au sens dégagé par Rogers. Car le changement à un
instant donné pour n’importe quelle variable, ne dépend (mathéma
tiquement) que de la situation globale, présente à cet instant. C’est le
« principe de contemporanéité » qui « signifie donc que le comportement
B (abréviation de l’anglais behavior) à l’instant t est fonction
seulement de la situation S (S est conçue comme incluant à la fois la
personne et son environnement psychologique), et n’est pas, en surcroît
(in addition) fonction des situations passées ou futures ».
Le passé, note aussi Lewin, a été analysé « plutôt excessivement » en
psychologie, particulièrement en psychanalyse classique (dans
l’anamnèse).
Il fait cependant remarquer que le « problème » du passé et celui du
futur sont contenus dans le champ psychologique qui existe à un moment
donné pour un individu grâce aux vues (views) qu’il a, aux
symbolisations qu’il se fait, de son futur et de son passé.
Ces caractéristiques de champ
rejoignent les conceptions théoriques de Rogers, qui s’est ressenti
proche de Lewin : il le cite plusieurs fois dans ClientCentered
Therapy, en 1951 (notamment pour la confirmation de sa réflexion :
« Rien n’est aussi pratique qu’une bonne théorie », à propos du concept
de moi ou self). Il précise, dans ce livre : « La conduite n’est
pas “causée” par quelque chose qui est apparu dans le passé. Les
tensions présentes et les besoins présents sont les seules choses que
l’organisme s’efforce de réduire ou de satisfaire ».
Dans Le développement de la
personne, traitant de la vie pleine et d’un être pleinement ouvert à
son expérience, il écrit également : « La configuration complexe
d’excitations internes et externes qui existe à tel moment n’a jamais
existé auparavant exactement de la même manière. Par conséquent, cet
être réaliserait que “ce que je serai au moment suivant, et ce que je
ferai, naît du moment présent et ne peut être prédit à l’avance ni par
moi ni par d’autres”. Il arrive assez souvent que nous entendions des
clients exprimer exactement ce sentiment… Cela signifie qu’on découvre
la structure de l’expérience dans le processus par lequel on vit cette
expérience ».
Ces considérations sont identiques
à celles de Dewey. Et on peut penser à la phrase de Gœthe : « Il
n’existe pas de passé qu’on ait le droit de regretter ; il n’existe
qu’un renouveau éternel qui surgit des éléments élargis du passé ».
La rupture du fonctionnement « optimal »
Le fonctionnement de champ, le
fonctionnement optimal, dont Rogers fait la théorie, est toujours
possible, reproductible, dans la personne humaine. Cependant, il est,
aussi bien, toujours susceptible d’être enrayé. Car l’équilibre
« indifférent », dont il suppose un usage croissant pour les relations à
des « régions » de l’espace de vie de plus en plus lointaines et
« étrangères », ne s’accommode pas nécessairement et souplement des
mécanismes d’homéostasie sur lesquels il doit s’établir ou avec lesquels
il doit composer, pour que soient assurées aussi bien la conservation
que la progression directionnelle de l’individu. Celleci peut être
inversée en régression si la première est excessive ou insuffisante.
Dans les systèmes à feedback
négatif propres à l’homéostasie, en effet, « le processus correctif
n’est pas toujours quantitativement ajusté au besoin », indique Berlyne
qui ajoute d’autre part « que le commencement et la cessation de son
effet se manifestent avec un certain retard ».
Deux conséquences peuvent donc se manifester et produire des
oscillations de blocage et de régression.
D’un côté, une correction
quantitativement trop importante (ou trop faible) fonctionne comme si un
élément de la situation extérieure était indûment majoré (ou minoré) et
donc d’autres ajustements minimisés voire effacés (ou accentués), par
rapport au besoin résultant de l’involution des énergies structurées
dans l’organisme. Il se produit donc un déphasage entre involution et
évolution, lesquelles, au lieu de fonctionner réversiblement, se
désaccordent et affaiblissent l’équilibre indifférent qu’elles
assuraient,
appelant par suite des oscillations de feedback négatif qui
renforcent l’importance de l’homéostasie, et consomment inutilement de
l’énergie et de l’information. Ce processus peut s’amortir de luimême ou
se fixer en bloquant de l’énergie destinée à freiner des ajustements.
D’un autre côté, la mise en jeu de
la régulation qui s’effectue avec retard introduit des éléments ou des
informations qui n’appartiennent plus à la situation, ce qui vicie la
réalité de la présenciation et rompt l’homogénéité du champ. Des
mécanismes de rejet de ces informations décalées tendent à apparaître,
mais contribuent également à renforcer l’action des feedback
négatifs, au dépens des possibilités d’équilibre indifférent. Des
saccades d’équilibre sélectif apparaissent et peuvent s’amplifier ou se
consolider.
Comme le remarque Rogers à propos
du fonctionnement optimal, « les défauts qui rendent ce processus peu
sûr chez la plupart d’entre nous sont l’inclusion d’informations qui
n’appartiennent pas à la situation présente ou l’exclusion d’information
qui y appartiennent. C’est quand des souvenirs ou des expériences
antérieurs sont fournis comme données de calcul comme s’ils étaient
cette réalité et non des souvenirs et des expériences passées, que
des réponses erronées sont fournies ; ou bien quand certaines
expériences menaçantes n’ont pas la possibilité d’accéder à la
conscience et par conséquent sont soustraites aux calculs ou introduites
d’une manière déformée ».
Le mauvais ajustement entre les
processus d’équilibre indifférent et les mécanismes d’homéostasie peut
n’être que léger et fortuit. Dans certaines conditions, il peut dépasser
un niveau critique. Dans ce cas, le passé et les anticipations
interfèrent avec excès sur le présent, en sorte que celuici est brouillé
et que le principe de contemporanéité est mis en échec. Le jeu souple du
« champ » est coincé, la disponibilité est bloquée par une viscosité
croissante, la distanciation « s’emballe » (en abstraction et
rationalisation) et les fantasmes apparaissent.
Il n’est plus possible, en ce
point, de pousser l’analyse sans faire entrer en ligne de compte les
concepts de moi ou de soi (self) et de conscience, comme Rogers
fut conduit à le faire.
L’émergence du moi (self) et l’extension de la conscience
Les énergies intégrées dans
l’organisme croissent et entrent en rapport de tension avec des régions
de l’environnement de plus en plus étendues (et des sources d’énergie de
plus en plus variées) dans « l’espace de vie » de l’individu, pour
prendre la terminologie de Lewin. Ces régions (ces sources) sont
éprouvées comme « inaccessibles » (et dangereuses) ou, de plus en plus,
comme « accessibles » directement (ou par le moyen d’outils et de
relais). En cas d’accessibilité perçue, elles localisent alors « le
libre mouvement », « la locomotion libre »,
c’estàdire l’autonomie, la maîtrise de l’individu, par rapport à
l’environnement.
Corrélativement, les énergies
intégrées sont portées à renforcer et à raffiner le serrage, la
centration de leurs rapports internes réciproques, c’estàdire à établir
progressivement un espace de référence dans « la plus grande
différenciation d’organes et de fonctions » ;
des « régions » intérieures, des « localisations », sont organisées et
différenciées, soit comme relatives aux distanciations du monde
extérieur et à l’actualisation possible des forces potentielles (et
germinatives) dans l’« expérienciation » (experiencing), soit
comme référées à l’individu en tant que proche, « présent », et donc aux
régulations qui le constituent dans cette présence.
Dans son processus même, la
différenciation dégage nécessairement, de façon de plus en plus
spécifique et distinctive par rapport aux stimuli ou excitations
extérieures, comme « variable importante de la dynamique de la
personnalité »,
un noyau ferme de référenciation (ou de présenciation). Ce noyau
qui reçoit et détient de l’énergie propre (selon une « note », une
« longueur d’onde » propre), c’est l’image ou « l’idée que le sujet se
fait de luimême »
en train de fonctionner et de disposer d’éléments d’expérience, dans son
monde privé total.
Ce noyau est construit comme un lieu de localisation intense (de
focalisation) des référenciations de plus en plus serrées et acérées (ou
contrastées). Il devient, dynamiquement, en se complexifiant, un
« échantillonnage (pattern) ou modèle organisé de perceptions de
soi et de soienrelation aux autres et à l’environnement. Cette
configuration, cette Gestalt, est dans ses détails, une chose
fluide et changeante, mais qui est nettement stable dans ses éléments
basiques ».
Et Rogers ajoute, citant Raimy (dont les travaux expérimentaux sur le
concept de moi ont eu beaucoup d’importance pour lui), que ce noyau est
« constamment utilisé comme un cadre de référence quand on doit faire
des choix. Il sert alors à réguler le comportement et peut servir à
rendre compte des uniformités observées dans la personnalité ».
Rogers ajoute enfin que « cette configuration est en général, disponible
(available) à la conscience » et qu’elle se présente « comme
étant une organisation d’hypothèses pour la rencontre de la vie ».
Si Rogers a souvent tenté de
définir opérationnellement le concept de moi ou de soi (self),
depuis qu’il en a constaté l’importance dans les besoins expérientiels
de ses clients, et ensuite dans des recherches expérimentales
stimulantes, il l’a conçu, la plupart du temps, comme une
« configuration » (plutôt que comme une image, une figure) qui
englobe les termes de moi, je, moimême, aussi bien que ceux de moi réel,
moi idéal, ou notion sociale du moi,
voire également celui du corps. Il reconnaît que des recherches
expérimentales sont nécessaires (et possibles) afin de répondre à de
difficiles questions telles que : « L’interaction sociale estelle
nécessaire pour qu’un moi (self) se développe ? Le moi estil
primairement un produit de la symbolisation ? Le moi estil simplement la
portion symbolisée de l’expérience ? »
Il associe en permanence ce concept
global à la notion de contrôle (et de proximité à la régulation),
notant par exemple : « Les éléments que nous contrôlons sont regardés
comme une part du moi, mais même quand un objet tel qu’une part de notre
corps est hors de notre contrôle, il est expériencé comme étant moins
une part de soi ».
Et il cite l’exemple d’une jambe, qui a des « fourmis » par mauvaise
circulation, et qui devient pour l’individu plus un objet qu’une part de
luimême. Il forme l’hypothèse : « Peutêtre estce ce “gradient
d’autonomie” qui donne pour la première fois à l’enfant la conscience de
soi, quand il est pour la première fois conscient d’un sentiment de
contrôle (a feeling of control) sur quelque aspect de son monde
d’expérience ».
La relation entre la consistance
du soi (ou du moi) et la proximité de référence au contrôle et au
« libre mouvement » (expérimentée selon le « gradient d’autonomie »)
va nous servir de fil directeur pour comprendre à la fois le
fonctionnement et l’évolution structurelle du moi, dans les péripéties
de la croissance de l’organisme.
Régulation et conscience
Revenons sur l’opération de
régulationcontrôle. Elle s’effectuait, au départ de l’organisme, assez
largement dans des réflexes décentralisés selon des processus directs
d’autorégulation locale, d’homéostasie, non intégrés (restant au niveau
de la moelle épinière). Elle s’effectue de façon croissante (grâce au
développement du cerveau et à l’accroissement des « traces » ou
« traçages » des expériences successives sur le corps et les énergies
intégrées) dans un lieu central de comparaison, d’évaluation interne et
de totalisation, la « conscience » (ou la « pensée » comme le note Dewey
dans Expérience et éducation, p. 115 : « La pensée est donc un
ajournement de l’action immédiate et, dans le même temps, elle est un
contrôle interne de l’impulsion par l’union de l’observation et de la
mémoire, laquelle union est au cœur de la réflexion »).
En ce lieu, qui s’autonomise de
plus en plus, les tensions des énergies appliquées à l’environnement
sont tracées et perçues de façon croissante (selon les excitations
sensorimotrices) en « hypothèses »,
comme proches ou lointaines en tant qu’« hypothèses »
d’actions plus ou moins retardées ou distantes par rapport à
l’organisme ; les régions de l’environnement où elles se localisent
sont évaluées, de plus en plus, comme ouvertes ou non à
l’« accessibilité », au « libre mouvement ». Ces « hypothèses »
d’éloignements, ces accessibilités ou nonaccessibilités, sont testées
dans leurs « gradients d’autonomie » immédiats : par référence au noyau,
à la Gestalt du moi.
Car celuici reste, par la part
d’énergie autonome dont il dispose, en interactions incessantes, en
« oscillations entretenues », avec les énergies comportementales et
informationnelles intégrées dans l’organisme ; mais la configuration qui
en résulte, en « structure d’expériences disponibles à la conscience »,
sert de cadre de référence (de code de « symbolisation ») pour évaluer
les énergies extérieures en tant que moins éloignées, ou au contraire,
inaccessibles et repoussées (ou dangereuses). La référence, la
symbolisation s’effectue grâce à l’énergie dont dispose la structure du
moi. Celleci exerce en faveur des énergies intégrées, comme une
surpression légère (une valorisation). Celleci sert alors à
discriminer des énergies externes comme plus ou moins distantes et
extérieures : on sait qu’une forme, une Gestalt, s’établit par
renforcement d’une « figure » contrastée sur un « fond » de perception
homogénéisée par affaiblissement des excitations qui en proviennent.
Cette surpression peut être
attribuée, par extension, et croissance, à des figures repères, des « personnescritères »
dit Rogers,
installées dans des régions d’accessibilité affermie. La forme du moi
s’établit alors par entretien, équilibre de tension (de
considération positive) avec ces figures et leur entourage,
repoussant sur un fond indifférencié les inaccessibilités ou les
valences négatives de l’environnement (objets, forces ou personnes
vécues dès lors comme indistinctement vagues, angoissantes et
menaçantes).
Dans le fonctionnement optimal, la
forme du moi reste souple, changeante, consommant un minimum d’énergie
pour se modeler aux résultats des expériences successives qui permettent
à l’organisme d’agrandir le domaine d’accessibilité. Il est ainsi
constamment possible à celuici de souscrire à un réalisme progressif,
assujetti au principe d’« isomorphisme » dégagé par la Gestalt Theory,
et qui « exige que, dans un cas donné, l’organisation de l’expérience et
les faits physiologiques qu’ils soustendent aient une même structure ».
Car « si le moi, dans l’expérience, est environné d’objets, le processus
(dans le cerveau) qui correspond au moi doit se dérouler parmi les
processus corrélatifs à ces objets ; plus particulièrement, les
caractéristiques spécifiques des processus, correspondant à l’objet,
seront en quelque manière représentées dans la région où se dérouleront
les processus sousjacents au moi : sous l’influence de ce « champ », les
processus correspondant au moi seront modifiés d’une façon ou d’une
autre. Réciproquement, une attitude particulière du moi, en rapport avec
un objet, verra sa contrepartie physiologique s’étendre vers le lieu où
cet objet est physiologiquement représenté, en sorte que les processus,
correspondant à cet objet, puissent changer sous l’influence du champ du
moi ».
Dans le « champ » de
contemporanéité, le moi se développe et s’organise pour maintenir la
stabilisation des changements par son intervention régulante : celleci
fait basculer le choix de l’expérience admise (vers la locomotion sur
certaines régions). Mais les changements n’ont pas à être considérés
comme nécessairement faciles, ni comme produisant une réduction de
tension, par prédominance d’homéostasie comme le souligne vigoureusement
Rogers.
Traitant des individus qui ont fait, en thérapie et ultérieurement,
« les plus grands progrès dans le sens d’une vie pleine », il écrit :
« Je crois qu’ils se considéreraient comme insultés s’ils étaient
décrits comme “adaptés”, et qu’ils seraient mécontent d’être appelés
“heureux” ou “contents”, ou même “actualisés”. Et de mon côté, je
considérerais comme très inexact de dire que toutes leurs tensions
impulsives ont été réduites ou qu’ils sont dans un état d’homéostase ».
La forme du moi doit donc rester
ouverte à l’équilibre indifférent pour permettre « l’intégration
symbolique de la totalité de l’expérience »,
avec toutes ses contradictions. Il s’ensuit qu’« essentiellement, c’est
une Gestalt dont la signification vécue est susceptible de
changer sensiblement, voire de se renverser, à la suite du changement
d’un quelconque de ces éléments. En fait, le caractère structurel du moi
peut se comparer aux figures ambiguës que l’on trouve dans les manuels
de psychologie de la forme ».
Il reste à voir sous quelles
conditions une évolution souple allant jusqu’au renversement de la forme
du moi peut se maintenir et quelles seraient les conséquences si par
hasard ces conditions étaient entravées. Mais c’est traiter du
fonctionnement enrayé de la personnalité, ou de la falsification de la
structure du moi, et de l’émergence prépondérante des mécanismes de
défense ; ou encore de l’aliénation, de « l’étrangement » que l’individu
rencontre et qui produit un « désaccord fondamental » entre le moi et
l’expérience, un blocage de l’accessibilité en certaines régions de
l’espace de vie.
La « scène primitive »
Inlassablement, Rogers a cherché à
exprimer le premier àcoup qui a introduit le déraillement, le dérapage
du fonctionnement optimal tel qu’il se constituait au cours de la
croissance de l’organisme et de celle corrélative du moi au cœur des
processus de régulation. Il a tenté de décrire cet événement aussi bien
dans ClientCentered Therapy (1951),
dans Psychothérapies et relations humaines (1959),
que dans Liberté pour apprendre ? (1969).
C’est cet événement, toujours esquissé en peu de mots, sans luxe de
détails et avec un minimum de commentaire, qui revient également au cœur
de son dialogue avec Paul Tillich, en 1965, dans leur débat autour de
l’ambiguïté de la personne humaine et des structures « démoniques »
(comme de « possession »).
Voici la description (l’une des
plus complètes) que Rogers en a faite dans ClientCentered Therapy.
Après avoir décrit l’évaluation organique directe que le petit enfant
utilise dans un équilibre sans distorsion avec son entourage, il
déclare : « L’un des premiers et des plus importants aspects de
l’expérience de soi (self experience) de l’enfant ordinaire est
qu’il est aimé de ses parents. Il se perçoit luimême comme aimable,
digne d’amour, et sa relation à ses parents est une relation d’affection.
Il fait l’expérience de tout ceci avec satisfaction. C’est un élément
signifiant au cœur de la structure de soi qui commence à se former.
« Au même moment, il fait
l’expérience immédiate de valeurs sensorielles positives, il fait
l’expérience immédiate du rehaussement (enhancement), dans
d’autres voies. C’est réjouissant d’avoir un mouvement viscéral (bowel)
en tout temps et en toute place où la tension physiologique est
ressentie (experienced). C’est satisfaisant et rehaussant de
frapper, ou d’essayer de le faire, le petit frère (baby brother).
Quand c’est la première fois que l’expérience de ces choses est faite,
elles n’apparaissent pas nécessairement incompatibles (inconsistent)
avec le concept de soi comme une personne aimable.
« Mais alors une sérieuse menace
survient sur le moi (self) de notre enfant schématique. Il fait
l’expérience de mots et d’actions de ses parents en réponse à ces
conduites satisfaisantes pour lui, et les mots et les actions en
rajoutent (add up) sur le sentiment “tu es méchant, ton
comportement est méchant, et tu n’es pas aimé ni aimable quand tu te
conduis de cette façon”. Ceci constitue une menace profonde pour la
structure naissante du moi. Le dilemme de l’enfant pourrait être
schématisé dans ces termes : “Si j’admets dans ma conscience les
satisfactions de ces conduites et les valeurs que j’appréhende dans ces
expériences, ceci est par suite incompatible avec mon moi comme étant
aimé et aimable”.
« Il s’ensuit alors des
conséquences dans le développement de l’enfant ordinaire. L’une des
conséquences est un refus de prendre conscience des satisfactions qui
étaient vécues. L’autre est de distordre la symbolisation de
l’expérience des parents. La symbolisation correcte serait : “Je perçois
mes parents comme faisant l’expérience de cette conduite en tant
qu’insatisfaisante pour eux”. La symbolisation déviée, déviée en vue de
préserver le concept menacé du moi, est : “Je perçois cette conduite
comme insatisfaisante”.
« C’est par ce chemin, sembleraitil,
que les attitudes parentales ne sont pas seulement introjectées, mais,
ce qui est beaucoup plus important, qu’elles sont expérimentées non
comme les attitudes d’autrui, mais, en distorsion (distorted),
comme si elles étaient basées sur l’évidence de l’équipement sensoriel
et viscéral de soimême.
« […] Les valeurs que l’enfant
attache à l’expérience en viennent à divorcer de son propre
fonctionnement organismique, et l’expérience est évaluée en termes
d’attitudes prises par ses parents, ou par d’autres personnes qui sont
en intime association avec lui ».
Cet événement, cette situation de
falsification ou de culpabilisation, de « faute », peut être présenté
comme l’équivalent pour Rogers de la « scène primitive » pour Freud.
Comme on le voit, cette scène ne se situe pas dans le rapport aux seuls
parents et à leur sexualité, mais dans le rapport à la fratrie, à un
puîné intervenant dans l’environnement parental (mais ce pourrait être à
un aîné, détrônant momentanément un puîné de son « impunité » et de sa
centration privilégiée). On ne peut manquer de penser que Rogers a
introduit un souvenir intense de sa première enfance comme Freud l’avait
fait pour édifier un symbole caractéristique, un mythe central,
justifiant ses pratiques et ses recherches.
Tillich fait d’ailleurs observer à
propos de ce tableau d’un petit garçon qui continue à tirer les cheveux
d’un puîné (cette fois une petite sœur) tout en disant à la ronde
« méchant garçon, méchant garçon », et cependant continuant à tirer les
cheveux interdits dans la délectation et déjà « l’étrangement », que
c’est aussi un symbole qui se rapproche de la « chute d’Adam et Eve » et
qui a la même signification du passage (de la fuite) de l’innocence
rêvante (dreaming innocence) à l’actualisation de soi consciente.
« Dans le processus, l’étrangement prend place également, aussi bien que
l’accomplissement (fulfillned), d’où mon concept de l’ambiguïté ».
Cette culpabilisation qui naît des
tiraillements du moi enfantin (ou adulte), pris entre son besoin
d’affection et son besoin d’actualisation et d’expansion entraîne pour
l’individu une perte de contact « avec son propre processus organismique
d’évaluation. Il a abandonné la sagesse de son organisme, désertant le
lieu de son évaluation ».
Et Rogers cite le cas de jeunes qui s’orientent vers la médecine, par
exemple, pour faire plaisir à leurs parents et qui essuient des échecs
inattendus jusqu’au moment où des entretiens thérapeutiques révèlent
qu’ils ont perdu le contact avec leur propre processus de détermination
des valeurs et que leur aliénation les entrave et les déséquilibre.
L’introjection de structures provenant, dans notre culture
« fantastiquement compliquée »,
d’une grande variété de sources et par suite souvent profondément
contradictoires, accentue encore le caractère aliéné, déséquilibré, du
fonctionnement de la personnalité.

Figure 1
« L’espace de libre mouvement de l’enfant inclut les régions de 1
à 6, représentant des activités telles qu’aller au cinéma à des tarifs
réduits pour enfants, appartenir à un club de garçons, etc. Les régions
7 à 35 ne sont pas accessibles, représentant des activités telles que
conduire une voiture, tirer des chèques pour des achats, des activités
politiques, l’accomplissement d’occupations adultes, etc.

Figure 2
« L’espace adulte de libre mouvement est considérablement plus
étendu, quoi qu’il soit, lui aussi, fermé par des régions d’activités
inaccessibles à l’adulte, telle que tirer sur son ennemi ou entrer dans
des activités situées audessus de ses capacités sociales ou
intellectuelles (représentées par les régions allant de 29 à 35).
Quelquesunes des régions de l’enfant ne sont plus accessibles à l’adulte,
par exemple, aller au cinéma à des tarifs réduits pour enfants, ou faire
des choses qui sont socialement tabous pour un adulte alors qu’elles
sont permises à un enfant (représentées par les régions 1 et 5) ».
Schémas d’approche
On peut essayer de rendre
signifiant, d’interpréter, en fonction des théories du champ et de la
Gestalt, cette scène primitive ou schématique…
Lewin a utilisé, en vue de rendre
possibles des expérimentations, des schémas permettant de représenter la
situation expérientielle, en termes de régions d’accessibilité ou de
nonaccessibilité. L’« espace de libre mouvement » est représenté par
l’ensemble des régions accessibles (figurées en blanc avec leurs
frontières de localisation, cependant que les régions d’inaccessibilité
sont figurées hachurées) : cet espace est notablement différent s’il
s’agit d’un enfant ou d’un adulte. (Nous avons représenté en figures 1
et 2 les schémas de Lewin, tirés de Field Theory in Social Science,
p. 136.)
Il va de soi qu’on pourrait établir
des définitions différentes pour les régions d’accessibilité et
d’inaccessibilité : en vue de décrire plus finement, à des âges
déterminés de façon clairement opératoire (permettant des
expérimentations) l’espace d’actualisation dans le domaine
d’accessibilité, ainsi que le tracé plus ou moins sinueux de la
frontière ou des frontières qui séparent celuici des zones
d’interdiction ou de répression. Mais il nous suffira ici d’évoquer la
structure de forme pleine ou de forme distordue qui peut être appliquée
aux schémas.
Reprenons donc ces schémas en
fonction de la dernière remarque de Lewin. La forme de l’espace de libre
mouvement de l’enfant est représentée comme d’un seul tenant. Au fur et
à mesure de son développement, en effet, les possibilités d’action
visàvis de son environnement et de son entourage se sont établies en
continuité, conformément à l’observation de Dewey que les « deux
principes » de « continuité et interaction » ne se séparent jamais l’un
de l’autre dans l’« expérience ». Même s’il ne fait plus certaines
activités atteintes par lui, l’enfant pourrait les faire à nouveau sans
difficulté probable et elles restent incluses dans son espace de libre
mouvement qui est compact, sans crevasse : les régions y
sont accessibles en termes d’équilibre indifférent alors que les régions
inaccessibles sont nettement délimitées derrière une frontière fermée
(par rapport à laquelle interviennent des processus primitifs d’homéostase).
Cette frontière mobile prend une forme simple, en raison des lois
fondamentales de la Gestalt Theory : car les « totalités
perceptives » comme le cite Piaget, ont tendance à prendre la meilleure
forme possible, selon la loi de la prégnance des bonnes formes, « ces
formes prégnantes étant caractérisées par leur simplicité, leur
régularité, leur symétrie, la continuité, la proximité des éléments,
etc. Dans l’hypothèse du champ, ce sont là des effets des principes
physiques d’équilibre et de moindre action (d’extremum), comme dans le
cas de la Gestalt des bulles de savon : maximum de volume pour le
minimum de surface ».
Mais à un moment donné de sa
croissance et de l’actualisation de sa pression sur le monde, notamment
à l’occasion de la scène primitive, l’espace de libre mouvement de
l’enfant au lieu de conserver une forme consistante et compacte
va se fissurer, quand des régions d’accessibilité éprouvée ou habituée
vont basculer, être bloquées et rendues inaccessibles. Cette structure
disjointe est représentée dans le schéma de Lewin concernant l’adulte.
Il faut en explorer les significations vécues par l’enfant au moment
où se défait sa première structure confirmée et « pleine ». La frontière
de l’interdit, du tabou, ne va plus rester pour lui lointaine et ronde,
mais brusquement s’ouvrir sur des régions plus proches et réputées
accessibles, fiables. Par exemple, l’enfant pouvait accéder à une région
d’activité audacieuse telle que jouer avec les êtres humains familiers
ou étrangers et même les frapper : il tente d’aller dans cette région,
en continuité avec le petit frère ou la petite sœur ; mais il constate,
par les réactions affectives et motrices des « personnes critères » (et
trop souvent agressives en ces circonstances) que cette région s’est
refermée, s’est bloquée d’un seul coup, avec un effet d’impulsion
négative, inattendu par lui (et en fait injuste).
Ce changement soudain de la
structure de l’autonomie accueillie, soutenue, retentit immédiatement
sur les processus régulateurs de son comportement, c’estàdire sur son
moi. La Gestalt du moi de l’enfant est comme frappée à la nuque,
dans le dos ; elle devrait par isomorphisme, se « décompenser » et se
fissurer brusquement : mais le moi risque de subir le contrecoup d’une
« dépressurisation » subite, c’estàdire un brouillage d’angoisse (et
d’asphyxie) qui tendrait à se diffuser sur toutes les régions
d’accessibilité à l’actualisation. L’enfant est donc porté, par économie,
à plonger vers les altitudes anciennes de sécurité, et à rechercher les
réserves d’énergie de valorisation qu’il a localisées dans les
« personnes critères », les figuresrepères près desquelles son moi
antérieur s’équilibrait et se compensait. Il va donc se cramponner en
elles à une configuration antérieure de leur accord (dans la
reconnaissance réciproque des « accessibilités »). Il y trouve
inspiration pour fuir le vertige de l’angoisse, mais, pour ce faire, il
doit se couper des tensions organismiques et de leurs apports
régulateurs là où elles sont apparues disruptrices de l’équilibre de
son actualisation. « Etant donné que l’enfant, note Rogers, attache
généralement une importance si grande à l’approbation de sa mère, il en
arrive à être guidé, non par le caractère agréable ou désagréable de ses
expériences et comportements (c’estàdire non par leur signification par
rapport à sa tendance actualisante) mais par la promesse d’affection qui
s’y attache. Or cette attitude visàvis d’expériences particulières
s’étend bientôt à sa personnalité dans son ensemble. Indépendamment de
sa mère et d’autres individuscritères, l’enfant en vient à adopter
visàvis de luimême et de son comportement l’attitude en quelque sorte
“globale” manifestée par ces individus ».
La fissure évitée dans la structure
du moi, au niveau de la régulation, va donc alors être déplacée vers la
structure de la communication des informations au moi. Et quelques
répétitions, sur d’autres régions, de la « scène primitive » vont
consolider ce processus parasite de censure.
Il en résulte une moindre
alimentation de l’autonomisation. L’individu s’accroche aux
personnescritères de façon ambivalente et crispée ; il les veut
« fiables » pour lui à tout prix, pour se ressentir fiable luimême et il
adopte donc, en identification aveugle, leurs points de vue pour y faire
rentrer (comme dans un lit de Procuste) ce qu’il reçoit de ses
évaluations organismiques devenues suspectes.
La structure du moi, préservée par
raidissement (par trempe brusque), s’est durcie, et ne se modèlera
ultérieurement qu’avec beaucoup de résistance. Les changements
deviendront de plus en plus difficiles, la personnalité devient
« méfiante » à l’égard d’elle et des nouvelles rencontres : elle
consacre de l’énergie à se « défendre », c’estàdire à maintenir
l’organisation raidie de son moi articulée aux figuresrepères figées, et
à maintenir en compartiment étanche les lieux occasionnels d’épreuve, au
lieu de communiquer librement et d’accroître souplement ses zones
d’expérience. Une part d’énergie est donc abandonnée dans les zones qui
ont été expérimentées comme accessibles, puis menaçantes, par surprise
(et injustice) : et ces sources obturées entretiennent une menace
flottante.
Les ajustements de l’individu au
monde extérieur ne vont donc pas disposer de la sécurité et de la
continuité antérieures (et « édeniques ») : les gradients d’autonomie,
au lieu d’avoir une répartition d’évolution continue, une « bonne »
forme sécurisante et économique, vont présenter de brusques sauts
d’intensité, un profil distordu d’accessibilité aux régions
d’actualisation, avec des caractéristiques de discontinuité dans la
viscosité ou la fluidité. Le comportement va se trouver soumis à des
déséquilibres brutaux et à des menaces plus ou moins inattendues : le
sentiment d’aisance, de contrôle, et donc la conscience de
l’autonomie vont se trouver mis en échec, en contradiction. Le
concept de soi va se raidir contre la symbolisation de certaines
expériences qui lui sont contradictoires : il va se bloquer dans une
certaine falsification, dans un engluement à l’inertie de ses
simplifications (ou de ses rationalisations). Et s’il faut concevoir la
vérité, selon Dewey, comme un processus d’« assertibilité garantie », il
va se cramponner à la « garantie » préalable (et dogmatique) ou fixe
plutôt qu’à l’assertibilité éprouvée et glissante.
Une seconde analogie
Pour aller dans le sens de la
nouvelle analogie que nous prenons, des risques de « dérapage » vont se
produire entre la conduite de l’individu et l’environnement, et, par
suite, une rupture d’« adhérence » à la réalité, avec et par perte du
contrôle de la « direction ». Rogers a donné luimême un certain
développement à cette analogie (en vue d’expliquer les rétablissements
possibles, par tâtonnements progressifs de l’accueil aux perceptions
organismiques, dans la progression d’une thérapie).
« Je suis en train de conduire ma
voiture sur une chaussée verglacée. Je suis en train de contrôler sa
direction — comme le moi (self) se sent en contrôle de l’organisme.
Je désire tourner à gauche pour suivre la courbe de la route. A ce
point, la voiture (analogue à l’organisme physiologique) répond aux lois
physiques (analogues aux tensions physiologiques) dont je ne suis pas
informé (aware), et dérape, se mouvant en ligne droite au lieu de
virer suivant la courbe. La tension et la panique que je ressens ne sont
pas différentes de la tension de la personne qui trouve que “je fais des
choses qui ne sont pas moimême, et que je ne peux pas contrôler”. La
thérapie est aussi semblable. Si je suis conscient (aware),
décidant d’accepter toutes mes expériences sensorielles, je sens le
mouvement (momentum) qui entraîne la voiture, je ne la refuse
pas, je fais osciller la direction “en dérapage contrôlé” (I swing
the wheel “with the skid”), plutôt qu’à suivre le tournant, jusqu’à
ce que la voiture soit à nouveau sous mon contrôle. Alors je suis
capable de tourner à gauche, plus lentement. En d’autres mots, je ne
gagne pas immédiatement mon objectif conscient, mais en acceptant toutes
les évidences de l’expérience et en les organisant en un système
perceptuel intégré, j’acquiers le contrôle par lequel des objectifs
conscients peuvent raisonnablement être atteints. Ceci est très
parallèle au sentiment de la personne qui a terminé sa thérapie ».
Rogers note alors, de cette
personne qui a repris la maîtrise de sa conduite, qu’elle peut avoir été
obligée d’infléchir ses objectifs, mais que toute déception, de ce chef,
se trouve plus que compensée par l’intégration et le contrôle accrus
dont elle est devenue bénéficiaire : il n’y a plus d’aspects de sa
conduite qu’elle ne puisse gouverner.
Elle a appris à « conduire » et à « négocier » des « dérapages »
contrôlés vers la régression de soi et l’agressivité des autres quand
cela se rencontre.
Troisième analogie
Nous aimerions proposer encore une
analogie, dont le schéma dynamique peut également donner des indications
opératoires sur les processus de fonctionnement faussé et de
fonctionnement plein ou restauré de la personnalité.
Supposons un individu à qui est
dévolu un large domaine au flanc d’un relief. Il s’établit peu à peu, il
actualise ses potentialités dans ce domaine qu’il explore et organise
progressivement avec l’aide de ses voisins : pour asseoir son
installation, il édifie d’abord un abri momentané, puis en raison des
besoins qui se dégagent en lui dès qu’il n’a plus à penser au plus
immédiat, il décide la construction d’une maison qui devienne vraiment
son chez soi (son « moi ») et dont il parle avec ses voisins qui
l’approuvent.
Cette construction, cependant va
transformer l’usage qu’il faisait des divers lieux et dénivellements de
son domaine. Supposons, au surplus, qu’en finissant d’approfondir et de
cimenter les fondations à l’endroit choisi, comme étant le meilleur, le
plus compatible avec ses désirs et ses habitudes déjà formées, en
creusant ou par suite de travaux réalisés par les voisins, une source
apparaisse (provenant d’une carrière voisine, ignorée en profondeur).
L’écoulement de son débit se faisait jusquelà sans aucun problème et
n’était donc pas pris en considération pour ses actions d’accessibilité.
Mais son émergence soudaine contrarie ses projets alors que les
soubassements de la maison sont déjà très avancés.
Surpris et surtout irrité de cette
irruption, craignant d’avoir des ennuis avec des voisins (ou les
autorités qui ont donné le permis de construire), l’individu se
précipite pour boucher cette source et pour préserver le plan initial
de construction (à tout prix, pour éviter de faire naître des
soupçons qui révéleraient le « pot aux roses »). Il va accumuler des
matériaux à cet endroit qui lui manqueront ailleurs dans son
exploitation ; il va ensuite édifier les étages successifs ; mais il
n’ira pas jusqu’au bout de son projet dans l’aménagement intérieur et il
ne pourra guère développer des extensions qui se révéleraient
nécessaires, mais qui se baseraient sur la portion qui reste douteuse en
l’absence de travaux d’assainissement. Il se préoccupera en permanence,
dans l’inquiétude, des suintements possibles, et se paniquera facilement
dans toutes les caves ou ailleurs, pour des traces d’humidité sans
relation avec la source ; il cachera ses préoccupations à ses voisins,
bloquant les relations à leur forme antérieure ; de plus, il évitera par
des multiples prétextes et avec beaucoup d’énergie dépensée là
inutilement, le contrôle des autorités dans la partie « douteuse » de
ses fondations et alentour. Son édifice, son « chez lui » restera
restreint au plan primitif vers l’extérieur, malgré tous les
agrandissements qui seraient possibles et souhaitables, et il y vivra
mal avec un aménagement sommaire, en dépit de toutes les apparences de
solidité et de confort. Il ne recevra plus chez lui pour cacher la
précarité de ses installations.
Il finira par ne plus oser
descendre dans ses caves, y laissant des provisions et des barriques
(d’énergie de bonne qualité). Il sera dans la crainte perpétuelle et
rongeante d’une érosion, ou, les jours de difficultés « climatiques »
dans l’environnement, dans l’obsession d’un envahissement torrentiel et
d’un effondrement. Il sera de moins en moins accueillant dans sa maison.
Il se montrera nerveux et susceptible à l’égard de ses voisins comme à
l’égard des autorités. Et il osera de moins en moins faire exécuter les
travaux qui le libéreraient de ces anxiétés et qui redonneraient toute
sa solidité et ses chances d’accomplissement à cette demeure si
importante pour la mise en exploitation sereine de tout le domaine.
Il se réfugiera de plus en plus au
« grenier », comme l’observe Jung, dans une analogie voisine : « La
conscience se comporte là comme un homme qui, entendant un bruit suspect
à la cave, se précipite au grenier pour y constater qu’il n’y a pas de
voleurs et que, par conséquent, le bruit était pure imagination. En
réalité, cet homme prudent n’a pas osé s’aventurer à la cave ».
Supposons que cet homme retrouve un
jour un ami en qui il a une confiance totale et qui n’a aucun lien avec
ses voisins ni avec les autorités. Il parlera peu à peu de son domaine,
de sa maison. Un jour, il évoquera avec nervosité les ennuis que lui
donne l’escalier de sa cave et se montrera brusque ou brutal avec son
ami. Mais celuici est un sage, peu disert, peu curieux, et qui ne se
formalise pas. Un peu plus tard, il demandera donc à l’ami s’il ne
trouve pas sa maison insalubre, trop humide et sans doute pas bien
solide : si l’ami reste quiet et montre qu’il se trouve bien, il
s’enhardira à reparler de ses caves. Puis il ira voir la première et
s’étonnera de la trouver en relativement bon état. Il s’enhardira peu à
peu. Ils s’approcheront ensemble de la partie douteuse, feront quelques
sondages, évoqueront des travaux possibles. Un jour, notre individu se
décidera aux travaux qui seront moins importants qu’il ne l’imaginait de
façon surdramatisée. La source sera dégagée ; une « con
duite » accueillant sa présence et son débit sera installée, ce qui
apportera des possibilités d’irrigation (voire de force motrice) dans le
relief et donc des fécondités nouvelles pour le domaine. Et la maison
pourra s’agrandir et s’aménager rationnellement et chaleureusement,
cependant que notre individu s’y trouvera à l’aise et en sécurité : il
deviendra dès lors accueillant à des visiteurs de plus en plus nombreux,
et ouvert à des expériences de plus en plus nouvelles.
Défenses et crispation de soi
Cette analogie permet de discerner
le processus dynamique selon lequel se fausse ou se restaure le
fonctionnement optimal de la personnalité.
Celleci, dans son organisation,
dans son « édification », peut rencontrer par surprise en raison d’une
« source » d’énergie inattendue (« le puîné » par exemple) une « région
d’accessibilité » subitement bloquée pour ses entreprises. Au lieu de
prendre en constatation la tension que cette source institue par rapport
à ses potentialités (en termes de différence de potentiel) et de
chercher à accomplir cette tension, la personne se laisse aller à réagir
en la refoulant, en l’écartant par l’interposition de « résistances »
rigides et coûteuses. Les énergies de cette source et des régions qui
l’avoisinent (les provisions dans la cave) sont alors vécues comme
dangereuses et négatives ; le blocage de leur approche est organisé par
une « défense » de l’individu qui refoule souterrainement la tension
qu’il peut ressentir, la cachant aux autorités de contrôle en lui et
hors de lui. Ce faisant, il place la tension en structure de conflit
névrotique : si l’on veut bien voir que la caractéristique d’un conflit
névrotique est l’inactualisation d’énergies, présentes à un certain
niveau dans la personne, mais neutralisées dans leur accès naturel par
une « barrière de potentiel » qui repousse leur prise en considération
(inconditionnelle). Ce refus par la barrière de potentiel consomme ou
bloque de l’énergie qui n’est plus disponible pour effectuer toutes les
évolutions souhaitables pour la personnalité pressée par sa tendance
actualisante.
Celleci est ellemême vécue comme dangereuse, et l’individu cherche à se
protéger en se portant comme en cercle vicieux, à des conduites
fixistes. Par exemple, comme défense structurée, il vivra de simulations
et d’« élusion ». Laing définit celleci comme « une relation où l’on
fait d’abord semblant d’avoir renoncé à cette simulation de manière à se
retrouver apparemment à son point de départ. Une double simulation
simule l’absence de simulation ».
Mais l’élusion, comme toute défense, ne fait que « tourner le conflit
sans l’aborder directement et sans le résoudre ».
Dans ces défenses, l’adulte ne
trouve, en fait, que l’entretien de son anxiété dépressive. Décroché de
la confiance dans ses bases d’autonomie, il se confiera plus aisément à
des situations de dépendance et à l’élucubration de fantasmes et d’illusions
qui le protégeront des risques d’une présenciation à luimême.
Que celleci redevienne possible,
qu’un « ami » puisse aider à accéder progressivement (et avec des
dégagements inéluctables de nervosité ou d’agressivité, c’estàdire
d’énergie de blocage brusquement détendue) à l’escalier de la « cave »,
cela pose le problème de la restauration du fonctionnement optimal. Mais
ce sont les conditions pratiques et le processus de la
thérapie qui sont dès lors en question, c’estàdire l’introduction ou
le rétablissement de la souplesse dialectique dans les
relations humaines.
Chapitre XIII
Dispositions techniques et pratiques
Par ses positions et ses hypothèses
théoriques, Rogers explicite l’engagement résolu de sa vie : le
développement de soi dans et par l’aide au développement d’autrui. Ces
développements, ces growths, sont conçus en termes de
restauration incessante d’un fonctionnement optimal : selon celuici, la
personnalité, mue par sa tendance actualisante se trouve de plus en plus
unifiée dans sa complexité.
Ceci signifie que les thèses de la
présenciation à soi et à autrui, dans la subjectivité, affinée par les
hypothèses de la socialité « incurable » et de la croissance organique
avec des àcoups, vont se retrouver et s’équilibrer dynamiquement dans la
pratique des relations psychothérapiques ou plus généralement des
relations humaines.
Fonctionnement optimal et paradoxe d’une aide
Mettant l’accent premier sur les
capacités de chaque individu à trouver originalement son chemin
d’actualisation et à compenser ses accidents de parcours, Rogers a
établi la pratique de la clientcentered therapy, c’estàdire une
pratique centrée sur les possibilités du client dans sa subjectivité
profonde. Il écrivait en 1946 : « L’individu a la capacité et la force
pour imaginer, tout à fait sans aide (quite unaided), les pas qui
le porteront à une relation plus mûre et plus confortable avec sa
réalité ».
Ultérieurement, Rogers relevait
bien entendu la maladresse de la notion de « tout à fait sans aide » (quite
unaided). Car l’individu ne peut être séparé de son environnement et
il ne peut évoluer qu’avec une transformation conjointe (même légère,
comme une nuance) de celuici, c’estàdire d’au moins un élément de la
configuration des relations. En sorte qu’il faut empiriquement et
théoriquement convenir de l’opportunité de construire par une relation
d’aide un climat libératoire, en vue de modifier spécifiquement un
climat, un environnement, de disposer un « humus » pour que la
possibilité de croissance autonome, la vis medicatrix naturae, se
développe : tout en sachant que c’est en l’individu intéressé que se
trouve la capacité créatrice et restauratrice. Avec ses distinctions
antagonistes, une aide est possible et nécessaire. Rogers pouvait quant
à lui considérer comme inexactes, inappropriées, les critiques traitant
d’optimiste et de « rousseauiste » sa démarche naturaliste (ou
dialectique), alignée sur celle de Goldstein. Il ne s’agit pas pour lui
de fatalisme, de providentialisme, de laisserfaire, pas plus que
d’interventionnisme soupçonneux : « Contrairement à ces thérapeutes qui
ne voient que dépravation (depravity) au cœur de l’homme, qui
voient les instincts les plus profonds de l’homme comme destructeurs,
j’ai constaté que, lorsque l’homme est vraiment libre de devenir ce
qu’il est le plus profondément, libre d’actualiser sa nature comme un
organisme capable de conscience, alors il apparaît clairement se mouvoir
vers la totalisation (wholeness) et l’intégration ».
Il restera jusqu’au bout fidèle à cette orientation fondamentale.
« Lorsque l’homme est vraiment
libre » : ce subordinatif circonstanciel suppose la possibilité de créer
paradoxalement pour autrui des conditions réelles de liberté.
Mais quelles seraient ces conditions, présentées extérieurement, pour
une liberté intérieure, et qui la soutiendrait dans sa naissance ou sa
renaissance incessante ? Des conditions déconditionnantes, et donc
inconditionnelles, pour une liberté : avonsnous raison de dire paradoxe,
ou fautil avouer contradiction ?
Peuton établir ces conditions, de
façon volontaire, par des dispositions pratiques qui soient, non pas
vagues et improvisées, mais définissables et opératoirement
maîtrisables, c’estàdire épaulées sur des techniques et des règles ?
Mais alors comment ces conditions, générales puisque définissables,
limitatrices puisque techniques et régulées, pourraientelles être
ajustées à l’originalité respectable de chaque individu et à
l’idiosyncrasie de chaque interlocuteur et thérapeute ? Ou à l’imprévisible
de leur interaction ? Contradiction ou paradoxe vécus encore ?
Plus généralement, peuton agir
scientifiquement, c’estàdire de façon universellement fiable et
communicable, parce que vérifiable, dans le domaine des relations
humaines où un art subtil intuitif est nécessaire à la communication et
où la complexité des possibles rend fragiles tout pronostic et tout
savoirfaire ? Et ne risqueton pas, en introduisant une méthode, des
principes et des théories, c’estàdire des formalisations, de fausser
l’existentiel et d’induire les conformismes de comportement et
d’expression làmême où on prétendait libérer l’informel et l’indicible ?
Contradictions (et mystification) ou paradoxes (et courage d’exister) ?
Nous aurons à retrouver la
compression, la géologie plus totale de ces contradictions ou paradoxes
(à la base des critiques, objectives ou passionnelles qui lui sont
faites et que retrace intelligemment Brian Thorne dans son ouvrage
Comprendre Carl Rogers, Le Seuil, 1994 ; pp. 90 à 105 ; suivies de
réfutation, pp. 105 à 118), au cours de notre exploration de la praxis
rogérienne, en plongeant dans son fonctionnement interne.
D’ores et déjà, nous pouvons dire
que Rogers soutient leur tension dans un défi incessant dont nous nous
proposons d’analyser la structure signifiante.
Des conditions attitudinelles nécessaires et suffisantes
La première forme de ce défi est
l’affirmation délibérée et réitérée, qu’il est parfaitement possible et
licite de formuler des « conditions nécessaires et suffisantes », en vue
de structurer un climat de relation libératoire pour l’individu.
« J’ai été assez téméraire pour tenter de définir les conditions
psychologiques qui délivrent une telle croissance personnelle et
thérapeutique dans l’individu. Je ne suis pas du tout certain de les
avoir définies correctement, mais je me sens sûr que de telles
conditions sont définissables, et seront avec le temps empiriquement
déterminées ».
Il a, pour sa part, essayé de
répondre à ce défi, en explicitant, non pas des énonciations compliquées
et ésotériques, et non plus des références à des herméneutiques ou des
techniques sophistiquées, mais des conceptsrepères, opératoires et
cependant non modélisants. Ces concepts sont construits de façon à être
susceptibles d’une extension très large (et donc d’application à
des domaines de relation éloignés de la thérapie) : ils sont néanmoins
de compréhension très fine, associant à la fois des références
rationnelles et des implications affectives. Dans leur concentration
extrême, ces concepts, ces « conditions », répondent à la règle que
Descartes énonçait pour la « direction de l’esprit » : « Si nous
comprenons parfaitement une question, il faut l’abstraire de tout
concept superflu, la simplifier le plus possible et la diviser au moyen
de l’énumération en des parties aussi petites que possible ».
Dans un premier essai, Rogers
proposait, en 1957, six conditions structurelles : allant de la « mise
en contact » du client avec le thérapeute, de la « vulnérabilité » du
client à la « congruence » du thérapeute, du « respect inconditionnel »
exercé par le thérapeute visàvis du client jusqu’à une « compréhension
empathique » du cadre de référence interne du client, enfin à une
« communication au client de la compréhension empathique et du respect
inconditionnel » ressentis par le thérapeute relativement au client.
« Aucune autre condition n’est nécessaire. Il suffit que ces six
conditions soient réalisées et maintenues pendant un certain laps de
temps pour qu’un changement constructif de la personnalité s’ensuive ».
Dans un schéma ultérieur repris en
1965, Rogers réduit à trois les conditions à réunir en soulignant pour
chacune un concept dense, établi dans la subjectivité du thérapeute,
vivant la phénoménologie de sa relation au client : la « congruence »,
le « regard positif inconditionnel » porté sur le client, enfin
l’« empathie » ou « la compréhension empathique » (empathic
understanding) du client par le thérapeute.
Qu’on ne se méprenne pas, ces
conditions construites pour aider le client ne désignent pas des
dispositions innées, gratuites et instantanées propres au thérapeute, ni
même des aptitudes exercées et acquises. Ce ne sont pas non plus des
modalités techniques organisées, instruisant des habiletés en vue de se
situer placidement face à autrui, et de l’aider à se révéler (par
exemple, grâce à une adresse pour interpréter les rêves ou pour
décrypter les symboles des mots ou des gestes), ou même afin de lui
apporter la réverbération des sentiments qu’il manifeste (la technique
du « miroir », de la réponsereflet, mise en évidence cependant par
l’école de Rogers).
Ce ne sont pas, enfin, des règles méthodologiques, extérieures,
structurant par réduction et obligation (comme la loi de nonomission et
la loi d’abstinence en psychanalyse) la relation de thérapie.
Ce sont plutôt des conditions
attitudinelles dont l’évocation peut donner des repères pour
mesurer les mouvements affectifs et émotionnels que le thérapeute doit
vivre de façon organismique, mais en observant leur surgissement
progressif face à autrui, et en raison de lui, afin de les optimiser en
termes d’« indications » libres de situation et de mouvement.
Toutefois, ces trois conditions
ont habituellement été déclarées « nécessaires et suffisantes » pour
assurer une thérapie, quelles que soient les références théoriques et
les pratiques des thérapeutes. Un débat à ce sujet (nécessaires ?
suffisantes ?) s’est instauré chez les psychothérapeutes centrés sur la
personne. Quoi qu’il en soit, ces conditions, ces indications
intériorisées, vécues existentiellement, de façon croissante ou
renouvelée, ne sont pas disjointes. Car la texture de leur rapport
réciproque contient un développement dynamique, une dialectique que nous
allons essayer de décrire.
Réalisme et congruence (Realness, Congruence,
or Authenticity Genuineness)
Le
thérapeute (ou l’individu facilitateur d’un approfondissement des
relations humaines) a pour objet de créer, à l’avantage d’autrui, un
environnement nourricier spécifique ; il se soucie d’établir une
médiation qui soutienne une croissance directionnelle chez l’autre, chez
le client.
Le premier mouvement de cette
démarche orientée vers l’autre, « la plus basique des trois conditions »,
est, pour Rogers, un retour paradoxal vers soimême, un mouvement de
présenciation à soi au cœur même de sa solitude. Il s’agit de se
« vérifier », de se mettre en mesure d’être vrai, réel (real), de
sonder ses sentiments, ses idées et d’assumer ses valeurs, telles
qu’elles sont : avant l’entretien avec le client, mais aussi au début,
sur toute la durée et à la fin de cet entretien. Il s’agit de savoir
« être la complexité de ses sentiments, sans crainte ».
Le thérapeute (le facilitateur) se
place « à son aise », en quelque sorte, avec luimême, et tout luimême,
en état de disponibilité, en contact potentiel avec toutes ses régions
d’« accessibilité ». Comme le notait Max Pagès, cette attitude « n’est
pas une ascèse, une inhibition de soi, elle est au contraire une
acceptation de soi, mieux, une “affection de soi”, un plaisir d’être soi
et nous ajoutons aussi le courage d’être soi ».
Il s’agit de prendre appui, référence, sur soi, et de se disposer à être
tout simplement naturel (genuine) dans la relation à l’autre,
simple et pourtant prêt à suivre toute la subtilité des évolutions de
sentiments et d’idées que l’expérience, naissante et fraîche, au contact
de l’autre, va mettre en marche.
Cette unité fluide de l’être en
relation, cette simplicité de la présence à soi devant autrui sans
distraction et sans masque (sans « façade » ni « rôle » ni
« prétention »),
ne s’entendent pas de façon statique, ou dans la facilité. Si ce n’est
pas une ascèse, ou une préoccupation soucieuse, ce n’est cependant pas
non plus un état béat, convenu et conventionnel, qui friserait
rapidement la tartufferie, c’est au contraire un courage consenti et
entretenu dans une attitude — Gestalt — maîtrisant des
contradictions par une souplesse d’évolution. C’est une concentration à
tout soimême, cependant détendue (autre forme de paradoxe), régulée par
la mobilité du flux des informations intellectuelles et émotionnelles
circulant « indifféremment » dans l’organisme et la pensée.
Cet ajustement dynamique et stable
concerne, chez le thérapeute (ou dans l’opération de relation), ce que
Rogers a appelé la « congruence ». Cette attitude, cette condition
structurale, désigne une fluidité consentie et ressentie dans l’être
soi, canalisé et disponible. Il est utile qu’elle soit soutenue et
mesurée tout au cours de la relation, dans l’effort immédiat. Rogers ne
cède d’ailleurs pas au perfectionnisme qu’il déjoue toujours : il ne
suppose pas que la congruence d’un individu puisse être constante ni
parfaite. « La plupart du temps, reconnaîtil, bien entendu, moimême,
comme tout un chacun, je manifeste un certain degré d’incongruence ».
L’attitude visant la congruence optimale est donc une recherche, liée
patiemment, avec des tâtonnements, à toute la maturation laborieuse de
l’individu : « Le thérapeute qui essaie d’utiliser cette approche
apprend vite que le développement de la manière de voir les gens qui
sousentend cette thérapie est un processus continu, étroitement relié au
propre combat du thérapeute pour sa croissance personnelle et son
intégration ».
Le thérapeute est stimulé dans sa
conduite par l’incitation du concept : mieux il pourra établir et
maintenir suffisamment dans une relation de congruence de luimême (cette
homogénéisation des accessibilités du soi, rétablie comme avant la
« scène primitive »), et davantage celleci aura, comme l’expérimentation
le prouve, pour le client, pour l’interlocuteur, un effet probable sur
sa propre restauration. Mais il peut vérifier, à tout moment, si cette
incitation est équilibrée à son orientation ou si, en la privilégiant
par zèle ou par force, il ne se crispe pas sur elle, ce qui serait
contradictoire. Il se situe donc par rapport à la congruence dans un
mouvement de clarification continue, par maintien d’un équilibre
« indifférent ».
On comprendra sans doute mieux
l’opération complexe de clarification que vise le terme de congruence en
regardant Rogers décrire, de manière vivante, la problématique selon
laquelle il se prépare au seuil d’un entretien thérapeutique (dans le
film avec la jeune américaine dont le prénom est Gloria et dont nous
avons déjà parlé).
« Avant toute chose, la question
est de savoir si je puis être “réel” dans ce rapport ? Ceci m’a semblé
de plus en plus important au fur et à mesure que passaient les années.
Je pense que cette qualité que j’aimerais posséder pourrait aussi s’appeler
“authenticité”. J’aime bien également le terme “congruent”, par lequel
j’exprime que ce que je ressens en moi est présent dans ma conscience et
réapparaît dans ce que je communique. Dans un sens, lorsque je possède
cette qualité, je me sens tout entier dans le rapport. Il y a un autre
mot qui peut décrire ceci pour moi. J’ai l’impression que dans le
rapport, j’aimerais avoir une “transparence”. Je serais tout à fait
disposé à ce que la cliente voie à travers moi, qu’il n’y ait rien de
caché. Et lorsque je suis authentique de cette façon que j’essaie de
décrire, alors je sais que mes propres sentiments surgiront sous forme
consciente et pourront s’exprimer, mais s’exprimer de manière à ne pas
s’imposer à ma cliente ».
Sous la bonhomie du propos, sous
son langage direct, la thèse initiale et basique d’aise, de cohérence,
est éclairée : la congruence se fonde sur la fluidité organismique,
organisée dans la conscience, mais aussi sur la transparence qui fait
antithétiquement réapparaître cette unification dans la
communication à l’autre. Le terme « congruence » désigne donc
simultanément « l’accord de l’expérience, de la conscience et de la
communication ».
Congruence et transparence
Une attitude congruente, une
authenticité vécue dans l’accueil de soi et d’autrui ne peuvent pas, en
effet, se maintenir dans l’organisme si elles ne sont pas présentes dans
la transaction à l’environnement : elles doivent être perceptibles
expérientiellement à l’autre. Mais Rogers délimite soigneusement la
nature de leur explicitation régulée : une « transparence » tranquille.
D’un côté, ce qui est vécu par le
thérapeute, le facilitateur de croissance, ne peut être exprimé ou caché
face à l’interlocuteur de façon systématique, mais d’un autre côté,
« cela ne signifie pas que le thérapeute encombre (burden) son
client avec l’expression ouverte de ses sentiments ».
Ce qui revient à dire que les sentiments sont présentés à autrui
quand ils affleurent naturellement, germinativement, sans irruption
impulsive, sans surcharge, sans aspect réactionnel.
Le seul critère, par suite, de la
verbalisation ou expression volontaire par le thérapeute, est non
l’aspect agréable ou désagréable du sentiment dominant qu’il ressent à
l’égard du client, mais la « persistance », la stabilisation manifeste
de ce sentiment dans la suite des oscillations affectives vécues dans la
relation.
Il y a là une honnêteté et un
discernement difficiles à observer, note Rogers. Car le courant des
sentiments et des idées est très complexe et en continuel changement.
« Si je ressens que je suis ennuyé (bored) par un client et que
ce sentiment (feeling) persiste, je pense que je dois, à lui et à
notre relation, de le partager. Ce serait la même chose si mon sentiment
était la crainte, ou si mon attention était tellement absorbée par mes
propres problèmes que je lui serais à peine attentif ».
Mais dire son ennui ne revient pas à dire que le client est ennuyeux ;
et cela ne peut s’exclure du contexte changeant qui doit aussi être
communiqué : la détresse de se sentir ennuyé, l’inconfort de s’en ouvrir
et en même temps la bascule de l’ennui dans une ardeur d’attente, dans
une appréhension de sa réponse. Car ce qui est dit n’est déjà plus vécu
exactement et fait apparaître son contraire, son antagoniste (faisant
réapparaître un « équilibre indifférent »).
Dans son livre Les groupes de
rencontre, Rogers raconte le mot d’un collègue disant de lui qu’il
« pèle son propre oignon », en explicitant continuellement des couches
de plus en plus profondes de sentiments dont il devient conscient dans
un groupe. Et il s’explique encore davantage sur ce point de verbaliser
les sentiments persistants dont il fait l’expérience à l’égard d’un
individu ou d’un groupe, dans une relation signifiante et continue.
(Il n’est pas question, notetil, de sentiments qui apparaîtront au début
d’une relation individuelle ou de groupe.) Et Rogers évoque une
discussion avec des animateurs de groupe : « Un facilitateur dit : “J’ai
essayé de suivre un onzième commandement, tu exprimeras toujours les
sentiments que tu ressens”. Un autre rétorqua : “savezvous comment je
réagis à cela ? C’est que nous devons toujours avoir le choix.
Quelquefois je choisis d’exprimer mes sentiments ; à d’autres moments,
je choisis de ne pas le faire” ».
Rogers commente alors : « Je me
trouve moimême beaucoup plus en accord avec la seconde déclaration. Si
on peut seulement être conscient de toute la complexité de ses
sentiments à un moment donné, si on peut être attentif à soimême
adéquatement ; alors il est possible de choisir d’exprimer les attitudes
qui sont fortes et persistantes, ou de ne pas les exprimer à ce moment,
si cela semble hautement inapproprié ».
Congruence et réserve
La signification de la transparence
des sentiments et du critère de persistance qui lui est conjugué,
d’unité « gestaltique » qui est perceptible, apparaît dans la stabilité
des oscillations affectives. Ce vécu d’une prise en considération
adéquate de soi se mesure alors par l’intensité de la liberté du choix
ressentie pour l’expression. Le signe de l’« équilibre indifférent »
retrouvé est comme un feu vert, ou mieux, comme un clignotant, pour
s’avancer dans le « dit » ou rester provisoirement dans le « non dit ».
Mais cette liberté prudentielle ne
peut aucunement être interprétée comme une réserve méfiante, comme le
produit d’un contrôle négatif et triste sur la spontanéité créatrice du
thérapeute (du facilitateur). « Je fais confiance (trust) dans
les sentiments, les mots, les impulsions, les fantaisies qui émergent en
moi. De cette manière, j’utilise plus que mon moi conscient, tirant sur
quelquesunes des capacités de mon organisme tout entier ».
Et Rogers montre comment les fantaisies mêmes ont avantage à être
exprimées (par exemple la vision de l’enfant craintif qu’il a été dans
un homme d’affaires impérieux et le souhait de voir ce « cadet » (youngster)
aimé et chéri par cet homme) et combien elles peuvent apporter de
surprenantes profondeurs d’évolution et de prises de consciences. Et il
reconnaît aussi qu’il répond sans détour si on lui pose une question, du
moins s’il ressent organismiquement qu’il n’y a pas d’autre contenu dans
le message que la question posée, ce qui n’est pas toujours le cas.
Dans le même temps où il explicite
ces libertés de congruence, Rogers se heurte à nouveau aux difficultés
qui restreignent l’énoncé des sentiments quels qu’ils soient. Il y a des
risques, constatetil, notamment dans un groupe, pour des sentiments
chaleureux, explicités, avoués, à l’égard de quelquesuns, et qui peuvent
bloquer, chez d’autres, la formulation de sentiments négatifs et de
colère, surtout en fin de relation. Et Rogers confie, d’autre part,
qu’il a de la difficulté à être luimême facilement, rapidement,
conscient de ses sentiments agressifs et qu’il le déplore, tout en
essayant de progresser sur ce point.
C’est que l’invitation à la
congruence, à la transparence bute sur sa limite dialectique : être
congruent dans une relation, soit, mais pour quoi faire ? Si le
thérapeute (le facilitateur, l’« aidant »), se recentre sur luimême dans
une relation, ce n’est pas pour un repli ou une satisfaction
narcissique. Ce ne saurait être, non plus, pour imposer sans
réplique ses sentiments et ses évaluations (plus ou moins directement) à
autrui. Ce ne saurait être pour se laisser ballotter par la réaction
incessante et inconsidérée aux sentiments et aux attitudes explicitées
par le client. Tout cela reviendrait à se laisser déplacer d’un
fonctionnement optimal de sa subjectivité dans l’expérience et à
démentir le projet de thérapie, de relation, centrées sur le client. La
situation du thérapeute visàvis du client doit donc être établie par la
négation d’une présenciation immodérée à luimême (qui perdrait, sinon,
sa relativité). Car il ne s’établit si commodément, si posément en
luimême (sur sa superficie totale d’être sensible, de « radar ») que
pour porter une attention profonde et ingénue à autrui en tant que
personne ayant des potentialités humaines de développement et d’apport
(ou de support) à soimême.
La considération positive inconditionnelle (Unconditional
Positive Regard)
Le thérapeute (le facilitateur),
appuyé sur luimême, « se centre sur le client ». Ceci revient à dire que
l’attention qu’il se porte est contrariée, niée dynamiquement,
par l’attention qu’il prête à autrui. Il importe qu’il se distancie
suffisamment de luimême pour prendre soin (caring) de l’autre,
sans projeter d’ombre portée sur son expression.
« J’écoute aussi soigneusement,
attentivement et sensiblement que j’en suis capable, chaque personne qui
s’exprime ellemême. Que le message (utterance) soit superficiel
ou signifiant, j’écoute. Pour moi, l’individu qui parle est plein de
valeur (worthwhile), digne d’être compris, en conséquence il est
plein de valeur pour avoir exprimé quelque chose. Des collègues disent
qu’en ce sens, je “valide” la personne ».
L’autre est validement autre, tel
qu’il est, comme il lui plaît d’apparaître provisoirement, et comme il
lui plaira de devenir. Il est pris en compte d’un seul bloc : le
thérapeute ne sépare rien de lui ; il ne risque aucune dissociation sur
l’être de cet interlocuteur ; il ne se laisse aller à privilégier aucun
des éléments de comportement, immédiats ou possibles, en fonction de ses
goûts à lui, ou même de ses impressions. C’est dire qu’il nie en lui
incessamment les tendances évaluatives qui proviendraient du
retentissement de ses valeurs sur les pensées, les sentiments ou la
conduite de l’autre. Il accueille en vérifiant en lui qu’il ne se met ni
à approuver ni à désapprouver, c’estàdire qu’il ne met aucune réaction
pour défendre ses choix à lui et ses valeurs par rapport au comportement
ou aux propos de l’autre. Il situe l’autre là où il entend se situer.
Il le constate dans sa distance
irréductible. Il lui porte, à cette distance, un « regard positif
inconditionnel ». Il l’accompagne « inconditionnellement », sans
inertie, et donc sans prévention ni défensive, sans pression ni
éloignement, dans sa démarche existentielle (comme une figure parentale
le faisait à l’enfant, avant la « scène primitive » de la « brouille »).
Il s’établit en « équilibre indifférent » à l’égard de toutes les
directions d’avenir qui semblent se présenter à son client : « Estce que
le thérapeute veut vraiment donner au client pleine liberté pour ses
issues ? Veutil sincèrement que le client organise et dirige sa vie ?
Veutil lui laisser le choix de buts sociaux ou antisociaux, moraux ou
immoraux ? Ou même, en plus difficile, veutil que le client puisse
choisir la régression plutôt que la croissance et la maturité ? Puisse
choisir la névrose plutôt que la santé mentale ? Puisse choisir de
rejeter l’aide plutôt que de l’accepter ? Puisse choisir la mort plutôt
que la vie ? Il m’apparaît que c’est seulement si le thérapeute désire
complètement que n’importe quelle issue, n’importe quelle direction
puisse être choisie, qu’il réalise le courant vital de la capacité et de
la potentialité de l’individu pour une action constructive ».
Mais cette prise en considération
inconditionnelle estelle une bascule dans une distanciation de froideur
ou de scepticisme ? Que non pas ! La constatation de l’autre est faite
dans un regard concentrique, chaleureux, valorisant, raffermissant sa
« figure » par rapport au « fond », écoutant sa « note tonique » ; il
n’est pas question d’une vue rejective, éloignant, effaçant le client
sur le « fond », et encore moins d’une vision fascinatrice et
possessive. Le terme « inconditionnel » ne connote pas « indifférent »
(au sens affectif), et non plus dominé ou dominateur ; il renvoie plutôt
à « totalement sensible », en attente de tous les possibles.
La personnalité du client, en fait
et en puissance, est respectée : elle est « confirmée » comme
autre, et soimême comme autre que lui, dans une recherche progressive de
la relation jetu, décrite par Martin Buber. La prise en considération est
simultanément (ou dialectiquement) inconditionnelle et positive : sa
positivité se mesure dans l’interaction, ou le dégagement d’une chaleur
d’accueil (a warm acceptance).
Le thérapeute (le facilitateur)
prise donc, estime le client d’une manière totalisante et globale, sans
établir de hiérarchie dans ce qu’il découvre en celuici. Il constate
tous les éléments de l’expérience du client comme des parts de son unité
en croissance. S’il ressent une restriction à son accueil, il explore
celleci par rapport à sa congruence pour discerner l’indication
corrective de son attitude qui lui permettra de retrouver l’« équilibre
indifférent » ; mais il ne projette pas cette restriction ressentie dans
un jugement qu’il opposerait à l’autre, pour raidir, à son avantage
apparent, la distanciation souple. Il se met, au contraire, en mesure de
recevoir de l’autre aussi bien l’expression de sentiments douloureux,
hostiles, défensifs ou anormaux que celle de bons sentiments, positifs
et mûris.
« Pour nous thérapeutes, note
Rogers, à l’occasion (incidentaly), il peut être plus facile
d’accepter les sentiments douloureux et négatifs que les sentiments
positifs et de confiance (self confident) qui parfois ressortent.
Nous regardons presque automatiquement ces derniers comme défensifs.
Mais le regard positif inconditionnel enveloppe une volonté de partager
également la confiance du patient et sa joie, ou sa dépression et ses
échecs (failure). C’est une sollicitude non possessive (unpossessive
caring) du client, en tant que personne séparée, qui permet à
celuici d’avoir à lui ses propres sentiments et sa propre expérience ».
Considération et sollicitude
Cette sollicitude, quand elle est
manifestée au client, entretient un contexte non menaçant (nonthreatening)
dans lequel celuici peut faire l’expérience des éléments les plus
profondément enfouis de son moi intérieur. Mais il ne s’agit pas
d’imaginer cette sollicitude comme établissant une protection, ou
offrant une commisération ou même de l’agrément facile. Rogers le marque
énergiquement : « Le thérapeute n’est ni paternaliste, ni sentimental,
ni superficiellement social et agréable ».
En cela, Rogers se sépare de
pratiques aussi bien trop affectives que trop intellectuelles, ou
instruites avec des impératifs. Du côté affectif, Max Pagès a noté que
« l’attention positive inconditionnelle est, si l’on veut, un amour,
mais un amour non ambivalent, différent de toutes les formes d’amourfuite
que recouvre habituellement le terme. C’est une sorte d’affection
désespérée et lucide qui lie deux êtres séparés ».
On peut remarquer, d’autre part, la différence entre la conception du
« regard positif inconditionnel » et les expressions freudiennes de
« neutralité bienveillante » et d’« attention flottante ». Cellesci
supposent une supériorité établie (bienveillance, attention) et elles
structurent délibérément une situation paternelle du thérapeute
(réaffirmée par la position de celuici derrière le divan, par la visée
insistante du transfert sur lui des sentiments infantiles enfouis et par
l’injonction de « nonomission » faite au patient). Les notions de
fantasmes et d’inconscient, constamment alléguées dans la perspective
psychanalytique, réassurent également cette supériorité, car, comme le
remarque Laing, l’analyste « déduit quelque chose concernant l’autre et
que ce quelque chose, l’autre l’ignore. Ce qui semble signifier qu’il
existe toute une catégorie d’expériences ainsi qu’un “contenu”
spécifique de l’expérience dont l’autre, qui “possède l’expérience en
question ne sait rien ou ne peut rien savoir” ».
Pour Rogers, au contraire, le
regard positif inconditionnel est à établir suivant un mouvement
d’égalité vécue dans la relation (on a souvent parlé de thérapie
fraternelle à son sujet) : il lui importe de n’aller à aucune prise de
possession ou de pouvoir sur l’autre, de n’introduire aucune
dénivellation entre l’importance de l’autre et l’importance de luimême,
pas plus qu’il n’introduit de préférence entre l’intellectuel et
l’affectif, en lui et dans l’autre, entre les expressions ou tendances
positives ou négatives. C’est une dynamique d’équivalorisation, sans
crispation, sans réserve davantage pour quoi que ce soit ou quiconque,
par le fait même, ce n’est aucunement, entre les partenaires, une
identification réductrice, puisque toute différence est accueillie,
constatée sans être utilisée pour privilégier un élément ou se défendre
de lui.
Considération et négativité
C’est une phénoménologie de
l’estime, comme le dessine Rogers, préalablement à son entretien avec
Gloria : « La seconde question que j’aimerais me poser est la suivante :
estce que j’estimerai cette personne, estce qu’elle comptera pour moi ?
Je ne veux surtout pas simuler l’intérêt que je ne ressens pas. En fait,
si ma cliente me déplaît avec insistance, j’ai l’impression qu’il vaut
mieux que je le dise. Mais je sais que le processus de la thérapie ainsi
qu’un changement constructif se produiront plus sûrement si je ressens
une véritable “estime” spontanée pour cet individu avec lequel je
travaille, une estime de cette personne en tant qu’individu séparé. Vous
pouvez appeler cette qualité “acceptation”, vous pouvez l’appelez
“intérêt”, vous pouvez, si vous le désirez, l’appeler de l’“amour non
possessif”. Je crois que n’importe lequel de ces termes la décrit assez
bien. Je sais que le rapport se révélera plus constructif si elle
existe ».
Le client, l’interlocuteur, est, si
cela est possible, accueilli dans son être réel et distinct : à égalité,
quoi qu’il soit autre et parce qu’il est autre ; car il n’y a pas de
comparaison ni d’interprétation à faire, ce qui facilite les choses.
Il est mis en dialogue de plainpied, avec une personne qui ne pose pas
au supérieur. Celuici ne masque donc pas son « imperfection » à
atteindre éventuellement la positivité et l’inconditionnalité dans son
projet de considération : au cas où le décrochement serait trop fort, il
expliciterait même son échec, dûtil avouer sa détresse, son impuissance.
Ce serait constater que la négation exercée par le regard positif
inconditionnel sur la congruence serait devenue excessive, et que seul
le retour à la congruence permettrait de faire repartir la dialectique.
Car le retour vers soi dans l’échec, dans la nonréussite, restaure la
proximité du client, placé dans ses difficultés ; elle réinstitue
l’égalité. La présenciation à soi retrouvée appelle à nouveau une
distanciation grâce à l’autre, dont la réponse à la situation est
appréhendée, pardelà la séparation reconnue : « Je suis de loin plus
capable d’entendre la surprise, ou peutêtre la blessure, dans sa voix,
maintenant qu’il se trouve luimême parler plus ingénument parce que j’ai
osé être réel avec lui ».
Et Rogers ajoute, à cette notation
d’un rapprochement dans l’impuissance, une observation qui vient encore
diminuer ce que pourrait avoir de dogmatique l’observance d’une
inconditionnalité radicale dans la considération du client. Les travaux
avec les schizophrènes ont fait apparaître que, pour des individus très
immatures ou à forte régression, « un regard conditionnel peut
être plus efficace ».
Car il apporte dans ce cas une sécurisation plus opportune, une
perception de « meilleur parent ». Cependant le regard inconditionnel
s’avère plus efficient pour « l’achèvement de la pleine maturité ».
Comme on le voit, le regard positif
inconditionnel ne peut donc être un critère suffisant en luimême, par
rapport à la congruence. Non seulement son exigence pourrait être
excessive, mal supportée par l’individu, mais elle peut être
mystificatrice comme le remarque Laing : « On fait semblant d’accepter
l’autre “comme il est”, mais c’est au moment où l’on croit le plus qu’on
est en train de le faire que, justement, on traite l’autre davantage
comme un fantôme incarné, “comme si” elle ou lui était à la fois une
autre personne et une propriété personnelle. Selon l’expression de
Winnicott (1958), l’autre est traité comme un “objet transitionnel”.
C’est, là encore, un fauxsemblant ».
Or, l’autre ne peut être traité
comme objet transitionnel. Il ne peut être seulement vécu dans sa
distanciation, comme autre. Il doit être découvert dans son intériorité
aussi délicatement, aussi subtilement que cela est possible. C’estàdire
que la prise en « considération positive inconditionnelle », globale et
teintée d’extériorité, doit ellemême être niée dans son mouvement
négateur de la congruence par une compréhension de l’intérieur du
client et par une présenciation à lui. Et c’est le mouvement même de
« l’empathie ».
L’empathie (Accurate Empathic Understanding)
Même s’il sauvegarde la distance de
l’autre par rapport à sa congruence propre, le thérapeute (le
facilitateur) rejoint, dans une proximité subtile, l’expérience de son
interlocuteur. Il se livre à un rapprochement délicat, sans pression sur
le temps, sans accélération des mouvements, pour percevoir les
configurations des sentiments et des perceptions de l’autre, et pour
comprendre les arabesques et les mélodies (avec les dissonances), les
significations successives qu’elles ont, moment par moment, pour lui,
dans un vécu de « champ ». Il s’approche assez près pour être « complè
tement chez lui dans l’univers du client »,
dans son présent immédiat, là où il est, tel qu’il est, selon son cadre
propre de référence : il ne cherche donc aucunement à précéder le
client dans la germination des signifiés qui lui apparaissent ; il
ne le pousse vers aucun raccord à du passé ni vers aucune anticipation
d’avenir ; il règle donc son attitude sur la mesure de sa coïncidence au
vécu explicité par le client, maîtrisant ses propres tentations
d’interpréter par référence à un nondit ou à un nonprésent. Comme un
agronome ne précède pas les saisons, ou comme un acteur, qui se met
vitalement en rythme avec les autres protagonistes d’une action
dramatique, ainsi que l’observe JeanLouis Barrault.
Cette compréhension de l’intérieur
« est une façon de sentir le monde intérieur du client et ses
significations intimes comme s’il était le nôtre, quoique en n’oubliant
jamais que ce n’est pas le nôtre ».
Là où le regard inconditionnel introduisait une différence, sans commune
mesure, et une distance dans le contact, l’empathie ajoute une
similitude ou une assimilation assez poussées, et une immédiateté
réflexive mais sans fusion, une altération vécue et réverbérante mais
sans aliénation réciproque. Le « comme si » est en effet capital. Il
assure la spécificité de la personne du thérapeute, et la singularité de
sa place dans la relation, même si cette place n’est pas en surplomb du
client et ne se relie à aucune supériorité. Le « chez soi », dans lequel
il se glisse, le monde de sentiments et d’idées ou d’apparences dans
lequel il s’introduit, n’est pas le sien. Il ne prend pas la place du
client, il ne le guide pas, il ne se laisser aller à aucune
identification ou fusion à l’autre. Cela signifie qu’il maîtrise son
propre cadre de référence à lui (qu’il le met « entre parenthèses » pour
reprendre la formule de Husserl, « l’époché »), pour se situer aussi
exactement que possible (en coïncidence aussi différenciée que possible)
dans le référentiel de l’autre, mais sans s’y perdre.
Empathie et différence
La pointe du paradoxe est ici la
plus acérée : être presque l’autre sans être l’autre et sans cesser
d’être soimême. La distanciation est niée, elle est presque annulée, et
pourtant, si minime soitelle, la distance, la différence (suprêmement
qualitative), demeurent, irréductibles, fondamentales. Cette différence
aide à l’exploration des différences dans le client. Au surplus, autre
aspect du paradoxe, s’il ne « se perd » pas dans le référentiel du
client, il importe pourtant que le thérapeute aille profondément et
qu’il ne s’en tienne pas au plus évident ou au plus facile, ce qui
reviendrait à se défendre et à établir une distance falsificatrice. Il
va au plus exact, au plus subtil. Et pourtant, ne courtil pas le risque
de glisser à des interprétations et à des curiosités ou des
anticipations ? Comme Rogers l’exprime avant de rencontrer Gloria, il y
va d’une efficience thérapeutique : « Ensuite, la troisième qualité :
seraije capable de comprendre de l’intérieur, le monde extérieur de
cette personne ? Seraije capable de le voir à travers ses yeux ? Seraije
capable d’être assez sensible pour évoluer à l’intérieur du monde de ses
sentiments, pour savoir comment l’on se sent si l’on est elle, afin de
pouvoir ressentir non seulement les significations superficielles, mais
quelquesunes des significations plus profondes ? Je sais que si je peux
entrer dans son monde d’expériences d’une manière plus sensible et plus
fidèle, le mouvement thérapeutique et le changement seront beaucoup plus
probables ».
On conçoit que, même s’il maîtrise
avec habileté les risques d’erreur et d’abus (en fait les risques
d’impatience), pardelà tous les pièges du langage et de l’expression,
dans cette « odyssée » de la relation, le thérapeute aborde, par
l’empathie, une activité qui pourrait être dangereuse pour luimême comme
Rogers s’en aperçut, on le sait, en 1948. Il a pu écrire plus tard :
« Je suis reconnaissant au Dr Don Hayakawa, sémantiste, d’avoir souligné
le risque très réel et le courage qu’il faut pour conduire une
psychothérapie de cette façon. En comprenant une autre personne de cette
manière, en pénétrant dans son monde privé et en percevant sa manière de
voir la vie, tout en se défendant d’émettre des jugements de valeur à
son égard, on court le risque d’être transformé soimême. On risque
d’adopter son point de vue, d’être influencé dans ses attitudes, sa
personnalité. Ce risque d’être changé est une des perspectives les plus
effrayantes que l’on puisse rencontrer. Si je pénètre dans toute la
mesure dont je suis capable dans le monde privé d’un névrosé, ou d’un
psychotique, estce que je ne cours pas le risque de m’y perdre ? La
plupart d’entre nous ont peur de courir ce risque. Ou encore si un
orateur communiste russe était ici ce soir, ou bien le sénateur Joe Mac
Carthy, combien d’entre nous oseraient essayer de voir le monde de leurs
points de vue ? La grande majorité d’entre nous serait incapable
d’écouter ; nous nous apercevrions que nous sommes forcés d’évaluer,
parce qu’écouter semblerait trop dangereux. Donc, la première condition
est le courage et il nous fait souvent défaut ».
Le risque, ici comme ailleurs, est
payant. Le courage, dans la relation, engrené sur la congruence et le
regard positif inconditionnel, confirme l’autre et soi. Un vécu,
affronté par le client, est débarrassé du caractère vertigineux,
inflammatoire, qui, comme dans le « stress », peut le rendre dangereux.
On sait, en effet, la conception profonde du stress et du
« syndrome général d’adaptation » que Selye a dégagée de ses travaux
expérimentaux ;
ce dernier est une réponse non spécifique, globalisée, qui peut devenir
excessive en forme de coup de bélier, à une excitation qui, au lieu
d’être localisée et située dans ses limites, est perçue dans des
conditions « non spécifiques » et par suite mobilise dangereusement, de
façon panique, la totalité des réponses de l’organisme, qui se
bousculent en désordre, dans une réaction convulsive, crispée et donc
non régulable. La difficulté, l’excitation, localisée au contraire, ne
requiert qu’une réponse adaptée, dont le retentissement est maîtrisable,
et le coût supportable. Mais l’équivalent psychologique de la
« cortisone », de la médiation antiinflammatoire pour un client, c’est
l’aide de la spécification apportée par le thérapeute : dans la mesure
où ce que celuici sent exactement dans le courant immédiat des
sentiments du client (par l’attention aux formes verbales, aux
inflexions de voix, aux sautes d’expression, aux mimiques ou aux
contradictions corporelles explicitées) est retransmis, réverbéré par
lui, en phrase, « dans un langage accordé (attuned) au client ».
Empathie et expression
L’empathie, la « compréhension
empathique exacte » (Accurate Empathic Understanding), ne se
réduit pas, en effet, à une intuition sensible et spécifiée du monde
intérieur d’un interlocuteur, elle ne reste pas absorbée ou stockée en
silence, mais elle est répercutée sans délai ni hâte, et sans
accentuation autre que celle de son relief naturel.
On sait l’usage très fréquent, en
thérapie centrée sur le client, du comportement en « miroir », ou en
« écho » plus léger, avec des modalités multiples et raffinées, que
Rogers et son émule Porter ont qualifiées de « compréhension ». Il
s’agit, non pas d’une réaction de sympathie, de conseil ou d’appui, ni
même de questionnement, encore moins d’un automatisme de renvoi, mais
d’une reformulation appliquée et chaude des configurations, des
Gestalt, telles qu’elles semblent émerger, instant par instant, de
la personnalité du client en recherche.
Dans ces réverbérations, le
thérapeute se garde, autant qu’il peut, des coups de pouce qu’il
pourrait être tenté de donner, mais éventuellement il rectifie, par
tâtonnements son expression, afin de se mettre au plus près de ce qui
survient, de ce qui « naît », dans l’expérience du client.
Au cœur de l’empathie, la
nondirectivité intervient opératoirement dans l’action du thérapeute :
il se centre sur des activités réverbérantes qui informent le client sur
sa propre activité structurante, sur son autoédification de formes
mentales et expérientielles, mais sans se laisser aller, lui thérapeute,
à participer directement à ces structurations. Comme l’analyse Max Pagès :
« D’une part, nonstructuration, ou plus précisément, nonintervention
directe au niveau des structures, ou encore nonsubstitution au client
dans son activité structurante. Et en contrepartie positive :
intervention en vue de l’information du client luimême ; d’autre part,
nondirectivité de ce processus d’information. Positivement :
facilitation d’un processus spontané de communication du client avec
luimême ».
On notera les aspects dialectiques dénotés par Max Pagès dans les
activités de réverbération. Il faudrait y ajouter un autre temps de
négation, ces nonstructurations et nondirectivités étant niées
ellesmêmes par un souci d’éviter tout systématisme (comme certains
débutants ont tendance à le faire) et en vue d’échapper à tout
conformisme réducteur de l’aisance d’être du thérapeute, toute
platitude.
Si ces précautions sont assurées,
des chances de fonctionnement souple apparaissent chez le client. Alors
que des attitudes extérieures et évaluatrices tendent à fixer son être
sur luimême en tant qu’objet (ou sur des rationalisations qui le
retranchent d’un contact fluide, avec l’expérience qui le pénètre (the
experiency going on within him),
la compréhension empathique, aiguë et spécifiante, habilement et
sensiblement communiquée, « semble crucialement importante pour rendre
le client plus libre d’éprouver ses sentiments internes, ses
perceptions, et ses significations personnelles ». Par l’accueil
vérifiable que le thérapeute fait aux explicitations progressives du
client, par leur verbalisation sans amplification ni réduction, celuici
est préservé des aspects vertigineux qu’il est porté à établir, en
comportement inflammatoire, avec des éléments de luimême enfouis et
insuffisamment spécifiés ; il peut mesurer qu’il ne s’agit pas, en ce
qu’il approche de lui, d’un insondable, ni d’une chute dans le vide ou
le néant, mais d’éléments délimitables, par rapport auxquels des
perceptions organismiques et des mesures éventuellement correctives sont
possibles. Il peut reconnaître, de luimême, parce qu’il en approche
davantage, comment et en quoi son expérience est en opposition à son
idée de lui, il peut prendre constatation, sans affolement ni
surdramatisation, de son incongruence provisoire, par le relais d’une
médiation chaude qui l’accompagne sans pression ni surprotection. Il est
mis de plainpied, à tous les niveaux, avec luimême. Et il peut approcher
de l’autre, et d’abord du thérapeute, sans précipitation ou rétraction,
sans dépendance ou contredépendance transférentielle consolidée, parce
qu’il est devenu plus sûr de luimême.
Notons que cette dialectisation
n’est pas une position de principe chez Rogers. L’ordre invariant, le
nombre et l’approfondissement structurel des « conditions » lui ont été
imposés par l’expérience : ils ne résultent aucunement d’une idéologie
préalable. Rogers a peu lu Marx
et il n’a jamais étudié Hegel.
Il en résulte qu’il a de la dialectique la conception fruste à deux
temps, si fréquente même chez des personnes qui ont plus ou moins
assimilé la pensée hegelienne : « Pour moi, le terme connote bipolarité,
contradiction, points de vue en conflit et la tentative de réaliser
quelque sorte de vérité en présentant à la fois (both) pleinement
les deux points de vue. Je n’ai aucune objection intellectuelle à ceci,
mais je trouve que personnellement je présente habituellement un point
de vue consistant, laissant aux autres le soin de présenter le point de
vue opposé ».
C’est donc la dialectique tronquée, abstraite et statique, que Rogers
refuse : mais non pas la dialectique complète, mouvante, avec ses trois
moments, insérée dans l’existentiel, avec toutes les régulations
saisissables dans ses négations successives (et qui assurent cette loi
de stabilisation, par inversion de mouvements, dont nous reparlerons).
Dialectisation des « conditions »
Avant d’approfondir les
conséquences dans leur application à une relation, nous souhaitons
revenir sur la structure des trois « conditions » attitudinelles
décrites pour une thérapie, pour une croissance de la personne : afin de
souligner encore combien elle est dialectisée à tous ses niveaux. Chaque
condition, en effet, est en situation dialectique par rapport aux
autres, et en même temps elle est établie selon une structure dynamique
de thèse, négation de la thèse, et négation de la négation.
Ainsi pour la congruence : elle
désigne une présenciation à soi, authentique par l’accueil de
tout le vécu expérientiel face à autrui. Mais ce mouvement intense vers
soi et vers son aise est concrètement nié par une détente de
transparence tranquille où l’on s’explicite éventuellement visàvis de
l’autre en se préservant de tout rôle. Et cependant cette transparence,
cet affleurement des sentiments persistants dans la communication à
l’autre, sont niés euxmêmes par une inspiration de liberté prudentielle,
de réserve établie, afin de maintenir la vérité du devenir de ses
sentiments propres et la juste distance par rapport à l’autre.
De même pour le regard positif
inconditionnel : il est dans son ensemble négation du dynamisme
premier de présenciation à soi. Il apparaît donc dans un mouvement
initial de distanciation par l’attention distinctive apportée à
autrui, constituant celuici dans sa globalité comme autre et comme
important, inconditionnellement, à la distance où il se place,
et dans le carrefour des directions multiples et opposées où il paraît
s’avancer. Mais cette démarche de distanciation objective est niée par
une sollicitude positive, selon un accueil à égalité, sans aucune
dénivellation entre le client et le thérapeute. Cependant cette prise en
considération, cette chaude acceptation, est niée à son tour par une
précaution de nonpossessivité (et de nonidéalisation) qui explicitent
les négativités résiduelles et signifiantes du thérapeute.
Enfin, pour la « compréhension
empathique exacte » : elle est dans son ensemble, négation de la
négation distanciante (du regard positif inconditionnel), mais elle
se déroule ellemême dans des spires dialectiques. Sa mouvance initiale
est une présenciation au monde intérieur du client, où le thérapeute se
glisse pas à pas en maîtrisant les projections de son cadre propre de
référence. Cependant ce mouvement de présenciation à l’autre est nié par
la spécificité acérée de soi que ressent le thérapeute (épaulé sur sa
congruence ainsi que sur la considération positive inconditionnelle de
l’autre) : il y a nonidentification agie dans une approche délicate des
signifiants les plus profonds du client et cependant cette spécificité
est niée à son tour : le thérapeute réverbère ces signifiants, spécifiés
en sorte d’être dédramatisés de leur indifférenciation stressante.
Mais à ce point de l’empathie, dans
cet accomplissement risqué de la compréhension, c’est l’unification
intérieure, la croissance du thérapeute qui est confirmée : il se
ressent luimême plus différent, plus congruent, plus apte à de profondes
acceptations de lui et des autres, plus prêt à consentir à ses
imperfections et à celles d’autrui, plus mobile pour suivre le dynamisme
de l’existence et de la spontanéité créatrice qui est en acte en lui et
en puissance dans l’autre. Mais qu’en estil dès lors en celuici ?
Le processus de l’évolution
Rogers a souvent décrit les
conséquences que comportent l’établissement dans une relation des trois
conduites conjuguées de congruence, de respect inconditionnel et de
compréhension empathique. Ces conditions sont, insistetil, nécessaires
mais aussi suffisantes (ce qui est actuellement remis en question) :
elles excluent l’intervention de procédures d’interprétation
herméneutique ou de diagnostic ; elles définissent le noyau d’une
relation humaine vive.
A propos de son entretien avec
Gloria, il énonçait en hypothèse : « Bien, supposons que j’aie de la
chance et que j’éprouve certaines de ces attitudes dans notre rapport,
que se passeratil alors ? Nous avons appris, d’après mon expérience
clinique et d’après nos recherches, que si des attitudes telles que je
les ai décrites existent, alors un bon nombre de choses se produiront.
« La personne examinera certains de
ses sentiments et ses attitudes plus profondément. Elle est aussi
capable de découvrir certains aspects cachés d’ellemême dont elle
n’était pas consciente auparavant.
« En se sentant estimée par moi, il
est possible qu’elle en vienne à s’estimer davantage ellemême. En
sentant que je comprends certaines de ses “significations”, elle peut
alors, peutêtre, s’écouter davantage, écouter ce qui se passe au sein de
sa propre expérience, écouter certaines des “significations” qu’elle n’a
pas été capable de saisir auparavant.
« Et peutêtre que si elle sent en
moi l’authenticité, elle sera capable d’être un peu plus authentique
ellemême. Je suppose qu’il y aura un changement dans sa manière de
s’exprimer, ceci, du moins, est le fruit de mon expérience dans d’autres
cas.
« D’un état où elle est loin de son
expérience immédiate, loin de ce qui se passe en elle, elle pourra se
mouvoir plus près de son expérience immédiate, devenir capable de
ressentir et d’explorer ce qui se passe en elle dans l’instant immédiat.
D’un état où elle se désapprouve ellemême, il est possible qu’elle se
dirige dans le sens d’une acceptation d’ellemême. Partant d’une espèce
de peur de la relation, il se peut qu’elle devienne capable d’entrer en
relation plus directement et qu’elle vienne ainsi plus directement à ma
rencontre.
« D’une conception de la vie rigide
en noir et blanc, elle peut ensuite évoluer vers des manières plus
souples de construire son expérience et d’en voir les significations. A
partir d’un lieu d’évaluation qui se situe en dehors d’elle, il est très
possible qu’elle en vienne à asseoir en ellemême une plus grande
capacité de porter des jugements et de tirer des conclusions ».
On sait, dans le cas de Gloria, que
ce sont bien des conséquences de cette nature qui ont été observées.
Plus généralement le vécu dialectique des trois conditions par le
thérapeute peut entraîner peu à peu un déblocage des antagonismes
défensifs et fixateurs où était coincée la personnalité. Elle peut
entrer dans une souplesse croissante de dialectisation de ses
expériences et de ses sentiments, et par suite dans une restauration
progressive du fonctionnement optimal.
Mais cette restauration estelle
seulement liée à la relation de thérapie ? Se produitelle par imitation
provisoire de la conduite du thérapeute, par induction ou mimétisme ?
Atelle un caractère fugace, réversible ou s’établitelle sur une échelle
d’évolution où des mesures soient possibles ? Peuton augurer de sa
stabilité, à un moment donné, en l’absence des événements marquants,
liés à la consistance du phénomène de transfert, qui se présente,
consolidé, au cours de la cure psychanalytique ?
Autrement dit, comment traiter de
façon objective des problèmes de personnalité situés dans des opérations
de subjectivité aussi délibérées ? La démarche rogérienne s’enfermetelle
dans un système de suggestion (et d’illusion), qui serait étanche à
toute vérification scientifique ?
C’est le mérite fondamental de
Rogers, dans le paradoxe maintenu, d’avoir associé, en chaque instant,
et avec acharnement, à sa démarche de subjectivité, et au vécu de ses
dispositions pratiques, des processus de validation, minutieux,
raffinés, de plus en plus rigoureux. Là encore, le ressort dialectique
réapparaît : à une présenciation de subjectivité, une distanciation
d’objectivité est conjuguée en négation et cette négation est à son tour
niée, en ce que les théorisations édifiées sur les mesures objectives ne
sont pas raidies en dogmatiques, mais réouvertes par une imagination de
pratique libre, partant de la créativité subjective.
En cela Rogers reste fidèle à la
conception de Dewey, telle qu’il la cite dans le Développement de la
personne : « La science a fait son chemin en libérant, non en
étouffant, les éléments de variation, d’invention, d’innovation et de
nouvelle création dans les individus ».
Chapitre XIV
Le développement de la recherche sur la thérapie et
les relations humaines
Pour Rogers, le projet d’une mesure
objective des formes et des conséquences de la relation thérapeutique
s’est inséré logiquement (au sens de Dewey) dans une « expérience »
de recherche scientifique, consubstantielle à son orientation et vécue
avec ses collègues, étape par étape. « Un des faits les plus marquants
de cette thérapie, notetil, c’est le caractère scientifique de son
développement ».
Dans l’expérience, il importait
d’installer une objectivité qui soit en cohérence par rapport aux
subjectivités impliquées. Ou, plus précisément, il fallait arriver à
construire des structures expérimentales adéquates, c’estàdire de plus
en plus isomorphes (Rogers parle de « parallélisme » entre son approche
et l’apparition de la recherche en thérapie)
aux structures existentielles ressenties, appréhendées.
Au cours des échanges incessants,
et grâce au recours à de multiples modes psychométriques ou
sociométriques, une épreuve de cohérence et de communication, mais aussi
d’invention et de rigueur s’institue pour Rogers. Après le petit groupe
de Rochester, l’investigation scientifique se développe autour de lui à
l’Université d’Ohio ; elle se déroule majestueusement au centre de
counseling de Chicago (cent vingtdeux travaux de recherches de
l’équipe étaient recensés par Cartwight en 1957), pour s’épanouir et
s’approfondir encore à Wisconsin et à La Jolla.
La méthodologie de ces recherches
de plus en plus coordonnées devait être cohérente simultanément à
l’orientation dynamique et à d’hypothèse du « champ » : ce qui revenait
à chercher comment établir une exploration des Gestalt
successives permettant leur mise en comparaison avec l’aide des outils
statistiques (tests de signification, corrélation, etc.) pour dénoter
les changements caractéristiques des structures d’une situation à une
autre, ou, dans le temps, d’un moment d’une relation interpersonnelle à
un autre moment de la même relation.
Dans le travail opiniâtre de Rogers
avec ses assistants, ses étudiants et ses clients, « en groupe »,
c’est une perspective structuraliste qui s’est par conséquent dégagée :
elle a renouvelé la méthodologie aussi bien que les critères de
catégorisation et de mesure, le plan des recherches et des contrôles
aussi bien que la disposition des variables relationnelles en
psychologie et en thérapie. Dans la fidélité au dicton de Thorndike que
cite Rogers : « Chaque chose qui existe, existe en quelque quantité qui
peut être mesurée ».
A ce compte, les procédures et l’ingénierie utilisées par Rogers et ses
collègues, méritent d’être exposés et analysés afin d’enrichir le
registre restreint, en France notamment, de la méthodologie des
recherches en sciences humaines.
Méthodologie objective et enregistrement
Le premier apport fondamental de
Rogers au niveau de la méthodologie a été, on le sait, dès 1938, la mise
en œuvre d’enregistrement des séances de counseling ou de
thérapie ; au magnétophone, en film ou en magnétoscope, puis en
retranscription verbatim (en scripts, indiquant les tonalités
affectives des paroles et les silences).
Le thérapeute, ses collègues, des
étudiants ou même des clients peuvent revenir aussi fréquemment ou
intensément qu’on le souhaite, aussi subjectivement qu’ils voudront, sur
les constats objectifs que ces enregistrements procurent. Cet usage
d’enregistrement est en cohérence avec l’importance des comportements de
réverbération utilisés par le thérapeute, pour réfléchir la situation et
faire réfléchir sur elle. Il est lié à une maîtrise, par le film et les
bandes, du dynamisme d’une relation. Il permet d’autre part de comparer
objectivement des séquences d’entretien à d’autres séquences d’un même
entretien, ou d’autres entretiens, dans des conditions sûres. Il
introduit un ajustement de distanciation et de présenciation aussi bien
visàvis du client que du thérapeute (ou que de soi). Il facilite enfin
une analyse en groupe.
Il est possible, par exemple,
d’étudier à loisir la structure des fréquences d’intervention
d’un thérapeute par rapport à celle d’un client au cours d’une
même séance, aussi bien que par rapport à d’autres séances (ultérieures
ou antérieures) pour les mêmes personnes, aussi bien que pour des
séances entre d’autres thérapeutes et d’autres clients. Il est possible
d’étudier, plus en finesse, la structure des catégories variées
d’intervention que le thérapeute emploie, et de rechercher s’il y a
évolution de cette structure, entre le début, le milieu et la fin d’un
traitement thérapeutique, ou bien s’il y a des différences
significatives d’un thérapeute à un autre thérapeute (par l’émergence
des formes d’équilibre variées de ces catégories mais aussi par celle de
catégories nouvelles d’interventions, non classables par rapport aux
catégories antérieures). Il est encore possible d’étudier les structures
d’interaction catégorisables qui se disposent entre le thérapeute
et le client au cours d’une ou plusieurs séances, mais surtout tout au
long d’une thérapie, intégralement enregistrée (on sait le souci
de Rogers de disposer d’un donné total, d’un « cas complet », comme il a
cherché à le faire en publiant dès 1942, le cas Herbert Bryan, édité
dans La relation d’aide et la psychothérapie, t. II).
L’accent d’étude structurale peut
également être placé sur les formes d’expression et de référenciation du
client : varientelles ou non significativement du début à la fin
du traitement ? Thématiquement ou même linguistiquement : varientelles
après le traitement (éventuellement avec ou sans régression) ?
Enfin il est possible d’utiliser
les réactions les plus subjectives de « juges » variés pour apprécier le
climat des relations enregistrées aussi bien que pour expliciter,
par leur mise en corrélation, la stabilisation objective des
appréciations et la cohérence de ces juges par rapport aux processus
analysables fixés dans les enregistrements ; ou bien les études de
fragments enregistrés peuvent être utilisés en conjugaison avec des
résultats de tests multiples, projectifs ou sociométriques, ce qui
permet des recoupements multiples.
La méthodologie des enregistrements
allait produire « un matériel de base pour commencer la recherche »,
observait Rogers en 1952, ajoutant : « L’énorme littérature de
psychiatrie et de psychanalyse nous offre bien peu d’éléments
objectifs ».
Et il s’enorgueillira dans le même temps que le centre de conseil de
Chicago ait enregistré alors en dix mois deux mille huit cents
interviews accordées à six cent cinq personnes.
Cette méthodologie entraînait donc des travaux de catégorisation en vue
d’obtenir des mesures utiles et analysables.
Critères structurels de mesure
Ces travaux se sont révélés ardus,
comme l’évoque Rogers à propos du cas Bryan, entièrement enregistré vers
1940 : « En écoutant le contenu en quelque sorte amorphe et décousu de
ce cas, nous croyions d’abord qu’il fallait renoncer à tout espoir de
traduire un matériel de ce genre en données nettes et claires se prêtant
aux exigences de la recherche. A première vue, ce genre de matériel
semblait défier toute possibilité de traitement objectif et
systématique. Néanmoins, nous essayâmes et nos efforts s’avérèrent
couronnés de succès dans une certaine mesure. L’enthousiasme et l’esprit
créateur de nos étudiants de doctorat suppléèrent au manque, jadis
complet, de fonds et d’équipement. Grâce à leurs efforts ingénieux et
tenaces, la “matière première” de la thérapie fut organisée en un
certain nombre de catégories élémentaires représentant les modalités de
l’interaction thérapeuteclient ».
D’autres tentatives ont été
conduites pour permettre de cerner et d’organiser progressivement tout
le donné objectif offert par les enregistrements multiples ou les
résultats de tests passés à différents moments ou par des personnes
différentes. Les critères de classification et de mesure, qui ont été
dégagés, se sont orientés suivant les vecteurs multiples de la relation,
tels qu’ils se dégagent hic et nunc, dans l’analyse structurale
de celleci. Les termes centered et directed, souvent
utilisés par Rogers (et pour le premier d’entre eux, inséré dans la
dénomination de son approche) indiquent assez la dominante
vectorielle ou tensorielle, c’estàdire structurelle plus encore que
« factorielle » de ses conceptions.
On verra, au tableau I, comment se
situaient déjà les tenseurs principaux de la relation de conseil ou
d’évolution, dans les préoccupations du groupe de recherche rogérien,
après douze ans d’investigations. Ils se disposent opératoirement du
côté du thérapeute, du côté du client et de son monde intérieur au
niveau des interactions clientthérapeute, ou bien, audelà de la
thérapie, dans le domaine de l’ajustement (non pas, platement, de
l’adaptation) des personnes à leur caractère, leur situation ou leur
environnement.
Tableau I
Sommaire des domaines de recherche
relatifs à la thérapie centrée sur le client (jusqu’en 1952)
Etudes sur le
processus thérapeutique
La méthode de relation
(ou d’aide, littéralement counseling)
— Le développement et l’évaluation d’une
mesure des procédures d’entretiens de thérapie (counseling) :
Porter (1943)
— Une recherche sur la conduite du
thérapeute (counselor) en thérapie non directive : Snyder (1945),
Seeman (1949)
Le processus dans le client
A. Etudes sur le Moi
— La référence à soi dans les entretiens
de consultation : Raimy (1948), Snyder (1945), Seeman (1949)
— La relation entre les attitudes visàvis
de soi et les attitudes visàvis d’autrui : Sheerer (1949), Stock (1949)
B. Etudes sur d’autres concepts relatifs
au processus
— La prise de conscience (insight) :
Curran (1945)
— Le comportement défensif dans la
thérapie centrée sur le client : Hogan (1945), Haigh (1949)
— Le lieu de l’évaluation en thérapie :
Raskin (1952)
— L’utilisation de catégories de langage
grammaticales et psychogrammaticales en thérapie : Grummon (1950)
— Les changements de la conduite en
thérapie : Hoffman (1949)
Interaction du client et du thérapeute
— Relation entre la méthode d’entretien et
les réponses du client : Bergman (1951)
— La relation thérapeutique comme créée
par des experts et des nonexperts : Fiedler (1950)
Etudes sur les
suites de la thérapie
L’évaluation par des tests de personnalité
— Les changements dans la personnalité des
individus survenant après la thérapie centrée sur le client : Muench
(1947), Carr (1949), Haimowitz (1952)
— Une étude des changements dans la
perception de la relation à la thérapie : Jonietz (1950)
— Une étude des mesures couramment
utilisées pour évaluer le changement de la personnalité en thérapie :
Mosak (1950)
Comportement situationnel
— Mesure des réponses physiologiques à la
frustration avant et après thérapie : Thatford (1952)
Etude de l’ajustement psychosocial
— Données sur l’adaptation personnelle
d’anciens combattants après thérapie : Bartlett (1950)
— Les effets de la thérapie sur la
fonction de lecture chez les enfants : Bills (1950)
Critères structurels de mesure propres à la conduite du thérapeute
C’est par les travaux mémorables de
Porter que furent dégagées avec Rogers vers 1940 (pour une thèse de
doctorat qui fut passée en 1941 à l’Université d’Ohio), les premières
catégorisations applicables aux interventions du thérapeute. Ces
catégorisations ont été ensuite adaptées et sont très largement
utilisées pour l’analyse des entretiens de recherche, de thérapie,
d’enquête ou de marketing, elles sont à la base de l’entraînement aux
communications en général.
Porter partit d’un matériel de
dixneuf entretiens enregistrés provenant de onze thérapeutes de
comportements différents (la moitié, c’estàdire cinq « plutôt faibles en
directivité », l’autre moitié — six — « très nettement directifs »). Il
en dégagera la structure de cinq catégories générales d’orientation des
interventions du thérapeute : une catégorie 1 visait la situation
globale d’entretien ellemême et les procédés de sa définition ; une
catégorie 2 se rapportait à l’exposé et au développement des
problèmes objectifs ou non du client ; une catégorie 3 concernait
l’intériorité du client et les procédés de développement de sa
compréhension ; une catégorie 4 regardait les renseignements ou
explications relatifs aux problèmes ou au traitement ; enfin la
catégorie 5 caractérisait les procédés qui favorisaient l’initiative
ou la prise de décision du client. Ces catégories étaient
affinées selon les mesures de pression, de facilitation ou de distance
que le thérapeute pourrait appliquer à ces orientations.
En sorte que Porter, guidé par les besoins de classement, aboutit à la
liste du tableau II, dans laquelle il s’efforça de ne pas offrir, pour
catégoriser des données, des concepts structurellement extérieurs à ces
données.
Tableau II
Liste des catégories d’interventions
Catégorie 1 :
Interventions du thérapeute ayant pour but de définir la situation de
l’entretien :
1a.
Elles définissent la relation en termes de diagnostic, de traitement,
etc.
1b.
Elles définissent la relation en termes de la responsabilité du client à
diriger l’interview, à prendre des décisions, etc.
1u.
Inclassables (unclassifiable)
Catégorie 2 :
Interventions du thérapeute ayant pour but de mettre au jour et de
développer la situation des problèmes. Elles usent d’une conduite
(lead) qui :
2a.
Impose au client le choix et le développement du problème (ou de thèmes
à discuter)
2b.
Indique le problème mais en laisse le développement au gré du client.
2c.
Indique le problème et restreint le développement à une confirmation,
une infirmation, ou à un apport d’éléments spécifiques d’information.
2u.
Inclassables
Catégorie 3 :
Interventions tendant à développer la prise de conscience (insight)
et la compréhension (understanding) du client. Elles
répondent au souci d’indiquer :
3a.
La reconnaissance (recognition) du contenu de ce qu’exprime le
client, explicitement ou implicitement.
3b.
La reconnaissance de l’expression d’une attitude ou d’un sentiment dans
la (ou les) réponse(s) verbale(s) du client immédiatement précédente(s).
3c.
L’interprétation ou la reconnaissance d’un sentiment ou d’une attitude
non exprimés dans sa (ou ses) réponse(s) verbale(s) immédiate(s).
3d.
L’identification précédente d’un problème, d’une source de difficultés,
d’une situation devant être amendée, etc., en utilisant des
interprétations de tests, des commentaires d’évaluation.
3e.
L’interprétation des résultats de tests, mais non pas comme indications
d’un problème, d’une source de difficultés, etc.
3f.
L’approbation, la désapprobation, l’indignation ou d’autres réactions
personnelles en regard du client (mais sans identifier un problème).
3u.
Inclassables.
Catégorie 4 :
Interventions de renseignement :
4.
Elles expliquent, discutent ou donnent une information relative au
problème ou au traitement.
Catégorie 5 :
Interventions ayant pour but de provoquer la prise de décision et
l’action du client. Elles proposent au client une activité :
5a.
Directement ou par l’intermédiaire d’une technique de questionnement.
5b.
En réponse à la question « que faire ? » du client. Elles influencent la
prise de décision par :
5c.
Le classement et l’évaluation des éléments d’appréciation, l’expression
d’une opinion personnelle, ou en argumentant.
5d.
L’indication que c’est au client qu’appartient la décision.
5e.
L’acceptation ou l’approbation de la décision du client.
5f.
Le rassurement du client.
5u.
Inclassables dans cette catégorie.
I :
Interventions déplacées (irrelevant) « Interventions inclassables
en aucune façon ».
Sur ce système de catégorisation,
Porter proposa ensuite, à un groupe de juges experts, de classer toutes
les interventions des thérapeutes, prises dans les dixneuf
enregistrements. Il demandait d’autre part à ces juges de situer chaque
entretien, sans jugement sur sa qualité, sur une échelle de onze degrés
de directivité, la valeur onze de l’échelle caractérisant un
entretien dont la conduite a été assurée totalement par le thérapeute,
la valeur un, celle d’un entretien où le thérapeute a refusé directement
ou non de prendre la responsabilité de la direction des échanges et, en
conséquence, contraint le client à conduire l’entretien. « Quand cette
évaluation a été terminée », observe Rogers, « et que les interviews les
plus directives ont été comparées avec les moins directives, certaines
différences de structures sont apparues de façon frappante ».
Les recherches poursuivies dans
cette voie par Porter et Rogers ont permis de différencier des autres
démarches thérapeutiques l’attitude et les comportements rogériens : par
la structure, significativement spécifique, des catégories
d’interventions utilisées de préférence (comme nous l’avons indiqué plus
haut), notamment par la fréquence élevée d’interventions réverbérantes
(catégories telles que 1b, 3a, 3b, 5d), mais aussi par la moindre
quantité totale des interventions (le thérapeute non directif parle en
moyenne sept fois moins que le client, alors que les thérapeutes
directifs parlent quatre fois plus que celuici, dans l’échantillon
étudié), et la rareté relative de certaines catégories (en moyenne, par
entretien, seulement 4, 6 questions précises contre 34,1 pour le groupe
des thérapeutes directifs).
Une autre conséquence de ces études
et de leurs résultats fut l’organisation d’un matériel d’entraînement à
la communication aussi bien qu’à la thérapie, propre à exercer les
individus à la maîtrise d’un clavier total des interventions possibles.
L’exemple le plus complet se trouve dans l’ouvrage que Porter publia en
1950, Introduction à la consultation thérapeutique (An Introduction
to Therapeutic Counseling, non traduit en français mais largement
pillé !).
Un certain nombre de recherches fut
effectué dans la même ligne. Virginia Lewis fit une analyse très
détaillée des douze mille unités d’intervention du thérapeute et du
client dans six cas d’adolescentes en difficulté (thèse de doctorat au
Teachers College en 1942). Elle mit en évidence le fait que les item
classés comme « explication du rôle du psychologue » étaient plus
fréquents dans le premier et le deuxième déciles du traitement et
disparaissaient ensuite ; plus généralement, elle parvint au même type
de résultats que Porter.
On notera ensuite une étude de
Miller (1949), établie sur huit interviews (deux d’orientation
psychanalytique, une d’orientation « non directive » et cinq non
directives). Partant des enregistrements, des juges étaient invités à
discriminer objectivement comment les interventions des thérapeutes
étaient ressenties par le client, en dehors des intentions de ceuxci :
en tant qu’acceptantes, aidantes, rejetantes ou neutres. L’analyse de
variance montrait peu de différences dans les classifications des juges,
surtout à l’égard des interviews non directives : cellesci
apparaissaient, d’autre part, caractérisées essentiellement par une
grande expérience d’acceptation que les clients dénotaient chez leurs
thérapeutes.
Une étude très originale était
menée par Blocksma, aidé par Porter, à Chicago, vers l’année 1947.
C’était une recherche sur la formation des thérapeutes, portant sur
trentesept personnes en apprentissage. Deux tests étaient utilisés,
chacun juste avant le début de la formation, puis six semaines après.
L’un des tests, « papiercrayon », de Porter et Axline, visait à mesurer
quantitativement comment chaque personne en formation se disposait par
rapport à cinq tendances ; de moralisation (propension à
concevoir des jugements sur le client) ; de diagnostic (tentation
d’obtenir de l’information en vue de comprendre les cas) ; d’interprétation
(tentative d’expliquer le client à luimême) ; de support (offre
d’un encouragement émotionnel) et de réflexion (essai de
comprendre le client de son point de vue et de le lui communiquer, la
compréhension atteinte). L’autre méthode de mesure était très
particulière. Blocksma avait repris l’enregistrement du premier
entretien conduit avec un de ses propres clients, Robert ; et il en
avait tiré les éléments essentiels (matériels, professionnels et
affectifs) pour jouer ce rôle de client fidèlement, avec chacune des
personnes en formation, chargées par conséquent de conduire un entretien
de début (qui était enregistré) dans une situation de comparaison
contrôlée. Un autre formateur en faisait de même, jouant le rôle d’un
autre client, John, présentant le même problème de base, mais en
contexte différent. C’étaient ces mêmes rôles qui étaient repris au
début et six semaines après le début de l’apprentissage. On analysait
ensuite pour chaque personne en formation, ses interventions en
catégories selon Porter, et leur disposition en lieu d’évaluation,
suivant une échelle de cinq points pour indiquer si le thérapeute en
formation pensait et communiquait :
1. avec les attitudes exprimées par le client ;
2. au sujet du client et avec lui ;
3. au sujet du client, balançant le lieu
d’évaluation en celuici ou en dehors de lui ;
4. au sujet du client et à sa place ;
5. à sa place.
Les mesures étaient faites par
plusieurs juges et leur stabilité vérifiée (accord complet à 85 % pour
les catégories et 66 % pour le lieu d’évaluation).
Les résultats montraient un
apprentissage significatif : les tendances à la réverbération passaient
d’un score de 50 % avant le début de la formation à un score de 85 %
après six semaines ; l’emploi de réverbération, dans le test
d’interview, passait de 10 % à 60 %, celui d’interprétation de 22 % à
15 %, et celui de recherche d’information de 16 % à 2 % ; enfin pour
l’échelle en cinq points du lieu d’évaluation, les apprentis thérapeutes
passaient de 4 % à 35 % pour le premier point (communication avec le
client), de 12 % à 25 % pour le second et de 35 % à 5 % pour le dernier
(à la place du client).
Cette recherche était complétée par
une étude sur les résultats professionnels des mêmes personnes au cours
d’exercices : en mettant en corrélation (avec calcul de X2)
leurs scores aux tests précédents avec les pronostics des formateurs à
la fin de la formation, les avis d’un superviseur (non rogérien) après
un an, et le nombre de cas de thérapie qu’ils avaient effectivement
poursuivis jusqu’au bout (variable sensible d’une certaine maîtrise
perçue par les clients). Si les tests papiercrayon et les situations
avant formation se révélaient peu sensibles pour prédire le succès
ultérieur, par contre les résultats marqués aux tests d’entretiens après
formation étaient signifiants. Rogers note que cette recherche et ses
résultats appelaient des réserves mais qu’elles avaient permis
d’améliorer les stages de formation, notamment pour permettre à chaque
postulant de se révéler à luimême ses choix principaux de counseling.
On peut noter enfin des études se
basant sur l’interaction directe entre le thérapeute et le client, quand
celuici fait une « requête » au thérapeute. Bergman relève
240 interactions, dans dix cas enregistrés complets (qui serviront aussi
à Raskin). Il classa les réponses du thérapeute aux requêtes selon cinq
positions : d’évaluation (en interprétation, accord ou désaccord,
suggestion) ; de structuration de l’interaction (explication de son
rôle, de ses références théoriques, de la situation d’entretien) ;
d’éclaircissement (pour mieux savoir ce que signifie la requête) ; de
reflet du contexte de la requête ; de reflet de l’objet de la requête.
Il examine les réactions du client suivant qu’elles réitéraient ou
modifiaient la requête, qu’elles y renonçaient (glissant vers un sujet
plus superficiel), qu’elles exploraient les attitudes et les problèmes
liés à la requête, ou enfin qu’elles témoignaient d’une prise de
conscience, par le client, d’aspects jusqu’ici inconnus de lui ou de la
situation. Les études de fréquence et leur traitement statistique de
signification non fortuite montrèrent l’importance des réponses de
reflet pour provoquer des activités d’exploration du moi et des prises
de conscience.
Critères structurels de mesure appropriés au client
Des catégorisations analogues aux
précédentes ont été établies, dès 1940, cette fois autour des
formulations du client luimême. Outre la recherche pionnière de Virginie
Lewis, citée plus haut, il faut évoquer tout d’abord les travaux de
Snyder à propos de sa thèse d’Etat, présentée en 1943, à l’Université
d’Ohio auprès de Rogers, et se rapportant à la nature de la
psychothérapie non directive.
Snyder avait pris pour base
l’analyse de dix mille messages, formulés par des clients et des
thérapeutes en entretien, qui provenaient de six cas de counseling
entièrement enregistrés. Pour ce qui est des clients, leurs messages
avaient été classés, à différents moments (quintiles) du
processus de counseling, selon cinq catégories (il y avait en
fait vingt et une souscatégories) qui étaient : la discussion de
leurs problèmes (et de leurs symptômes) ; les prises de conscience
(insight) ; la discussion de projets d’avenir ; les
acceptations simples ; les autres catégories.
Quantitativement, les formulations sur les problèmes avaient diminué
d’un pourcentage moyen de 52 % dans la conversation totale du client, au
premier cinquième de counseling, à 29 % dans le dernier
cinquième ; l’expression des prises de conscience s’était élevée, au
contraire, de 4 % à 19 %, et la discussion de projets d’avenir de 1 % à
5 %. Cette étude démontrait qu’« on peut étudier objectivement le
matériel désorganisé d’une interview », comme le remarque Miguel de la
Puente ;
elle montrait aussi que le client tend à rejeter les réponses directives
du thérapeute, telles que l’interprétation, la persuasion et la
désapprobation ; elle faisait la preuve de la primauté de deux
techniques, la simple acceptation de l’expression et le reflet des
sentiments.
Snyder avait également étudié les
types d’attitudes affectives exprimées dans les déclarations des
clients, en termes de catégories positives, négatives ou ambivalentes
et, en raffinant, si les catégories positives ou négatives l’emportaient
dans les premières phases de la thérapie, c’étaient les attitudes
positives qui avaient tendance à prédominer vers la fin de celleci ; et
cette bascule était accentuée en ce qui concerne les sentiments relatifs
au vécu présent (un tiers d’évaluations positives pour deux tiers de
négatives dans le premier cinquième de la thérapie ; deux tiers
d’évaluations positives pour un tiers de négatives dans le quintile
final).
Les résultats obtenus par Snyder
étaient confirmés six ans plus tard par une étude analogue de Julius
Seeman, établie sur les enregistrements de dix autres thérapies
complètes. Seeman vérifia d’autre part la fiabilité des catégories
utilisées en recourant aux services de différents psychologues et
thérapeutes, comme juges : il apparut 87 % de concordance dans leurs
jugements sur le contenu des formulations, et 76 % dans les jugements
sur les attitudes.
Rogers notait que, cliniquement, le
mouvement opéré dans le client par la thérapie semblait cheminer à
partir de la considération de ses symptômes pour aller vers son moi (self)
et depuis l’environnement ou depuis autrui pour se diriger vers le moi
(de même que depuis le passé vers le présent immédiat). Il devenait
important de vérifier ces mouvements.
C’est ce que fit Raimy, en 1943,
également dans une thèse de doctorat préparée à l’Université d’Etat
d’Ohio sous la conduite de Rogers (qui en fut frappé). Cette thèse
portait sur le concept du moi considéré à partir de l’exploration de
quarante thérapies continues, comme une configuration d’éléments
catégorisés en : perceptions des caractéristiques et des capacités de
soi, perceptions et conceptions de soi en relation aux autres ou à
l’environnement ; qualités de valeur associées aux expériences et aux
objets ; buts et idéaux perçus avec une valence positive ou négative.
Raimy constata, dans le déroulement des thérapies, considérées comme
réussies, un courant croissant de références positives attribuées au
soi, associé (après des oscillations) à un courant décroissant de
références négatives et à un courant faible de références ambivalentes
(avec tendances à décroître en fin de thérapie). L’étude de Raimy
s’était accomplie avec le contrôle de quatre experts (en accord à 80 %
sur la catégorisation, accord maintenu six mois plus tard).
De son côté, Charles Curran poussa
sa thèse de doctorat (Ohio, 1944) vers une analyse du processus de la
thérapie chez le client. Il procéda à une analyse exhaustive d’un seul
cas, le cas Alfred, traité d’un point de vue non directif, en utilisant
vingt entretiens enregistrés. Trois juges approuvèrent indépendamment
l’un de l’autre toutes les formulations du client en ce qui concerne :
les émotions (négatives ou positives) ; l’insight, c’estàdire la
prise de conscience, et les options. Les résultats montraient une
modification structurelle de l’expression du client dans l’avancement du
traitement : diminution progressive des émotions négatives ;
accroissement des prises de conscience (réduisant le nombre des
problèmes) ; émergences croissantes de résolutions personnelles et
constructives.
Ces résultats furent corroborés par
de nombreuses autres recherches accomplies dans la même optique à Ohio
ou à Chicago : l’individu, en fin de thérapie réussie, se perçoit
comme une personne plus adéquate, plus digne de valeur, s’appréciant
plus réalistement et évaluant plus objectivement ses relations et son
environnement dont il se défend moins parce qu’il en dépend moins.
Rogers a luimême commenté les études sur la selfperception,
d’auteurs tels que C. Kessler (1947), Nathalie Rogers, sa fille (1947),
S. Lipkin (1948), mais aussi Julien Seeman (1949) et Elisabeth Sheerer
(1949).
Ces constatations amenèrent tout
naturellement aux études sur les réactions de défense du moi. Cellesci
furent notamment mesurées objectivement par Hogan pour son doctorat à
Chicago, en 1948 : en établissant des catégorisations de modes de
défenses à partir du contenu d’entretiens enregistrés, Gérard Haigh
accomplissait un travail analogue un an plus tard. Au même moment,
Dorothy Stock rédigeait pour une thèse de troisième cycle (M.A. theses),
également à Chicago, une recherche sur les interrelations entre le
concept du moi et les sentiments dirigés vers d’autres personnes et
d’autres groupes.
Enfin, pour sa thèse à Chicago
(1949), Nathaniel Raskin s’appliqua à étudier « objectivement » la
tendance du client en cours de thérapie à s’expérimenter progressivement
luimême comme centre de l’évaluation (locus evaluationis).
Il opéra en quatre étapes. Il confia d’abord à trois juges, procédant
indépendamment, le soin de sélectionner, sur dix cas totalement
enregistrés, les passages se référant à la fonction d’évaluation du
client. L’accord des juges dépassa 80 %, « ce qui indique que la
dimension étudiée était une notion discernable », note Rogers.
Dans une seconde étape, Raskin entreprit d’extraire du matériel, ainsi
sélectionné, vingtdeux passages qui paraissaient représentatifs de la
variété des positions possibles pour des évaluations. Il copia ces
passages sur des cartes et présenta la série des cartes à vingt juges,
qui devaient les répartir en quatre catégories séparées par des
intervalles approximativement égaux. En prenant les douze passages sur
lesquels l’accord des juges était le plus prononcé, il élabora une
échelle de 1 à 4. La valeur 1 de l’échelle représentait une position de
soumission totale au jugement d’autrui. La valeur 2 signifiait une forte
dépendance au jugement d’autrui mais une certaine dissatisfaction à ce
sujet. La valeur 3 désignait une position où une importance équivalente
était accordée aux valeurs d’autrui et à son propre jugement. Rogers
cite, pour désigner la position 3, le passage suivant : « Je suis enfin
parvenu à prendre une décision. Mais je me demande si elle est bonne.
Vous savez, lorsqu’on appartient à une famille comme la mienne, où tout
le monde est intelligent… »
Au cours d’une troisième étape, Raskin mit l’instrument à l’épreuve en
analysant cinquanteneuf entretiens provenant de dix cas de thérapie
relativement brefs (et qui avaient fait l’objet d’autres recherches). Il
prit, au hasard, dans chacune des cinquanteneuf interviews, un passage
d’évaluation qu’il avait luimême caractérisé : il soumit par précaution
le matériel ainsi obtenu à un autre juge qui ignorait où ces passages se
plaçaient dans le déroulement des cas. La corrélation entre ses
caractérisations et celles du juge s’établit à .91, ce qui était
excellent. Raskin, sûr de la constance de son échelle, entreprit alors
la quatrième étape : l’analyse de la position moyenne d’évaluation des
clients, soit dans les premiers entretiens soit dans les derniers. Il
constata que la valeur représentative moyenne (par addition des passages
classés 1, 2, 3 ou 4, et division par le nombre des passages)
appartenant aux premiers entretiens des dix cas examinés était de 1,97
alors que celle des derniers entretiens était de 2,73. Si on prend les
cinq cas considérés (par d’autres critères et d’autres études) comme
plus réussis, la moyenne était de 2,12 au début et de 3,34 pour les
derniers entretiens. Les hypothèses de la thérapie centrée sur le client
se voyaient confirmées. Les études de validation allaient pouvoir se
raffiner encore.
La corrélation interpersonnelle ou la technique du QSort
Les travaux de catégorisation
entrepris allaient, en effet, connaître des possibilités nouvelles, à
partir de l’application décisive d’une technique à fondement statistique,
dérivée de l’analyse factorielle par William Stephenson, depuis ses
études accomplies en 1936 et 1939.
Cette technique ou Qsort method (méthode de triage de quotation)
dont Stephenson publierait seulement en 1953, aux presses de l’université
de Chicago, la théorie (The Study of Behaviour : QTechnique and its
Methodology), fut utilisée pour la première fois (à la connaissance
des assistants de Rogers) par Thomas Jaffrey (pour une analyse
quantitative, effectuée en 1949, sur l’effet du counseling
clientcentered) et par Margaret Hartley (dans une dissertation de
doctorat, présentée à l’université de Chicago en 1951, sur : « L’étude
en Qtechnique des changements de concept de soi pendant la
psychothérapie »).
Le principe de cette technique
consiste à faire décrire par un ou plusieurs individus (éventuellement
en répétant l’opération à différents moments) un objet (une personne,
une interview, une technique, soimême, son moi idéal, une personne
« ordinaire », etc.) par le classement, selon onze classes par exemple,
d’un nombre important de jugements formulés avec des fiches (pour onze
classes, 150) qui peuvent concerner cet objet et être considérés comme
plus ou moins caractéristiques de lui. Par exemple, on invitera à placer
dans la classe 0 les fiches des jugements qu’on estimerait les moins
caractéristiques, les moins semblables à l’objet ; dans la classe 10 les
fiches des jugements apparemment les plus caractéristiques, les plus
semblables ; et dans les classes intermédiaires, les jugements estimés
comme partant de la moindre similitude pour aller, par graduation, vers
la plus grande similitude. On demande, au surplus, à chaque individu de
placer dans les classes un nombre donné de jugements, afin d’obtenir une
distribution statistiquement normale de l’ensemble des jugements : ainsi
pour 150 jugements, le nombre requis pour chacune des classes, de la
classe 0 à la classe 10, seront respectivement, 4, 5, 10, 25, 30, 25,
16, 10, 5, 4. Il est, en ces conditions, possible d’étudier les
corrélations entre deux classements quelconques (d’une même personne à
des moments différents, ou de deux personnes) et plus généralement
d’analyser factoriellement les matrices de corrélations multiples : on
dispose, en effet, d’un grand nombre d’éléments, même si on ne
s’intéresse qu’à une seule personne (en 2 ou quelques états) ou à un
petit nombre de personnes, ce qui rend possible l’application de
méthodes statistiques très élaborées, et ce qui permet d’aller plus
profond qu’en comparant un petit nombre de traits sur un grand nombre de
personnes (comme dans les habituelles études de corrélation en
psychologie).
Ce principe de corrélation
interpersonnelle présente, d’autre part, l’avantage de permettre des
comparaisons entre des structurations établies globalement sur des
continuums : les tests de significativité, applicables en raison des
grands nombres, permettront de vérifier s’il existe ou non des
modifications de structure qui soient significatives d’un changement de
comportement et d’attitude, et non pas seulement dues au hasard. Par ce
fait, il n’est pas nécessaire que le donné des jugements ait été trituré
et découpé à l’avance (et plus ou moins hypothétiquement) en différentes
rubriques comme cela est de règle dans un test classique de personnalité
(et que cela se fasse a priori, expérimentalement ou par analyse
factorielle) ; et pas nécessaire non plus que ce donné ait été étalonné
sur des échantillons (plus ou moins aléatoires ou arbitraires) de
clients.
Comme l’écrivait, en 1952, Max
Pagès : « Le Qsort est un test si l’on veut, et chiffrable, mais un test
sans étalonnage et sans scores individuels. L’interprétation du donné
psychologique y est réduite au minimum puisqu’il n’est pas besoin d’organiser
ce donné pour effectuer des comparaisons. Les manipulations du
psychologue, bien entendu toujours présentes, sont réduites au domaine
du choix des jugements utilisés ».
En fait, ces « manipulations », ces
choix du psychologue chercheur peuvent également être rendus aussi
objectifs et contrôlables qu’il est possible, en se référant à une
« population » nombreuse de jugements exprimés par des thérapeutes ou
des clients très divers au cours d’entretiens enregistrés. Dans le cas
des études faites sur la perception du moi, Rogers écrit : « Un vaste
“univers” de déclarations autodescriptives a été tiré d’entretiens
enregistrés et d’autres sources. Citons quelques déclarations typiques
telles que : « Je suis une personne docile », « je ne fais pas confiance
à mes émotions », « je me sens détendu et rien ne me tracasse », « j’ai
peur des questions sexuelles », « généralement, j’aime les gens »,
« j’ai une personnalité sympathique », « je crains ce que les autres
pensent de moi ». Je me suis servi comme instrument de travail d’une
centaine de ces déclarations prises au hasard, que j’ai travaillé à
rendre les plus claires possible. Théoriquement, nous avions maintenant
à notre disposition une série d’exemples de toutes les façons dont un
individu peut se percevoir luimême. Chacune de ces cent déclarations fut
imprimée sur une carte. Ensuite, elles furent données au client à qui on
demande de les classer pour se représenter luimême dans son état actuel.
Il devait les répartir en neuf piles… Le client opérait ce tri aux
principaux moments de la cure, avant le traitement, après le traitement,
au moment du posttest et aussi en plusieurs occasions au cours du
traitement. Chaque fois qu’il classait les cartes pour se dépeindre, on
lui demandait également de les trier pour représenter le moi qu’il
aimerait être, son moi idéal ».
Deux ans plus tard, dans un article
paru dans la revue Le traitement psychiatrique, Rogers assurait :
« La Qtechnique semble admirablement adaptée à une recherche raffinée et
intensive de phénomènes entièrement subjectifs d’une manière totalement
objective ».
L’utilisation de la « Qtechnique »
fut faite dans la plupart des localisations du champ de la thérapie :
aussi bien pour l’étude de la relation du côté du thérapeute, que pour
l’analyse des changements de la perception du moi ou des évolutions
d’attitudes du côté du client. Elle serait, par la suite, étendue au
champ de la formation et de l’éducation, notamment en France.
Des études nouvelles sur le comportement des thérapeutes d’écoles
différentes
Dès 1949, Fiedler comparait, dans
une thèse de doctorat soutenue à l’université de Chicago, les relations
thérapeutiques initiales (early) créées par des experts et des
nonexperts, appartenant à des écoles différentes : psychanalytique, non
directive et adlérienne. Il approfondissait sa recherche, en 1950, par
une étude sur la relation thérapeutique idéale visée par des thérapeutes
d’obédiences différentes (trois d’orientation analytique, trois
d’orientation centrée sur le client, un adlérien et trois amateurs).
Fiedler procédait de deux façons.
Dans la première, il invitait les dix juges à classer en sept
catégories, selon la Qtechnique, 75 jugements descriptifs d’un aspect
possible de la relation thérapeutique, qui étaient tirés de la
littérature ou de réflexions de thérapeutes (par exemple « le thérapeute
est en sympathie (sympathetic) avec le patient », « le thérapeute
essaie de se vendre », « le thérapeute traite le patient avec beaucoup
de déférence »). Les résultats offraient beaucoup d’intérêt : « Toutes
les corrélations étaient fortement positives, se rangeant de .43 à .84,
indiquant que tous les thérapeutes et même les nonthérapeutes tendaient
à décrire la relation idéale en termes semblables. L’analyse factorielle
révélait un seul facteur, indiquant par conséquent que tous les
thérapeutes s’efforçaient de créer un seul type de relation. Il y avait
une plus haute corrélation entre experts qui étaient considérés comme de
bons thérapeutes, quelle que soit leur relation, qu’entre experts et
nonexperts de même orientation. Le fait que même des amateurs pouvaient
décrire la relation thérapeutique idéale avec des termes qui avaient une
haute corrélation avec ceux des experts suggérait que la meilleure
relation de thérapie pouvait être généralement référée à de bonnes
relations interpersonnelles.
Au passage, on notera que les
caractéristiques mises en valeur pour définir la relation thérapeutique
idéale corroboraient l’importance accordée à l’empathie. On trouvait, en
effet, en tête des catégories, dans les assertions les plus
caractéristiques ou très caractéristiques, des formulations telles que :
« Le thérapeute est capable de participer complètement à la
communication du patient », « les commentaires du thérapeute sont
toujours droits dans la ligne de ce que le patient est en train de
transmettre (convey) », « le thérapeute voit le patient comme un
coopérateur (coworker) à un commun problème », etc. L’ensemble de
ces résultats, sur le bout positif de l’échelle, était confirmé par les
résultats exprimés sur le pôle négatif.
Dans la seconde procédure de sa
recherche, Fiedler faisait écouter à quatre « juges » expérimentés dix
enregistrements d’entretiens : quatre entretiens étaient conduits par
des individus d’orientation psychanalytique, quatre par des individus de
tendance rogérienne, et deux par des individus de tendance adlérienne,
mais la moitié des entretiens dans chaque groupe étaient conduits par
des thérapeutes expérimentés, l’autre moitié par des nonexperts. A la
suite de chaque écoute, chaque juge devait classer selon la Qtechnique
75 item de description. Les résultats des intercorrélations
montraient que les experts créaient des relations plus proches de leur
idéal que les nonexperts, qu’ils étaient plus semblables dans leur
conduite en dépit de leurs différences d’orientations que les nonexperts
de la même orientation qu’eux, que les facteurs qui différenciaient des
nonexperts se rapportaient surtout à l’habileté pour comprendre le
client et maintenir une distance émotionnelle appropriée, et enfin
qu’ils se distinguaient entre eux surtout dans le statut qu’ils
assumaient, compte tenu de leurs écoles, à l’égard du client.
D’autres études sur le comportement des thérapeutes
Beaucoup d’autres recherches
relatives au comportement et aux attitudes des thérapeutes s’inspirèrent
plus ou moins directement de la démarche de Fiedler.
Rogers a cité les travaux de Heine
et de Quinn, l’un et l’autre pour leur doctorat à Chicago en 1950, près
de Rogers. Heine part des impressions des clients euxmêmes sur leurs
thérapeutes afin de dégager ce qu’ils ont noté comme facteurs favorables
(la confiance vécue par le thérapeute, la clarification par lui des
sentiments explicités par le client) ou comme facteurs défavorables (la
distance ou une sympathie trop grande). Quinn, par contre, donna, à des
experts, uniquement des enregistrements de phrases prononcées par des
thérapeutes, sans la référence du contexte : il apprend qu’il était
possible sur ces seules phrases de juger du degré de compréhension du
client par le thérapeute ; ce qui prouvait que « c’est l’attitude
consistant à vouloir comprendre qui est communiquée ».
Fiedler poursuivit ses « études
quantitatives sur le rôle des sentiments de thérapeutes visàvis de leurs
patients » dans une publication de 1953. Rogers évoque également un
projet pilote pour l’entraînement des conseillers de santé mentale
conduit en 19601961 par Margaret Rioch et qui « tend à confirmer
l’hypothèse que ce n’est pas l’entraînement professionnel technique du
thérapeute, mais ses attitudes, qui le font efficace ou non ».
Ces travaux sont confirmés dans leurs résultats par une étude de Galatia
Halkides en 1958 : trois juges devaient écouter à quatre reprises une
bande où étaient enregistrées au hasard des séquences de 18 extraits d’entretiens
thérapeutiques, provenant de dix cas jugés satisfaisants et de dix
autres jugés moins satisfaisants, 9 pris au début et 9 à la fin du
traitement ; ils notaient chacune de 360 interactions sur une échelle de
sept points pour quatre « conditions » fondamentales (congruence, regard
positif inconditionnel, empathie, plus une correspondance à l’expression
affective qui se révéla sans intérêt) : ils obtinrent une corrélation
hautement signifiante (.80 à .90) du vécu des conditions avec le succès
de la thérapie.
Des recherches complémentaires
effectuées par Barrett Lennard, en 1959 et 1962, ajoutèrent des
confirmations, par l’utilisation d’un matériel de type « papiercrayon »,
l’« inventaire de relation » (the relationship inventory) : les
clients qui ont montré (par des tests appropriés) le plus de changement
à la suite de leur thérapie ont perçu davantage les conditions
attitudinelles chez leurs thérapeutes (et cela dès la cinquième
interview même) de façon significative par rapport aux clients qui ont
montré moins de changement.
Une autre extension des recherches
sur les attitudes des thérapeutes s’est faite au cours de programmes
d’étude sur des alcooliques hospitalisés et sur la thérapie des
schizophrènes, celleci entreprise vers 19601964 à l’université de
Wisconsin. Dans le cas des alcooliques chroniques, les auteurs, Ends et
Page, en 1957, expérimentèrent avec un groupe de clients trois
orientations thérapeutiques : une thérapie basée sur une théorie de
l’apprentissage, une thérapie centrée sur le client et une thérapie
psychanalytique. Dans leurs hypothèses, les auteurs plaçaient en tête la
thérapie du conditionnement fondée sur l’apprentissage de comportements.
Les résultats, infirmant leur hypothèse, furent plus favorables d’abord
à l’orientation centrée sur le client, ensuite à l’orientation
psychanalytique, l’orientation d’apprentissage se révélant plus nuisible
qu’utile (par référence à un groupe de contrôle). Dans le cas des
schizophrènes, le classement des attitudes des thérapeutes était en fait
sur des segments de quatre minutes d’entretien par des juges qui ne
savaient rien sur les cas en traitement. Un plus haut niveau des
attitudes des thérapeutes était positivement associé avec des
changements constructifs de personnalités, euxmêmes significativement
distingués de mesures faites sur un groupe de contrôle.
Rogers a également évoqué
l’importance des travaux de Gendlin sur une théorie de l’experiencing
chez le thérapeute, dans sa relation avec des personnes hautement
perturbées ou enfermées dans leur mutisme ; et par suite sur la mesure
d’une distance à l’expérience. Cette orientation fut appliquée à
Wisconsin, dans une comparaison entre schizophrènes et individus
normaux. Plusieurs thérapeutes devaient s’occuper chacun de trois cas :
un cas de schizophrénie aiguë, un cas moyen et un client normal. Nous en
reparlerons plus loin.
Nouvelles recherches « du côté » du client
Nous avons déjà évoqué
l’utilisation de la Qtechnique pour les études de la perception du moi.
On peut compléter ces indications en regardant l’étendue du champ des
recherches qui ont été consacrées à étudier l’évolution des clients et
la stabilité des changements mesurables dans leurs comportements.
Tout d’abord la Qtechnique a pu
être employée auprès des clients selon diverses modalités indépendamment
ou en combinaison avec des instruments de mesure plus classiques (et
généralement très étalonnés). On notera, parmi ceuxci, tout d’abord des
tests projectifs tels que le test de Rorchach, le thematic
apperception test (tat
de Murray), et d’autres tests d’exploration (l’inventaire d’adaptation
de Bernreuter ; l’inventaire de personnalité multiphasique de
Minnesota ; le test d’association de mots de KentRosanoff ; le test
d’attitudes affectives de Hildreth, le test de phrases à compléter de
Stein).
Des mesures comparatives ont été
effectuées, d’autre part, avec des instruments tels que des échelles
d’attitudes existantes ou aménagées. L’échelle EmotionMaturité de
Willoughby (E.M. Scala de 1931 qui servit à une importante étude de
Rogers conduite à Chicago) ; l’échelle SoiAutrui dérivée par Jenkins de
l’échelle construite en Californie par Adorno, pour mesurer
l’ethnocentrisme. Cette échelle est structurée en huit souséchelles
(mesurant respectivement l’ethnocentrisme, c’estàdire l’attitude à
l’égard des noirs, des juifs et des minorités américaines ;
l’orientation politicoéconomique ; les tendances au fascisme ; les
tendances à l’indépendance et à l’autoritarisme ; les attitudes à
l’égard du leadership ; l’acceptation ou non des différences d’opinion ;
les croyances à l’égard de la démocratie ; le désir de changer les
autres).
Diverses échelles d’attitudes, ou
de développement au profit de l’évaluation par des thérapeutes ou des
juges objectifs ont également été construites au cours de leurs
recherches, par les membres de l’équipe de Rogers ou Rogers luimême.
Ainsi l’échelle de santé mentale (mental health scale) a été
construite par Eve John en vue d’analyser les résultats du
tat :
elle comprend vingtcinq souséchelles en sept points permettant de
classer les attitudes aux niveaux relatifs des autres, à soi, à la
société, aux domaines principaux de la vie et aux niveaux de tension et
d’énergie ; les sept points de la plupart des souséchelles ont été
dérivés des stades de développement psychosexuel, classiquement retenus
par la psychanalyse (stades autistique ; oral suçant, oral mordant ;
anal expulsant ; anal possessif ; phallique ; et génital).
De même l’échelle de classement des cas (Rating scale) en dix
souséchelles de neuf degrés, a été élaborée par Nathaniel Raskin et
Julius Seeman (avec l’aide de l’équipe du centre de counseling de
Chicago) : cette échelle permet de situer le jugement des thérapeutes
sur les clients en début et en fin de cure, comme critère de mesure d’un
changement thérapeutique, et de corréler ces jugements avec des
résultats obtenus par les clients à des tests objectifs.
D’une façon générale, Rogers et son équipe trouvèrent que « la
psychométrie souffre d’une réelle pénurie de tests à évaluer le
comportement ordinaire, quotidien ».
Outre les instruments de mesure
précédents, l’équipe de Rogers a utilisé des tests de situation (émanant
de jeux de rôle, notamment utilisés par Gordon) ou plus généralement des
tests sociométriques (tel que le test « devine qui » ou le test
sociométrique de Fleming dans lequel on demande à des individus
d’indiquer les noms de personnes avec lesquelles ils feraient quelque
chose de défini).
On n’oubliera pas non plus des
recherches sur des caractéristiques physiologiques qui seraient
mesurables objectivement et qui pourraient servir à évaluer les
changements qui se produisent à la suite d’un traitement thérapeutique.
William Thetford, à Chicago, pour sa thèse vers 1949, a effectué des
mesures physiologiques variées relatives au réflexe psychogalvanique de
la peau, au pouls et à la respiration, sur dixneuf personnes qui
suivaient des thérapies individuelles ou en groupe (ou les deux). Il
enregistrait ces mesures (sur ces phénomènes échappant au contrôle
conscient) alors que les personnes étaient soumises à des situations
standardisées de frustration (échecs provoqués sur une tâche de mémoire
arithmétique), avant et après la série des entretiens de thérapie et il
procédait de même avec un groupe de contrôle de dixsept personnes ne
suivant pas de thérapie. Les résultats apparurent significativement
concluants : le coefficient de récupération après frustration (recovery
quotient) résultant des mesures physiologiques était
significativement meilleur pour les personnes ayant suivi une thérapie.
On pouvait en déduire qu’une thérapie rend capable de supporter et de
compenser plus facilement des situations de choc émotionnel et de
frustration, même non évoqués pendant la thérapie : le contrôle
organismique se fait plus souplement.
Rogers a signalé les travaux de
Seeman recherchant si la thérapie affecte la perception des individus.
Il a luimême souvent confronté les résultats des recherches de son
groupe avec des travaux expérimentaux notamment les travaux d’Olds
(1955) réalisant des impressions de plaisir chez des rats par des
stimulations électriques et surtout ceux de l’université Mac Gill au
Canada, en 1954, où la suppression de stimulations sensorielles
produisait chez des individus des hallucinations fortes et des réactions
anormales.
Il devait entreprendre à
l’université de Wisconsin, avec les docteurs R. Roessler et
N. Greenfield un programme de recherche expérimentale visant à mettre en
évidence les corollaires physiologiques et psychoneurologiques de la
thérapie centrée sur le client. La comparaison des mesures enregistrées
du réflexe psychogalvanique, de la température et du pouls du client,
avec les contenus de ses verbalisations était conçue en vue de permettre
une meilleure compréhension des facteurs physiologiques du processus de
réorganisation personnelle.
L’étendue des moyens techniques,
des méthodes objectives et des références expérimentales mis
progressivement en œuvre dans la recherche sur le client, en concurrence
la plupart du temps avec la Qtechnique, invite à réfléchir aux besoins
d’organisation qui se sont développés rapidement. Les apports
organisationnels de Rogers pour la recherche sur la thérapie et les
relations humaines se sont révélés très importants. Non seulement
les études les plus variées ont été effectuées par ses assistants et ses
étudiants ou des collègues travaillant autour de lui en expérience de
groupe intensif, sans préséance, mais encore elles ont été conçues et
traitées de plus en plus selon des plans concertés avec des contrôles
multiples apparentés aux méthodologies agronomiques qui avaient fasciné
Rogers, dans sa jeunesse, en raison de leur naturalisme rationnel.
Les plans méthodologiques
Pour caractériser le genre
d’entreprise expérimentale que Rogers anime, on peut décrire le
programme de recherche déterminé en automne 1949 au centre de
counseling de Chicago. Ce programme fut défini comme l’organisation
planifiée (planning) d’une série intégrée d’activités de
recherches focalisées sur un problème central et employant un nombre de
chercheurs pour plusieurs années.
Ses objectifs étaient triples :
— l’étude fouillée de la dimension interne de la
thérapie — découverte des lois de la relation (lawful relationships)
inhérentes au processus de la thérapie et qui interviennent dans la
réorganisation de la personnalité en thérapie ;
— l’investigation de la dimension externe de la
thérapie — la découverte des corrélations du processus thérapeutique
dans les champs les plus larges possible, psychologiques,
physiologiques, sociologiques de l’individu ;
— la relation de ces constats à la théorie de la
personnalité et au savoir présent sur la personnalité.
Le groupe de recherche, pour cette
entreprise d’approche multidimensionnelle de la personnalité et des
comportements en thérapie, a compris de quinze à trentecinq personnes
(dont dix avec des fonctions continues). A ce groupe s’ajoutait un grand
nombre d’étudiants, de troisième cycle, qui accomplirent des tâches
spécialisées notamment en travaux statistiques, en passation de tests
(une vingtaine de thèses devaient sortir de ces travaux vers 1954). Des
consultants, des professeurs de l’université, participaient également au
programme. Il n’y a pas eu de directeur de ce groupe : « Il a fonctionné
de telle manière que tous les participants se sont sentis libres
d’assumer un leadership fonctionnel toutes les fois que la qualité de
leur contribution le légitimait… La structure organisationnelle du
groupe de recherche a été en changement permanent ».
C’était un mode « flexible », « fluide », de fonctionnement où la
liberté de critique était complète, sans distinction de rôle et de
hiérarchie. Tout projet présenté par un participant pour être incorporé
à l’entreprise, devait formuler une hypothèse reliée à un corps
théorique explicite, la traduire en termes opérationnels, sélectionner
des instruments de validation, prendre en considération les problèmes
d’échantillonnage et de contrôle. Le programme se développa sur ces
bases « comme n’importe quel développement organique, avec toutes les
phases de la croissance — le bouton, la fleur épanouie et le spécimen de
musée amoncelant de la poussière dans une cage vitrée ».
Ce groupe au travail eut non
seulement à affronter de difficiles problèmes de précaution et
d’éthique, mais également des problèmes de durée et de masse, en raison
du poids des matériaux rassemblés. Pour chacun des cas de thérapie
étudiés (compte tenu du cas de contrôle qui lui était associé), il
fallut compter, en effet, près de sept cents heures rien que pour réunir
les données (entre les durées d’entretien, les notations, les passations
de tests et les transcriptions de tests et d’enregistrements). Le
matériel fut réuni avec un soin méticuleux : il importait, en effet, que
le programme de recherche, dans sa variété multidimensionnelle, fût lié
en cohérence par l’utilisation d’une seule population, d’un seul
block de clients considéré comme une « unité ».
On conçoit l’importance des précautions avec lesquelles ce Block I
(I pour l’université de Chicago, mais aussi pour tout le champ des
recherches en thérapie et en relations interpersonnelles) fut constitué.
L’échantillon de population fut
recruté, après entretien initial, parmi la clientèle du centre de
counseling de Chicago. On chercha à ce qu’il fût représentatif de
cette clientèle, quant au sexe, à l’âge, au fait d’être étudiant ou non,
tout en étant tiré au hasard. Les procédures de propositions et de
définition furent complexes : il fallait tenir compte de la priorité de
la thérapie, des relations à certains thérapeutes, des possibilités de
différer ou non la thérapie, d’accepter ou non les tests, de poursuivre
ou non la thérapie.
Finalement, le « groupe
expérimental » (ou « groupe de thérapie ») comprit vingtneuf clients non
sélectionnés, entre vingt et un et quarante ans (âge moyen vingt sept
ans), qui eurent au moins six entretiens de thérapie : 17 hommes, 11
femmes ; 18 étudiants et 10 non étudiants ; pour le statut
socioéconomique, une personne de très bas statut, six de bas statut,
dixneuf de moyen statut, et deux de statut élevé. En fait, parmi ces
vingthuit clients, le nombre moyen des entretiens fut de trente et un,
les bornes extrêmes étant de dix et de cent huit, sauf pour un cas qui
continuait en 1954 après cent soixantehuit entretiens. S’il y avait
parmi ces personnes des cas difficiles, la moyenne des clients se
situait autour d’un client typique, de classe moyenne, organisé
défensivement et tentant de rationaliser et de minimiser ses problèmes,
en hésitation sur la recherche d’une aide thérapeutique. La moitié de
ces clients fut mise en « attente » de la thérapie et passa une batterie
de tests une première fois deux mois et une seconde fois quelques jours
avant le début de la thérapie. L’autre moitié répondait aux tests
uniquement quelques jours avant la thérapie. Pour tout le groupe
expérimental, la même batterie fut proposée ensuite à la fin de la
thérapie, puis six mois et un an après celleci.
La batterie comportait le
tat, l’échelle
EmotionMaturité, l’échelle SoiAutrui, un test situationnel de jeu de
rôle et un test spécial de Qtechnique, ainsi qu’un questionnaire
d’histoire personnelle (pour des identifications socioéconomiques) ; le
client donnait également le nom de deux amis le connaissant bien et qui
pourraient le classer sur l’échelle EmotionMaturité.
Tous les entretiens des clients
étaient enregistrés ; après le septième entretien (puis, s’il y avait
lieu, après le vingtième, le quarantième, etc.) les clients repassaient
le test de Qtechnique. Après la passation de tests, six mois et un an
audelà de la thérapie, les clients avaient deux entretiens de follow
up, enregistrés. L’un de ces entretiens était conduit par
l’administrateur des tests, ignorant comment le client avait vécu sa
thérapie ; il l’interrogeait sur sa réaction à l’expérience de thérapie,
et sur les changements qu’il percevait dans ses sentiments à l’égard de
luimême, dans sa conduite, ses relations avec sa famille et son
entourage, ce qui avait été efficace ou non dans la thérapie ; l’autre
entretien était conduit par le thérapeute. Enfin, les clients avaient à
remplir un questionnaire final où ils étaient invités à évaluer leur
thérapie, à indiquer les expériences significatives qu’ils avaient
vécues depuis, et à faire savoir s’ils avaient cherché l’appoint (ou
senti le besoin) d’une aide additionnelle.
A côté de ce groupe de thérapie, un
groupe de contrôle était constitué. Il comprenait vingttrois personnes
entre dixneuf et quarantequatre ans (âge moyen vingtsept ans) : 12
hommes, 11 femmes ; 12 étudiants, 11 non étudiants ; pour le statut
socioéconomique, 4 de bas statut, 16 de statut moyen et 3 de statut
élevé. L’appariement (matchage) avec les individus du groupe de
thérapie était donc satisfaisant. Ces personnes étaient choisies au
hasard compte tenu des critères d’appariement, parmi des volontaires
pour participer à une recherche sur la personnalité. La moitié d’entre
eux subissait les tests dans les mêmes conditions (notamment de temps)
que la moitié des clients du groupe de thérapie qui avaient subi
l’attente de 60 jours, l’autre moitié comme les autres.
Le modèle général du Block I
était finalement défini comme suit :
|
Groupe de thérapie |
 |
sousgroupe avec attente
sousgroupe sans attente |
tests à deux mois
|
tests en thérapie
|
tests à six mois
tests à un an
tests à six mois
tests à un an
|
|
Groupe de contrôle |
 |
sousgroupe avec attente
sousgroupe sans attente |
tests à deux mois
|
tests
|
tests à six mois
tests à un an
tests à six mois
tests à un an
|
La constitution des quatre
sousgroupes avait pour but de contrôler s’il y avait des
caractéristiques significatives dans les résultats aux tests : il
fallait isoler la thérapie comme variable indépendante, et s’assurer que
des évolutions chez les individus ne provenaient pas simplement de la
participation à un projet de recherche ou de la passation des tests ni
même du temps ou des influences environnantes. Les tests étaient
d’ailleurs présentés avec soin à chaque personne, individuellement,
selon les procédures cliniques usuelles, l’« examinateur » restant
toujours dans la pièce avec le sujet même pour des tests remplis seuls
et prenant des notes sur le comportement par rapport aux tests. Le
tat et le jeu de rôles
étaient enregistrés. La passation était faite dans le même ordre et
achevée en deux sessions de trois heures, séparées par moins de cinq
jours. Les « examinateurs » étaient des personnes établissant des
relations chaleureuses avec leurs sujets.
Outre le groupe de thérapie et le
groupe de contrôle, un troisième groupe fut constitué : il comprit
vingtcinq clients qui avaient abandonné pour diverses raisons la
thérapie avant moins de six entretiens. Ce fut le groupe
d’« attribution » (attributiongroup) dont les cas furent étudiés
séparément du Block I, afin de savoir s’ils se différenciaient
significativement de ceux des autres clients qui avaient persévéré dans
la thérapie.
Il reste enfin à parler du groupe
des thérapeutes. Il fut constitué au sein des membres du centre de
counseling, au hasard, sous réserve d’une expérience en thérapie
supérieure à un an et d’un nombre d’entretiens supérieur à 341 (nombre
moyen à l’actif des membres du centre à l’époque), et pour condition de
n’être pas gêné par l’enregistrement. Le groupe comprit douze
thérapeutes pour la thérapie des individus du groupe expérimental, dont
cinq conseillers relativement novices et un thérapeute de plus de
vingtdeux ans d’expérience (moyenne d’expérience cinq à six ans). Chaque
thérapeute s’occupa d’un nombre relativement égal de cas (huit eurent de
trois à cinq cas, et les autres de un à deux). Les thérapeutes devaient
accomplir le test de Qtechnique, à propos de chaque client, après chaque
septième entretien, en classant les item comme il prévoyait que
son client les placerait ; ils en faisaient de même à la conclusion de
la thérapie ; ils remplissaient, en outre, une échelle de classement
situant les événements de chaque thérapie, la nature de la relation et
celle du processus thérapeutique.
Sur cet ensemble imposant de
relations et de données, un grand nombre de projets de recherche
concertée fut établi. Il ne s’agissait pas d’évaluer les évolutions
thérapeutiques en termes de critères uniques et globaux tels que celui
de « succès » ou d’« échec ». Après de mûres réflexions, des variables
sensibles furent ingénieusement dégagées et mises en caractère
opérationnel ; par la formulation d’hypothèses prédictives de
changement, mesurables sur des repères définis par rapport aux tests
choisis.
Les variables de la perception de soi
Le projet n° 1 visait les
changements dans la perception du moi. Butler et Haigh avaient adapté la
Qtechnique à cet effet en construisant le « sio.
Qsort » : le Soi — Idéal du Moi — « ordinaire » Moi. Qsort. Le sujet
devait trier en neuf cas, selon une répartition quasi normale, cent
propositions relatives à des sentiments convenant plus ou moins bien à
la description de son moi, de son idéal du moi, d’un moi d’une personne
ordinaire. Les résultats de ces tris étaient explorés par des méthodes
de corrélation et d’analyse factorielle ; ils devaient permettre de
vérifier ou d’invalider des hypothèses telles que la corrélation
croissante entre les structures des classifications relatives au moi et
au moiidéal au fur et à mesure de l’avancement de la thérapie. Ce qui
fut vérifié, et de façon plus marquée pour les cas où des progrès au
cours de la thérapie avaient été décelés par d’autres voies. Ces
résultats restaient stables après la thérapie.
Rosalind Dymond utilisa la même
technique en se centrant sur le moi idéal et en isolant 74 item
qui, d’après les juges, pouvaient relever d’une étude d’adaptation. Deux
juges non rogériens classèrent 37 item comme correspondant aux
jugements qu’une personne bien équilibrée déclarerait ellemême lui être
applicables et 37 autres comme ne lui étant pas applicables.
Quatre autres juges vérifièrent l’accord, qui était considérable, entre
les deux juges : cette double répartition en jugements applicables et
non applicables (ce choix étalon) situait opératoirement la définition
d’un « type idéal » de personne équilibrée ou ajustée. Le « score
d’ajustement » pour chaque individu du Block I, était alors
calculé en comptant simplement le nombre des 74 item qu’il
plaçait conformément au choix étalon : c’estàdire ceux des item
« semblables à moi » sur les tas de tri 5, 6, 7 et 8, et des item
« différents de moi » sur les tas de tri 3, 2, 1 et 0, dans la
description structurale de son idéal de moi. Ce score pouvait aller de 0
à 74.
Les résultats analysés par Rosalind
Dymond sont très intéressants. Par l’absence de variation dans des
groupes de thérapie ou de contrôle en attente, on constate d’abord que
la motivation pour la thérapie n’influence pas la variable étudiée. Dans
la comparaison totale des groupes expérimental et de contrôle, on
constate des différences de scores très significatives au départ, avant
thérapie, indiquant bien un moindre niveau d’ajustement des sujets
s’engageant en thérapie ; mais ce niveau se relève notablement au cours
de la thérapie et ensuite, selon des changements significatifs (.01
degré de significativité se rapprochant du niveau des individus
normaux).
Le tableau III que donne Dymond
est particulièrement parlant. On notera que les résultats de changement
pour les femmes ont été significativement plus importants, ce qui
suggère une efficacité plus grande de la thérapie pour elles.
Tableau III
|
Passation du Qtechnique
|
Groupe expérimental
|
Groupe de contrôle
|
|
Scores |
Score moyen |
Ecarts |
Score moyen |
Ecarts |
|
Avant thérapie |
29 |
11 à 42
(pour 25 pers.) |
45 |
27 à 60
(pour 23) |
|
Après thérapie |
40 |
18 à 54
(pour 25) |
45 |
27 à 56
(pour 23) |
|
Dans la suite |
38 |
17 à 53
(pour 22) |
44,5 |
22 à 58
(pour 17) |
Les variables relatives à l’adaptation (Adjustment)
Le projet n° 2 devait étudier les
changements produits dans la personnalité totale et l’adaptation
personnelle avec l’aide du tat. Les hypothèses à vérifier étaient que les changements de
la personnalité allaient dans la direction d’un ajustement, que les
clients après la thérapie percevraient et décriraient leurs relations de
façon plus mûre et enfin qu’à la suite de la thérapie, il y aurait une
plus grande congruence entre les perceptions que le client aurait de lui
par la Qtechnique, et le diagnostic clinique révélé par le
tat.
Ces deux dernières hypothèses
étaient explorées sur la continuité de deux cas complets par Rogers
luimême, l’un des cas était celui d’une thérapie qui s’était avérée
réussie (Madame Oak, avec 48 entretiens), et l’autre cas correspondant à
un échec (le client, Monsieur Bebb, jeune mais très perturbé, avait
marqué des progrès pendant la thérapie, mais celleci avec 9 entretiens
ayant été trop courte, il régressait ensuite). Ces deux cas étaient
également analysés avec l’aide des autres tests, qui montraient un
« surprenant degré de parallélisme » dans leurs constatations avec
celles provenant du tat et
du Qtechnique.
Dans le cas réussi, les changements
dans la conduite se révèlent concomitants ou consécutifs à des
changements dans l’image de soi. Celleci apparaît de façon centrale
comme « l’architecte » de la personnalité, la personne tendant « à
devenir, à la fois phénoménologiquement et diagnostiquement, le moi
qu’elle désirait être ».
Le moi dans ce cas est devenu largement moins défensif, plus accueillant
de certains aspects de son expérience, plus conscient de sa perception
et de ses réponses « organismiques » grâce au processus thérapeutique :
la thérapie centrée sur le client paraît objectivement produire de tels
effets en profondeur.
Le cas d’échec soulignait
l’importance d’une certaine durée pour les traitements, d’une précaution
pour le thérapeute afin d’accepter la poursuite de la thérapie et pour
ne pas expliciter trop vite son accueil de sentiments non encore
exprimés par le client.
L’hypothèse centrale sur les
changements d’adaptation était examinée par les travaux de Rosalind
Dymond en utilisant une échelle globale en sept points (de la
perturbation forte à la bonne intégration) pour caractériser les
variables d’indépendance, de créativité, d’émotion, de relation, de
conflit et de logique explicitées dans les histoires suggérées par les
20 planches du tat
(auxquelles une vingt et unième, portant une image de ce groupe, était
ajoutée). Quatrevingtdouze histoires enregistrées provenant du
Block I, furent soumises à un juge, deux fois (le coefficient de
fiabilité fut de .936). Les résultats étaient les suivants : les
histoires enregistrées avant thérapie et provenant des individus du
groupe de thérapie se plaçaient plus bas dans l’échelle que celles du
groupe de contrôle, les histoires après thérapie étaient
significativement plus élevées que celles avant thérapie, pour le groupe
de thérapie, alors qu’il n’y avait pas de changement sur l’échelle pour
les histoires du groupe de contrôle ; les scores du groupe expérimental
après thérapie n’étaient pas significativement différents de ceux du
groupe de contrôle au même moment ; les mesures au
tat et celles résultant du
Qtechnique se révélaient en parallélisme ; les classements au
tat se révélaient conformes
aux jugements des thérapeutes sur le succès des cas ; enfin des
différences significatives en faveur des femmes étaient encore mises à
jour.
Une autre étude fondée sur le
tat fut réalisée par Eve
John et Donald Grummon, en utilisant les 25 échelles de jugements
référés à des concepts psychanalytiques élaborés par Eve John. Ces
échelles exploraient au travers des histoires inventées par les clients
dans leurs passations successives, des directions d’attitudes à l’égard
de la mère, du père, de la fratrie, du conjoint, de l’entourage ; du
concept de soi, du moiidéal, de la prise de conscience ; des supérieurs,
des subordonnés, des pairs ; de l’activité sexuelle, du travail, des
activités sociales, des activités intellectuelles ; du niveau des
sources de satisfaction, du niveau de menace, du niveau de défense ; du
niveau de culture, du niveau d’intelligence fonctionnelle, du niveau
d’énergie ; du degré d’ajustement, de l’impression de diagnostic. (Deux
autres échelles étaient faites de combinaisons des précédentes.) Pour
vérifier la stabilité des jugements, douze psychologues cliniciens (dont
les deux « juges » de la recherche propre) reçurent les protocoles de
tat provenant d’un
échantillon de cinq clients d’un hôpital de Chicago ; les résultats
furent satisfaisants. Par surplus de précaution, deux juges traitèrent
23 des cas du Block I deux fois à six mois d’intervalle sur
quelques échelles délicates (ce qui permit de faire des réserves sur
l’usage de l’une d’entre elles). Les analyses montrèrent dans le groupe
expérimental un changement favorable dans la santé mentale à l’issue de
la thérapie mais aussi après au moins six mois, changement significatif
à un niveau de 5 % en plus pour la majorité des échelles ; et il était
aussi notable mais non probant en termes de moyenne de groupe par
rapport au groupe de contrôle.
Les variables relatives aux attitudes face à autrui
Le projet n° 3 avait à mesurer les
changements possibles dans les attitudes du client à l’égard d’autrui.
L’échelle SoiAutrui et un test situationnel de Gordon (pour mesurer la
réponse à autrui dans certaines situations interpersonnelles critiques)
furent utilisés.
L’hypothèse principale à mettre
sous investigation était formulée dans les termes : « Une psychothérapie
individuelle centrée sur le client produit, dans les atti
tudes du client vers autrui, des changements dans la direction d’une
plus grande acceptation et d’un respect pour autrui ».
Des définitions opérationnelles, dérivées de cette hypothèse, allaient
être vérifiées avec l’échelle SoiAutrui et le croisement des résultats
de celleci avec ceux provenant des recherches sur l’adaptation (projet
n° 1), les évaluations faites par les thérapeutes et les analyses au
tat.
Les contrôles (en utilisant le test
de Student) montrèrent qu’il y avait équivalence entre le groupe
expérimental et le groupe de contrôle, en ce qui concerne les scores sur
l’échelle SoiAutrui, et qu’il n’y avait pas eu d’influence de la période
d’attente ; ils permirent d’établir, qu’au niveau moyen, il n’y avait
pas eu de différence significative entre les deux groupes pendant et
après la thérapie. Par contre, grâce à un critère multiple de succès
dans la thérapie (établi sur les mesures d’adaptation, de Qtechnique, de
tat et de jugements des
thérapeutes), on put distinguer un groupe de 16 thérapies « réussies »
et un groupe de 6 thérapies en échec (failure) : pour le premier
groupe, le changement dans la direction prévue était mesuré par les
scores, pour le second, c’est un changement inverse qui était mesuré.
Il fallait donc réviser l’hypothèse
initiale, en introduisant trois facteurs :
— la position avant thérapie du client sur un
continuum d’acceptation et de respect d’autrui ;
— le degré selon lequel l’expérience du client en
thérapie est jugée réussie ;
— si le client est ou non dans le groupe en
attente. Et on pouvait faire deux hypothèses certaines :
1. Les clients qui se situent à peu près au milieu
du classement dans les tests avant thérapie tendront à changer dans la
direction d’un moindre extrémisme dans leurs attitudes visàvis d’autrui,
et par suite à mieux bénéficier de la thérapie.
2. Les clients qui se situent audessus ou en
dessous du rang moyen tendront à devenir plus extrêmes, devenant moins
accueillants pour autrui s’ils avaient initialement des scores élevés,
et plus acceptants, s’ils avaient initialement des scores faibles (ceuxci
tirant donc aussi bénéfice de l’expérience de thérapie). Quant à l’attente,
elle réduit les chances de succès de la thérapie et accroît les risques
d’accentuation, d’extrémisation des attitudes vers autrui (sans doute en
plaçant les individus en situation expérimentale, jugée souvent
irritante).
Thomas Gordon et Desmond Cartwright
attiraient l’attention sur les précautions à prendre pour interpréter
ces résultats, en notant que l’échantillonnage du Block I
contenait trop de gens déjà orientés dans des attitudes
« démocratiques », et qu’on ne pouvait répondre aux conséquences d’une
thérapie pour des individus hautement antidémocratiques et non
acceptants. Et ils concluent, prenant de la distance par rapport aux
concepts de démocratie et d’acceptation situés dans l’échelle et par
rapport à l’échelle ellemême, en corrigeant l’hypothèse sur l’effet de
la thérapie ; celleci doit rendre les attitudes moins extrêmes et
réduire la défensivité quand elle réussit. Une notion de
désaccentuation (deemphasize) des attitudes était évoquée, de
tendance plus dialectique que celle d’une conformité ou d’un
libéralisme : « Le mili
tant libéral peut être tout aussi inflexible, défensif, et aussi
insécurisé et instable que l’individu autoritaire ».
L’étude précédente était relayée
par une recherche de Rolland Tougas, comparant sur l’échelle
d’ethnocentrisme et sur un classement de succès ou d’échec de la
thérapie le groupe expérimental (en thérapie rogérienne) avec un groupe
analogue de 25 clients qui avaient suivi une thérapie selon
l’orientation de Sullivan. L’analyse statistique et l’interprétation
indiquèrent une limite possible à l’efficacité respective des deux
thérapies verbales en liaison avec les degrés d’ethnocentrisme des
clients. Il fut aussi démontré que les individus peuvent être
différenciés valablement pour la probabilité de leurs chances d’une
thérapie riche ou pauvre dans les limites des échantillons étudiés.
La maturité émotionnelle
Le projet n° 4 concernait l’étude
de la maturité émotionnelle dans la conduite. Rogers s’attacha à ce
projet qui appliquait l’échelle de maturité émotionnelle de Willoughby,
adaptée pour la cause.
Willoughby, en 1931, avait
construit de nombreux item décrivant la conduite et les avait
fait classer par cent cliniciens selon des intervalles indiquant les
degrés de maturité émotionnelle, celleci étant désignée comme « la
liberté à l’égard du narcissisme et de l’ambivalence ; en d’autres
termes, il s’agit d’un dégagement de l’égocentrisme, d’un achèvement des
pulsions socialisées, d’une prise de conscience ; l’acceptation
émotionnelle du principe de réalité et une condition d’“analyse” sont
aussi des synonymes approximatifs ».
Willoughby choisit soixante item parmi ceux qui avaient été
classés avec le plus d’accord entre les juges. Les item étaient
rangés au hasard, mais des scores de 1 à 9 en échelle de maturité leur
étaient associés. Par exemple, l’item 15 « le sujet demande à
être ponctuellement servi dans les hôtels, les wagonslits, etc. » avait
la valeur 2 en maturité ; l’item 17, « le sujet organise et
ordonne ses efforts dans la poursuite de ses objectifs, en considérant
clairement qu’une méthode systématique est un des moyens pour les
atteindre », avait le score 7. Rogers réincorpora dans l’échelle neuf
autres item qui avaient été classés par les cent juges, pour
accroître la variété spécialement du côté « immature » de l’échelle. Il
choisissait de se référer au jugement opérationnel, sociologiquement et
historiquement situé, de ces cent personnes, pour explorer l’évolution
possible de maturité des clients du Block I, sans jugement de
valeur subjectif, en faisant l’hypothèse qu’un changement serait
intervenu si on trouvait des différences dans les scores statistiquement
significatifs au niveau de 5 %.
Le test de l’échelle était passé
par les clients (quatre fois pour une moitié, trois fois pour l’autre),
mais on demandait simultanément à deux amis de chaque client, indiqués
par lui, de remplir cette échelle pour celuici. Pour contrôle, on
demandait à ces amis de remplir aussi le test pour une autre personne de
leur connaissance avec laquelle ils restaient en relation. Malgré
d’extrêmes difficultés, le projet n° 4 donna des résultats importants.
On trouve l’analyse serrée de ceuxci dans l’ouvrage Psychotherapy and
Personnality Change. Malgré son aspect encore « rudimentaire »
(Rogers propose des modifications pour l’avenir), l’échelle de
Willoughby apparut fiable, par rapport aux individus et par rapport au
temps (c’estàdire en l’absence d’entretien thérapeutique). On constata
des changements significatifs chez les clients dont le thérapeute avait
classé la thérapie comme devant être au moins modérément réussie : en
ces cas, apparaissait une croissance significative de la maturité dans
la conduite quotidienne de l’individu, que celleci soit jugée par le
client luimême ou par ses amis, aussi bien pour des changements subtils
du caractère que pour la façon dont il faisait les choix ou conduisait
une voiture ou se comportait dans une discussion ou lorsque ses
activités étaient interrompues.
Les recherches sur le processus de la thérapie
Dans le programme de Chicago,
d’autres projets furent encore établis et conduits, notamment en vue
d’analyser les dimensions internes des moments d’entretien
thérapeutique. Ce fut une étude capitale sur le processus de la
thérapie. Elle conduisit à de nouvelles recherches, réalisées notamment
à Wisconsin, et qui permirent à Rogers de proposer une échelle
d’évaluation des processus de thérapie sur un continuum en sept stades,
selon lequel le sujet passe de la fixité à la fluidité, « d’un point
situé près du pôle statique du continuum à un point situé près de son
pôle en mouvement ».
Pour Rogers, le premier stade se
situe dans une rigidité et une répugnance à toute élaboration de
l’expérience immédiate. A ce stade, l’individu refuse de communiquer
personnellement ; il est tributaire de schémas et n’a aucun désir de
changement.
« Quand, au cours du premier stade,
l’individu a éprouvé qu’il était totalement accepté, il passe alors au
second ».
Au cours de celuici, l’expression concernant les autres personnes
devient moins superficielle. Si les problèmes sont encore perçus comme
extérieurs à soi, ils sont cependant reconnus : « Les contradictions
peuvent s’exprimer mais sont à peine reconnues comme telles ».
Si le dégel obtenu n’est pas
bloqué, l’assouplissement de l’expression symbolique se poursuit. Dans
le troisième stade, l’individu parle de lui, de ses expériences
personnelles, mais au passé, comme s’il s’agissait d’objets. Il a encore
peu d’acceptation pour ses sentiments. Les schémas personnels restent
rigides, mais par moments peuvent être reconnus comme des schémas et non
des faits objectifs. Les contradictions de l’expérience immédiate sont
reconnues et les choix découverts comme inefficaces.
Au quatrième stade, le client
s’encourageant, décrit des sentiments plus intenses, même s’ils sont
encore situés dans le passé. L’expérience immédiate surgit parfois. Les
sentiments, les schémas se nuancent. « Le client se rend compte des
contradictions et des dissonances entre son expérience immédiate et son
moi ».
Le sujet prend conscience avec hésitation, de sa responsabilité propre.
Et il se rapproche du thérapeute avec prudence.
L’assouplissement, le dégel se
poursuivent en sorte qu’au cinquième stade, « les sentiments sont
exprimés librement comme s’ils étaient éprouvés dans le présent ».
Mais la peur et la méfiance du client demeurent encore, quoique le
client se sente prêt à accueillir ses sentiments et revendique d’être
son propre moi. L’originalité apparaît et les contradictions sont
assumées.
Les sentiments autrefois bloqués,
si l’assouplissement se poursuit, sont éprouvés immédiatement et
s’épanouissent. Le moi tend à disparaître comme objet et l’expérience
prend le caractère d’un processus. Une détente physiologique se
manifeste, quoique le client se sente coupé de son cadre de référence
habituel par dissolution des schémas. « Le client vit subjectivement une
phase de son problème », dans ce sixième stade.
Dans le septième stade, qui
survient souvent à l’extérieur de la relation thérapeutique, une
richesse de sentiments est vécue, selon une confiance solide dans
l’évolution de soi. « Les schémas personnels sont refondus
provisoirement, pour être éventuellement validés par une expérience en
cours, mais même alors, ils sont soutenus de façon moins rigide ».
Sur ce repérage, Rogers construisit
avec Rablen une échelle d’évolution personnelle en psychothérapie, à
l’université de Wisconsin, en 1958.
Cette échelle a été utilisée dans
de nombreuses recherches et notamment par Betty Meador, pour analyser le
processus de l’évolution dans un groupe de rencontre (pour une thèse de
1969 à l’université internationale des EtatsUnis). Ce chercheur partit
d’un film tourné sur un groupe qui s’était réuni cinq fois au cours d’un
weekend (au total seize heures). Il y avait huit personnes dans le
groupe, plus deux animateurs dont Rogers. Meador choisit, de façon
systématique et au hasard, des segments de deux minutes pour chaque
individu, un dans la première moitié, et l’autre dans la deuxième moitié
de chacune des cinq séances. Elle disposait donc de dix segments de film
de deux minutes, pour chaque personne, et les raccorda au hasard. Treize
examinateurs, après entraînement, regardaient ces huit montages bout à
bout, sans avoir l’ordre réel des séquences dans le temps (et sans
pouvoir arriver à les situer) : ils devaient donner un score de 1 à 7, à
chaque séance, pour chaque personne. Les scores donnés, en dépit de
certaines difficultés, se révéleront fiables entre les divers juges, et
les résultats éloquents : chacun des huit individus a témoigné, à un
degré significatif, d’une évolution allant d’un score (ou stade) 3 en
moyenne (dispersion de 2,5 à 4,4 dans la première séance) à un score 4,5
(de 3,2 à 6) dans la cinquième séance, c’estàdire d’une évolution vers
une plus grande souplesse et une plus grande expressivité. Betty Meador
put écrire : « Il est manifeste que ces individus, au départ étrangers
les uns aux autres, ont établi entre eux des relations que l’on trouve
rarement dans la vie ordinaire ».
Les recherches sur les schizophrènes
Le travail considérable accompli
avec plus de deux cents participants de la recherche, pendant cinq ans,
à propos du traitement de schizophrènes, à Wisconsin, offre également
des exemples de procédures subtiles et de méthodologies pleines
d’enseignements. Cellesci sont dans le prolongement des dispositifs mis
en œuvre à Chicago. Nous nous bornerons à indiquer les formes les plus
nouvelles, relatées dans l’énorme ouvrage The Therapeutic
Relationship and its Impact.
Au niveau de l’échantillonnage des
individus, on notera tout d’abord une double innovation. Le « bloc » ou
design de la recherche sur 48 individus, comprenait 16 individus
normaux, alors que les 32 autres étaient des schizophrènes (16 de
caractère aigu et 16 de caractère chronique).
L’inclusion des « normaux » dans la population étudiée devait servir
à tester l’hypothèse que l’évolution de la personnalité en
reconstruction suit un processus universel en toute personne,
qu’elle soit réputée psychiquement psychotique, névrotique ou bien
portante. Ces normaux furent pris parmi des personnes volontaires,
appartenant à plusieurs organisations et à des groupes d’employés, en
vue de participer à une « recherche sur la personnalité » (sans savoir
que certaines d’entre elles se verraient offrir une psychothérapie).
Les 48 personnes furent choisies
pour représenter équitablement dans chaque sousgroupe de 16, les
diverses variables (sexe, âge, par rapport aux moyennes de l’hôpital,
niveau socioculturel défini par rapport au passage ou non en deuxième
cycle du secondaire) ; elles furent également soigneusement appariées
deux à deux. Par tirage au sort, il fut ensuite proposé une thérapie à
24 d’entre elles, dont huit personnes normales ; les autres
formèrent un groupe de contrôle. D’autre part huit thérapeutes
volontaires (variant considérablement dans leurs orientations et
dans leur façon de conduire les entretiens, mais, à regret pour Rogers,
plus ou moins de tendance centrée sur le client) ; les uns très
expérimentés, les autres plus novices
se virent confier chacun une triade en thérapie : c’estàdire un individu
normal, un schizophrène chronique, et un schizophrène plus aigu, ces
individus étant choisis pour différer sur les variables observés (par
exemple si l’un était un jeune schizophrène chronique de bas niveau
socioculturel, l’autre était une schizophrène plus âgée de caractère
aigu et de haut niveau socioculturel, et le troisième était un jeune
homme normal de bas niveau socioculturel). La formulation des choix des
divers échantillons de population présenta, comme on le devine, de
multiples difficultés et complexités en vue d’assurer des définitions
aussi claires que possible des caractéristiques ; elle exigea une
collaboration étendue avec les médecins de l’hôpital de Mendota. Cette
collaboration, qui fut ultérieurement reprochée à Rogers par certains,
comme le note Brian Thorne, fut nécessaire également pour faire
dispenser de l’usage des tranquillisants les patients de la recherche
(sauf dans les cas d’urgence, sur la décision du médecin de garde) :
afin de mieux percevoir les changements de comportement et de laisser
aux individus leur expérience émotionnelle nécessaire au processus de
psychothérapie. Enfin, pour des raisons pratiques, les thérapeutes
eurent souvent à s’entretenir avec d’autres patients que ceux qu’ils
suivaient : il en résulta des possibilités fructueuses de comparaison.
Le plan d’expérimentation comporta
des passations de tests pour les 48 personnes (au début de la recherche,
puis tous les trois ou six mois). La batterie utilisée comprit le
Minnesota Multiphasic Personnality Inventory, le Rorschach, le
tat (en utilisant seulement
cinq planches), l’échelle d’intelligence adulte de Wechsler, le test
d’interférence Stroop, un Qsort (sur la perception de son moi courant),
une échelle d’anxiété de Truax, et l’inventaire de relation de
BarretLennard (pour mesurer les conditions de la thérapie telles que les
perçoit l’individu). Les thérapeutes devaient de leur côté remplir
l’inventaire de relation en même temps que leurs patients, ainsi qu’une
échelle de classement des suites probables de la thérapie (après le
cinquième entretien, puis à intervalles réguliers) : les individus du
groupe de contrôle étaient invités à remplir ces inventaires par rapport
à la personne qu’ils percevaient comme la plus secourable pour eux (helping).
Les médecins de l’hôpital, quant à eux, avaient à remplir des échelles
de classement psychiatrique de Wittenborn, pour les patients du groupe
de contrôle comme pour ceux du groupe expérimental. Le personnel de
garde devait également donner à intervalles réguliers (tous les trois
mois) des informations sur les changements perçus dans les comportements
des malades hospitalisés. Au surplus, chacun des 48 individus était vu
en entretien (enregistré) par un seul et même interviewer, le docteur
Robert Roessler, à l’époque président du département de psychiatrie et
directeur de l’Institut psychiatrique de l’université de Wisconsin : au
début de la recherche et tous les trois mois, c’était un « entretien
d’échantillonnage » (sampling interview). Enfin, pour les 24
membres du groupe de thérapie, les entretiens thérapeutiques, qui
avaient lieu deux fois par semaine, étaient aussi enregistrés. Cet
ensemble énorme de données avait pour fonction de permettre d’étudier
les modifications de la personnalité qui résulteraient, dans les divers
cas, des conditions mesurées de la thérapie offerte, en éliminant les
évolutions accidentelles ainsi que les effets de suggestion (du genre
« place
bo » en thérapie), et en observant l’incidence de toutes les variables.
Le résultat de toutes les actions
entreprises (avec des difficultés pratiques impossibles à résumer) fut
le rassemblement d’un gigantesque matériel : outre les centaines de
passations de tests, 1 204 heures d’enregistrements. Comment traiter ce
matériel ? A l’issue d’une étude pilote, il fut décidé d’extraire au
hasard un segment de deux minutes pris dans la seconde moitié des
entretiens pour étudier les courants généraux de la thérapie, ou bien
pour des analyses approfondies, trois segments de quatre minutes pris au
hasard dans chacun des trois tiers de certains entretiens : afin
d’éviter les biais, les choix au hasard furent déterminés à l’aide
d’instructions objectives et de tables de nombres au hasard. L’équipe de
recherche obtint ainsi trois mille segments soigneusement
référencés, qui furent présentés (de façon anonyme et intemporelle) à
des juges ou évaluateurs (raters). Ceuxci avaient à évaluer, pour
chaque segment la qualité d’une des conditions de thérapie ou d’une des
autres caractéristiques de l’interaction entre les clients et les
thérapeutes, en utilisant des échelles d’évaluation spécifiques mises au
point par Rogers et ses collaborateurs. Après expérimentation, les
échelles furent révisées de manière à être utilisables, grâce à des
indications présentées en exemples gradués, par des individus
intelligents, mais sans formation psychothérapeutique :
il fut alors possible de recruter des étudiants de troisième cycle,
qui cherchaient du travail et qui acceptaient d’être engagés pour une
longue période. Pour chaque échelle d’évaluation, un petit groupe
d’étudiants (sans prévention sur ce que devrait être une thérapie et
sans information sur la population étudiée), fut entraîné à son
utilisation, et reçut la consigne d’éviter des communications entre eux
jusqu’à la fin du travail. Il y eut donc un groupe d’évaluateurs du
degré d’empathie apparaissant chez le thérapeute, mais aussi, toujours
pour celuici, un groupe d’évaluateurs de l’immédiateté de l’expérience
émotionnelle (experiencing) se manifestant dans l’expression de
chaque client ; mais aussi, pour chaque client, un groupe d’évaluateurs
du système conceptuel (personal constructs) utilisé par lui ; un
groupe d’évaluateurs de la manière d’exprimer ses problèmes ; et enfin,
un groupe d’évaluateurs de sa manière d’être en relation (manner of
relating).
Plus de 17 000 évaluations furent
ainsi produites (et leur qualité vérifiée par une ou plusieurs réécoutes
des segments évalués).
A partir des données considérables
ainsi traitées, de très nombreuses études furent réalisées qu’il serait
trop long de retracer. Elles portèrent sur l’évolution des diverses
variables chez les clients et les thérapeutes ; sur le processus
thérapeutique ; sur les changements constructifs observés ou non dans
les personnalités ; sur les suites des thérapies ; sur les effets
réciproques des rapports d’entretien chez les thérapeutes comme chez les
clients ; sur les procédures spécifiques au traitement des
schizophrènes ; sur ces cas très particuliers ; sur la signification
sociale de la recherche, et sur son rapport avec la science
psychologique.
Il y eut également une étude
originale réalisée par la confrontation de thérapeutes de diverses
orientations, discutant sur le processus de la thérapie centrée sur le
client : il s’agissait de tenter ainsi de sortir du « provincialisme »,
du ghetto, où un mouvement de thérapie ou de recherche peut s’enfermer.
Cette confrontation fut effectuée par des segments de quatre minutes
extraits à chaque cinquième du traitement, sur trois cas seulement
(menés par trois thérapeutes différents, dont un débutant et sans doute
Rogers) ; il y eut donc, pour chacun des trois cas, une heure
d’échantillonnage sommaire des enregistrements, en version sonore et en
version dactylographiée. Cette procédure donnait une image moyenne de la
thérapie, mais non la présentation des moments les plus significatifs ou
les plus profonds, ce qui offrait des risques pour le regard de
spécialistes étrangers : c’était une « aventure nouvelle » pour l’équipe
de Rogers, comme pour eux. Acceptèrent néanmoins Paul Bergman,
psychologue analysé, Spurgeon English, psychiatre, William Lewis,
psychanalyste, Rollo May, analyste existentiel, Julius Seeman,
thérapeute d’orientation centrée sur le client, Carl Whitaker, promoteur
d’une analyse centrée sur la relation dynamique. Il leur fut demandé de
mettre l’accent sur trois aspects critiques du processus thérapeutique :
quel est le mouvement, s’il en est, qui s’effectue ? Que fait le
thérapeute, qui soit favorable (helpful) ? Que fait le
thérapeute, qui ne soit pas favorable ? Leur confrontation apporta une
riche moisson de commentaires et de points de vue sur la thérapie :
Rogers en fit une étude approfondie, soulignant la convergence de tous
sur l’importance, pour le thérapeute, de la spontanéité et de la
simplicité vécues, ainsi que le dégagement de stéréotypes et contraintes
orthodoxes. Il nota l’utilité de l’accueil du client, car elle favorise
son indépendance et fortifie sa conception d’être une personne valable,
capable d’affronter la vie.
En ce qui concerne les résultats
d’ensemble de la recherche, on peut noter qu’ils parurent vérifier les
hypothèses de travail de la thérapie centrée sur le client, mais en les
affinant. Il se révélait possible d’isoler et de mesurer efficacement
certaines des qualités de la relation thérapeutique : cellesci
apparaissent avoir une grande importance pour la thérapie, notamment la
compréhension sensiblement empathique et la façon d’être perçu réel et
authentique. Cependant, il apparaît nécessaire de tenir davantage compte
de la qualité de l’interaction, de l’accord possible, entre le client et
le thérapeute. Le jugement des patients psychotiques, ou celui des
évaluateurs, à propos des relations perçues, apparut plus « utile » (et
probablement plus exact) que celui des thérapeutes (suroptimistes ou
aveugles à certains aspects). Il se vérifiait significativement que les
mêmes qualités dans la relation sont facilitatrices aussi bien pour
l’individu schizophrène que pour le névrotique ou le normal : la
relation interpersonnelle serait sans doute l’élément le plus
important pour apporter un changement dans les personnalités.
On pouvait aussi discerner des qualités dans la conduite du client en
thérapie qui seraient indicatrices de changements en instance, lesquels
s’actualiseraient dans la conscience qu’il en prendrait.
Il apparaissait aussi que les
conceptions élaborées par la thérapie rogérienne se heurtaient aux
limites présentes des institutions sociales, dans la cité, la science,
l’éducation ou les structures hospitalières, et militaient, par suite,
pour l’évolution de cellesci.
Les groupes et les systèmes pédagogiques
Audelà des recherches sur la
thérapie individuelle ou en groupe, Rogers allait s’intéresser à des
recherches sur la pédagogie, notamment sur le projet de changement
autodéterminé (ou plutôt autodirigé) dans un système éducationnel dont
il décrit les phases principales d’intervention dans Liberté pour
apprendre ?
Le programme de recherche
« ”rigoureux”, avec tous les contrôles nécessaires, fut soigneusement
élaboré », des instruments de mesure ont été utilisés, une équipe
extérieure a procédé à une première évaluation et des projets de thèses
mis en œuvre mais, comme on l’a vu précédemment,
la recherche expérimentale n’a pu être poursuivie jusqu’au terme
initialement fixé. Rogers fait état néanmoins, du travail de Shaevitz et
de Barr qui ont pu procéder à des enquêtes objectives, de l’été 1967 au
printemps 1969. Ils ont discerné dans l’application du plan de
changement autodéterminé six phases (sans accord complet avec Rogers sur
ce point) : une phase d’attente, une phase d’appréciations
différenciées, une phase de « bipolarisation » (les pour et les contre),
une phase de début de rejet, une phase d’activité réduite, une phase de
dépassement.
Les sociologues enquêteurs constataient des effets positifs sur la vie
personnelle des étudiants qui avaient participé et des réactions
négatives surtout chez les nonparticipants ; les effets étaient plus
complexes dans le groupe des enseignants et des administrateurs (ceuxci
plus sévères) ; malgré la bipolarisation, aucun départ d’enseignant ne
fut alors noté ; la participation des étudiants s’accrut, et beaucoup
d’innovations furent instituées.
A propos des groupes intensifs,
Rogers évoque alors l’étude très complète réalisée par Jak Gibb, sur les
effets des stages de formation aux relations humaines (the effects of
human relations training) : celuici a analysé 106 études (dont 7
recensions antérieures de recherche accomplies en ce domaine) ; il a
également dépouillé 123 études complémentaires ainsi que 24 thèses
récentes de doctorat, à la date de 1970. Gibb tire quelques conclusions,
que relève Rogers : « Il a été solidement démontré que l’expérience de
groupe intensif a des effets thérapeutiques » (Rogers élargit : « Des
effets psychologiques promoteurs de croissance, growth promoting
effects ») : « Des changements évidents se produisent dans la
sensibilité, dans la capacité de prendre en charge ses sentiments,
d’orienter sa motivation, dans les attitudes envers le moi, envers
autrui et dans l’interdépendance » (ces constatations rejoignent celles
de Rogers sur le processus de la thérapie centrée sur le client et sur
le groupe de rencontre). « Le témoignage des recherches est clair :
aucun fondement n’existe qui permette de faire quelques restrictions que
ce soit à la participation de quelqu’un à un groupe » (cette conclusion
est importante : elle coïncide avec le choix même de Rogers, refusant
tout « filtrage », toute discrimination réjective). « Des groupes sans
moniteur sont efficaces comme moyens de formation » (cette découverte,
note Rogers, « ouvre la voie à un usage beaucoup plus large des
groupes », notamment dans les milieux d’enseignement, et il vaut mieux
pas de moniteur qu’un moniteur prétentieux et manipulateur). « Pour
obtenir les meilleurs résultats, la formation en groupe doit être
associée à l’environnement professionnel, familial et au cadre de vie de
la personne » (on voit ici la progression du vecteur interpersonnel vers
le vecteur institutionnel, suivant le chemin où s’engage Rogers);
« D’efficaces séances de consultation, en prolongement du groupe, sont
au moins aussi importantes que ce qui se produit pendant les séances de
groupe, en ce qui concerne l’impact sur le participant » (Rogers insiste
sur l’importance essentielle du « suivi », followup, et critique
l’offre d’expériences de groupe intensif non assortie de suite ; il a
mis au point un très intéressant inventaire d’évaluation pour les
followup). « Pour obtenir les meilleurs résultats, les expériences
de formation devaient être concentrées en des séminaires d’une assez
longue durée ininterrompue » (cette considération justifie l’usage des
stages intenses et d’une durée assez longue) ; enfin, « la grosse
crainte répandue chez les personnes non averties à propos des effets
traumatisants de la formation en groupe a peu de fondement ».
(Rogers se réjouit de voir dégonfler ce « spectre » par des études
sérieuses sur le « phénomène de rumeurs » relative au travail de groupe,
notamment par une enquête auprès de 1 200 directeurs d’une association,
la Young Men Christian Association (ymca),
où circulaient des bruits alarmants et où il se révéla qu’un seul
directeur considérait son expérience comme négative, sans qu’elle
l’empêchât de travailler efficacement.)
Il faudrait, à ces indications,
ajouter de nombreuses études et recherches, actuellement encore en
cours, sous l’influence de Rogers, et relatives aux effets individuels
et collectifs des groupes.
Recherches en éducation
Comme on vient de le rappeler, une
vaste intervention de Rogers et de ses associés du Centre de recherche
sur la personne dans une institution d’enseignement de Californie, en
1967, était assorti d’un programme de recherches exigeant. Mais celuici
n’avait pu être mené à son terme : aussi malgré les résultats
démonstratifs de l’intervention, Rogers éprouva une frustration pour sa
volonté de vérification expérimentale. Celleci allait se trouver
néanmoins satisfaite par les travaux à grande échelle de divers
chercheurs aux EtatsUnis, dans plusieurs pays et notamment en Allemagne.
Il allait relater les résultats de
ces recherches dans un article de 1976, dans The Burton Lecture of
1976, à l’Université Harvard, puis dans Un manifeste
personnaliste, en 1977, enfin dans Freedom to Learn in the
Eighties, en 1983.
Après la fin des années soixante,
en effet, David Aspy et Flora Roebuck, avaient conduit pendant dix ans,
de nombreuses recherches, pour le National Consortium for Humanizing
Education, touchant cinq cent cinquante enseignants et dix mille
élèves, pour trois mille sept cents heures de cours, en premier et
second degré, à la fois dans des zones rurales et dans des villes. Ils
s’appuyèrent, pour l’étude des modalités et des habiletés
d’enseignement, sur les travaux et instruments de Bloom (relatifs
notamment à l’évaluation des progressions vers des objectifs clairement
distingués), de Flanders (permettant la mesure des interactions entre
enseignants et élèves) et de Carkhuff (proposant des échelles
d’attitudes et de processus interpersonnels) : en vue de corréler les
« conditions de facilitation » déployés par les enseignants et les
effets ou résultats obtenus chez les élèves (sur des tests de
connaissance, l’aptitude à résoudre des problèmes, l’absentéisme, etc.).
Aspy et Roebuck rassemblèrent les
résultats des multiples recherches qu’ils avaient conduites dans un
ouvrage de plus de trois cents pages, paru en 1977 sous le titre :
Les jeunes ne peuvent apprendre de la part de gens qu’ils n’aiment pas
(Kids don’t learn from people they don’t like). Cet ouvrage n’a pas
été traduit en français.
Dès la page 5, Aspy et Roebuck
précisaient leur filiation à Rogers et le choix de leurs concepts de
base dans l’ordre : empathie, congruence, regard positif, mesurés du
plus bas au plus haut niveau manifesté pour chacun de ceuxci. Et ils
formulaient leur hypothèse : « Plus les niveaux de compréhension,
d’authenticité et de respect qu’un enseignant donne à ses élèves sont
élevés, plus les élèves désirent apprendre ».
Carl Rogers notait « les légères
modifications à la définition des termes utilisés, pour les rendre
appropriés au contexte scolaire. L’empathie (E) à été redéfinie comme
l’effort d’un enseignant pour comprendre la signification que
revêt l’expérience vécue à l’école par l’élève. Les manifestations de
considération positive (PR = positive regard) ont été
définies comme les diverses façons pour lesquelles l’enseignant
manifeste du respect à l’élève en tant que personne. La
congruence (C) n’avait pas besoin d’une nouvelle définition. Il
s’agissait du degré d’authenticité de l’enseignant dans sa relation aux
élèves ».
Les échelles de Carkhuff
distinguaient, pour les trois concepts, des repérages de comportements
dans les relations interpersonnelles de l’enseignant visàvis de ses
élèves, cotés de 1 à 5. Rogers résumait les constatations auxquelles
étaient arrivés David Aspy et Flora Roebuck au terme du traitement
statistique raffiné de leurs considérables données : « Les élèves de
maîtres davantage centrés sur la personne offrent un contraste frappant
avec les élèves dont les maîtres sont moins centrés sur la personne. Ils
tiraient un plus grand profit de l’étude des disciplines
traditionnelles. Ils étaient plus portés à faire appel à leurs
structures cognitives les plus élevées, telles que la résolution de
problèmes. Ils avaient une représentation d’euxmêmes plus positive que
celle que l’on constatait dans d’autres groupes. Ils manifestaient en
classe des comportements plus actifs. Ils avaient manifestement moins de
problèmes de discipline. Ils avaient un taux d’absentéisme plus faible.
Les recherches ont même mis en évidence, chez ces élèves, une
augmentation du qi ».
Dans Freedom to Learn in the 80th,
en 1983, Rogers consacra de nombreuses pages à l’exposition des
raffinements méthodologiques et à la multiplicité des analyses
qu’avaient comportés les recherches d’Aspy et Roebuck. Il faut regretter
avec vivacité, une fois de plus, qu’aucune traduction de ces pages, pas
plus que de tous les ouvrages de recherche élaborés par Rogers et ses
équipes n’aient été publiés en français, jusqu’à présent. Il est vrai
qu’en France, quelles que soient leurs qualités, les travaux de
recherche en pédagogie n’entraînent ni le souci de leur lecture, ni a
fortiori quelque conviction fondée. Il est plus agréable, pour nombre
d’intellectuels, de donner libre cours non à l’étude des faits mais à
leur fantaisie, souvent portés à ce que Julien Benda avait appelé « la
trahison des clercs », basculant d’un « romantisme du pessimisme » à un
« romantisme du mépris ».
Le défi de recherches sur
l’enseignement devait toutefois être relevé en divers pays (Canada,
GrandeBretagne, Israël). Ce fut le cas également en Allemagne où
Reinhard et AnneMarie Tausch, à l’université de Hambourg, entreprirent
de renouveler et développer dans leur propre style, les études
AspyRoebuck. Travaillant avec leurs étudiants, ils conduisirent à leur
achèvement de nombreux diplômes et une « armée » de thèses, qui furent
publiés dans une variété de périodiques allemands. Un de leurs
assistants modifia le échelles de Carkhuff, pour les rendre plus
précises, plus détaillées.
Reinhard et AnneMarie Tausch
avaient cherché à voir si les conclusions des travaux AspyRoebuck se
trouveraient encore valables dans un autre climat culturel. La
confirmation de la généralité de ces conclusions ressortit de leur
propre et longue recherche. « Avec une conscience teutonique, observa
Rogers, ils examinèrent l’enseignement de 234 enseignants de différentes
disciplines avec des étudiants d’âges différents fréquentant des écoles
primaires, secondaires et techniques […] Ainsi, il semble vraiment se
confirmer que les éléments de facilitation dans la relation maîtreélève
font partie des conditions les plus importantes d’amélioration des
acquisitions des connaissances des élèves ».
Et ils concluaient leur étude en
observant que « si les enseignants, les parents, les psychothérapeutes,
les membres de groupes et les gens en général, pouvaient à un degré
signifiant être authentiques, empathiques et compréhensifs, traiter
chaque autre avec un chaud respect, et interagir dans des voies non
directives, les conséquences seraient substantielles. Une telle conduite
faciliterait un développement constructif de la personnalité,
faciliterait une santé psychologique, et promouvrait le développement
intellectuel […]. Malheureusement, de telles qualités semblent
relativement rares chez les personnes à présent. Il nous est évident que
seulement 10 % des enseignants traitent leurs classes selon une approche
centrée sur la personne. Si des groupes de rencontre centrée sur la
personne pouvaient être proposées à des enseignants, des formateurs, des
thérapeutes et des leaders de groupe, alors il est raisonnable de
présumer que cela influencerait grandement leur aptitude à faciliter le
changement chez les autres ».
Les recherches incitaient en effet
à mettre au point des programmes de formation relationnelle pour les
professeurs et les cadres des systèmes éducatifs. Les expé
riences réalisées dans ce domaine se montrèrent prometteuses, mais leur
extension se heurta à des résistances qui étonnèrent Rogers : « Pourquoi
un tel programme prendil une extension si rapide dans la formation des
médecins et pour quelle raison cependant, n’existetil aucun programme de
ce genre, ni autant que je le sache, le moindre désir d’un tel
programme, dans nos départements de sciences de l’éducation et nos
institutions de formation des maîtres ? ».
Rogers pensait que l’une des causes de ces résistances était l’absence
d’encouragement à l’innovation dans les systèmes d’enseignement ; une
autre pouvait être la protection institutionnelle contre l’imputation
des « dégâts » effectués sur des personnes. Il faut reconnaître
également qu’un système culturel, gardien des distances et des rapports
entre les individus, ne peut évoluer trop vite, ne peut être trop
flexible. Dans le cas français, il faut désigner également notre
propension à l’abstraction et à l’accumulation des savoirs, ainsi que
les caractéristiques du tempérament national porté à l’absentéisme et
aux distinctions séparatives, même si l’évolution scientifique et
technologique pousse au décloisonnement et à la croissance des
relations.
Sans doute, on peut reconnaître
que, malgré tant de résistances ou de lenteur dans les évolutions, des
progrès dans les systèmes d’enseignement ont été réalisés : en Italie,
en Belgique, en Espagne, comme en GrandeBretagne ou en Grèce. On sait
aussi qu’en France la finalité du système éducatif a été centrée sur
l’élève et l’étudiant, par la loi de juillet 1989 ; des essais ont été
réalisés dans les pratiques de formation initiale et continue, comme
dans la diffusion de la « pédagogie différenciée » (par définition,
soucieuse de respecter chaque élève) ; il faut aussi mentionner le
développement, encore timide, de « l’évaluation formative » soutenue par
le ministère de l’Education nationale à partir des travaux de l’Institut
national de recherche pédagogique.
On doit évoquer, enfin, la thèse
d’Ada Abraham, professeur à l’université de Jérusalem, de formation
rogérienne et psychanalytique, sur le « monde intérieur des
enseignants ». Sa recherche a utilisé un instrument de Qsort avec
60 cartes, présenté à 120 enseignants et 120 élèves. Les concepts sur le
« moi » sont reliés aux conceptions rogériennes et sont analysés avec
beaucoup d’intelligence. Ada Abraham conclut à la gravité de la crise
que vivent les enseignants : « Comment l’enseignant, cet être
énigmatique, piégé dans l’absurde de sa condition actuelle, peutil
transformer son destin, en choisir un autre, sinon en éprouvant son soi
vrai à travers l’apparence ».
Ada Abraham a également élaboré une procédure et un instrument
d’orientation rogérienne, le mispe,
matrice du soi professionnel de l’enseignant (1972).
En guise d’alerte
Nous avons détaillé, sans pouvoir
entrer dans la finesse des analyses, les modalités multiples et
obstinées des recherches auxquelles Rogers a donné une impulsion
ininterrompue et un approfondissement ou une simplification subtils.
Cette volonté de preuve,
rejaillissant en créativité de moyens proposés aux relations, est
caractéristique de l’approche rogérienne. Celleci se débat pour
accroître les chances d’une vérité ou plutôt d’une vérification : contre
ses détracteurs, ses propres doutes, ses contradictions ; pour une
signification croissante. Non que le débat soit clos : loin de là. Il en
est des recherches rogériennes comme de toutes les autres. En ce qui
concerne la psychothérapie, un examen scrupuleux permet à Neil Watson
d’assurer en 1984 : « Après vingtcinq années de recherches sur les
hypothèses de Rogers, il n’y a pas encore de recherche menée avec la
rigueur requise pour pouvoir tirer des conclusions sur la validité de
cette importante théorie ».
On peut faire remarquer, avec le grand mathématicien René Thom qu’« il
n’y a pas de définition rigoureuse de la rigueur ».
Mais il faut aussi remarquer avec Brian Thorne que « des thèses plus
modestes [en] sont ressorties solidement confortées : les qualités
d’acceptation, d’empathie et de congruence sont, pour le moins en
rapport avec l’efficacité de la thérapie et de l’enseignement ».
Mais dans le sens même de l’approche rogérienne, il faut souhaiter un
renouvellement incessant des recherches et des théories.
Chapitre XV
Relief et paradoxes
Une vie remplie de controverses et
d’honneurs, de rencontres intenses et de solitude ; un caractère
accueillant et néanmoins volontaire, obstiné ; une activité associant à
une pratique clinique, délibérément modeste, un programme de recherche
puissant et ambitieux même s’il doit être repris et dépassé ; une
démarche de liberté dégageant pour soi (et d’autres) des étapes de
croissance, avec continuité et pourtant suivant des ruptures ; une
pensée s’organisant dans l’originalité et l’économie des
conceptualisations, et cependant assimilant, unifiant des domaines de
plus en plus variés ; pour finir, une influence stimulante ou vécue
comme provoquante et insupportable, une vertu d’authenticité souvent
ressentie comme troublante, et le témoignage d’une problématique et d’un
questionnement déconcertants que l’on veut croire dépassés quand ils se
manifestent plus indépassables… Rogers en vérité ! Certains pourraient
lui voir appliqué le mot connu de Carl Barth à l’égard de Hegel : « Une
grande question, une grande désillusion, et pourtant, une grande
promesse ». Une grande promesse et une stimulante alerte ! (Pour ceux
qui se réfèrent à lui, comme pour ceux qui pourraient l’écarter !)
L’alerte centrale
Inlassablement, inexorablement,
Rogers nous interpelle à propos de notre lourdeur dans les relations ou
les sciences humaines. Il pose des questions opportunes, et
intempestives, sur notre inclination naturelle à empiéter sur autrui et
à imposer, par anxiété, des surcharges conceptuelles, affectives ou
morales. Et il ne nous laisse pas quittes de nous empâter nousmêmes dans
des complications théoriques ou pratiques. Au premier chef, son alerte
concerne donc une volonté de « nonépaississement », plus générale que
celle de nondirectivité. Et ce « nonépaississement » concerne non
seulement le domaine des conceptions et des représentations, mais aussi
celui des démarches et des rencontres : autant dire « noncomplication »
d’une part, et « nonengluement » d’autre part.
Car l’alerte est d’être alerte, en
toute perception, comme en toute opération. C’est une invitation à être
présent à sa propre conscience et à son langage intérieur, mais à
condition de rester subtil, disponible, en état d’accessibilité rapide à
tous les domaines et à tous les niveaux progressifs de l’expérience et
de la représentation, où retentissent les surprises que nous causent les
autres personnes. Les variétés, les différences, les nuances doivent, en
effet, être accueillies : « Nous ne gagnons rien à confondre des
relations différentes »,
observait naguère Rogers. Notre organisation conceptuelle ne doit donc
pas être resserrée, obsidionnale, défensive, mais ouverte à l’inattendu,
en vue de faciliter l’affinement incessant de nos possibilités de
percevoir et de recevoir. Il nous importe donc de savoir « comment
pratiquer une théorie qui ne soit pas une défense »,
ainsi que le remarque Alexandre Lhotellier.
Qu’on se retienne, par conséquent,
de tout réduire à des schémas ou modèles, ou catégorisations,
obsessionnels. Qu’on veille à ne pas se laisser prendre par « l’ankylose
des intuitions premières » dénoncée par Bachelard.
Qu’on soit vigilant pour ne pas expliquer ou construire banalement tout
rapport, toute expression, tout symptôme perçu, en recourant d’ailleurs
à des théorisations sophistiquées. Au congrès international de
psychothérapie à Barcelone, en 1958, Binswanger décrivait, selon une
précaution analogue, le mode d’expérience phénoménologique de
l’« analyse existentielle » (dont Rogers s’est reconnu solidaire) : en
ce « qu’il veut montrer la chose en question à partir d’ellemême, sans
aucune construction théorique qui lui soit étrangère ».
Le recours aux complications préétablies (et coupées d’une vérification
tangible) nous éloigne des faits. En nous encombrant, il obture
l’accueil progressif de l’indicible, plus dense et plus sûr que
le nondit, en tout échange.
Rogers nous met donc en garde
contre des formalisations qui sont d’autant plus fermées qu’elles sont
davantage conformistes et « mondaines », tarabiscotées ou
« délirantes », éloignées de leurs points de départ, et dont le mode
d’expérience, remarque Binswanger, est « discursif, élaborant par
extrapolation ».
La griserie des constructions indéfinies risque alors de cacher la
pesanteur réelle des ratiocinations : en cellesci s’épaissit un
terrorisme intellectuel et affectif, qui protège d’autrui mais qui
inhibe l’audace de la pensée. Au contraire, Rogers invite au
renouvellement des perspectives ou du langage, même s’il ne porte à
aucune précipitation ni à aucun effet de rivalité.
Son alerte, comme celle de
Binswanger, se situe notoirement en face de certaine psychanalyse, telle
qu’il la rencontre aux usa ;
mais elle s’est opposée également aux lourdeurs de démarches
expérimentalistes ; et elle s’est justifiée tout autant face aux
idéologies réductrices, qui se réclament abusivement de la pensée
marxienne. Tout effort scientifique doit se dégager du porteàfaux des
systèmes ou idéologies qui se sont surcompliqués, comme pour solidifier
leur crédibilité déliquescente et mieux stériliser leurs fondateurs.
(Que ne pourraiton dire, à cet égard, de Descartes et des cartésiens, de
Hegel et des hégéliens, de Marx et des marxistes, de Freud et des
psychanalystes, aussi bien que de saint Thomas et des thomistes ou du
Christ et des théologiens ?) Il a fallu savoir, jadis, renoncer aux
élucubrations, pourtant précises, de Ptolémée, pour consentir à
l’approche de Copernic et de Galilée, plus simple, et par conséquent,
plus économique c’estàdire susceptible de potentialités accrues devant
les faits nouveaux. Mais saiton encore le faire ? Et ne préfèreton pas
indéfiniment gloser, par prétention ? On sait ce que Nietzsche
reprochait à l’esprit de lourdeur.
Par sa volonté de noncomplication,
Rogers souhaite par conséquent conserver de l’aisance, comme un voyageur
sans bagage trop lourd, désireux d’un long périple. Gardant de la
disponibilité, il peut, en thérapie, comme Binswanger, chercher à
préserver l’équilibre de « la liberté du psychiatre et de la liberté du
malade mutuellement articulées ».
Et il a cherché un petit nombre de concepts repères à extension non
restreinte et quoique de compréhension subtile et intense. Il a éliminé
des symbolismes fascinateurs, notamment sexuels, pour un langage plus
direct. Plus généralement, et en continuité, Rogers nous inspire de
conserver à l’existence sa tonicité en nous interrogeant pour « ne pas
substituer au drame concret de l’existence quotidienne, un conflit
d’entités abstraites ».
Alexandre Lhotellier ajoute : « C’est là poser le problème d’une
épistémologie génétique en tant qu’étude de l’accroissement de nos
connaissances. Estce possible ? ».
Limites
A cette question, on peut adjoindre
d’autres interrogations, relatives aux limites possibles, nécessaires,
de l’inspiration et de la praxis de Carl Rogers.
Par son désir d’une certaine
légèreté d’approche et d’une grande simplicité de conceptualisation où
il peut se retrouver proche de courants scientifiques ou juridiques,
soucieux de principes et d’« économie de pensée »,
C. Rogers n’atil pas couru le risque de se fermer (en contradiction avec
sa volonté d’ouverture) à nombre d’apports denses qui auraient pu
élargir son horizon théorique ou le clavier de ses pratiques cliniques?
Ne s’estil pas mis en situation de rester en deçà de problématiques
essentielles [sur les plans sociologique, éthique, philosophique et
spirituel] ?
En ce qui concerne sa relative
fermeture, elle a pu lui être reprochée, même par ceux qu’il a davantage
influencés. Dans un texte récent, Max Pagès précise, par exemple :
« Rogers a eu raison de critiquer une certaine défensivité de la pensée
psychanalytique à l’égard de la relation, à tout le moins l’inadéquation
de son vocabulaire. […] Mais cela n’autorise pas pour autant à se priver
de l’apport scientifique des recherches psychanalytiques pour l’analyse
des processus psychiques, de leur genèse et de leur évolution. Il
n’autorise pas davantage à se priver des apports, à la théorie et à la
clinique des émotions, des nouvelles thérapies reichiennes et
gestaltistes, de ceux de l’analyse sociofamiliale des trajectoires
individuelles…, quelles que soient les difficultés de la mise en œuvre
conjointe de ces apports ».
Le fait de savoir ne pas se fermer
dans la spécificité de certains cas, à d’autres conceptions et d’autres
méthodes que celles de l’approche centréesurlapersonne, à des ajouts
désirables, est aussi reconnu et soutenu par des personnalités telles
que Reinhard Tausch (même si s’en indignent des rogériens plus
« puristes » comme Jerold Bozarth). « Notre pratique quotidienne »,
assuretil, « nous montre bien qu’il nous arrive, à nous thérapeutes
centréssurleclient, de ne pas aider certains de nos clients comme il le
faudrait. Cela se trouve confirmé par les résultats de diverses thèses
doctrinales entreprises dans le cadre d’un plan de recherche sur les
thérapies individuelles, portant sur environ deux cents clients, et sur
la thérapie de groupe, portant sur trois cent cinquante clients ». Brian
Thorne, qui cite ce texte, ajoute : « Tausch, qui est un des chercheurs
les plus productifs en matière de psychothérapie dans le monde, est
persuadé, pour sa part, que dans les cas où la thérapie purement
centréesurleclient ne semble pas efficace, le thérapeute ne doit pas
hésiter à proposer d’autres stratégies à son client ».
Allant plus loin, en 1993, Max
Pagès, dans son ouvrage Psychothérapie et complexité (en
consonance avec les tonalités systémiques et les thèmes de la complexité),
souligne avec force la nécessité de recourir à « un croisement de
méthodes thérapeutiques », ou à des « stratégies thérapeutiques
combinées », pour étudier et dénouer les liens selon lesquels
s’« amalgament » de façon défensive « trois systèmes » qu’il décrit :
émotionnel, discursif et sociofamilial. Une « réévaluation de la
psychopathologie et de la psychothérapie », au terme d’une recherche
approfondie « ne peut d’ailleurs s’opérer sans une confrontation de
trois disciplines, ou de trois langages théoriques majeurs, la
psychanalyse, la phénoménologie et la théorie des communications, dont
chacun est indispensable et aucun pleinement satisfaisant ».
S’il place Rogers et son approche
« compréhensive » dans le courant phénoménologique (lequel doit être
« conjugué » à la « démarche analytique »), Pagès se rapproche de son
« maître » en concevant le transfert comme « épreuve de communication »,
aboutissant dans le thérapeute à « une transmutation interne du
contretransfert ».
Et il peut alors écrire en 1996 : « Rendons donc hommage à notre maître
Carl Rogers pour avoir affirmé sans ambiguïté la légitimité d’une
approche existentielle et relationnelle en psychothérapie. Associons à
cet hommage d’autres maîtres, Freud, Reich, Marx et bien d’autres
encore. Ne retenons de leurs querelles, de leur méconnaissance mutuelle,
de celles de leur postérité, que ce qui est susceptible de fortifier
notre esprit critique, sans adhérer à des anathèmes, à des interdits et
exclusives non nécessaires ».
Nous sommes, par ce témoignage,
loin de la critique systématique d’un Jeffrey Masson (« qui avait été
psychanalyste et directeur de programmes aux archives de Sigmund
Freud ») attaquant en 1989 les fondements même de toute psychothérapie,
quelle qu’elle soit. S’il reconnaît en Rogers un être « gentil, plein de
compassion, secourable »,
s’il loue même son « désir sincère de ne pas faire d’intrusion dans le
processus de pensée de son client », il le désigne néanmoins comme
« despote bienveillant » : car la nature de toute thérapie pour Masson,
quelles que soient les précautions prises, ne peut que « déformer la
réalité du client ».
Une relation optimiste de
développement sans déformation, et de « confir
mation » sans dépendance trop affermie, s’avère pourtant possible entre
deux personnes, audelà des fermetures et des réciproques influences.
Mais les doutes restent importants, si les démarches et les
conceptualisations s’arrêtent au seuil des grandes problématiques. La
nature humaine, en profondeur, estelle fiable, constructive ?
l’insertion ou la réinsertion sociale, sontelles viables, morales ? La
personne échapperaitelle au double danger du narcissisme fermé ou d’un
engluement collectif ? Que vaut l’optimisme, même méthodologique ?
Jusqu’où peutil aller ? Et que peuton attendre d’une confiance accordée
aux individus ou à la société ? Une acceptation de l’autre estelle
acceptable ? Plus profondément, peuton ignorer le problème du mal ?
Et la thérapie ne jouetelle pas, comme Rollo May le reproche
affectueusement à Rogers (dans un célèbre échange de lettres en 1982),
avec « le fait de ne pas affronter les sentiments haineux, négatifs,
hostiles des clients, c’estàdire le mal » ?
Plus encore, le mal reconnu, pour
Rollo May, infiltre et corrompt toute la civilisation. A quoi Rogers
objecte dans sa réponse, influencée par la pensée de Prigogine que « les
perturbations actuelles dans notre société et notre monde lui semblent
annoncer une inévitable transformation sociale qui vient » : il en
résultera, comme le suggère l’ensemble des perturbations en chimie, « un
niveau d’ordre plus élevé », atteint grâce aux personnes qui se battront
« pour vivre dans le monde transformé, non des personnes moyennes (average) ».
Mais Rogers reconnaît qu’il est bien conscient que sa réponse est
« hâtive et inadéquate », même si, de leur débat, public, « des gens
peuvent tirer des pensées constructives ».
Retenue ?
Réponse hâtive ou réserve face aux
problématiques essentielles : il faut reconnaître que Rogers est resté
au seuil de la philosophie, surtout de la métaphysique, comme il s’est
tenu en retrait des questions religieuses et spirituelles. Mais auraitil
dû ou pu aller audelà de cette retenue ? Michel Serres, philosophe, nous
rappelle, en cette fin du xxe siècle
que « nous avons quitté le bien platonicien, l’âge des Lumières, la
victoire exclusive de la science classique […] Voici venu l’âge des
lueurs […] Voici l’âge des éclats et des occultations locales, l’âge du
scintillement ».
Et il vante « la pudeur de la culture, la vergogne de la vérité », ou,
comme « première obligation : la réserve ».
Car « l’homme gentil se retient. Il réserve quelque force à retenir sa
force… ».
C’est à une telle caractérisation,
baroque et non classique, qu’on peut rattacher la démarche rogérienne :
n’outrepassant pas les limites de son domaine d’expérience vécue, et se
gardant de l’enclore dans une orthodoxie rigide, qui apparût
définitive ; avec sans doute l’accueil d’une insuffisante variété des
approches relationnelles et thérapeutiques. S’il « surfe » [Californien
d’adoption] sur les grandes houles de symbolisation et de théorisation,
c’est qu’il tend à se prémunir contre une immersion trop profonde, trop
étendue, dans l’abstraction. Car l’individu concret mérite d’être
atteint : pardelà les concepts, « tout homme est une histoire sacrée »,
comme le rappelait le poète Patrice de la Tour du Pin. Présence et
distance, présenciation et distanciation ont donc à être vécues dans la
netteté, en maîtrisant les chutes ou dégâts qui peuvent se produire par
avalanche ou par engluement.
Rogers nous alerte justement sur
les impatiences ou les rétractions qui nous prennent en tout rapport,
comme en pédagogie ou en thérapie : il ne s’agit pas de deviner ou de
pousser autrui, moins encore de le précéder dans ses élaborations
existentielles, non plus que de traîner le pas ; mais il s’agit de
prendre à la lettre, sans la sacraliser, sa parole du moment,
d’accompagner sa marche, en devenant pour soi et autrui, à chaque
instant, plus réellement soimême. Il s’agit aussi bien de consentir à sa
propre pesée sur le monde, à sa puissance propre, à son pouvoir : mais
non pas au point d’enfler et de bloquer notre pression sur autrui, par
l’enflure d’un savoir ou d’un rôle englués. Jacques Ardoino reconnaît
que « l’idée clef de la clinique rogérienne est dans la capacité, ou si
l’on préfère, dans le pouvoir, ou dans la “puissance”, postulés chez le
client ».
Le pouvoir est potentiellement réparti, il est équilibré et se
retournant sur luimême, se compense relationnellement, sans fixation
monopolistique. Ce qui est plus embarrassant que facile.
Rogers nous engage, par suite, à
vivre les relations sans établir des surpressions et des surincitations
ou des distances, coûteuses, bloquantes et inutiles. Il ne s’agit pas
d’utiliser la rencontre des autres pour pérenniser leur dépendance et
annoncer en eux des approfondissements indéfinis. Fidèle à son « ami »
Kierkegaard, Rogers peut répéter avec lui que « philosopher ne consiste
pas à tenir des discours fantastiques, à des êtres fantastiques, mais
c’est à des existants qu’on parle ». Face aux personnes vivantes, il ne
saurait importer, par suite, de se tenir coi et froid, distant et
neutre. Rogers engage autrui à se dégager, se dégageant luimême tout en
s’impliquant. Il ne se dérobe pas devant des structures d’attente
sociale ; il ne se crispe pas devant la notion d’aide, et il aide ; il
n’estime pas « bons pour des goujats » le désir d’étayer autrui, et il
essaie de communiquer des moyens progressifs d’autonomisation ; il
approche avec simplicité, avec sensibilité, les individus, les groupes
ou les institutions et ne se met aucunement en retrait tactique : car il
nous invite à consentir à l’immédiateté, avec ses risques et ses
chances. Dans le même temps, il ne se laisse pas prendre par l’inertie
de la démarche, il ne se laisse pas aller à des interventions brusquées,
il ne majore pas son rôle opératoire, il tente de réduire au minimum
« la menace pour le moi de la personne »,
il est intensivement attentif à ce que la structure de la relation ne
s’épaississe pas. « Comprendre les forces subtiles qui opèrent, les
reconnaître et coopérer avec elles, exige un maximum de concentration et
l’étude soigneuse et… de rigueur des comptes rendus complets qui
découvrent le processus »,
écrivaitil dès 1942.
Lourdeur ou providentialisme
Coopérer aux forces subtiles ! Avec
rigueur, mais en souplesse : pour éviter les engluements, il n’est pas
interdit d’être adroit, sembletil nous dire, même si on accepte de
paraître gauche. Il faut beaucoup d’esprit pour accepter de ne pas se
défendre par du « brillant » ou du conflit fracassant. Rogers nous
rappelle que le sérieux d’un projet se fonde sur la simplicité, laquelle
débusque le simplisme aussi bien que la volonté d’importance ou de
domination. « Quand le but est plus modeste et qu’il est d’aider
l’individu à se libérer pour qu’il puisse décider de ses problèmes à sa
manière, alors les qualités nécessaires au psychologue sont réduites à
des dimensions humaines ».
Le mandarin doit donc être démasqué, et ses prétentions ont à être
ramenées à leur juste valeur. Cela vaut pour le chercheur, l’enseignant,
l’éducateur, le clerc, comme pour le thérapeute, et tout responsable :
pouvonsnous convenir que les rôles gagnent à être simplifiés, dégagés de
leur superfétation, démythifiés de leur magie oppressive.
Et peuton opter pour une « modestie » solide ?
Ceci ne voudrait pas dire défaut
d’ambition ou renonciation, mais plutôt une attention vigilante aux
richesses de tout instant, aux chances de tout devenir. Mais alors ce
nonengluement, au nom des forces subtiles, ne se référeraitil pas en
définitive à un « providentialisme » ? Ou bien, seraitil la maîtrise de
la lourdeur ? Il nous faut préciser sur ce point, pour analyser les
malentendus, en éducation comme en thérapie.
Tout d’abord, la désenflure des
rôles et des situations, le désengluement des structures de relations,
ne dénotentils pas une baisse d’intensité dans l’affrontement du réel.
Ardoino s’interroge : « Trop de praticiens hâtifs, et confondant
l’optimisme avec la naïveté ou la désinvolture, se satisferaient d’un
néorationalisme siégeant confortablement au sein d’une affectivité
bien tranquille. En cela, les rogériens sont en retrait sur les
moréniens. Ils ont aussi l’idée de la « rencontre » ; ils ont moins
celles du « conflit ».
En fait, Rogers n’a cessé
d’affronter, nous le savons par sa vie et son œuvre : et il est loin de
s’être procuré une « affectivité bien tranquille ». Il a précisé que son
approche n’était guère facile (not an easy road). On souhaiterait
voir démontré qu’il en est différemment pour les rogériens. Mais on peut
parier que c’est inutile : qui serait dispensé de la tension créatrice
et des oppositions inhérentes à la condition humaine ?
Il est clair, sur ce point, que
certains sociologues comme JeanClaude Passeron ont plutôt reproché aux
relations pédagogiques non directives de coûter cher et d’avoir, en
conséquence, un rendement inférieur à l’enseignement traditionnel :
« L’enseignement non directif coûte aussi, pour être efficace, plus
d’efforts et plus de travail aux professeurs comme aux étudiants, ce
dont les uns et les autres tendent à esquiver l’idée ».
Trop cher et trop incommode ou pas assez courageux et confortable : on
voit l’hésitation des critiques. En fait, les incertitudes visent le
dégonflement des allégations de conflit dans la rencontre
interpersonnelle et sociale.
Le problème est de savoir si le
« conflit » est ou non la réalité dernière et unique d’un projet social.
Déjà, traitant de l’œuvre de Lewin, Pierre Kaufmann demandait : « Pourronsnous
tenter enfin de reprendre dans un esprit relativiste le problème du
conflit ».
Ceci revient à déceler si ce conflit est conçu et vécu de façon
économique, dialectisée et créatrice, ou s’il est hypostasié en vue de
préserver des idéologies dictatoriales et bureaucratiques, conscientes
et inconscientes. Et, plus complètement, si l’engluement dans des
théories ne procède pas d’une fuite fondamentale qui permet de
cacher les vrais conflits sous des faux conflits délibérément
investis sur les lieux sociaux (comme un surcroît de jets de vapeur qui
ferait baisser la pression dans la chaudière productrice). On
comprendrait alors pourquoi Rogers dérange tant de gens.
Sur ce point, Edgar Morin
remarque : « Ce qui me frappe une fois de plus, ce sont les mutilations
qu’entraîne la pensée alternative. Chez les jeunes, les questions
politiques urgentes occultent les problèmes théoriques. Chez les autres,
les problèmes théoriques anesthésient les problèmes politiques ».
Il s’agit, dans l’alerte de Rogers, de se dégager à la fois des urgences
aveuglantes ou engluantes et de l’épaississement des théories : mais
pour mieux s’ajuster à l’évolution des temps qui nous éloigne des
oppositions conflictuelles en tout ou rien. Il importe dès lors de se
fier aux tensions réelles et non pas aux processus réactionnels,
inflammatoires, aux « stress », qui mettent en défaut l’affrontement
existentiel. C’est la relation nue qu’il faut atteindre avec rigueur,
débarrassée de ses parades défensives en surtension ou soustension et de
leurs oscillations dissuasives (par inhibition ou enflure).
On sait que Max Pagès,
approfondissant la pensée de Rogers, a exposé une conception dialectique
du développement de la relation qui donne de la tension conflictuelle
une notion unifiante : « Le conflit, si l’on réserve le mot pour
désigner l’opposition de tendances mutuellement exclusives, n’est (donc)
pas la loi des couches les plus profondes de la personnalité ».
Car, au niveau profond, dans une perspective héraclitéenne (à laquelle
Binswanger a porté une attention particulière), les termes d’un conflit
ne s’excluent pas mutuellement : « Au contraire, chacun contient l’autre
terme ».
C’est un dépassement de l’ambivalence, mais aussi une présentation des
processus de défense comme des modes de dissociation de l’unification,
de l’économie profonde de l’être. C’est par leur réaction de défense
forcée contre la relation authentique, que s’établit l’hostilité et les
conduites agressives ou l’amour fusionnel. « En refusant l’angoisse de
séparation, l’homme établit une relation close, et du même coup se ferme
la possibilité d’une relation universelle ».
Dans l’exaltation des phénomènes de conflit ou de partisanerie (de
privilégiation, comme de propriété) l’individu se replie et
s’emprisonne. Il se bute et se castre dans l’inertie fébrile. « Il est
donc équivalent de dire que l’on fuit la liberté et que l’on fuit la
séparation ».
Effet « Bunuel » !
Lobrot, de son côté, a dénoté la
récupération qui est faite des conflits pour assurer des emprises
excessives. « La bureaucratie… sort de ces conflits et se justifie par
eux ».
Et il analyse les contradictions flagrantes et les mécanismes de dépit
et de pourrissement qui poussent « à favoriser les attitudes régressives
et primitives, les réactions de dépendance, les “appels au père” ». On
ne conçoit pas d’autre solution aux menaces venant des autres
collectivités, des autres ethnies, des autres personnes que le recours à
un Pouvoir toutpuissant ennemi de tous et rétablissant, en fait, une
domination bien pire que les autres puisqu’elle supprime la liberté
humaine fondamentale ».
Daniel Hameline remarque que Lobrot dénonce ici un déplacement subtil du
« providentialisme » ; « l’intériorisation répressive du modèle
autoritaire du DieuProvidence est à la source même de l’aliénation des
personnes dans la dépendance du pouvoir bureaucratique. Ni Dieu, ni
Père, ni Maître ».
C’est sur une dénonciation de cette
nature quoique plus nuancée que repose l’alerte de Rogers : trop
d’individus s’agenouillent devant les divers avatars, les divers
« totems et tabous » de la structureProvidence. Et ils font comme si un
changement institutionnel, un remaniement des structures sociales,
entraîneraient par eux seuls un bienfait absolu, une « solution
définitive ou finale » aux difficultés de relation, aux effets de
domination et aux racismes.
Joseph Gabel a dénoncé une telle
mystification dans sa « sociologie de l’aliénation », en parlant sur
l’exemple de la décolonisation : « Celleci apparaît tout d’abord comme
une négativité créatrice et, à la différence des autres révolutions, ce
caractère négatif est inscrit ici dans la nomenclature. La tentation
surgit alors d’ontologiser cette négativité… dans les cadres de
cette ontologisation, la persistance réelle ou imaginaire de l’exadversaire
colonialiste peut devenir prétexte d’immobilisme, de régression, voire
d’ambitions impérialistes de signe contraire. Un concept historiquement
et culturellement aussi valable que celui de négritude peut ainsi
dégénérer en facteur de réaliénation à partir du moment où il se définit
comme rejet ethnocentriste global du « Blanc » ou encore s’il s’assortit
— et ce n’est pas une vue de l’esprit — de préjugé antisémite ».
Gabel précise : « Pas d’aliénation sans mystification et sans
mystification acceptée. Ce n’est pas l’Etat totalitaire qui est
aliénant, c’est la logique totalitaire, dans la mesure où elle est
acceptée, “intro
jetée”. La possibilité même d’une telle introjection, la nature de ses
mécanismes, constitue un problème angoissant et tenacement actuel ».
Dans le défi que nous fait Rogers,
la bataille peut réduire les inerties qui alourdissent les rapports
sociaux et qui raidissent ou bloquent les structures et les sociétés,
inhibant les personnes, est une bataille à recommencer toujours ; et
elle se place au cœur de chaque individu, comme à tous les niveaux et
sur toute la superficie des institutions (à commencer par celle du
mariage, de la culture et de la pédagogie). A chaque personne revient le
soin de démasquer les surcharges qui rendent obèses les théories,
dispendieuses les pratiques et bloqués en dépendance et en inhibition
les rapports à autrui ou à soimême.
Car nous pouvons comprendre
davantage que nous n’imaginons ; nous pouvons agir plus loin et plus
simplement que nous ne le croyons ; nous pouvons être plus libres et
plus mobiles, visàvis des autres ou de nousmêmes ; nous pouvons aller
audelà des limites provisoires qui nous heurtent, à condition de
consentir à ces limites pour qu’elles se défassent, et que nous les
dépassions sans les transgresser par un faux emportement. Nous pouvons
décoller du conditionnement des institutions et des structures. Et il
faut se garder du blocage par des dogmatismes et tous les « ismes » :
« Car tout mouvement qui se met à penser en fonction d’un “isme” se
trouve aussitôt si fortement appelé à réagir contre d’autres “ismes”
qu’il est, à son insu, contrôlé par eux », comme le constate Dewey.
Un nouveau point de vue
Mais cette aisance dans les
théories, cette économie dans les constructions intellectuelles, ce va
et vient continu et libre entre la pratique et la théorie (ou entre
l’affectif et l’intellectuel), le personnel et l’institutionnel, comment
pouvonsnous l’expliciter ?
Je suis porté invinciblement dans
mes réflexions sur l’immédiateté, l’économie et la structure des
concepts, le « continuisme » (au sens de Dewey) constatés chez Rogers,
et pour me signifier son alerte, à me servir d’une image empruntée, en
deçà de la biologie, au monde de la physicochimie. Et je médite sur une
situation d’être qui aurait quelque analogie avec le « point triple » ou
les « points eutectiques » étudiés expérimentalement pour une substance
ou un mélange. A une certaine température et à une certaine pression
déterminées, un corps chimique pur peut se manifester simultanément
dans sa phase solide, dans sa phase liquide et dans sa phase gazeuse, en
proportions variables et changeantes aux moindres coûts d’énergie :
c’est le point triple défini par une température et une pression
déterminées. Sur ce point d’existence,
la « communication », le passage, d’une phase à une autre est quasiment
instantané, et les trois phases au lieu de s’exclure ou de se détruire
réciproquement restent compatibles. Il en est de même aux points
eutectiques : points triples et points eutectiques manifestent ainsi une
simplicité, une unicité dans une complexité de changements incessants et
autoéquilibrés ou équilibrables à moindre prix. Leur connaissance
importe à la maîtrise des substances et de leurs mélanges.
Mais son image peut aussi être
rapprochée du problème plus profond qui se noue à la notion d’énergie.
Dans l’histoire de la science et de la pensée, celleci a rendu possible
la conception même, puis la mesure et la maîtrise, des transformations
possibles, les unes relativement aux autres, de toutes les structures
phénoménologiques. Non seulement, selon la physique et la
thermodynamique anciennes, toutes les formes de l’énergie (mécanique,
chimique, calorique, lumineuse, électrique) peuvent être transformées
l’une dans l’autre. Bien plus, depuis Einstein, la structure ellemême de
la masse peut se quantifier et se changer en énergie, et inversement ;
et les forces gravitationnelles peuvent, sans doute, être réincorporées
à un champ unitaire de toutes les autres forces, électromagnétiques
notamment. Il n’y a pas de barrière définitive, il n’y a pas de
catégorisation absolue, mais il y a poussée de transitivité sous
certaines conditions. On devine sans doute la direction de notre
démarche, rejoignant celle de Gilbert Simondon, dans sa thèse sur
l’individuation : pourquoi ne pas enrichir les modèles de l’action et de
la pensée humaine, interprétés en termes énergétiques aussi, par la
référence métaphorique à ces modèles physicochimiques, au moins dans
certaines limites ? Et notamment pour s’expliquer la démarche rogérienne.
Le lieu méthodologique à établir
opératoirement, en soi et en rapport à toute connaissance et action et
où se situer, ne seraitil pas comme un « point multiple » ou un « lieu
eutectique » (on pourrait dire aussi selon la pensée de Michel Serres,
un « point de métissage ») où communiqueraient le plus vivement et le
plus économiquement possible, les diverses phases de notre substance
d’être, en état d’échange généralisé avec tous les ordres de la
perception et de la nature. C’est une autre manière d’expliciter la
recherche de congruence, et sa signification, cela revient à établir un
mode d’exister, d’être soi, où émergeraient réversiblement
(réflexivement, ou en équilibre « indifférent ») les forces diverses qui
nous constituent et qui se transforment ou se fuient… Et par continuité
à retrouver la considération positive inconditionnelle par contact sans
rupture avec tout autrui, écouté en « solution » réciproque sans abandon
de ses différentes caractéristiques.
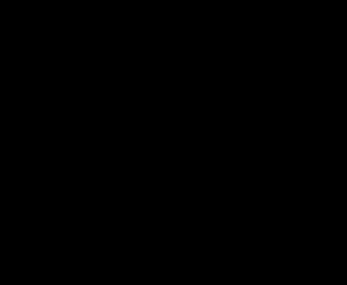
Diagramme de phase schématique pour un système à un seul composant

Diagramme de phase indiquant les phases présentes pour deux corps,
Bismuth (Bi) et Cadmium (Cd)
La découverte de ce lieu de
compatibilité profonde dans l’être humain au sein de la nature se ferait
dans une fidélité aux rappels de Freud qui nous a dégagés des tentations
de nous abstraire du monde animal, en suite de Darwin. Mais elle se
produirait aussi dans un attachement au pragmatisme qui recherche des
opérations mesurables et découvre avec ingéniosité (avec esprit) des
« variables » à saisir et réguler. Elle serait cohérente au postulat de
Simondon : « Le monisme ontologique doit être remplacé par un pluralisme
des phases, l’être incorporant au lieu d’une seule forme donnée
d’avance, des informations successives qui sont autant de structures et
de fonctions réciproques. La notion de forme doit être dégagée du schéma
hylémorphique pour pouvoir être appliquée à l’être polyphasé ».
Elle ne se séparerait d’aucune forme explorable du vécu dès qu’il
affleure en soi et qu’il se place dans des suites, en perspectives
diachronique ou synchronique, équilibrées. Si tant est que se manifeste
l’alerte de Joyce, nous invitant à découvrir « les moyens de vivre
simultanément de façon tout à fait consciente dans tous les modes
culturels ».
Avec Joyce et les commentaires à
son propos que fit Umberto Eco dans L’Œuvre ouverte,
nous pouvons retrouver l’invitation à comprendre la civilisation
nouvelle, polymorphe sinon polythéiste, pluraliste au moins, en train de
prendre forme et force devant nous : une civilisation néobaroque,
faite de foisonnements (de phases contrastées), de métissages
(culturels et personnels), poussant au relief même les surfaces
planes (par des « trompel’œil »), naturalisant les formes
abstraites (simulacres de vignes autour de colonnes torses),
conjuguant les extrêmes (à la Victor Hugo), associant virtuels
et pragmatismes, liant des réseaux d’interaction amplifiée
entre des individus en voie de différenciation et d’homogénisation
accélérées et en rupture d’équilibre. Un nouveau monde ? En clairobscur ?
Simultanéisation et sens des paradoxes existentiels
Dans ce monde émulsionnaire, la
personne, dans son mouvement « directionnel » d’individuation, vivra des
contraintes qu’elle pourra appesantir, ou au contraire réduire : si elle
recherche la position, multiple ou eutectique, où la simultanéisation
des phases possibles est vécue « organismiquement », c’estàdire dans un
jeu délié de présenciation et de distanciation, comme en « dansant ».
La poursuite de cette position, de
ce mode d’exister revient à rechercher les dénivellations optimales
(minimales, mais non restreintes) entre les phases de soimême ou dans
les relations à autrui et aux structures (ou rôles) de toute nature. La
prise en charge organismique, en effet, réunit des réalités différentes
qui ne sont pas censurées mais non plus ségrégées. Les phases ou les
êtres ont entre eux des degrés de singularité, de différenciation, ou
comme dit Simondon, de « disparation », qui ne sauraient être ni
insignifiants ni excessifs. Il en est de la simultanéisation réalisée de
façon unifiante dans les relations, comme de l’effet de relief dans la
perception visuelle.
« Le relief intervient comme
signification de cette dualité des images ; la dua
lité des images n’est ni sentie ni perçue ; seul le relief est perçu :
il est le sens de la différence des deux données. De même, pour qu’un
signal reçoive une signification, non pas seulement dans un contexte
psychologique, mais dans un échange de signaux entre objets techniques,
il faut qu’il existe une disparation entre une forme déjà contenue dans
le récepteur et un signal d’information apporté de l’extérieur. Si la
disparation est nulle, le signal recouvre exactement la forme, et
l’information est nulle, en tant que modification de l’état du système.
Au contraire, plus la disparation augmente, plus l’information augmente,
mais jusqu’à un certain point seulement, car audelà de certaines
limites, dépendant des caractéristiques du système récepteur,
l’information devient brusquement nulle, lorsque l’opération par
laquelle la disparation est assumée en tant que disparation ne peut plus
s’effectuer ».
L’individu peut percevoir comme un
relief les structures de différentes représentations ou significations
qui le relient à autrui : sous réserve d’une vision ou d’une action qui
ne divergent ou ne convergent pas trop. L’hypermétropie à la façon
herméneutique peut ôter la vision des plans immédiats tout autant que la
myopie expérimentaliste ou idéologique troublerait les plans lointains :
en ces deux dispositions, les différences de plan (ou de phase)
deviennent des contradictions inassimilables, entraînant des
impossibilités de mise au point. L’individu voit une forme ou une autre
forme, mais non pas le relief signifiant, par rapport auquel l’action
optimale deviendrait possible.
Il importe donc qu’une personne,
dans un monde en turbulence instable, se place dans la position juste,
focale, où les changements de plans ou de phases s’effectuent de la
façon la plus mobile et d’où il est possible de se mouvoir du plus
proche vers les lointains de l’environnement ou réciproquement, sans
àcoups violents ni apparente incohérence. Mais cette réflexion peut
expliquer aussi comment, se plaçant audelà ou en deçà des positions de
« disparation » forcée ou réduite, Rogers s’est libéré de la logique
aristotélicienne des contradictions et s’est placé sur un mode d’être
paradoxal. Le paradoxe (baroque par excellence) n’est autre, en effet,
que le « relief » des différences assumées, au point de vision sans
fatigue, au point « triple » de compatibilité des phases. C’est la
saisie des oppositions, des antinomies ramenées à leurs facteurs
essentiels, dans une comparution supportée et fécondante.
Et on comprend alors comment être
centré sur un client, au point juste de la présence distance, est aussi
être centré sur soi, en « accommodation » souple, et sur tout autre. La
vision optimale libère des alternances contradictoires de la vision de
soi et d’autrui : en bien et mal, en indifférent ou altérant, en tout ou
rien, en subjectif ou en objectif. Et le thérapeute travaille non pas à
proposer les verres qui améliorent sa vue à lui, mais ceux qui, après
expérimentation, aident le client à retrouver une vue normale, c’estàdire
une vue où les différences de plans apparaissent en forme de relief et
non pas en trouble insupportable ou en alternance d’exclusivité (par
tout ou rien).
Les « disparations », les distances
ou différences ramenées à leurs écarts optimums, ni excessifs ni trop
réduits, font apparaître la structure du paradoxe si souvent évoqué à
propos de Rogers. Celuici se présente avec un sérieux candide et
cependant avec une subtilité et même une ruse (paysanne). Il établit une
méthode de modestie dans ses relations ; cependant, il pratique une
phénoménologie de l’émerveillement en cellesci. Il s’attache au
développement de la personne, et pourtant il s’emploie activement à
faciliter l’évolution des institutions.
On a relevé dans la
« compréhension » rogérienne bien d’autres paradoxes : il utilise une
technique aussi serrée, aussi précise de « nondirectivité » ou de
réverbération qui, dans le même temps, assure une relation totalement
intuitive avec autrui ? Il se fonde sur une attitude d’ouverture
totale mais, en même temps, pose des limites ?
Il y a encore bien d’autres
paradoxes : qu’estce, en effet, que la certitude que le conseiller
mettrait en acte, existentiellement, devant le client, et selon laquelle
celuici posséderait totalement la possibilité de se diriger alors qu’il
sait que le client, puisqu’il est venu le trouver, ne possède
précisément pas encore l’aptitude à s’autodiriger ? Il y a bien
contraste entre le fait et la certitude vécue ; et pourtant celleci est
assez intense pour motiver comme norme le refus de donner une direction
quelconque, un conseil appesanti au client. En quoi cette certitude
systématique peutelle au surplus coexister en conservant son caractère
d’hypothèse ? Car elle est un pari de départ, toujours difficile à
vivre, et en même temps elle se vit expérientiellement comme une
certitude. Il y a là une opposition, une tension importante.
On peut joindre aussi un autre
paradoxe fondamental : c’est que l’attitude rogérienne n’est pas une
attitude rigide, une attitude de principe, se consolidant
confortablement dans un précepte de nonintervention. Elle est au
contraire, reliée à une affectivité très chaude, à une présence, à une
confiance probe dans les sentiments, (feelings). Sur ce point,
Rogers doit être, d’une certaine manière, toujours redécouvert. Il fait
confiance aux émotions et au growth, c’estàdire à la germination,
à l’épanouissement spontané du cœur et de l’être. Et autant il vit
concrètement la confiance que cette germination se fera, autant il
vérifie avec rigueur ses attitudes, afin d’éviter de peser indûment sur
l’orientation que prendra un individu. Ainsi, conjuguetil la confiance
au spontané et la rigueur pour contrôler ce qu’il fait.
Mais le paradoxe central est situé
par Max Pagès dans la proposition que l’expérience pleinement assumée
(non « ambivalente ») des angoisses fondamentales « de la solitude, de
la séparation, de la mort, de la différence avec autrui, de l’individualité
de l’incommunicabilité avec autrui, angoisses qui s’évoquent l’une
l’autre et se symbolisent mutuellement… est, paradoxalement,
l’expérience de leur contraire. Accepter son individualité, sa
contingence, en définitive sa mort, c’est accepter de changer et
accepter de vivre ».
La reconnaissance de la valeur de la personne se fait, à la limite,
« dans une expérience pleinement assumée de nonvaleur, de contingence ».
Par cette expérience d’acceptation de l’angoisse, celleci est dépassée :
l’« inversion de mouvement » se produit, la fuite de soi se change en
découverte de soi, le dénuement devient sécurité. La dépendance peut
s’inverser en autonomie.
Paradoxes ! « Mais il ne faut pas
penser du mal du paradoxe, cette passion de la pensée, et les penseurs
qui en manquent sont comme des amants sans passion, c’estàdire de
piètres partenaires ».
Ces mots de Kierkegaard invitent à comprendre la « passion » de la
personne, la prise en charge de l’affectivité immédiate, signifiante
dans l’interaction : car « dans la forme la plus abrégée, le paradoxe
peut s’appeler l’instant ».
Nous pourrions dire aussi le « relief ».
La philosophie du non et le néopersonnalisme
On voit donc que la maîtrise des
écarts, des « disparations », saisis en forme de « relief », au lieu
optimal, peut expliquer le mécanisme de la loi d’inversion de mouvement,
formulée par Max Pagès à propos des procédures rogériennes. En ce lieu
d’intériorité ou de relation, les structurations affectives et
conceptuelles ne sont plus bloquées de façon rigide, mais elles se
trouvent dans des équilibres « métastables », selon le mot de Simondon.
Des réversibilités incessantes et ouvertes y sont possibles, et les
intégrations progressives, en « relief », s’y édifient. Aucun vecteur ou
paramètre de l’existence n’y est isolé par contrainte univoque de
solidification, ou de liquéfaction, ou de sublimation. Mais toute
démarche se régule par la coexistence contrastée et par l’équilibre de
pesée des autres démarches simultanément possibles : un développement
affectif, conceptuel ou moteur, se produisant (se polarisant) dans une
direction, ne bascule pas dans de l’indéfini (où il y aurait
« patinage » et usure), mais il est à terme compensé ; et la position de
la psyché est ramenée vers le point multiple, le lieu optimal, le point
d’ajustement où se formule une évaluation organismique, aux moindres
coûts.
En ce lieu pluraliste des
articulations rogériennes, les frontières perdent leur rigidité abrupte
et deviennent poreuses. Bachelard réfléchissant à la fois sur les
apports de la sémantique générale formulée par Korzybski (dont Rogers
s’est souvent réclamé, même s’il ne l’a pas rencontré) et sur le
postulat de « nonanalyse » d’Heisenberg en physique atomique, constate
l’impossibilité présente de maintenir « la séparation des qualités
spatiales et des qualités dynamiques dans la détermination du microobjet ».
Et il note que « la logique ne peut plus être chosiste ; elle doit
réintégrer les choses dans le mouvement du phénomène ».
Les conceptions doivent être formulées en position de transitivité ou de
transduction ; c’est un « nonélémentalisme » qui apparaît ; un
pluralisme des interprétations simultanées des phénomènes devient
nécessaire. La logique aristotélicienne, basée sur l’impossibilité de la
contradiction (laquelle était soulignée, renforcée et réifiée) doit
céder le pas à une logique plus générale, « non aristotélicienne », dans
laquelle la noncontradiction émerge avec le relief du paradoxe. C’est
une « philosophe du non » qui se développe par conséquent, et qui relève
d’une conception active de la dialectique. Bachelard remarque : « Si
nous cherchions à développer la philosophie du non correspondant aux
progrès actuels de la pensée mathématique, il nous faudrait corriger et
dialectiser un à un tous les éléments de l’intuition. On montrerait
facilement que l’intuition commune est caractérisée par un déficit
d’imagination, par un abus de principes unifiants, par un repos dans une
molle application du principe de raison suffisante ».
Et il pense à un « surrationalisme » construisant des « surobjets » :
avec croissance de l’imagination, modération des principes théoriques et
mise à l’honneur de « la raison polémique ». Permettre l’afflux des
critiques sur des intuitions ou des conceptions offertes, c’est aller
dans la voie de la science moderne : « les intuitions sont très utiles :
elles servent à être détruites. En détruisant ses images premières, la
pensée scientifique découvre ses lois organiques. On révèle le noumène
en dialectisant un à un tous les principes du phénomène. Le schéma de
l’atome proposé par Bohr il y a un quart de siècle a, dans ce sens, agi
comme une bonne image : il n’en reste plus rien. Mais il a suggéré des
non assez nombreux pour garder un rôle pédagogique indispensable
dans toute initiation ».
On ne peut s’empêcher de penser à
Carl Rogers : d’une part à cause de son usage de la négation, par la
diffusion donnée au concept de nondirectivité ; d’autre part, en raison
de l’afflux des critiques qui ont assailli les signifiants essentiels de
sa démarche et de son alerte.
En ce qui concerne les négations,
elles ne cessent de rebondir positivement à partir de l’épicentre de la
nondirectivité. Et il faut parler d’une nonmodélisation (Rogers
précise à de nombreuses reprises que les expériences pédagogiques qu’il
présente ne sont pas des « modèles à imiter », mais des « valeurs de
stimulation ».
De là, il faut aussi considérer une nonmutilation de la personne,
au cœur de la maîtrise de ses propres interventions, en même temps
qu’une nonréification en ce qui concerne les individus par
rapport auxquels elle doit dépasser la tentation de les fi
ger ou de les catégoriser. Mais il faut aussi bien désigner un projet de
nonidentification à autrui (chacun devenant davantage différent
de ses partenaires), conjoint à un projet de nondéfensivité
(Rogers me disait son accord sur cette formulation) mais également de
nonculpabilisation (si mal entendue par tant de gens, fascinés ou
exaspérés par le terme de non directif). Et il faudrait parler ensuite
de noninertie et de nonperfectionnisme et plus
généralement de nonradicalisation : en se souvenant de la
remarque de Hegel que « le savoir ne se connaît pas seulement soimême,
mais encore le négatif de soimême ou sa limite ».
Et de même pour l’action.
Nonmoralisation et
nonmanichéisme, mais aussi non laisserfaire ;
noninstitutionnalisme, mais aussi nonindividualisme ;
nonenrôlement mais aussi nonanarchisme ; nonsurrépression,
également, mais nondémobilisation pourtant. (Il est intéressant
de noter que Rogers, à notre connaissance, n’a jamais utilisé le terme
de nonviolence pourtant bien connu.)
Dans cette propagation sismologique
des négations, c’est une positivité qui est saisie essentiellement par
Rogers au sein des négations : il agit une négation de cellesci,
instaurant une dialectisation incessante. Et c’est ce qui le sépare, par
exemple, de Marcuse. Sans doute la nondirectivité et la nonrépressivité
ont des connotations semblables. Mais Marcuse tend, malgré lui, à
absolutiser la négation (selon le « grand refus ») cassant la
dialectique, alors que Rogers, dès son mouvement initial, consent aux
limites, « utilisées de façon compréhensive (help fully)
et délimitées a minimis dans un cadre de contraintes élucidées ».
Il y a plus dans leur distance :
car chez Rogers la position antidogmatique, dès l’abord limite tout
radicalisme : la construction transitive de ses concepts et de ses
projets vise à dissoudre les butées absolues et les cloisonnements. Mais
surtout, sa démarche, pas à pas, approximation par approximation,
négation niée par négation niée, déjoue les désespoirs et les fuites en
avant : le recours à la loi d’inversion de mouvement permet le
dépassement des obstructions provisoires dans la relation entre des
personnes ; les liens sociaux doivent perdre leur consistance excessive,
leur fait de dépendance, en gardant leur vertu de mise en présence
paradoxale d’énergies individuelles, qui se stimulent, par résonance. Au
pessimisme esthétique ou « intellectuelocentriste » de Marcuse répond
donc, en Rogers, la confiance d’une hypothèse expérimentalisée comme on
le sait.
Et cette hypothèse concerne, en
dernier ressort, une philosophie résolument personnaliste, accessible à
l’effusion des critiques, si, du moins par cellesci, un « sursujet »,
plutôt qu’un surobjet (et autrement qu’un surhomme) peut apparaître,
audessus de toutes les systématiques, fruits de « l’excès de la
philosophie des idées et de la philosophie des choses »,
comme le notait Emmanuel Mounier.
Rogers n’a pas connu Mounier et il
n’a pas lu, à ma connaissance, son œuvre. Sans doute aimeraitil le
propos de ce dernier : « Un existant n’est pas une cire sur laquelle on
imprime des idées, des convictions ou des consignes, c’est un mouvement
dialectique d’une pensée implicite à une pensée réfléchie, d’une volonté
sourdement et obscurément voulante à une volonté voulue, et l’idée,
l’appel, l’ordre, fussentils transcendants, doivent aller chercher au
cœur de ce mouvement les dispositions qu’ils vont combler. Il faut donc
que la pensée se fasse chair, chair d’existence, et en chaque homme
chair de son existence ».
Volonté « voulante » et « voulue »,
pensée faite « chair d’existence », et aussi « être surabondant » ou
« optimisme tragique », ces expressions ne concernentelles pas le
mouvement dialectique auquel s’est efforcé Rogers ? Celuici nous porte
défi de croire en l’homme, de soutenir la croissance du sujet (« le
sursujet » même) de l’histoire en chaque personne rencontrée pardelà la
peur petite bourgeoise d’être soimême, d’exister. Il affronte le devoir
de décloisonnement et d’échange généralisé sur lequel s’ouvre la
déclaration moderne des chances de l’humanisme et de la démocratie
renouvelés. Il nous rappelle le droit de défaire les dénivellations
inutiles. Il nous ouvre la voie d’un type de conduite « multiphasique »,
accordé au monde actuel des hautes tensions et des grands échanges. Ce
monde appelle dorénavant le plus grand nombre à une personnalisation se
développant simultanément en densité et en fluidité comme
en ouverture. Car, énonçait Paul Fraisse au
xxie Congrès
international de psychologie, à Paris, en 1976 : « L’avenir appartient
aujourd’hui à ceux qui feront appel à des tâches ouvertes et non pas
fermées, à des situations ambiguës à solutions multiples, où le plan
expérimental prendra en compte la recherche des processus d’élaboration
et la fixation des solutions ». Demande exigeante ! Et cependant, en
« retenue », Carl Rogers peut nous rappeler, selon son expression,
l’imperfection à consentir en vue de progresser : par le jeu incessant
des négations accouchées à leur positivité comme le sentait Hegel,
soulignant que « le négatif s’enfonce avec le positif dont il est la
négation ».
C’est une vision et une action
enroulées et « en relief » que nous présente Rogers, au milieu d’une
profondeur claire, plus nécessaires que jamais pour la culture et la
civilisation nouvelles en train de s’ébaucher. Je ne puis m’empêcher de
penser que son « approche » optimiste et paradoxale contient une
signification religieuse, comme il le lui fut si souvent rappelé.
Indications bibliographiques
1. Principales œuvres de Carl Rogers
1931 : Measuring Personality
Adjustment in Children Nine to Thirteen. New York, Teachers College,
Columbia University, Bureau of publications.
1937 : « The Clinical
Psychologist’s Approach to Personality Problems ». The Family, 18.
1939* : The Clinical Treatment
of the Problem Child. Boston, Houghton Mifflin.
1940 : « The Processes of
Therapy ». Journal of Consulting Psychology. 1940a, 4.
1940 : Some Newer Concepts of
Psychotherapy. Talk at University of Minnesota. December 1940b.
1942* : Counseling and
Psychotherapy. Boston, Houghton Mifflin.
1944 : « Psychological Adjustments
of Discharged Service Personal ». Psychological Bulletin. 41.
1951* : ClientCentered Therapy.
Boston, Houghton Mifflin.
1955 : « Persons or Science ? A
Philosophical Question ». American Psychologist. 10.
1957 : « The Necessary and
Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change ». Journal of
Consulting Psychology. 21.
1959 : « A Theory of Therapy,
Personality and Interpersonal Relationships as Developed in the
ClientCentered Framework ». In S. Koch (ed.) Psychology : A Study of
Science. Vol. 3 : Formulations of the Person and the Social Context.
New York, McGrawHill.
1961* : On Becoming a Person.
Boston, Houghton Mifflin.
1970* : Carl Rogers on
Encounter Groups. New York, Harper & Row.
1972* : Becoming Partners :
Marriage and its Alternatives. New York, Delacorte Press.
1977* : Carl Rogers on Personal
Power. New York, Delacorte Press.
1980 : « ClientCentered
Psychotherapy ». In A.M. Freedman, H.I. Kaplan & B.J. Sadock (eds.)
Comprehensive Textbook of Psychiatry (3rd ed.).
Baltimore, Williams & XXX. 1980a.
1980* : A Way of Being.
Boston, Houghton XXX, 1980b.
1983* : Freedom to Learn for
the 80th (Rev.
ed.). Columbia Oh, Charles E. Merrill.
1989* : Carl Rogers Reader,
Selections from the Lifetime Work of America’s Preeminest Psychologist,
Houghton Mifflin.
* Œuvres majeures, dont deux rapports de recherche
avec des collaborateurs, cités ciaprès.
2. Principales œuvres en collaboration
1946. Rogers,
C. ; Wallen, J.L.
Counseling with Return Servicemen. New York, McGrawHill.
1952. Rogers,
C. ; Roethlisberger, F.J.
Barriers and Gateways to Communication. Harvard
Business Review, 30.
1954*.
Rogers, C. ;
Dymond, R.F. (Eds.)
Psychotherapy and Personality Change. Chicago, University of
Chicago Press.
1956. Rogers,
C. ; Skinner, B.F. « Some
Issues concerning the Control of Human Behavior ». Science. 124.
1967*.
Rogers, C. ;
Gendlin, G.T. ;
Kiesler, D.V. ;
Truax, C. (Eds.)
The Therapeutic Relationship and its Impact : A Study of
Psychotherapy with Schizophrenics. Madison, University of Wisconsin
Press.
1968. Rogers,
C. ; Steven, B. Person to
Person : the Problem of Being Human. Lafayette, CA : Real People Press.
1983*.
Rogers, C. ;
Haigh, G. « I Walk Softly
through Life ». Voices : The Art and Science of Psychotherapy.
18.
1989. Rogers,
C. ; Buber, M. ;
Tillich, P. ;
Skinner, B.F. ;
Bateson, G. ;
Polanyi, M. ;
May, R. and others. Carl
Rogers : Dialogues. Boston, Houghton Mifflin.
1989. Rogers,
C. ; Stanford, R. « ClientCentered
Psychotherapy ». In Kaplan & Sadok, Comprehensive
Textbook of Psychiatry, Baltimore, Williams and Wilkins.
3. Etudes consacrées à Rogers
On trouvera une bibliographie récente, détaillée dans
l’ouvrage de Brian Thorne, traduit en français par Daniel Le Bon,
Comprendre Carl Rogers, Privat, 1994.
4. Œuvres de Rogers traduites en français
1959 : « La communication : blocage et
facilitation ». Hommes et techniques, n° 169.
1959 : « Conditions nécessaires et suffisantes d’un
changement de personnalité en psychothérapie ». Hommes et techniques,
n° 169.
1962 : « Théorie et recherche ». Dans : M. Kinget et
C. Rogers. Psychothérapie et relations humaines. Vol. I, Paris,
Nauwelaerts.
1962 : « Enseigner et apprendre ». Education
nationale, n° 22.
1963 : « La relation thérapeutique : les bases de son
efficacité ». Bulletin de psychologie, n° 17.
1966 : Le développement de la personne. (On
Becoming a Person, 1962). Traduction de Lily Herbert, préface de Max
Pagès, Dunod, Paris.
1970 : La relation d’aide et la psychothérapie
(Counseling and Psychotherapy, 1942). Traduction de J.P. Zigliara,
esf, Paris, 2 tomes.
1971 : Autobiographie (Autobiography,
1967). Traduction de Jacques Hochmann et Catherine Dubernard, Epi, Paris.
1972 : Liberté pour apprendre ? (Freedom to
Learn, 1969). Traduction et préface de Daniel Le Bon, Dunod, Paris.
1973 : Les groupes de rencontre (Carl
Rogers, on Encounter Groups, 1970). Traduction de Daniel Le Bon,
préface d’André de Peretti, Dunod, Paris.
1974 : Réinventer le couple
(Becoming Partners : the Marriage and its Alternatives, 1972).
Traduction de Théo Carlier, Robert Laffont, Paris.
1979 : Un manifeste personnaliste (on
Personal Power, 1977). Traduction de Michèle Navarro, préface d’André
de Peretti, Dunod, Paris.
5. Principales études sur Carl Rogers en français
Pagès,
M. 1965. L’orientation non directive en psychothérapie et en
psychologie sociale. Dunod, Paris (3e éd.
1986)
Peretti,
A. de. 1966. Liberté et relations humaines ou l’inspiration non
directive. Epi, Paris.
Hameline,
D. ; Dardelin, M.J. 1967.
La liberté d’apprendre. Justifications pour un enseignement non directif.
Les éditions ouvrières, Paris.
Peretti,
A. de. 1969. Les contradictions de la culture et de la pédagogie.
Epi, Paris.
Puente,
M. de la. 1970. Carl Rogers : de la psychothérapie à l’enseignement.
Epi, Paris.
Marquet,
P.B. 1971. Rogers. Ed. universitaires, Paris.
Snyders,
G. 1973. Où vont les pédagogies non directives ?,
puf, Paris.
Peretti,
A. de. 1974. Pensée et vérité de Carl Rogers. Privat, Toulouse.
Hameline,
D. ; Dardelin, M.J. 1977.
La liberté d’apprendre, situation II. Les éditions ouvrières, Paris.
Poeydomenge,
M.L. 1984. L’éducation selon Rogers, les enjeux de la nondirectivité.
Dunod, Paris.
Thorne,
B. 1994. Comprendre Carl Rogers. Privat, Toulouse.
6. Ouvrages de référence
Publié en 1995, Positive Regard : Carl Rogers and
Other Notables he Influenced, Science and Behavior Books, Palo Alto,
458 p., contient les témoignages sur Carl Rogers de neuf personnalités :
Howard Kirschenbaum, Maureen O’Hara, Arthur W. Combs, Natalie Rogers,
Haruko Touge, Akira Takeuchi, David Rogers, Thomas Gordon, Diane Dreher et
Ruth Sanford.
On pourra consulter le journal de recherche
international PersonCentered Review, notamment son numéro spécial
pour le cinquantième anniversaire de l’approche centrée sur la
personne,volume 5, numéro 4, novembre 1990.
En France, sur le plan de l’éducation, on dispose du
n° 324 des Cahiers pédagogiques, mai 1994 : Une personne,
l’élève.
Un lien est aussi établi entre les personnes
intéressées par un organisme trimestriel : Mouvances rogériennes.
|