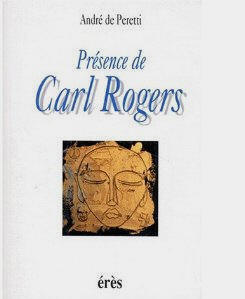|
|
|
|
|
|
Première partie |
|||
|
Présentation... Notoriété Méconnaissance et controverses Idéologies radicales et dictatures Décloisonnement et complexification dans le second demi-siècle Effondrement des dogmatismes Rogers et notre temps Pressentiments sur l’avenir Présence sans méprises Note
Préface de Carl Rogers
Première partie
Chapitre I. L’enracinement paysan Les origines rurales La famille L’école La ferme Solitude et labeur
Chapitre II. L’expatriement universitaire Au foyer Le voyage en Chine L’éloignement de la famille Amour et séminaire Une rencontre opportune : Kilpatrick L’ouverture à la psychothérapie
Chapitre III. L’orientation professionnelle En quête d’emploi Les années de Rochester La rencontre d’Otto Rank Originalité et praxis
Chapitre IV. Les débuts d’une carrière universitaire Professeur à l’université d’Etat de l’Ohio Luttes et controverses La démarche thérapeutique des années quarante Précautions, subtilité et modestie En pratique L’aube des recherches Ouverture
Chapitre V. La Counseling Center à Chicago Approfondissements à Chicago Le paradoxe d’un « temps d’épreuve" La thérapie centrée sur le client La pratique approfondie Thérapie et transfert La « rencontre » de Kierkegaard Radicalisme et pédagogie Le climat spécifique et ses phases successives Le défi à Harvard Une onde de choc
Chapitre VI. Wisconsin, ou l’apogée d’une carrière Le départ pour Madison Le dialogue avec Martin Buber La thérapie existentielle Activités durant les années de Madison L’approche thérapeutique des schizophrènes Les recherches à l’université de Wisconsin
Chapitre VII. Groupes et humanisme La Jolla Le groupe intensif Le dialogue avec Tillich L’homme et la science de l’homme
Chapitre VIII. La rencontre de l’Europe en 1966 Préparations Le séminaire de Dourdan Les évaluations sur Dourdan Le colloque de Paris Animation et contestation Non-conformisme, audace et sentiments positifs Objections ou oppositions Significations Portée des problématiques
Chapitre IX. Vers le personnalisme Activité au wbsi Une démarche pédagogique renouvelée L’enseignement autodirectionnel L’intervention institutionnelle en pédagogie Le Centre d’études de la personne (The Center for Studies of the Person Une activité renouvelée, soutenue et toujours contestée
Chapitre X. L’ouverture institutionnelle Premières rencontres institutionnelles L’Irlande du Nord Politique enfin L’approche institutionnelle Le séminaire en Espagne (1978) Le refus du phénomène religieux Maladie et mort d’Helen Afrique du Sud (1982 et 1986) « Le défi de l’Amérique centrale » (1984) « Réception enthousiaste » en urss (1986) Retour, fête et nouveau départ
|
Présentation La personne et l’œuvre de Carl Rogers ont marqué et accompagné de façon exemplaire, parmi d’autres, les évolutions culturelles et sociopolitiques du xxe siècle. Elles s’avèrent, chaque jour davantage, au-delà des polémiques ou des étonnements, signifiantes et stimulantes, utiles et incontournables, pour les temps qui viennent, dans leurs topiques et limites naturelles. Il y a, pour nos réflexions et nos actions, une présence de Carl Rogers que je souhaite donc rendre sensible et probante au lecteur : dans la mesure où sa référence peut aider à démêler les fils embrouillés des devenirs individuels et collectifs, ou désensorceler le « labyrinthe »1 où se perdent nos visions et prévisions actuelles, moroses ou en crise, accolées au concept insistant, au « paradigme » de la « complexité ». Sans doute mes propos doivent-ils intervenir en contrechamp des ignorances ou des idéalisations, des partis pris d’indifférence ou d’hostilité, des incompréhensions ou des malentendus, des imitations erronées ou des résistances renouvelées, dont les idées et les modalités d’action de Carl Rogers ont fait l’objet : notamment en France, mais aussi dans son pays, au contraire d’autres contrées. Des courants de doute ou de ressentiment (tant il a dérangé les tenants d’idées reçues) ont naturellement entravé sa démarche innovatrice, ou, par un mot dont il a contribué à faire la fortune, et pour souligner son double dessein d’avancée et de précaution, son « approche » : sans toutefois réussir à réduire sa notoriété. NotoriétéNé en 1902 à Chicago, Carl Rogers s’est éteint le 4 février 1987 à La Jolla, le jour même où une lettre aurait pu lui apprendre qu’il était proposé pour le prix Nobel de la Paix. Il avait antérieurement reçu, au
cours de sa longue carrière, de nombreuses marques d’honneur. Entre
autres, et indépendamment de multiples désignations en tant que docteur
honoris causa par des universités des deux Amériques ou d’Europe
(Leyde, Hambourg), on peut noter : la médaille d’argent Nicholas Murray
Butler (1955) ; l’admission à l’American Academy of Arts and Sciences
(1961) ; la désignation comme « humaniste de l’année », par l’American
Humanist Association (1964) ; l’hommage pour sa contribution
exceptionnelle (distinguished Contribution Award) par l’American
Pastoral Counselors Association (1967) ; l’hommage pour sa réussite
professionnelle (Professional Achievement) par l’American Board
of Pro- La citation pour la haute distinction dans le domaine scientifique mettait en 1956 l’accent sur « le développement d’une méthode originale pour rendre objectives (to objectify) la description et l’analyse du processus thérapeutique, la formulation d’une théorie vérifiable (testable) de la psychothérapie et de ses effets sur la personnalité et le comportement, et sur une large recherche systématique pour montrer la valeur de la méthode et éprouver les implications de la théorie »3. La seconde citation, en 1972, soulignait le fait que « son engagement en faveur de la personne intégrale (the whole person) a été un exemple qui a guidé la pratique de la psychologie dans les écoles, dans l’industrie, et d’un bout à l’autre de la communauté » et qui a poussé (caused) « tous les psychothérapeutes à réexaminer dans une nouvelle lumière leurs procédures »4. De son vivant, pour ses quatre-vingts ans, Rogers avait pu connaître également l’hommage éloquent qui lui était rendu, en dépit de beaucoup d’hostilité et de critiques) par ses contemporains. Une enquête sur « les auteurs et les articles et livres spécifiques […] qui avaient tenu le test du temps et qui influençaient encore le champ “de la psychothérapie” classait Rogers comme le premier dans un groupe de ceux qui avaient le plus apporté (major contributors) »5. Une autre étude, conduite par un questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des membres de l’American Psychological Association, désignait les « dix plus influents psychothérapeutes » et donnait encore à Rogers le premier rang6, avant même Freud. Commentant cette notoriété exceptionnelle, Brian Thorne7 peut remarquer : « Il apparaît comme une figure idéalisée symbolisant la “pureté” dans la méthode et aussi comme un nouvel espoir pour les gens comme pour les thérapeutes »8. On ne peut manquer non plus d’observer que Carl Rogers a publié une œuvre immense, largement traduite à travers le monde, en douze langues, et diffusée dans plus de quarante pays. La plupart de ses ouvrages ont connu rapidement un succès considérable : « Près de trois quarts d’un million d’exemplaires d’On becoming a Person » (Le développement de la personne)9, toujours réimprimé ; trois cent mille exemplaires de Freedom to learn ? (Liberté pour apprendre ?) vendus en une dizaine d’années10 ; deux cent cinquante mille exemplaires de Carl Rogers on En-counter groups (Les groupes de rencontre)11. Sans faire même l’addition des multiples traductions, on peut parler de « best-sellers » à répétition12.
Méconnaissance et controversesEt pourtant, constatent ses présentateurs « ironiquement, alors que Rogers a influencé et continue à influencer les vies de millions d’individus pris en charge dans des cadres professionnels dans le monde entier, le public, ici ou là, ne pourrait même pas reconnaître son nom »13. Même s’il n’a pas recherché une large popularité, il a toujours écrit et parlé pour être accessible au plus grand nombre ; et l’inspiration pionnière de ses propos est devenue, avec l’évolution des temps, sous-jacente à de nombreuses démarches dans le champ des rapports humains et des orientations institutionnelles. Car « bien des concepts de Rogers (notamment le concept de soi) ont été absorbés dans la psychologie courante, souvent sans la reconnaissance de leur origine. A un large degré, l’impact de Rogers a été indirect. En conséquence, l’ampleur de son impact est difficile à évaluer »14. En toute hypothèse, l’influence, directe ou indirecte de Carl Rogers, aussi bien que son message et son image doivent être dégagés des défauts de perception et de perspective ou des altérations et confusions qui ont pu, à certains moments, brouiller ou restreindre leur qualité. Il s’agit bien de voir sereinement, avec leurs prudentes limites, les suggestives possibilités qu’il a ouvertes, en précurseur, dans des champs multiples : ceux de la psychothérapie, du travail social, de l’éducation et de la formation, des institutions, de la gestion des conflits à tous les degrés de l’échelle des relations, ainsi que, plus généralement, de la personne et des sciences humaines. L’ampleur et l’extension croissante de ses entreprises et de ses propositions, théoriques et pratiques, devaient naturellement provoquer des contestations. Rogers a été et demeure, dans tous les domaines qu’il a abordés, une personnalité vivement controversée, « a controversial person », comme il le reconnaît dans son Autobiographie, en 1967 : « J’ai souvent été ce qu’on appelle un “fauteur de troubles”. C’est que j’ai été impliqué dans toutes sortes de conflits, de batailles professionnelles »15. Il a connu le sort de tous les pionniers : précisément, par le fait d’avoir été placé à la charnière des deux moitiés du xxe siècle, en précurseur des décloisonnements généralisés qui allaient préparer le passage des sociétés postindustrielles aux caractéristiques du troisième millénaire, après un demi-siècle de virulence guerrière et d’enrégimentement, qu’il importe d’évoquer comme contexte puissamment signifiant sur son message même.
idéologies radicales et dictaturesDans sa première moitié, en effet, notre siècle a été le théâtre d’un asservissement croissant des individus, neutralisés en masse, sous l’invocation d’entités inexorables (l’Etat ; le Parti ; le Prolétariat ; le Capital ; le Progrès ; la Nation ou la Patrie). Il faut bien rappeler, tout d’abord, les nationalismes plus ou moins belliqueux (même en France jusqu’en 1918 !) diabolisant les peuples étrangers, mais aussi le colonialisme dominant. On ne peut oublier, en Europe et en Asie, les conceptions oligarchiques ou élitaires de l’Etat, ayant abouti, par leur dérive, à l’émergence tragique des dictatures : au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Japon, en URSS et dans les pays de l’Est ou en Chine. On doit y ajouter les ségrégations ou relégations sexuelles (la femme tenue en dépendance, sans droit de vote le plus souvent). Couvrant le tout, il y avait l’emprise d’un scientisme hautain, gouvernant, au nom du Progrès, des logiques coupantes, une pensée par oppositions radicalisées, des jugements catégoriques en tout ou rien. Et, en ces conditions, l’individu n’était souvent plus rien, sinon une unité conforme ou informe, un « homme-masse », disait Ortega y Gasset, inséré et enfermé, par l’application d’un « mythe identitaire », dans une des strates hiérarchisées d’identification, maîtrisant les « révoltes »16, à la mode indo-aryenne des castes (Hitler ne s’y était pas trompé !). La voix des idéaux personnalistes était étouffée ; les individus étaient dépouillés de leur « moi irrévocable » (Ortega y Gasset), et séparés, disjoints les uns des autres, abstraitement « classés ». Qu’on ne l’oublie pas ! A tous les niveaux il y avait, en effet, une sorte de clivage endémique séparant les élites reconnues (jusqu’aux « apparatchiks » !) et le vulgum pecus : même en France, les enseignements secondaires et supérieurs étaient encore réservés à un petit nombre. L’esprit du temps laissait croire volontiers à la « distinction », inéluctable et apparemment définitive, entre des individus (cultivés ou non) réputés supérieurs et d’autres classés comme inférieurs ou ennemis : occidentaux et « indigènes », blancs et « colorés », ingénieurs et ouvriers, hommes et femmes, chefs et « assujettis », bourgeois et « prolétaires », mandarins [universitaires ? scolaires ?] et auditeurs [ou élèves] passifs. On prônait, corrélativement, une seule bonne manière de faire ou de voir : le « One best way » cher à Taylor (en attendant la « pensée politiquement correcte » !) ; et il ne pouvait y avoir qu’« un petit nombre d’élus », selon un jansénisme rampant. Dans ces dispositions, les « différences » et la variété étaient mal considérées, sinon exclues. Les cloisons, sociales ou intellectuelles, disciplinaires ou culturelles, étaient bâties en dur. Même Sartre, quoique philosophe de la liberté existentielle, allait jusqu’à saluer « les gigantesques planifications socialistes »17 et reconnaître « au niveau de l’intérêt individuel […] la massification des individus en tant que tels », sur le plan « pratico-inerte »18. Loin de se dégager ou de se révolter, Sartre a longtemps défini sa propre démarche comme « enclavée dans le marxisme lui-même qui l’engendre et la récuse tout à la fois »19. Ainsi les édifices, sociaux ou psychiques aussi bien qu’économiques et intellectuels étaient cimentés par les ferveurs d’un rationalisme abstracteur et réductionniste ainsi que par le mythe identitaire hostile aux différences. Les rigidités, les intransigeances et les totalitarismes, les haines qu’ils engendraient devaient provoquer des déflagrations de violences inouïes qui allaient en contrepartie les ébranler, puis les fissurer, secousses par secousses, dans les ricochets monstrueux de deux guerres mondiales et des luttes coloniales : amorçant la décolonisation généralisée et, non sans remous ni répressions, de multiples mouvements d’émancipation (notamment pour la « condition » féminine et l’enfance) ou de décloisonnement.
Décloisonnement et complexification dans le second demi-siècleLe paradoxe des déchaînements de violence brute, au cours du premier demi-siècle, tient dans les conséquences inattendues des résistances ou précautions qu’ils provoquèrent dans le second demi-siècle. La défense contre les attaques aériennes fit, en effet, développer, par réplique, les radars mais surtout des organes de calcul et d’automatisation qui se perfectionnèrent selon une incroyable explosion technologique : la cybernétique engendra, après la mécanographie, l’informatique (démultipliée et miniaturisée par les microprocesseurs et les micro-ordinateurs), mais aussi la robotique et la bureautique ou la productique qui allaient alléger, restreindre et menacer l’emploi à son terme. L’épée de Damoclès, forgée d’autre part par les armements nucléaires, allait contraindre à la « froideur » les formes de la guerre ; elle rendit alors possibles des « explosions » scolaires, universitaires, culturelles dans tous les pays, mais aussi celles des communications, des migrations et des différenciations sociales ou mercantiles, imposant la mondialisation des rapports d’interaction entre les individus et les peuples. L’économie, l’organisation et la recherche devenaient des continuations de la guerre sous d’autres formes, pour paraphraser Clausewitz. L’obstacle des distances, alibi des morgues et des cloisonnements, se dissolvait devant la quasi-instantanéité des échanges réciproques d’informations et de savoirs, et l’accélération des déplacements. La complexité croissante des relations à tous les niveaux, les effets d’interfertilisation (conceptuels ou technologiques) et de métissages amplifiés qui en résultaient se trouvaient en même temps renforcés, potentialisés, par la révolution épistémologique, qui, préparée dans la première moitié du siècle, était désormais en irrésistible déploiement. Les conceptions du monde et les structures sociales pouvaient-elles rester classiques, en effet, c’est-à-dire distinctes et claires ou définitives, alors que la Relativité généralisée d’Einstein ne permettait plus de séparer l’espace et le temps, l’énergie et la matière. Il n’était plus question non plus, depuis Max Planck et Louis de Broglie, d’opposer les ondes et les corpuscules, le continu ou le discontinu. Pouvait-on croire encore à des entités parfaitement distinctes, alors que le physicien Schrödinger nous avertissait, dès 1953 : « La chose qu’on a toujours nommée particule et qui est encore par la force de l’habitude appelée d’un nom de ce genre, n’est […] certainement pas une entité individuellement identifiable »20 ? Un autre physicien surenchérissait : « On est obligé de concevoir l’univers comme un système d’interconnexions, comme un système de relations, d’événements, et non pas comme un système d’objets séparés »21. Relation, systémique, complexité, non-séparabilité s’imposaient comme des considérations essentielles à prendre en compte. Il fallait : accepter des contradictions non séparables22 ; renoncer au principe du tiers exclu ; sur le plan scientifique, combiner la rigueur avec l’incertitude ou l’indétermination (Principe d’Heisenberg) ; faire son deuil du rationalisme total (théorème d’indécidabilité ou d’incomplétude irrémédiable de Gödel en mathématiques23). Profitant de l’effervescence des connaissances et de ces considérations, la biologie allait au surplus s’imposer comme étant « de plus en plus la scène où se reflètent avec le plus d’acuité les métaphores et les sensibilités de la pensée contemporaine. Dans ce rôle elle remplace peu à peu la physique, qui sert de point de référence depuis plus d’un siècle »24. Biologisation, personnalisation… le neurobiologiste Francisco Varela insisterait, selon l’expérience des « laboratoires », pour marquer « que notre monde et nos actions sont inséparables »25, de même qu’il y a « une spécification mutuelle des transformations chimiques et des frontières physiques »26, et que « celui qui sait et ce qui est su, le sujet et l’objet, sont la spécification réciproque et simultanée l’un de l’autre »27. Par ce lien d’interaction entre la subjectivité et l’objectivité, énoncé vers la fin des années quatre-vingt, on retrouve ce qu’exprimait trente ans auparavant Carl Rogers : « Une de mes convictions les plus profondes concerne la raison d’être de la recherche scientifique et de l’explication théorique. A mon sens, le but capital de ce genre d’entreprise est l’organisation cohérente d’expériences personnelles significatives »28. Cet accent sur la personne singulière allait être confirmé et renforcé par l’importance nouvelle des conceptions sur la complexité, comme le marque Edgard Morin : « Ainsi la biologie actuelle ne conçoit plus du tout l’espèce comme un cadre général dont l’individu est un cas particulier. Elle conçoit l’espèce vivante comme une singularité qui produit des singularités »29. Des personnes !…
Effondrement des dogmatismesProlongeant les effets des déflagrations militaires et technologiques, la nouvelle « orientation épistémologique et scientifique » allait, conformément à la « ferme conviction » formulée par Francisco Varela, se révéler efficace « pour lutter contre les diverses formes de dogmatisme qui enserrent partout notre monde et qui peuvent nous mener à la destruction mutuelle »30. Conceptions scientifiques, mœurs, liens institutionnels et structures sociopolitiques allaient être touchés. En premier lieu, le scientisme est rompu. « Le strict déterminisme a craqué », constate un astrophysicien, Michel Cassé : « La mécanique quantique introduit un élément de hasard, d’incertitude, qui est définitivement irréductible »31. Il ajoute : « Le certain est remplacé par le probable »32. Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, dont la pensée avait frappé Rogers, va plus loin : « Pendant longtemps le déterminisme était le symbole même de l’intelligibilité scientifique, tandis qu’aujourd’hui il se réduit à une propriété valable seulement dans des cas limites »33. Et il publie en 1996, annonçant « un changement radical de la direction suivie par la physique depuis Newton »34, un ouvrage sur le temps, le chaos et les lois de la nature, portant un titre claironnant : La fin des certitudes. Sur le plan des mœurs, en second lieu, bien des équilibres anciens dans les rapports humains sont également rompus. Les relations sexuelles se libèrent, notamment au nom des « événements » de 1968, modifiant la vie familiale (Carl Rogers publie dès 1972 un ouvrage traitant du mariage et de « ses alternatives », traduit en français sous le titre Réinventer le couple). Un nouveau rapport à la nature se manifeste aussi, marquant un militantisme écologique, souvent ardent et impliquant, par rapport au cosmos, pour Prigogine et Isabelle Stengers, une « nouvelle alliance »35. Les liens institutionnels perdent
également leur rigidité : « Les barrières de la répression », note en
1977 Rogers, « qui empêchent un si grand nombre d’individus d’accéder à
une prise de conscience, sont nettement plus basses que pour les
générations précédentes »36.
Un déclin du pouvoir et de l’autorité institutionnelle peut alors
atteindre les sociétés devenues inéluctablement « pluralistes », comme
le constate Paul Ricœur, « où chacun n’a que la force de sa parole »37.
Tout consensus global devenant impossible, les individus ont à
construire des « compromis », permettant néanmoins l’expression de leur
différences spécifiques, aux dépens du « mythe iden- Les structures sociopolitiques sont plus profondément ébranlées. Le mur de Berlin et son cloisonnement symbolique craquent en 1989, à l’issue de la célébration du bicentenaire des Droits de l’Homme. De vastes constructions, telles que celles de l’URSS et de ses satellites se sont décomposées en quelques années. Les idéologies dominantes (et impérieuses, totalitaires) s’effondrent rapidement : qu’elles aient été marxistes-léninistes, rationalistes, structuralistes, néo-libérales (?), maoïstes, voire existentialistes (sartriennes) ou freudiennes puristes ! Il demeure néanmoins des séquelles d’intégrismes et de fondamentalismes menaçants quoique minoritaires . Mais les idéaux, les « grands récits », au sens que leur donne le sociologue Jean-François Lyotard39, perdent leur attrait et leur crédibilité. Si tant de conceptions et structures, politiques, sociales, et scientifiques (pour les disciplines « dures » ou « nobles ») se trouvent ainsi émulsionnées en profondeur, il n’en est cependant pas de même pour les sciences humaines. Celles-ci résistent. En recherche contestée d’une scientificité légitimante, elles mettent du temps à admettre le défi de l’époque les conviant à simultanément se décloisonner et articuler leurs disciplines antagonistes. Elles manifestent donc de l’hostilité, ou au moins une ambivalence défensive, à l’égard de pionniers plus portés à répondre à ce défi, comme Rogers.
Rogers et notre TempsLes considérations qui précèdent, opposant et conjuguant les deux moitiés de notre siècle sur la charnière de la guerre de 1939-1945, ne nous ont pas éloignés, tant s’en faut, du parcours original et du message de Carl Rogers. Car, avec d’autres précurseurs, il a participé à la propagation de l’onde de « désabsolutisation » et de décloisonnement agissant, par ricochets successifs (comme ceux d’un « galet » tombant sur « l’eau d’une mare », dit-il dans la préface du présent livre), sur des secteurs de plus en plus étendus et divers : psychothérapeutiques, phénoménologiques, éducatifs, organisationnels, médicaux, sociaux, culturels, institutionnels, philosophiques, théologiques, scientifiques, et même politiques. Son action s’est située au sein de la confluence turbulente des courants multiples qui ont pu s’épancher sur l’espace de la société américaine, « la seule qui ne soit faite que d’émigrés »40 , remarque Paul Ricœur, et où « la tolérance a longtemps reposé sur une véritable acceptation de la diversité »41. Alors que l’Europe et la plupart des pays étaient absorbés dans leur difficile restauration matérielle, les Etats-Unis offraient un espace ouvert au débridement des esprits les plus originaux, souvent venus d’ailleurs. Outre les mouvements psychanalytiques variés, on peut en effet distinguer, dès la fin de la guerre 1939-1945 : le courant vif de la Dynamique de groupe, avec Kurt Lewin, secouant les inerties de conformité et d’autoritarisme, au profit d’un climat démocratique ; le psychodrame et la sociométrie, impulsés par Jacob Moreno, assouplissant et relativisant les rôles sociaux ainsi que leurs configurations et leur complémentarité ; les conceptions relationnelles et communicationnelles portées par la Sémantique générale (Korzybski), l’analyse transactionnelle (Eric Berne), la Gestalt-Therapy (F. Perls), l’Ecole de Palo Alto (Bateson) ; la prolifération de nombreux courants californiens (ou orientaux) relatifs au potentiel humain ou consacrés à la libération sociale et sexuelle (Marcuse, Reich, etc.). Il faut citer également, particulièrement pour la France, le développement de la psychosociologie42 et, plus à terme, le courant systémique. Aux Etats-Unis, se développe l’important mouvement de la « psychologie humaniste », avec Maslow, Rollo May auxquels se joint Rogers. Sur un tel maëlstrom interculturel, au sein du melting-pot américain, Carl Rogers « surfe » en dessinant un parcours personnaliste subtil, consacré à accroître à la fois l’autonomisation des individus et la qualité de leurs relations. Il se joue des difficultés en vue d’assurer des rapports non-séparatifs, non-verticalistes, entre des personnes ayant des situations et des compétences différentes (le malade, l’élève sont promus au statut de « client », puis de « personne »). Il participe à une forte mise en interaction de points de vue scientifiques et de démarches cliniques. Il associe opiniâtrement une rigueur objective et une vive intuition subjective portant à l’empathie. Il combine, avec d’autres chercheurs, les recherches expérimentalistes et les actions engagées sous forme de « recherche-action ». Il équilibre, entre autres paradoxes, un sérieux professionnel et une ingénuité relationnelle dans les rapports interpersonnels et thérapeutiques ou dans les « groupes de rencontre », se montrant à la fois réservé et audacieux. Rien ne saurait mieux rendre compte de la capacité de Carl Rogers à équilibrer les penchants paradoxaux de son approche que les citations de la préface qu’il donnait en 1951 à son œuvre professionnelle majeure, Client-Centered Therapy : « Cette œuvre est relative à la souffrance et à l’espoir, à l’anxiété et à la satisfaction, dont est rempli le bureau du thérapeute. Elle est relative à l’unicité de la relation de chaque thérapeute avec chaque client, et, aussi, aux éléments communs que nous découvrons dans toutes ces relations. Ce livre est relatif aux expériences les plus personnelles de chacun de nous. Il est relatif au client chez moi qui est assis là au coin du bureau, luttant pour être lui-même, et cependant mortellement effrayé d’être lui-même, tentant de voir son expérience comme elle est, désirant être cette expérience, et cependant profondément troublé de la rechercher. « Ce livre est relatif à moi, en tant que je suis assis là avec le client, lui faisant face, participant à ce combat aussi profondément et sensiblement que j’en suis capable. Il est relatif à moi en tant que j’essaie de percevoir son expérience, et la signification et le sentiment et le goût et la saveur qu’elle a pour lui. Il est relatif à moi en tant que je déplore mon humaine faillibilité à comprendre le client et les défaillances occasionnelles à voir la vie comme elle lui paraît… « Il est relatif à moi qui me réjouis du privilège d’être la sage-femme d’une nouvelle personnalité, qui assiste avec une stupeur sacrée à l’émergence d’un moi, d’une personne, qui voit se dérouler une naissance à laquelle j’ai pris une importante part de facilitation. « Il est relatif à la fois au client et à moi dans la mesure où nous portons une attention émerveillée aux forces puissantes et ordonnées qui sont évidentes dans toute l’expérience, forces qui semblent profondément enracinées dans l’univers total. « Ce livre est, je crois, relatif à la vie, à la vie comme elle se révèle de façon éclatante dans le processus de thérapie, avec sa puissance aveugle et sa terrifiante capacité de destruction, mais aussi avec son élan compensateur vers la croissance, si la possibilité de croître lui est fournie. « Mais ce livre est aussi relatif à mes collègues et à moi, en tant que nous entreprenons les débuts d’une analyse scientifique de cette expérience vivante, émouvante. Il est relatif aux conflits à cet égard […] Je me base sur la conviction croissante que, quoique la science ne puisse jamais faire des thérapeutes, elle peut aider la thérapie »43.
Pressentiments sur l’AvenirAu-delà de l’enjeu des développements personnels, par le counseling ou la psychothérapie (« douce » ? subtile ?) et par l’appui de la science et des recherches, Rogers avait aussi discerné l’importance, pour notre temps, d’une croissance de chaque personnalité devenant apte à se réapproprier le pouvoir concret dont elle dispose réellement et dont elle se dessaisit, trop habituellement, de façon inerte ou aveugle. Il avait pressenti, sans erreur, que l’évolution historique vers le troisième millénaire, allait se produire, dans le vide des idéaux (ou des idéologies), non pas par la violence mais sous la forme d’une « révolution tranquille (quiet Revolution)44. Et il voyait « venir » celle-ci, depuis les années soixante-dix, « non pas sous la forme d’un grand mouvement organisé, d’une armée avec des canons et des bannières, des manifestes et déclarations, mais grâce à l’apparition d’un nouveau type de personne en train de poindre à travers les feuilles et les tiges mourantes, jaunissantes, en putréfaction, de nos institutions en voie de dépérissement »45. Révolution des « œillets » au Portugal, révolution de « velours » dans les pays de l’Est… Et il s’était, en juste cohérence, attaché à faire se rencontrer des personnalités au-delà des « langues de bois » et des défenses stéréotypées. A Rust, en Autriche, en 1985, il avait su préparer, avec l’ancien président du Costa-Rica et une cinquantaine de personnes en positions conflictuelles, l’apaisement des conflits violents qui avaient ensanglanté si longtemps le Nicaragua : ce qui valut un prix Nobel de la Paix au président en exercice du Costa-Rica. En Afrique du Sud, il était intervenu patiemment et courageusement entre les communautés et à l’intérieur de celles-ci. Il avait aussi participé à plusieurs séminaires avec des psychologues et des enseignants des pays de l’Est, dans les années quatre-vingt. Et il est mort, après un voyage enthousiaste à travers l’URSS, en préparant une nouvelle tournée en Afrique du Sud. Ainsi, sans se cacher ni oblitérer les risques de contrôles pervers ou de totalitarismes brutaux ici ou là, même dans son pays, il refusait alors tout pessimisme. « Même sous les régimes totalitaires les plus sévères, où la politique gouvernementale, l’organisation économique, le comportement personnel et la pensée individuelle sont contrôlés par un groupe central, des personnes se font jour. En Russie, le nom de Soljenitsyne n’a été que le symbole d’un mouvement beaucoup plus large. […] Rien ne peut éteindre l’impulsion de l’organisme humain à être lui-même — à se réaliser de façon humaine et créatrice »46. L’histoire, du vivant de Rogers mais surtout après sa mort en février 1987, lui a rendu raison. Anouar El Sadate va en 1979 à Jérusalem chercher une réconciliation inespérée auprès de Menahem Begin, au nom de l’hospitalité sacrée d’Abraham : et c’est la paix de Camp David, patronnée par le président Carter (admirateur de Carl Rogers), mais aussi marquée par l’assassinat de Sadate en 1981. Andrei Sakharov défend magnifiquement, en urss même, les droits de l’Homme jusqu’à sa mort en 1989, facilitant l’évolution décisive de Gorbatchev, au-delà de la « glasnost » et de la « perestroïka ». En Afrique du Sud, après une trentaine d’années d’emprisonnement Nelson Mandela est libéré par le président De Klerk en 1990 et il abolit avec lui l’Apartheid. Shimon Pérès, pour Israël et Yasser Arafat, pour les Palestiniens, préparent en Suède des accords de paix qui sont signés par Yitzak Rabin, à nouveau à Camp David, en 1994 : accords consacrés par le prix Nobel de la Paix pour ces trois personnes, mais aussi endeuillés par l’assassinat de Rabin. Si provisoires ou énigmatiques qu’ils soient, de tels dénouements effectifs à des conflits ou durcissements apparemment insolubles, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Russie et dans les pays de l’Est, ont déjoué de façon humiliante les prévisions pessimistes ou fixistes des politologues et des experts de tous niveaux. Mais ils rendent justice, sinon à un sens « prophétique » chez Carl Rogers, du moins à son écoute sensible des aspirations sous-jacentes dans les individus et les peuples, et à sa confiance méthodique dans l’intervention décisive d’audaces individuelles et de rencontres interpersonnelles, faisant des trouées au-delà des masques ou des trivialités. Rogers a pu connaître aux Etats-Unis, entre autres, l’action exemplaire de Martin Luther King. Mais il ne lui a pas été donné de connaître, en confirmation de ses vues, de nos jours mêmes, l’ampleur de mouvements efficaces, débordant les institutions et les syndicats, et s’effectuant à partir de décisions prises de façon purement individuelle mais en convergence ; en France (contre des dérèglementations), en Belgique (contre des complicités politiques à des crimes pédophiliques), en Serbie (contre l’annulation inique de résultats électoraux). Il n’a pu voir le développement d’engagements individuels, souvent héroïques, au service des personnes en péril, dans des organisations non gouvernementales. Aurait-il deviné qu’en France, où il n’avait pas connu un accueil aimable, une loi d’orientation sur l’éducation, le 10 juillet 1989, placerait, selon une « inversion copernicienne »47, l’élève et l’étudiant au centre des institutions scolaires et universitaires : « Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances […]. Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités, avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents »48. Aurait-il pu prévoir, en forme de réponse à ceux qui doutent de la continuité de son influence, qu’un rapport publié en 1994, par la Commission des communautés européennes, le Conseil de l’Europe, et l’Organisation mondiale de la santé, en vue de « promouvoir la santé des jeunes en Europe », préciserait, dans le chapitre III, la nécessité d’une « approche globale », « centrée sur l’individu » ? Ou qu’au chapitre consacré à « l’estime de soi », à propos de l’apprentissage de compétences sociales, serait indiqué : « Carl Rogers (1983) estime que les bonnes relations interpersonnelles se fondent sur le respect, la compréhension (qu’il nomme empathie) et la sincérité. Respect veut dire que vous pensez que l’autre personne est importante, elle a une certaine valeur, elle est précieuse et unique » ?49
Présence sans méprisesOui, il y a, n’en déplaise à quelques-uns, une présence de Carl Rogers. Et il subsiste de multiples « inspirations » (mieux qu’orientations) à tirer loyalement de la lecture de son œuvre et de la réflexion critique sur ses positions successives ainsi que sur le sens de son cheminement solitaire et solidaire, en se gardant des méprises sur ses intentions essentielles. Car ce qu’il a fait, ce qu’il a présenté de ses expériences ou de ses pratiques n’était en aucune façon (ce qu’attendait ou attendrait le conformisme habituel) destinés à entraîner l’imposition d’un modèle identitaire, contraignant, impersonnel, ni à favoriser une « orthodoxie » rigide de son approche. Il a averti, vertement, à propos de l’enseignement : « Ma façon de faire n’est d’aucune manière proposée comme un modèle à suivre. J’exprime ma façon de faire simplement pour sa valeur de stimulation »50. Alerte aux imitateurs ! Il propose donc ouvertement ses pratiques ou ses conceptualisations (élaborées par le recours premier et dernier à son expérience propre) non pour réduire narcissiquement mais bien pour agrandir l’espace des possibilités combinatoires ouvertes à chacun. Il invite à échanger sur des données concrètes, personnalisées, en vue d’assurer des progressions individuelles par entrechocs de positions et dispositions diverses, contrastées, sans absolutisation ni reproduction à l’identique. Il se félicite, pour lui sinon pour les autres, de n’avoir « jamais appartenu à aucun groupe professionnel »51, ni d’avoir eu de « maître à penser »52 : « Mais il est important pour moi d’avoir une influence, et non pas du pouvoir »53. Car « je crois en ce que je fais, je fais plus confiance à mon expérience qu’à telle ou telle “opinion autorisée” »54. Et il constate son plaisir et son goût pour une « facilitation » tournée vers « le développement d’une personne en psychothérapie, le développement d’une interaction productive dans un groupe, ou à servir d’“agent de changement” dans une institution »55. Il éprouve alors une « certitude à pouvoir servir de catalyseur et produire l’imprévisible », ce qui est bien aux antipodes de la réalisation d’une obédience. Bien au contraire, il nous convie « à découvrir un ordre dans un vaste et complexe réseau d’expériences »56, à nous soucier de « la logique interne dans tous les domaines », à nous « trouver à l’avant-garde de ce qui est en train de se développer »57. Quant à lui, il n’accueille, en toute situation ou relation, « l’ici et maintenant » avec respect que pour mieux accompagner la germination qu’il contient, sans la brusquer ni la figer. Growth ! (« Croissance ! ») est en quelque sorte sa devise ; elle appelle de l’ingéniosité et de la délicatesse, car (nous rappellent la sagesse et la ruse paysannes, ici, pour moi, bourguignonne), « il ne faut pas tirer sur l’herbe pour la faire pousser » ! Foin donc de l’impatience et du bricolage, ou de la rodomontade ! Mais bien plutôt confiance en soi et dans la vie elle-même associée à une maîtrise sensible et renouvelée des attitudes et des moyens personnels mis en œuvre. « Les faits sont toujours des amis » aimait répéter Carl Rogers. C’est à leur dégagement et à leur amitié que le présent ouvrage est consacré. Que ces faits nous portent à nous situer personnellement, originalement, sur les grandes questions que Carl a soulevées : confiance en l’humanité ; optimisme méthodologique ; rapports créatifs entre la personne et les institutions ; destination de la recherche scientifique et de la technologie ; conception des conflits et de leur traitement ; métissage de l’affectivité et de la rationalité ; culture paradoxale et civilisation nouvelle en gestation. Bienvenue au lecteur ! André de Peretti, décembre 1996 NoteUne partie notable du présent ouvrage est constituée par la reprise de chapitres que j’avais rédigés avec l’aide de Carl Rogers et en large correspondance avec lui. Ils furent publiés, en 1974, dans un livre intitulé Pensée et vérité de Carl Rogers. (Rogers n’aimait pas l’utilisation du mot « vérité » dans le titre, en raison d’ambiguïtés possibles.) De ce livre, j’ai retiré un long chapitre xiv, traitant sur quarante pages des objections faites à Rogers, surtout en France : j’ai pu, avec la décantation qu’apporte le recul du temps, le condenser en quelques pages adjointes au chapitre viii traitant de « La rencontre de l’Europe en 1966 ». En revanche, j’ai intercalé comme nouveau chapitre x, sous le titre « L’ouverture institutionnelle », un texte développé retraçant la biographie et l’évolution des activités de Rogers entre 1974 et 1987. J’ai également ajouté, dans la plupart des chapitres, des précisions provenant de ses derniers ouvrages et de travaux récents. La présentation, au début, est entièrement nouvelle et remplace plusieurs textes. J’ai également complété la conclusion (devenue « Relief et paradoxes »). Je souhaite que ce livre aide le lecteur à se faire une opinion personnelle sur l’apport à notre temps de Carl Rogers et de son « approche ». Certains trouveront que ma contribution ne fait qu’une part réduite aux objections ou réfutations opposées à ses thèses. En présentant, de façon aussi compréhensive (aussi « empathique ») que possible, un corpus de ses positions et dispositions, je pense, selon mon tempérament et mes démarches habituelles, offrir aux réflexions, comme aux critiques, un espace d’assimilation, de développement, et de recherches fécondes. Il y a, dès ici-bas, un « au-delà » !
Il est agréable d’avoir l’occasion de parler personnellement aux gens qui, en France, s’intéressent à mon œuvre. J’ai maints souvenirs plaisants des échanges passionnants, émouvants et souvent animés que j’ai eus avec les responsables et les participants à un séminaire d’une semaine, organisé à Dourdan en 1966. Ce fut pour moi le moment privilégié de ma visite en France. C’est là qu’il m’a été permis de connaître et de prendre en estime André de Peretti qui a écrit ce livre. Je ne peux commenter ce livre puisque je n’ai pas demandé à lire le manuscrit, mon français n’étant malheureusement pas à la hauteur de cette tâche. J’ai de plus le sentiment que, même si j’avais lu l’ouvrage, il serait malséant et même présomptueux de ma part de le commenter. C’est aux autres de décider dans quelle mesure il clarifie, développe, modifie ou contredit mon œuvre et ma pensée. Mais ceci me laisse libre pour une tâche plus agréable, essayer de me situer dans l’optique qui est la mienne à présent en me tournant vers le passé et en considérant les plus de quarante-cinq années de travail clinique accompli avec des particuliers et des groupes et les diverses phases de mon propre développement et de mon évolution personnelle. Lorsque je regarde en arrière vers mon œuvre, et considère la façon dont elle a été reçue, je crois que ma réaction est avant tout une réaction de surprise. M’eût-on fait part, trente-cinq ou quarante ans auparavant, de l’impact qu’elle allait avoir, j’eusse été parfaitement incrédule. Le travail que mes collègues et moi avons accompli a apporté des transformations ou des modifications dans des secteurs extrêmement divers dont je mentionnerai quelques-uns. Ce travail a complètement bouleversé les méthodes employées en psychologie. Il a ouvert le champ de la psychothérapie aux investigations du public et aux travaux de recherche. Il a rendu possible l’étude empirique de phénomènes hautement subjectifs. Il a contribué à apporter quelques changements aux méthodes éducatives à tous les niveaux. Ce fut un des facteurs qui a apporté un changement au concept du « leadership » industriel (et même militaire), au concept de l’exercice du travail social et du personnel infirmier et au concept de travail religieux. Il a été responsable d’une des tendances majeures du mouvement du groupe de rencontre. Il a, au moins dans une faible mesure, affecté la philosophie des sciences. Il commence à exercer quelque influence dans le domaine des relations interraciales et interculturelles. Il a même influencé les étudiants en théologie et en philosophie. C’est avec le plus profond étonnement que je considère cette liste. Pourquoi l’impact de mon œuvre a-t-il été aussi vaste ? Je n’attribue certes pas ce succès à un quelconque génie personnel ; pas davantage au fait que j’aie vu loin dans l’avenir. Je fais pleinement confiance à mes jeunes collègues qui, au fil des années, ont contribué au développement et à l’approfondissement de ma pensée et de mon œuvre, mais leurs efforts n’expliquent cependant pas cette influence et ce rayonnement. Dans un certain nombre de domaines que j’ai mentionnés plus haut, ni mes collègues ni moi n’avons jamais travaillé ou été mis à contribution de quelque façon que ce soit, sinon par l’intermédiaire de nos écrits. Pour moi, qui m’efforce de comprendre ce phénomène, il semble que, sans m’en douter, j’aie exprimé une idée au moment même où on était prêt à la recevoir, tout comme si l’eau d’une mare étant devenue parfaitement lisse et immobile, un galet tombé dans celle-ci dessinait des rides de plus en plus grandes et exerçait une influence impossible à saisir pour qui se contenterait de regarder le galet. Ou bien, pour utiliser une analogie empruntée au domaine de la chimie, c’est comme si une solution liquide étant devenue sursaturée, l’addition d’un minuscule cristal entraînait alors la formation de cristaux dans la masse tout entière. Quelle était cette idée, ce galet, ce cristal ? C’était l’hypothèse peu à peu élaborée puis vérifiée, selon laquelle l’individu possède en lui de vastes ressources qui lui permettent de se comprendre lui-même, de changer l’idée qu’il a de lui-même, ses attitudes et le comportement qu’il se dicte à lui-même, et que l’on peut faire appel à ces ressources, seulement s’il est possible de créer un climat bien défini qui facilite ces attitudes psychologiques. Cette hypothèse, si neuve et pourtant si ancienne, n’était pas une théorie élaborée en chambre. Elle avait surgi d’un certain nombre de démarches proches de la réalité quotidienne. — Premièrement, j’avais appris, à la suite d’expériences difficiles et frustrantes, qu’écouter simplement un client en essayant de le comprendre, puis s’efforcer de rendre sensible cette compréhension, était un moteur puissant de changement thérapeutique pour l’individu. — Deuxièmement, mes collègues et moi, nous nous sommes rendu compte que cette écoute fondée sur « l’empathie » offrait comme une fenêtre, parmi les moins embuées, qui permettait d’entrer dans le cheminement de l’âme humaine, dans tout son mystère et sa complexité. — Troisièmement, de nos observations nous n’avons fait que des déductions simples et nous n’avons formulé que des hypothèses vérifiables. Nous aurions pu choisir de tirer des conclusions d’un haut niveau et d’élaborer une théorie supérieure, abstraite et invérifiable, mais je pense que l’origine terrienne et agricole qui est la mienne m’a détourné de cette voie. (Les penseurs freudiens ont choisi cette seconde ligne de conduite et ceci marque, à mon avis, une des différences les plus fondamentales entre leur approche et l’approche centrée sur le client.) — Quatrièmement, en vérifiant nos hypothèses, nous avons mis le doigt sur des découvertes concernant les personnes et les relations entre les personnes. Ces découvertes et la théorie qui les englobait ne cessaient de changer au fur et à mesure que surgissaient de nouvelles découvertes et ce processus se poursuit à l’heure actuelle. — Cinquièmement, parce que nos découvertes touchent aux aspects fondamentaux de la façon dont peuvent se libérer les propres possibilités de changement de l’individu et à la façon dont les relations humaines peuvent encourager, ou faire échouer ce changement dicté par l’individu lui-même, on découvrit que leur champ d’application était vaste. — Sixièmement, les situations impliquant des personnes, un changement de comportement chez les personnes et les effets de différentes qualités de relations interpersonnelles, existent pratiquement dans chaque entreprise humaine. En conséquence, d’autres commencèrent à s’apercevoir que les hypothèses vérifiables de cette approche étaient peut-être susceptibles d’avoir une application pratiquement universelle, ou pouvaient être revérifiées ou reformulées afin d’être utilisées dans une variété quasiment infinie de situations humaines. Telle est la façon dont je tente d’expliquer une diffusion d’idées qui, autrement, serait incompréhensible et qui commença par une question très simple : « En observant et en évaluant minutieusement l’expérience que j’ai avec mes clients, puis-je apprendre à être plus apte à les aider à résoudre leurs problèmes d’angoisse personnelle, de comportement défaitiste et de rapports interpersonnels destructeurs ? » Qui eût pu deviner que les réponses, hésitantes et expérimentales, prendraient une telle ampleur ? Assez parlé de ce passé. Le présent et l’avenir restent ma préoccupation essentielle. Quels sont mes activités et mes intérêts courants ? Je ne m’occupe plus activement de thérapie individuelle et de recherche empirique (je suis en train de découvrir que, passé l’âge de soixante-dix ans, il est certaines limites physiques à ce que l’on peut faire). Je continue à participer à des groupes de rencontre lorsque j’ai la conviction qu’ils pourraient avoir un impact social de grande portée. Ainsi, je prends part à l’élaboration d’un programme visant à humaniser les études médicales. Jusqu’ici plus de deux cents éducateurs médicaux d’un rang élevé se sont engagés dans d’intensives expériences de groupes, qui, semble-t-il, réussissent à faciliter le changement, ceci au-delà de ce que nous avions osé espérer. Peut-être en sortira-t-il des praticiens plus sensibles aux problèmes humains. J’ai aussi aidé à parrainer des groupes interraciaux et interculturels car je suis convaincu qu’une meilleure compréhension et une meilleure communication au sein de divers groupes est chose essentielle si notre planète est destinée à survivre. Le groupe le plus difficile se composait de citoyens de Belfast (Irlande du Nord). Dans le groupe étaient représentés des catholiques (des militants et des moins militants), des protestants (militants et moins militants), et des Anglais. Le film de cette rencontre rend compte des progrès difficiles et partiels accomplis vers une meilleure compréhension, première étape d’une longue marche. Je considère que c’est un petit essai — semblable à celui que l’on ferait à l’aide d’une éprouvette — dont on pourrait tirer profit plus en profondeur et à plus grande échelle. Je continue à écrire. Alors que l’approche générale que j’ai des gens et de leurs relations ne change que lentement (et peu dans son principe), je dois reconnaître que l’intérêt que je porte à sa mise en application s’est nettement transformé. Je ne m’intéresse plus de façon primordiale à l’apprentissage de la thérapie individuelle mais aux implications sociales qui prennent de plus en plus d’ampleur. Les titres de quelques-uns de mes récents articles (qu’ils soient terminés ou en cours) permettront peut-être au lecteur de mieux savoir où j’en suis de mon travail actuel. Ces titres (approximatifs) sont les suivants : — Ma philosophie des réactions interpersonnelles et la façon dont elle se développa. — Réconciliation de ce qui relève de la connaissance intellectuelle et de l’expérience affective dans l’éducation. — Quelques nouveaux défis à la psychologie. — Quelques questions d’ordre social qui me préoccupent. — L’individu en train d’émerger : une nouvelle révolution. Tandis que j’écris ces lignes, surgit dans mon esprit la question que je me suis souvent posée dans le passé : « Mon influence a-t-elle des bases trop fragiles ? » Seul le jugement d’autrui peut apporter une réponse à cette question, à quelque date future. Et puis je fais du jardinage. Les matins où je n’arrive pas à trouver le temps d’examiner mes fleurs, d’arroser les jeunes pousses que je fais se reproduire, de vaporiser de l’insecticide sur certains parasites destructeurs, de verser l’engrais approprié sur quelques plants près d’éclore, je me sens frustré. Mon jardin me pose la même question mystérieuse que j’ai essayé de résoudre tout au long de ma vie professionnelle : « Quelles sont les conditions les plus favorables pour arriver à maturité ? » Mais dans mon jardin, bien que les frustrations soient tout aussi immédiates, les résultats, bons ou mauvais, apparaissent plus rapidement. Et quand, par des soins patients, intelligents, empreints de compréhension, j’ai réussi à créer les conditions optima dont il résultera la production d’une splendide floraison, je ressens le même genre de satisfaction que j’ai ressentie lorsque j’ai facilité l’épanouissement d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Carl R. Rogers La Jolla, Californie Juillet 1973 L’enracinement paysan Tout en doutant de la possibilité d’écrire une « histoire vraie de sa psychogenèse », comme il le dit dans son autobiographie, Carl Rogers ne se refusait pas à évoquer le sol culturel où il a pris naissance. Dans le plus lointain de son origine, apparaît un monde paysan : « Mes parents, eux-mêmes élevés à la campagne1 étaient des gens à l’esprit hautement pratique qui gardaient leurs deux pieds sur terre »2.
Les origines ruralesOn n’a pas assez mesuré l’importance d’une caractéristique terrienne dans le tempérament de Rogers : c’est en paysan prudent et obstiné, défiant vis-à-vis de l’intellectualisme, qu’il défrichera son champ d’exploitation et de recherche en psychologie, en thérapie ou dans les sciences du développement (n’a-t-il pas pris comme concept central de sa théorie et de sa praxis la notion agricole de growth, « croissance », « pousse » ou « maturité » ?). Une caractéristique analogue a été relevée pour Martin Heidegger, né en pays souabe « avant tout un homme de la campagne, attentif à la sourde palpitation de la terre, posant l’horizon de sa méditation phénoménologique, “existentiale”, face au décor fascinant de la Forêt Noire »3. Mais le monde paysan dans lequel Rogers sera frotté est en Amérique, où il est pénétré par l’esprit d’entreprise et d’aventure, par l’envie précoce des études universitaires, autant que par le puritanisme. « A une époque où l’enseignement supérieur n’était pas aussi généralisé qu’aujourd’hui, mon père avait passé un diplôme d’ingénieur et même suivi un enseignement de licence à l’université du Wisconsin. Ma mère avait également suivi des cours à l’université durant deux ans… Tous deux travaillaient très dur et surtout croyaient fortement à la vertu du travail. Il n’y avait rien pour eux qui ne puisse s’arranger en travaillant. Ma mère était très croyante et son point de vue devait devenir de plus en plus rigide avec l’âge. Elle avait continué de citer, dans les prières familiales, deux sentences bibliques qui se sont gravées dans ma mémoire et donnent une idée de sa religion. C’était : « Sortez du reste des nations et soyez séparés » ; « Toute notre rectitude n’est que haillons souillés devant Toi, Seigneur »4. Travail dur, séparation des autres et sentiment d’« élection » mais aussi de péché (et de distance), ce signifiant puritain et rural aura frappé Carl d’une dure empreinte et de sa contradiction, même s’il était compensé par les dimensions larges et l’horizon simplifiant de l’Amérique. Il aimera la solitude.
La familleQuand Carl Rogers naquit, le 8 janvier 1902 à Oak Park (« le parc du chêne »), dans la banlieue de Chicago, son père, qui avait fondé une entreprise de construction et de travaux publics avec un associé plus âgé, avait réussi : « Les années de vaches maigres étaient passées et nous étions devenus une famille aisée appartenant à la couche supérieure de la classe moyenne »5. Par cette caractéristique, Rogers ne serait-il pas poussé à devenir, à terme, praticien et théoricien d’une thérapie et d’une éducation de classe moyenne dominante, de tolérance néanmoins répressive, comme Freud fut amené à construire une thérapie appropriée à une intelligentsia de bourgeoisie victorienne et donc autoritaire ? Trois enfants étaient nés avant lui : l’aîné Lester, en 1894, puis une sœur qui resta la seule fille, et un autre frère, Ross, en 1899. Après lui naîtraient encore Walter en 1907 et John en 1909. Les parents tenaient la main : « Ils étaient passés maîtres dans l’art d’un contrôle subtil et aimant. Je ne me rappelle pas avoir jamais reçu un ordre direct à propos de quelque chose d’important. Et cependant telle était l’unité de notre famille qu’il était implicitement entendu que nous ne devions ni danser, ni jouer aux cartes, ni aller au cinéma, ni fumer, ni boire, ni faire montre d’une quelconque préoccupation sexuelle »6. Dans cette famille de cinq garçons et une seule fille, les questions sexuelles n’étaient pas à l’ordre du jour, et l’on tenait à distance la mère, la femme. On peut supposer en outre que ses trois aînés séparèrent Carl de sa mère. « Je trouvais que mes parents faisaient plus attention au frère qui me précédait qu’à moi. Ce sentiment dut être assez fort, puisque je me rappelle avoir construit une théorie selon laquelle j’étais un enfant adoptif (ce n’est que des années plus tard que je découvris la banalité de ce fantasme) »7. Ce qu’il dit de ses parents, de l’ambiance familiale laisse percer un obscur grief. Comme je lui faisais remarquer qu’il n’avait jamais parlé de sa sœur, aînée de cinq ou six ans, Rogers me répondit : « Elle n’a jamais joué un rôle très important dans ma vie. Elle était la seule fille dans une famille de six enfants et je crains (I am afraid) que chacun de nous, garçons, l’ait tourmentée (teased) bien impitoyablement. Cela me rend malheureux (unhappy) quand je regarde en arrière vers cet aspect de ma vie. Je pense que les vues religieuses trop strictes de mes parents et les taquineries de ses frères ont été les facteurs qui l’ont empêchée de se marier. Elle a travaillé de façon indépendante un certain temps mais semblait foncièrement dépendante de la maison et revint finalement vivre auprès de ses parents ; puis quand mon père mourut, elle et ma mère vécurent en Floride pendant un certain nombre d’années jusqu’à la mort de ma mère. Depuis lors, elle a développé une vie de son crû, réellement agréable et indépendante, avec des amis, s’intéressant à un club de jardinage et à l’association chrétienne des jeunes femmes. Je l’aime bien et la tiens en amitié mais ne j’ai que peu de relations avec elle »8. A distance de sa mère et de sa sœur, en rivalité avec le frère préféré, le jeune Carl concentre son attention sur l’aîné Lester, qui fut son « idole ». Il établit sur lui un « culte du héros », soutenu grâce à la révélation obtenue par la presse : Lester avait obtenu le score le plus élevé au test d’intelligence de l’armée, pendant la Première Guerre mondiale. Outre cette identification valorisante (et qui distrayait Carl des relations aux figures parentales), Lester procurait à Carl, par la venue de ses amis, l’agrément de réunions au sein de l’austère vie familiale, marquée par l’acrimonie des taquineries : « Il me fallut atteindre l’âge adulte pour découvrir que ces taquineries n’étaient pas un condiment indispensable des relations humaines »9. C’est cependant avec son cadet Walter que Carl se lia surtout et ce lien durera : « Le seul membre de la famille dont je me sens proche est mon frère Walter, qui a cinq ans de moins que moi. Ma femme et moi l’aimons beaucoup ainsi que son épouse. Il est de façon courante à New York mais se rend à Tucson. C’est un médecin »10. Avec leur cadet John, Carl et Walter formeront un « solide trio » malgré les différences d’âge. Plus tard, on pourra remarquer l’intérêt de Rogers pour les enfants-problèmes et autant il gardait ses distances à l’égard de ses contemporains ou de ses « pairs », autant il se sentait proche des étudiants.
L’école
Au moment de la naissance de John, Carl, âgé de sept ans, fut mis à l’école Holmès, à Oak Park. Cette école est renommée pour avoir produit Ernest Hemingway et les enfants de Frank Lloyd Wright, ses condisciples, note Helen Elliott, qui raconte aussi sa première rencontre avec celui qui devait devenir son époux : « Dans la classe fut introduit un petit garçon, qui se tint debout en face de nous, avec un livre ouvert qu’il nous lut couramment ; si couramment que le maître l’admit d’emblée en cours élémentaire (alors que c’était sa première expérience scolaire) avec grand plaisir. Ainsi ai-je fait connaissance avec ce garçon farouche, sensible et asocial, qui préférait vivre dans les livres et dans son rêve plutôt que de rencontrer la rugueuse cour de jeux ou entrer en compétition sportive. Il rentrait directement chez lui après l’école, et pendant que nous nous attardions à jouer à la balle, il allait nourrir ses poulets ou vendre des œufs aux voisins, pour un petit commerce dû à son initiative et que ses parents encourageaient. Ma maison était seulement à un bloc de la sienne et de temps en temps nous nous rencontrions en bicyclette et faisions une promenade ensemble »11. Carl n’oubliera jamais Helen même s’il se sent attiré par ses institutrices successives au point de ne plus rentrer directement chez lui, remarque-t-il. Il rêve et lit de plus en plus : après les lectures bibliques, des histoires d’indiens et de pionniers, voire l’encyclopédie ou le dictionnaire. « Je me rappelle encore certains essais pour obtenir une information sexuelle de cette manière, aboutissant toujours à une impasse au moment crucial. Ces lectures me rendaient coupable, bien souvent.12 » Malgré ses débuts scolaires brillants, Carl devint si distrait, si perdu dans les nuages (on l’appelait Professor Moony, « professeur Lune ou Nimbus ») que ses parents s’inquiétèrent. Ils eurent l’idée (très en avance, pour leur époque, et sans doute prémonitoire pour la nôtre) de le sortir un temps du climat scolaire et de le mêler à la vie. Pour son douzième anniversaire, « alors que j’étais en quatrième, mon père proposa de m’emmener en voyage d’affaires avec lui pendant deux ou trois semaines dans le Sud et dans l’Est. J’obtins la permission de quitter l’école sous la condition de présenter au retour un compte rendu écrit de mon voyage. Père et moi nous visitâmes la Nouvelle-Orléans, Norfolk en Virginie et New York, passant une grande partie de notre temps sur les chantiers. Je m’amusai bien (I enjoyed myself) mais ne tombai pas pour autant amoureux du métier d’ingénieur. C’est seulement en repensant à ce voyage que je réalise son caractère extraordinaire. Je ne me rappelle pas qu’aucun de mes frères ait été emmené de même en voyage »13. Carl l’esseulé n’était pas oublié par ses parents : il retira de cet épisode le souvenir d’une expérience enrichissante, l’enthousiasme pour les chants des travailleurs noirs sur les docks de la Nouvelle-Orléans et une passion pour les huîtres.
La ferme
Mais un événement décisif suit ce voyage et vient marquer l’automne 1914 : étrangers à ce qui se passait en Europe, mais soucieux de préserver leurs six enfants des maléfices de la vie citadine ou banlieusarde, et leurs affaires prospérant, les parents Rogers s’installent dans une grande ferme qu’ils achètent à cinquante kilomètres de Chicago. C’est une nouvelle acculturation rurale pour Carl : il aime, dès le déménagement, cette ferme et les bois où il apprend à découvrir les oiseaux et les animaux, vivant des histoires de pionniers et d’indiens avec ses jeunes frères. Dans cette phase d’épanouissement terrien, deux expériences le frappent. Tout d’abord il fait la découverte fascinante de magnifiques papillons de nuit, ce qui le conduit à élever des chenilles pour « un premier projet de recherche indépendant, comme on dirait de nos jours »14. Corrélativement, en contact avec la direction scientifique de la ferme, il entreprend la lecture de livres scientifiques d’agronomie : « La construction d’un modèle expérimental adapté, le principe des groupes de contrôle, le contrôle de toutes les variables sauf une, l’analyse statistique des résultats, tous ces concepts, je les absorbais sans m’en rendre compte, entre treize et seize ans, en lisant »15. C’est dans l’enracinement paysan
que Rogers découvrit donc la méthodologie scientifique qui ne cessera de
le mouvoir dans son activité de psychologue et d’enseignant16.
Et cet enracinement ne sera pas qu’intellectuel ou affectif. Sans doute
peut-on remarquer que les papillons auxquels il s’intéresse se désignent
génériquement sous le terme féminin de moth (est-ce la mère,
the mother qu’il recherche en s’occupant de leurs activités
sexuelles, de leur ponte, et de la mutation, du « devenir » de leurs
chenilles ?…). Mais Carl va travailler dur, menant de front, matin et
soir, travail domestique et travail scolaire. Cet adolescent (est-il
encore rêveur ?) se lève avant cinq heures, et en attendant de se
rendre à l’école « en voiture à cheval, en train, en auto ou en
combinant ces trois moyens de transport »17,
doit traire une douzaine de vaches. Il doit à nouveau les traire, le
soir, au retour de l’é-
Solitude et labeur
Cet adolescent expérimente dans son corps la tension entre l’activité pratique et le travail intellectuel dans lequel il réussit sans peine et brillamment, notamment en anglais et dans les disciplines scientifiques (il a des « très bien » à presque tous ses cours). Mais passant successivement dans trois lycées, il n’a pas le temps de se faire d’amis, même s’il n’éprouve pas de difficultés à s’entendre avec ses camarades de classe : « Simplement je ne les connaissais que de manière superficielle et me sentais différent et seul »19. Différent et seul ! Tout un programme de vie rurale qu’il consolide par ses activités de vacances. « Pendant les mois d’été je labourais toute la journée, habituellement un champ de maïs plein d’herbes folles, à l’autre bout de la ferme. C’était une leçon d’indépendance que d’être mon maître : loin de tous les autres.20 » On conçoit que plus tard il se tiendra farouchement à distance des influences, et qu’il a pu évoquer sa chance de n’avoir jamais eu d’autorité à laquelle se soumettre : « Je n’ai eu, dans le domaine professionnel, ni à m’assujettir, ni à combattre une image paternelle. De nombreux individus, des organisations, des écrits ont joué un grand rôle dans ma formation mais aucun n’a été dominant »21. Et il pourra précocement critiquer, dans des dissertations, Shakespeare, « auteur surfait ». Son adolescence s’accomplit dans une autonomisation et une austérité croissantes. En 1919, finissant l’enseignement secondaire à dix-sept ans, il travaille pendant toutes les vacances, avant de faire ses débuts à l’université, sur un chantier à bois, loin des siens, dans le Nord-Dakota. Il y travaille dur, ne fréquentant personne, mais passant de longues soirées à lire Carlyle, Victor Hugo, Dickens, Ruskin, R.L. Stevenson, Emerson, Scott, Poe et bien d’autres, dans de petits livres reliés en cuir qu’il avait achetés avec les quarante dollars de son cadeau de fin d’études. « Je me rends compte que je vivais dans un monde à moi, fait de tous ces livres », commente-t-il22. Trente-deux ans plus tard, publiant son maître-livre, Client-Centered Therapy, Rogers éprouva le besoin de citer en exergue Emerson (Divinity School Address, 1838) : « Nous gardons avec lumière dans la mémoire les quelques entretiens que nous avons eus, dans les années lugubres de routine et de péché, avec des âmes qui ont rendu nos âmes plus sages ; qui parlaient ce que nous pensions ; qui nous disaient ce que nous savions ; qui nous donnaient la permission d’être ce que nous étions intérieurement ». La solitude de Carl, accentuée à l’égard des filles, allait être entamée par la vie universitaire : il devait y rencontrer des personnes qui parleraient de ce qu’il pressentait et qui le confirmeraient dans son devenir.
Chapitre II
L’expatriement universitaire
Lié à son enracinement, Carl Rogers avait décidé de devenir agronome. Il s’inscrivit à l’université du Wisconsin en 1919 : tous les siens, parents, frères et sœur y étaient passés ; et il y avait une très bonne école d’agronomie.
Au foyer
Il se retrouve en chambre, avec son frère Ross, de trois ans son aîné, dans le cadre d’un foyer de l’ymca (Young Men Christian Association, Union chrétienne des jeunes gens). Il va découvrir des amitiés fraternelles, élargies, vivant intensément des sentiments religieux, en même temps qu’il aborde des études supérieures et qu’il retrouve (après cinq ans d’éloignement) la jeune Helen Elliott, qui suit des études artistiques. Remué par l’ambiance universitaire, en précurseur des incertitudes étudiantes d’aujourd’hui, Carl va osciller sur son orientation : après un congrès d’étudiants « volontaires » (benevols), aux vacances de Noël de sa deuxième année (1920), il décide de devenir pasteur ; il abandonne donc l’agronomie pour l’étude de l’histoire, comme formation de base. Symboliquement, l’attrait du « ciel » l’arrache à sa « terre » isolante. Son zèle néophyte a bientôt une conséquence exemplaire : au milieu de sa troisième année d’université, il est désigné avec neuf autres étudiants américains pour représenter son pays à un congrès de la Fédération mondiale des étudiants chrétiens à Pékin. « A l’annonce de cette nouvelle, je pleurai de joie et de surprise. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi c’était moi qu’on avait choisi. »1
Le voyage en chine
Ce ne fut pas un simple séjour. Le dépaysement s’étendit sur près de six mois. Tout d’abord, les voyages en paquebot furent longs : ils donnèrent lieu à des échanges approfondis sur les relations interculturelles. Les étudiants s’y trouvaient pris au sérieux dans leurs rapports avec des personnalités adultes de premier plan. Rogers fit sans doute des lectures d’ouvrages de philosophie orientale : « Quoique je ne puisse dire que j’ai souvenir d’avoir été spécialement remué ou excité par eux. Peut-être ai-je fait quelques lectures qui ont eu un impact que je n’ai pas réalisé, mais je n’en ai pas de mémoire consciente »2. En second lieu, le congrès à Pékin se tint du 4 au 9 avril 1922, au Tsing Hua College. Il était placé à grande échelle, rassemblant six cents délégués chinois, venus des vingt et une provinces de la Chine d’alors, ainsi que deux cents délégués étrangers, envoyés par trente-quatre pays. Les langues officielles étaient l’anglais et le chinois. Le professeur Latourette, de l’université de Yale, qui conduisait la délégation américaine avec John Mott3, citait, parmi les délégués européens : un Hollandais, le Dr Rutgers ; un juriste italien, le Dr Geil ; un Français, M. Médard ; et parmi les Allemands, le professeur Heim, de Tubingen. Il y avait aussi vingt-quatre Japonais que Rogers a dû rencontrer avec Kenneth Latourette. Celui-ci parle également avec affection du peuple chinois et de ses nombreux délégués, dont certains avait fait des études brillantes aux Etats-Unis (C.T. Wang, David Yui, Dr T.T. Lew, Dr Chang Po Ling). Et Rogers constate : « J’ai rencontré beaucoup de Chinois au cours du voyage en Chine mais pas principalement (primarily) des philosophes et des penseurs orientaux, quoique je suppose (suspect) avoir écouté les interventions de quelques-uns d’entre eux à la conférence de Pékin »4. Dans le numéro de juin 1922 de l’Intercollegian, bulletin des ymca, le jeune Rogers, dans ses vingt ans, a fait un compte rendu du congrès, placé en première page, sous le titre : « Une expérience d’internationalisme chrétien ». Le début de ce compte rendu est annonciateur et significatif : « Des hommes et des femmes de trente-quatre pays, vivant ensemble, se rencontrant dans la même pièce, discutant franchement de leurs communs problèmes, tout en divergeant fortement sur beaucoup de points, et cependant avec un esprit d’accord (agreement) qui allait plus profond que leurs différences — est-ce que cela ne sonnerait pas un peu comme une description du millenium5 ? Pourtant ce fut un fait qui s’accomplit à la conférence de la Fédération mondiale des étudiants chrétiens à Pékin »6. Cette expérience (experiment) marque de façon indélébile Rogers, dans sa forme : il s’en souviendra dans sa pratique, bien plus tard. Il y avait rencontré un échange concret dans lequel la situation en Chine et la situation mondiale étaient prises en charge ; il constatait des discussions vives et franches dans une large ouverture : « C’était loin d’être une conférence pour les étudiants », dit le jeune Rogers. « C’était une conférence des étudiants. Ils étaient en alerte sur tout ce qui était offert, et francs et ouverts dans leurs critiques de certaines choses qui ne correspondaient pas à leurs attentes… La génération présente n’est satisfaite de ses leaders que lorsque ceux-ci, non seulement reflètent (reflect) leurs pensées et leurs aspirations, mais les mettent au défi (challenge) d’aventures supplémentaires dans la foi.7 » Repenser ses positions sur beaucoup de vieux problèmes, vivre des « forums » intenses où il fallait en rabattre avec « l’autosatisfaction occidentale », pour constater que les orientaux étaient déjà en beaucoup de manières bien au-delà de nous dans leur façon de penser ces questions8. Refus des compromissions : le jeune Carl retrace ces apprentissages vécus au cours du congrès. Il note également que dans ce rassemblement il n’y a pas eu « une note de faux optimisme »9. Il redécouvrait, en effet, à sa stupéfaction, l’Occident et sa rage des divisions. Il se voyait, écrit-il dans sa maturité, « mis au défi de comprendre les échanges entre étudiants et enseignants, allemands et français, qui étaient toujours aussi remplis de la haine et de la défiance héritées de la guerre de 14-18 »10. Et il écrivit, comme conclusion de son compte rendu : ce congrès « a été accablé (charged through and through) par la prise de conscience (realization) de la terrible somme de mal, d’égoïsme et de haine, que nous observions dans le monde et ceci nous a ramenés au Christ comme au seul Unique qui ait la solution à nos problèmes. Chaque autre moyen a été essayé et trouvé insuffisant. Pourquoi ne pas prendre le Christ au mot et essayer Sa voie ? Les étudiants du monde ont été affrontés à ce défi, à Pékin »11. Mais après la surchauffe du congrès, loin de rentrer, Carl allait se « tremper » dans la Chine occidentale avec des tournées de conférences qu’il fit dans les centres universitaires ; il accompagne ensuite le professeur Latourette, qui amasse du matériel pour un livre, en Chine du Sud (puis aux Philippines, en Corée et au Japon). C’était la Chine de 1922, en lente révolution, celle où arrivaient Saint-John Perse, Teilhard de Chardin, et trois ans plus tard Malraux. Saint-John Perse, diplomate, y écrivit Anabase : « Mais par-dessus les actions des hommes sur la terre, beaucoup de signes en voyage, et sous l’azyme du beau temps, dans un grand souffle de la terre, toute la plume des moissons…12 » Teilhard, paléontologue, évoque à propos de ce pays, en 1923, l’offrande de « l’accroissement du Monde emporté par l’Universel Devenir »13. Et Malraux fortifie son culte du héros et de son devenir dans le tragique, libérateur de La condition humaine. Rogers découvrit l’Orient : foules et individualités, aspects immémoriaux et connaissance de l’instant intense, changements et relativités en attente. Peut-être rencontra-t-il des sages qui, comme Krishnamurti, lui assurèrent : « Le corps a son intelligence… La vie est maintenant, mais s’il y a de la peur on ne peut pas vivre… L’innocence existe… La vérité n’a pas de chemin… On peut devenir autre… Changer immédiatement n’est pas une utopie… Est-ce que vraiment le temps existe…, si la division n’existe plus entre les hommes ou en soi-même…14 » Notant la succession de ses impressions, chaque jour, Rogers peut constater : « Mon horizon intellectuel s’élargit de manière incroyable pendant toute cette période et mon journal témoignait de ces changements »15. Carl envoya un exemplaire de son journal à sa famille, un autre à Helen devenue sa « bien aimée ». La famille fut consternée, mais ses réactions mirent deux mois à rejoindre Carl ; il était trop tard. « C’est ainsi qu’avec le minimum de douleur, je brisais les liens intellectuels et religieux qui m’attachaient aux miens.16 » Sur le bateau du retour, un doute sur la divinité du Christ le saisit, ce qui l’écartera définitivement des siens.
L’éloignement de la famille
Cependant, sa « rébellion » vis-à-vis de sa famille ne se fit pas sans heurt physiologique. Carl souffrait de l’estomac depuis l’âge de quinze ans ; dès son retour ses souffrances s’aggravèrent, et il dut passer plusieurs semaines à l’hôpital, pour un ulcère duodénal. Il resta ensuite six mois soumis à un régime sévère. « On trouvera peut-être quelque indication sur l’atmosphère ouatée de refoulement dans laquelle nous fûmes élevés, commente-t-il avec amertume, quand on saura que nous fûmes trois sur six à faire un ulcère à un moment ou à un autre de notre vie »17. Toutefois, momentanément abstrait du travail universitaire (son année étant compromise), Carl reprit complètement pied chez ses parents et s’embaucha dans un magasin de bois voisin de la « maison » : comme ses parents, il croyait que « le travail remédiait à tous les maux y compris à (son) ulcère »18. Il se referme à nouveau en lui, prend de la distance vis-à-vis de ses amis de la « fraternité » (Alpha, Kappa Lamda), et suit par correspondance des cours de l’université du Wisconsin pour une introduction à la psychologie (selon un William James peu convaincant). Mais il fréquente assidûment Helen, revenue comme par hasard à Chicago pour travailler dans un atelier de peinture. Il la rejoint le soir après sa rude journée au dépôt de bois, dans une vieille Ford, de ce modèle T qui a fait les délices des films comiques muets. Helen avait accueilli son journal, et consenti à son évolution. A l’automne 1922, il peut retourner à l’université : il a pris un an de retard, mais à l’occasion d’une des visites d’Helen à la maison, tous deux se fiancent le 29 octobre 1922 et sur ce point il prend de l’avance : « J’avais beaucoup douté de pouvoir la conquérir et je nageais dans la joie »19. Deux ans plus tard, en juin 1924, Carl, intéressé par des professeurs « remarquables »20 termine sa licence d’histoire (grade de bachelor of arts). Il s’était aussi passionné pour les débats publics de l’université, y ayant acquis de l’assurance sur ses capacités à aborder, de front, de nouveaux problèmes intellectuels. Il importe de noter qu’il écrivit également trois études, l’une sur « la source de l’autorité chez Martin Luther », une autre sur Benjamin Franklin et la troisième sur « le pacifisme de John Wycliff ». Il se révélait à lui-même, écrivant en pleine « indépendance », mais dans la tension d’une méthodologie solide. « Je me rends compte aujourd’hui qu’une des idées que je développais alors, à savoir qu’en dernière analyse la seule chose dont l’homme puisse être sûr c’est sa propre expérience, est restée un de mes thèmes favoris.21 » Il utilisait même ce recours à sa propre expérience, non seulement intellectuellement et spirituellement, mais aussi physiquement. Une anecdote de cette époque le démontre avec éloquence : « Je me rappelle qu’une fois ma Ford modèle T, ma première voiture, était coincée dans le parking du dépôt de bois. Je soulevai simplement l’arrière de la voiture et la déplaçai de quelques pouces. Ce faisant, je me donnai un tour de rein. L’idée, semble-t-il, ne me serait jamais venue de demander de l’aide à quelqu’un »22 .
Amour et séminaire
Le recours à son expérience en actes, Carl Rogers va le mettre sans plus attendre en pratique. Malgré l’opposition de ses parents et de ceux de sa fiancée au mariage précoce, très contraire aux usages de l’époque, il épouse Helen le 28 août 1924 (là encore Carl se pose en précurseur des mariages ou compagnonnages estudiantins actuels). Il désire partager avec Helen la nouvelle expérience au cours de laquelle il espère trouver un équilibre entre une vocation religieuse et ses sentiments nouveaux et celle-ci accepte de renoncer à un travail de peintre publicitaire. Mais derechef en opposition avec sa famille qui fait pression pour l’orienter vers un séminaire d’orthodoxie stricte, Carl Rogers choisit de poursuivre ses études à New York, à l’Union Theological Seminary, séminaire le plus libéral : passant un concours, il obtient une « bourse confortable », qui assure son autonomie. Après des noces très simples, Helen et Carl, en lune de miel, partent, dans une nouvelle Ford achetée d’occasion (pour 450 dollars), un coupé modèle T, « conquérir New York »23. Et ce fut la découverte de l’amour dans un « petit appartement moderne » installé grâce aux cadeaux des parents, mais aussi intellectuellement, celle d’« une expérience aussi séduisante qu’une aventure amoureuse »24. Ce fut en premier lieu l’initiation à des conceptions religieuses libérales et modernes. Rogers découvrit, grâce au professeur Mac Giffert, qui dirigeait le séminaire, un art d’enseigner également chaleureux pour les diverses doctrines présentées, mais respectant profondément l’indépendance de pensée des étudiants. Mac Giffert traite notamment de « la pensée protestante avant Kant », c’est-à-dire avant une poussée de théorisation abstraite, suraccentuant les antinomies. Mais on comprend d’autre part le retentissement que pouvait avoir pour ce jeune rural qui avait déjà tant bougé, le point de vue relativiste que soutenait Mac Giffert : « La croissance et le changement (growth and change) appartiennent à l’essence de la réalité »25. Cette hypothèse non platonicienne fut plus tard à la base des conceptions thérapeutiques et philosophiques de Rogers. Il fut également marqué par ses contacts avec Godwin Watson et Joseph Chassel, l’initiant aux sciences humaines, à la « clinique », aux counselings individuels et aux travaux de petit groupe : « Pour la première fois de ma vie, je réalisais que travailler avec autrui en relation d’aide pouvait représenter un métier »26. Ces apports stimulants de l’Union Seminary furent intégrés et complétés par une entreprise singulière, « amusante mais lourde de sens »27, réalisée grâce à une compréhension dont Rogers s’étonne encore, connaissant la rigidité persistante des universités. « Nous voulions explorer nos propres questions et nos propres doutes et suivre notre propre cheminement. Nous réclamâmes de l’administration l’autorisation d’organiser un séminaire d’études (qui compterait pour l’examen) et dont le programme serait composé par nos seules questions. On comprend la perplexité de l’administration devant cette requête que, finalement, elle accepta. Seule restriction, un jeune instructeur devait assister à nos débats, mais sans prendre part à la discussion, sauf demande expresse de notre part. Ce séminaire d’études m’apporta beaucoup et m’aida à clarifier mes vues. Grâce à cette expérience, j’évoluais considérablement construisant peu à peu une philosophie de l’existence. La plupart des membres de ce groupe, en tentant de réfléchir sur les questions qu’ils avaient eux-mêmes posées, découvrirent qu’ils n’étaient vraiment pas à leur place dans le pastorat. Je fus un de ceux-là, Théodore Newcomb en fut un autre. Divers membres du groupe sont devenus sociologues ou psychologues »28. On aperçoit encore ici un aspect précurseur : le passage du « cléricat » à des professions liées aux sciences humaines. Mais il y a un aspect précurseur plus étrange en cet enseignement « critique » : on comprend qu’en 1968, un amphithéâtre d’une faculté de lettres et sciences humaines à Bordeaux, ait porté le nom de Carl Rogers. Car, remarque Max Pagès, c’est une « première expérience pédagogique non directive »29. Dès lors les dés sont jetés. Rogers virait vers la pédagogie et la psychologie, conçues en forme non dogmatique : « Je me rendais bien compte des bouleversements déjà survenus dans mes conceptions ; il était probable que je continuerais à changer »30.
Une rencontre opportune : Kilpatrick
Dès la deuxième année de séminaire, Rogers s’était inscrit au Teacher’s College de l’université de Columbia, une des plus célèbres écoles de pédagogie des Etats-Unis. Il est alors stimulé par des cours sur la philosophie de l’éducation que William H. Kilpatrick dispense grâce à des exposés-discussions et à un travail en petits groupes ; il découvre, par eux, pour la première fois, la pensée monumentale de John Dewey, « la plus profonde et la plus complète expression du génie américain », assurait-on vers la même époque, en Sorbonne, à l’occasion de son intronisation comme docteur honoris causa, en 193031. Rogers en resta inspiré de façon inaltérable. La rencontre avec Kilpatrick semble avoir été déterminante : Rogers, dans toutes ses présentations, dans ses biographies, dans ses bibliographies, évoque inlassablement Kilpatrick. « Je pense que l’essentiel de mon savoir sur Dewey m’est venu au travers de cours que j’ai eus avec Kilpatrick. Je me suis référé à ses livres nombre d’années après avoir quitté le Teacher’s College. »32 Il est curieux qu’aucun des auteurs qui ont étudié Rogers ne se soit soucié de rechercher, sinon qui était ce Kilpatrick, ou du moins quelles étaient ses positions, liées à celles de Dewey. C’est tout d’abord un américain défendant fougueusement une conception « consistante » de la démocratie et de la liberté dans les institutions et dans la pédagogie. Il se réfère fréquemment à Jefferson dont il oppose les positions à celles de Napoléon : « Napoléon n’avait aucune confiance (faith) dans l’opinion (the thinking) des gens (people) et ne la désirait nullement, estimant au contraire que les individus doivent se voir enseigner depuis leur enfance ce qu’ils doivent penser. Jefferson, par contre, croyait profondément (exactly) à l’opinion des gens, s’ils sont “convenablement éclairés” »33. Au contraire de l’école napoléonienne construite pour le dressage et la parade au tambour, l’école jeffersonienne se définit par des exercices et des jeux, et par l’apprentissage d’une voie personnelle « qu’une personne autonome (self directing) et responsable peut apprendre à gagner ». Rogers reprendra quarante ans plus tard cette terminologie du self-directing que lui inculquait Kilpatrick, en la vivant : et il la développera selon des concepts personnels ou institutionnels de self-directed learning, self-direction, mais aussi de self-evaluation, et enfin de self-directed change (pour tout un système éducationnel)34. L’étudiant Rogers, en attendant, avait dû être séduit par des assertions du genre : « […] A quelque moment vers la fin de l’adolescence, chacun devrait réexaminer pour lui-même ce qu’il a antérieurement reçu comme établi, soit dans la tradition ou la foi ou au moins avec une intuition enfantine (childlike insight). Ce réexamen (rethinking) sera accompli au mieux s’il est fait en connexion avec des discussions conduites par un adulte sympathique et critique, qui sache comment questionner et guider sans interposer sa manière de penser pour empêcher le jeune d’aborder de lui-même ses problèmes réels et d’aller vers ses propres conclusions à la lumière des vues diverses que les hommes ont tenues ou tiennent sur de tels problèmes »35. Ce que Rogers avait vécu pour lui-même dans sa jeunesse était confirmé par ces propos de Kilpatrick. Et l’attitude préconisée pour un adulte pourrait se réidentifier chez lui sous forme de pratique à produire face aux adolescents montants (mais aussi dans toute psychothérapie). Kilpatrick avait sans doute authentifié en Rogers une attitude profonde de liberté, mûrie dans la solitude terrienne et le dépaysement. Mais il apportait d’autre part à celle-ci des fondements philosophiques et une autre confirmation. Cet Américain possédait, en effet, une vaste culture européenne : ses cours sur l’éducation ont mis Rogers au contact de toute la pensée occidentale et de ses débats sur l’éducation. Kilpatrick connaît et cite couramment Rabelais, Montaigne, et Galilée ; mais aussi Descartes et Pascal, Montesquieu, Condorcet et Adam Smith, Voltaire et Rousseau, Turgot et Napoléon, Kant et Hegel, Tocqueville et Schopenhauer, Darwin et Stuart Mill, Spencer et Nietzsche, mais encore Ortega y Gasset, Tagore, Bernard Shaw, Wells, Thorndike, Toynbee. Son enseignement dispensait certains de ses étudiants de recherches philosophiques propres — on ne trouve effectivement guère celles-ci dans les bibliographies rogériennes. Mais il assurait un soubassement solide, enfoui sous l’activité du psychologue clinicien, apportant néanmoins une cohérence dans la construction d’hypothèses de travail et de recherche dans les sciences humaines et dans la thérapie. Kilpatrick, en troisième lieu, apparaît comme un philosophe « naturaliste », étayant son empirisme libérateur sur une référence conjointe à Descartes et Darwin. « Ce fut Descartes, assure-t-il, ainsi que Bury le pense, qui plus que tout autre, écrivit “la déclaration de l’indépendance de l’Homme”. Et cela il le fit en conduisant les hommes à accepter : 1. la suprématie de la raison scientifique ; 2. la règle de la loi naturelle… Il s’agissait d’être homme en face (versus) de la nature, ou plus exactement homme dans la nature travaillant à la contrôler selon ses propres fins choisies »36. Ce qu’on sait du jeune Carl laisse à penser combien il dut adhérer à ces principes d’indépendance et de progrès, réaffermis chez Kilpatrick par l’évocation de l’Aufklärung. Conjointement, la philosophie de Kilpatrick s’exprime par une adhésion profonde aux thèses de Darwin, datant de L’origine des espèces (1859) une orientation fondamentale vers le changement dans la nature en général et dans la nature de l’homme en particulier. « Deux conséquences de la position de Darwin nous concernent ici : […] d’abord que le changement devient la conception principale (chief) pour comprendre les affaires humaines, à la fois dans le développement individuel et dans la civilisation ; en second lieu, que la conduite biologique, la conduite de l’homme quand il affronte une situation pour la contrôler, devient la clef pour l’étude du processus de la vie, aussi bien de l’individu (physique, biologie) que du groupe (sociologie, histoire, sciences politiques, économie) »37. Rogers n’oublia pas cette mise à contribution de « la biologie pour comprendre le processus de la vie »38. Il resta sensible à l’usage répété de verbes en forme progressive : (feeling, goal-seeking, thinking, learning, experiencing, etc.) et à la construction de propositions en cohérence logique, qu’on retrouve fréquemment dans le style de Kilpatrick ainsi qu’à cette « recherche obstinée de valeurs de plus en plus adéquates, que nous appelons acte philosophique (philosophizing) »39. Il souscrivit toute sa vie à la déclaration de Kilpatrick selon laquelle son œuvre « voudrait aider chaque lecteur à construire une philosophie pour lui-même »40. Et il goûta son sens de l’approximation, induisant à entreprendre son action propre, « même si on ne doit pas réussir pleinement (not perfectly) »41. Il adhère tout naturellement à une éducation fondée sur le développement social, affectif et intellectuel, dans la confiance au surplus de l’énergie présente en chaque être. « C’était cette provision de vivant (living) qui, à la génération précédente, était refusée explicitement par l’école “en silence, sans mouvement, en mémorisation”, selon Thorndike. Et cette école, pensait-il, “réprimait, contrecarrait et déformait la croissance (growth) mentale”. C’était plus encore la croissance dans les lignes sociale, morale et émotionnelle qui était réprimée, contrecarrée, déformée, rejetant ainsi toute la croissance efficace dont nous avons besoin »42. Rogers, enfin, comprend que les idéaux et principes d’action ne soient pas construits hors de l’expérience propre de la personne et de sa pensée active (thinking) : en ce que les « généralisations » sont « non-transférables ». Sur ce point crucial où la pensée de Kilpatrick rejoignait l’œuvre majestueuse de Dewey et sa « logique », Rogers attache sa démarche centrale en psychothérapie : il conçoit que la « guidance d’un enseignant avisé » apporte à une personne une aide importante, mais que « la construction réelle » de la personnalité s’effectue par la pensée active (thinking) de la personne sur ses propres expériences, spécialement les expériences dans lesquelles elle détient une part responsable de direction (management) »43. Et il peut approfondir l’importance d’une compréhension active et subtile de l’interlocuteur, à laquelle il rattache la notion d’« empathie » et que signifiaient déjà les alertes de Dewey : « L’éducateur authentique […] doit avoir cette compréhension sympathique des êtres qui lui fait saisir, au moment même, ce qui se passe dans l’esprit des élèves »44.
L’ouverture à la psychothérapie
En même temps qu’il était introduit à la philosophie de l’éducation et à la confirmation de ses propres intuitions, Rogers était initié à la psychologie clinique : non seulement au séminaire avec Godwin Watson mais au Teacher’s College même. On doit noter que là, c’est une femme, « sensible et pratique », Leta Holligworth qui guide ses premiers pas dans ce domaine : il ne pourra l’oublier. « Elle était pleine de chaleur humaine, très soucieuse de l’individualité de chacun tout en faisant de la bonne recherche scientifique. C’est sous sa direction que je fis mes premières armes de clinicien avec des enfants »45. Par la chance d’une relation chaleureuse et précoce établie en face de jeunes aux prises avec leur devenir, Rogers entrait dans la voie d’une maïeutique en thérapie. On se souvient qu’il se présenterait, un quart de siècle plus tard, comme « la sage-femme » qui s’émerveille à la naissance « d’un soi, d’une personne »46. On verra aussi qu’il sera très sensible à la praxis d’Otto Rank, mettant en perspective thérapie et dépassement du traumatisme de la naissance. Il se présentera dès lors, face au client ou plutôt de trois-quarts, pas dans son dos, comme dans la pratique du divan en psychanalyse classique. Il restera fidèle à cette disposition de communication et d’aide, toute sa carrière. Cette démarche s’assurait au moment où naissait au foyer d’Helen et de Carl, en 1926, un premier enfant, David. « Nous nous efforcions de l’élever selon les règles du behaviorisme watsonien, horaires stricts, etc. Heureusement Helen avait assez de bon sens pour faire une très bonne mère malgré toute cette nocive “science” psychologique.47 » C’est en ces conditions, sans secousse, « sans douleur », unissant déjà indissolublement éducation et thérapie, clinique et recherche, développement professionnel et vie familiale souple, échanges et vie privée, affectivité et rationalité scientifique, que Carl décidait de quitter définitivement l’Union Theological Seminary à la fin de la deuxième année. Il ne s’inscrit, à la rentrée d’octobre 1926, qu’au Teacher’s College, à la fois en psychologie clinique et en psychopédagogie. Il se sentait alors très assuré face aux examens à braver (même pour un cours de statistique dont l’enseignement par Thorndike lui-même, lui avait paru important mais abscons). Il ne lui venait pas à l’idée qu’il pourrait échouer et était surpris de l’effroi de certains, par exemple pour l’examen d’admission au doctorat. « Je me présentais et réussis comme je m’y attendais. Plusieurs mois plus tard, je fus surpris de découvrir, par hasard, que j’avais obtenu le score le plus élevé de mon groupe, au test de performance intellectuelle de Thorndike et aussi les meilleurs notes à l’examen de contenu.48 » Helen note, quant à elle, la sincérité vécue alors par son mari : « Ce qui me fut le plus précieux fut la capacité de Carl à être ouvert et franc et plein de confiance en faisant face à tous nos problèmes, y compris notre vie sexuelle… Son aptitude à écouter et à être empathique était là dès les premières années de notre mariage »49. Dans un de ses derniers livres, Becoming Partners : Mariage and its Alternatives (« Devenir conjoints : le mariage et ses alternatives »), Rogers donne quelques précisions sur leur vie commune à cette époque. « Je devins très vaguement conscient qu’alors que notre relation sexuelle était importante pour moi, elle n’avait pas cette importance pour elle… Au cours de ma maîtrise, j’appris qu’un psychiatre, le docteur G.V. Hamilton, recherchait quelques jeunes mariés pour achever une recherche qu’il avait entamée. Il y avait probablement une indemnité qui était proposée, ce qui expliquait mon empressement à saisir l’occasion (en fait, l’étude était, de façon plus personnalisée, un travail précurseur à l’enquête Kinsey, et très bien faite, quoique jamais connue de façon étendue). Je rencontrais le docteur Hamilton à son bureau pour deux ou trois entretiens prolongés. Il me questionna si calmement et si aisément sur chaque aspect de ma vie et de mon développement sexuel que j’arrivais graduellement à en parler avec une aisance presque égale. J’en vins à réaliser que je ne savais justement pas si ma femme avait eu un orgasme. Elle semblait souvent se réjouir de nos rapports, si bien que je présumais avoir la réponse. Mais la chose la plus importante que j’appris fut que l’on peut parler, aisément et librement, des choses de la vie privée dont on croit qu’il n’est pas possible de parler. « Alors vint la question : “Pourrais-je traduire ceci dans ma vie personnelle” ? Je commençais le processus effrayant (frightening) de parler — de parler réellement — avec Helen à propos de notre relation sexuelle… Et nous avons survécu à cela (weathered it) ! Chacun apprit à comprendre beaucoup plus profondément les désirs de l’autre, ses tabous, ses satisfactions et ses mécontentements dans notre vie sexuelle »50. Il était possible, avec humour, de « révéler » à l’autre ce qui ne pouvait être révélé : l’approfondissement et l’accomplissement mutuel de leur vie sexuelle allait renforcer chez Rogers le principe d’une thérapie directe, dans un dialogue tranquille.
Chapitre III
L’orientation professionnelle
David était présent au foyer des Rogers. Il fallait l’éduquer mais d’abord gagner sa vie..
En quête d’emploi
A la rentrée universitaire de 1926, Carl ne disposait plus de bourse et il ne se sentait guère à son aise pour continuer à travailler, à la paroisse du Mont Vernon, comme directeur d’enseignement religieux, ainsi qu’il le faisait depuis deux ans, durant ses week-ends. Il eut alors la première bonne fortune de se voir confier par son jeune et brillant « patron » du séminaire en sciences humaines, Goodwin Watson, la quasi-responsabilité d’une recherche extensive qu’il avait entreprise : « Je dirigeai un groupe appréciable de techniciens, analysai un matériel très complexe et dus écrire le texte de présentation, le tout dans un temps limité de manière impitoyable »1. Puis nouvelle chance, vers la fin de 1926, il était admis à un poste d’interne dans un nouvel institut de guidance infantile (ou psychopédagogique) qui s’ouvrait à New York. A ce moment se place un événement significatif : le psychiatre qui présidait le comité de sélection découvre tardivement « que c’était aux internes en psychiatrie qu’était allouée la bourse de deux mille cinq cents dollars. Les internes en psychologie ne devaient recevoir que mille deux cents dollars »2. On retrouve ici la querelle d’intérêts qui continue d’opposer, en Amérique comme en France, l’exercice de la profession médicale et celle de la psychologie, tenue en lisière. Mais, en précurseur encore, Rogers se démène et se bat : « Je ressentis cette insulte beaucoup plus sur le plan financier que sur le plan professionnel et me mis en colère. Je lui écrivis une lettre bien sentie »3. Rogers obtient gain de cause et note : « Fait intéressant et symbolique, je commençais ma formation professionnelle, sur un coup de chance, au même niveau que les internes en psychiatrie »4. Rogers continua par la suite à lutter pour sa place en thérapie et justifia sa consécration. Il pourra écrire, quarante ans plus tard : « Alors que les psychiatres soutenaient que la psychothérapie était un acte médical interdit aux psychologues, je n’ai pas perdu mon temps à discuter mais j’ai tenté d’améliorer la psychothérapie et de renforcer la recherche en psychothérapie. J’avais la conviction que l’argumentation perdrait de sa force si les psychologues faisaient de la bonne thérapie et apportaient dans ce domaine, grâce à la recherche, de nouvelles connaissances. Je pense que ce point de vue s’est révélé justifié »5. L’activité à l’institut de guidance infantile permettait de vivre : Rogers put mener à bien sa thèse de doctorat consacrée à l’élaboration d’un test de personnalité pour les enfants, encore utilisé actuellement. Mais cette activité eut une autre conséquence capitale : l’enseignement et la méthodologie rigoureusement expérimentalistes du Teacher’s College (centrés sur des mesures et des statistiques) furent contrebalancés par « l’esprit hautement spéculatif »6 et le « freudisme éclectique »7 qui régnaient à l’institut. Rogers ressentit la tension (l’incompatibilité radicale, même, dira-t-il parfois) qui existaient entre ces deux points de vue, au moment où il découvrait ses capacités cliniques. « A la réflexion, je considère aujourd’hui que la nécessité où je me trouvais de résoudre ce conflit en moi-même fut une expérience précieuse », observe-t-il en 19618. Il se laisse emplir par les théories psychanalytiques, mais les expérimente et fait des progrès, « malgré » elles. L’éclectisme de l’institut fut bénéfique à la longue, reconnaît-il. Il y écoute des conférences d’Alfred Adler qui « choquait tout le monde en déclarant qu’une observation très complète n’était pas nécessaire »9. Cette libération par rapport à la minutie maniaque des diagnostics deviendra de plus en plus fondamentale pour Rogers et soutiendra son projet d’apporter une aide thérapeutique, qui soit épurée d’une volonté de domination rationnelle. A la fin de l’année 1928, Carl recherche enfin un emploi véritable. On lui offre un poste à Rochester, à la Société de protection pour l’enfance en danger, dans un centre d’observation de l’enfance, un Child Study Department, où il se retrouve isolé, avec trois psychologues. « Il s’agissait d’un cul-de-sac professionnel »10. Mais, précise-t-il, « j’ai toujours pensé que du moment que l’on me donnait l’occasion de m’employer à faire quelque chose d’intéressant, le reste s’arrangerait bien un jour ou l’autre »11. L’esprit paysan, le goût du travail méthodique dans la solitude libre l’inspirent de plus belle au terme de ses années universitaires.
Les années de Rochester
Douze années fécondes s’écoulèrent alors à Rochester dans une petite maison de style colonial hollandais. Peu après leur arrivée, une fille, Nathalie, naquit. Les deux enfants ont vécu toute leur enfance à Rochester. « C’est grâce à eux que j’ai appris beaucoup plus au sujet de l’individu, de son développement et de ses relations, que je n’aurais pu le faire professionnellement », convient-il. « Je n’ai pas l’impression d’avoir été un très bon père pendant les premières années de leur existence, mais, heureusement, ma femme était très bonne mère, de sorte que je crois avoir appris graduellement le rôle d’un parent meilleur et plus compréhensif. »12 On becoming… ! Les Rogers achètent alors un petit terrain au bord du lac Seneca, à soixante-quinze miles de leur domicile, où ils passent agréablement beaucoup de temps, construisant leur « cabanon et vivant tout à fait primitivement dans les bois sur le lac »13. Carl retrouvait là son goût pour la nature. Il dessine et construit lui-même, pendant les hivers, aidé par Helen, un petit bateau, le Snark. Soutenu par cette chaude vie familiale, Carl s’épanouit professionnellement, traitant des enfants délinquants, menant des entretiens thérapeutiques, dans un relatif isolement. « Nous devions vivre avec nos échecs aussi bien qu’avec nos succès, ce qui nous forçait à apprendre »14, note-t-il pour cette époque, précisant : « Il n’y avait qu’un seul critère pour juger des méthodes que nous employions avec les enfants ou les parents et c’était : “Est-ce que ça marche ? Est-ce que c’est efficace ?” » Il constate que les interprétations sexuelles en vogue n’aident en rien le traitement d’un jeune pyromane, et que les investigations trop hostiles d’un thérapeute tournent à l’« interrogatoire de type policier » ou à la manipulation coercitive et n’aboutissent pas. « Je commençais à découvrir que plutôt que de céder à mon besoin de démontrer mon adresse et ma science, je ferais mieux de faire confiance au client pour diriger le processus thérapeutique.15 »
La rencontre d’Otto Rank
A cette époque, à la demande d’un collègue, il invite Otto Rank pour un week-end avec leur équipe à Rochester. Cette brève rencontre de quelques jours laissera des traces profondes : Rogers n’a cessé de citer Rank dans ses bibliographies, et d’indiquer sa référence, parmi les rares influences qu’il souligne. Mais quel fut l’impact de la rencontre avec Rank ? « J’ai dit à quelqu’un, ensuite, que je n’ai pas pensé grand-chose de sa théorie mais que sa thérapie avait beaucoup de retentissement pour moi (made a great deal of sense to me). J’ai bien connu une de ses clientes et j’ai reçu d’elle un long compte rendu de sa thérapie avec Otto Rank. J’ai aussi connu des travailleurs sociaux et d’autres gens qui avaient été influencés par la pensée de Rank à l’école du travail social de Philadelphie. J’ai pensé qu’il savait maîtriser sa relation avec les gens mais que ses théories, comme beaucoup de théories psychanalytiques, me semblaient trop éloignées de la réalité (farfetched) »16. Quel était ce personnage, quinquagénaire quand Rogers le découvre ? C’était lui aussi un Viennois, né Otto Rosenfeld, de milieu modeste. Son journal d’adolescent retrace ses luttes pour conquérir l’autonomie entre un père alcoolique et une mère pleine d’attention. Préparé à un travail manuel, il prend un emploi de bureau, mais, attiré par l’art et la philosophie, il prépare dès ses vingt ans un livre sur la psychologie de l’artiste et de la création artistique, en s’inspirant des travaux de la psychanalyse. Freud est séduit par son intelligence et en fait un disciple préféré, l’aidant à reprendre des études universitaires. Rank passe une thèse de doctorat de philosophie en 1912, sur la légende de Lohengrin. Secrétaire de la société psychanalytique de Vienne (de 1910 à 1915), il explore la littérature mythologique et fait des études sur le « Double » et sur le « Mythe de la naissance du héros ». Mobilisé en Pologne de 1916 à 1919, il revient à Vienne, marié, et connaît des difficultés pour s’installer comme psychanalyste, puisqu’il n’est pas médecin. Au congrès de La Haye, en 1920, il devient secrétaire du mouvement psychanalytique international. Mais il se heurte à des inimitiés (celles d’Abraham et de Jones), même s’il noue des amitiés (avec Ferenczi). Les relations avec Freud se détériorent, surtout après la publication d’un ouvrage sur Le traumatisme de la naissance (1924). L’importance redonnée par Rank à la mère, et au « rôle animateur de la femme »17, inquiétait Freud et ses émules, très occupés de l’Oedipe et du rôle du père, incarnant pour eux le principe de réalité. On sait aussi que Freud avait été très fortement attaché à sa mère, dont il fut le premier enfant, alors qu’elle était très jeune, et qui l’appelait son « merveilleux Sigi » (Sigismond, nom princier devenu Sigmund). On conçoit les réactions que pouvaient susciter des affirmations de Rank telles que : « La véritable libido de transfert, celle que le psychanalyste a pour tâche de supprimer chez les sujets des deux sexes, n’est autre que la libido maternelle, telle qu’elle est présentée par le lien physiologique qui rattache l’enfant à la mère »18. Plus tard, Mélanie Klein put se permettre d’aller plus loin, tout en restant dans l’orthodoxie freudienne : mais elle était femme. Rank, dès la parution du Traumatisme de la naissance, avait séjourné aux Etats-Unis où il retourna fréquemment, avant de s’y fixer définitivement en 1934. La rupture avec Freud fut complète en 1926. Rank, isolé en Europe, trouvait un terrain propice en Amérique. Soutenu par une équipe solide à l’université de Philadelphie, il développe des études sur la situation analytique où il préconise une intervention active du thérapeute centrée sur le transfert maternel, et donc sur une expérience émotionnelle chaude. Il minimisa, par suite, l’Oedipe et la rationalité socratique requise par Freud : ce qui ne pouvait manquer de convenir aux tendances américaines, où Keyserling relevait une dominante féminine19. Habile, stimulé par l’accélération de la vie américaine, Rank optait pour un traitement thérapeutique raccourci : il laissait, comme le note son élève Jessie Taft, « au patient le rôle créateur dans le processus thérapeutique, acceptant la réalité émotionnelle de la relation thérapeutique »20. Ces attitudes purent frapper Rogers, soucieux de se prémunir contre la prétention intellectualiste et « interprétatiste ». Il fut aussi frappé par l’idée de fixer au départ une limite de temps à la durée d’un traitement thérapeutique. Toutefois Rogers ne suivit pas Rank dans cette direction : la décision de finir une rencontre thérapeutique appartenait, pour lui, au client aidé par le thérapeute à clarifier les questions que soulève une cessation des rencontres21. Sur un plan plus personnel, Rogers a pu être influencé, directement ou non, par des allusions relatives aux études de Rank sur le Moi et son « double ». Partant d’œuvres dramatiques ou littéraires, dès 1914, Rank précédait certaines recherches de Lacan sur le stade du miroir ; il relevait dans Nietzsche « l’ennui dans la société de son propre moi »22 ; et il admettait que « la signification mortelle du Double s’allie intimement au narcissisme »23. Rank portait attention dès lors à la rivalité fraternelle, aux mythes sur les jumeaux et à leur rapport à l’agriculture (« en raison de l’idée de l’indépendance de l’âme »24). Il observait encore, dans la fondation des villes par les jumeaux, « qu’ils manifestaient ainsi leur indépendance de leurs parents »25, par autoréaction. « Le jumeau paraît donc être l’homme qui, en venant au monde, a amené son Double immortel, c’est-à-dire l’âme et, de ce fait, il est devenu indépendant de toutes les autres idéologies concernant l’immortalité, y compris la filiation sexuelle avec ses parents.26 » Rogers devait être intéressé par cette orientation de Rank vers la vie biologique, associée à une mise en valeur quasi « héroïque » de l’individu, arraché aux contextes génésiques ou religieux : ne retrouvait-il pas ses problèmes personnels à l’égard de ses frères et de ses parents, adossés à sa solitude paysanne. Surtout à cette époque où son frère Ross, né en 1899, et avec lequel il avait très affectivement vécu, « décédait très soudainement et en quelque façon mystérieusement au début de ses trente ans »27.
Originalité et praxis
Stimulé par ce que la rencontre d’Otto Rank éveille en lui, Rogers s’intéresse dès lors davantage à l’attitude individuelle et aux valeurs vécues par les thérapeutes plutôt qu’à leur théorisation abstraite, ou à leurs références idéologiques. Il s’attachera à la phénoménologie de la relation thérapeutique dans sa réciprocité créatrice entre le psychologue et le client. Et il entretint de « bons rapports confraternels » avec les psychiatres de l’université de Rochester. Il réussissait professionnellement : il était devenu directeur du centre d’observation, Child Study Department, de Rochester, dès 1930 ; il obtint de haute lutte le poste de premier directeur du centre de guidance de Rochester, créé en 1938, en dépit de l’opposition corporatiste des psychiatres, pourtant amicaux. En 1935, il avait été invité à donner, pendant l’été, quelques cours au Teacher’s College de Columbia. Il avait réussi à faire des exposés-discussions avec des amphithéâtres de cent cinquante à trois cents personnes, et soulevait les « applaudissements bruyants et prolongés »28 des étudiants. A l’université de Rochester, il commença « à faire des cours au département de sociologie…, sur la compréhension et le traitement des enfants-problèmes. Bientôt le département de pédagogie réclame mon concours »29. Malgré ces succès, sa démarche, l’éloignant des sécurités théoriques (dogmatiques) et des ritualisations pratiques, renforçait sa solitude et ses anxiétés, dans son travail de clinicien. Les résistances extérieures s’accrurent au point que lui-même « éprouvait des doutes »30 quant à ses qualités de psychologue. On le lui faisait sentir, à l’université de Rochester, quoiqu’il y enseignât aux départements de sociologie et de pédagogie, en ne l’admettant pas à enseigner au département de psychologie, et il se sentait mal à son aise aux congrès de l’Association américaine de psychologie (apa), orientés vers des courants behavioristes plus que cliniques. Dans cette période d’épreuve, Rogers se recentrait sur lui-même et se cramponnait obstinément à sa route sans trop se préoccuper de savoir s’il restait ou non « dans la ligne » de son « groupe de référence »31. Il inaugurait dès 1938, en pionnier, l’enregistrement au magnétophone (alors à ses débuts) d’entretiens thérapeutiques, dont il ferait tant d’usage en formation pratique et en recherche théorique. Il découvrait l’œuvre de Goldstein, La structure de l’organisme. Et il préparait pendant ses loisirs son premier grand livre : Le traitement clinique de l’enfant-problème, publié en 1939 (et non traduit en français). Le département de psychologie de Rochester lui ouvrait enfin ses portes. Bien plus, une chaire de professeur titulaire lui était offerte à l’université d’Etat de l’Ohio, pour le début de 1940. En dépit de son regret de quitter son poste de directeur du centre de guidance et malgré les réticences de son fils David, Carl Rogers, pressé par Helen, acceptait : pendant vingt-trois ans, il fut professeur dans l’enseignement supérieur, comme il l’avait longtemps désiré, promu d’emblée à une chaire. Et il en tire argument pour sa contestation immédiate du système universitaire : « Je me suis souvent félicité de n’avoir pas eu à subir le processus de concurrence parfois humiliante de la promotion graduelle dans les facultés où l’on ne tire d’autre enseignement que “de ne pas se mouiller” »32.
Chapitre IV
Les débuts d’une carrière universitaire
Ce fut un autre « grand moment » (big moment) dans la vie des Rogers, comme le note Helen. La famille se rendit à Colombus en plein blizzard dans le courant de décembre 1939 : deux jours de route difficile en raison des rafales de vent et du verglas. Mort de fatigue, Carl se reposait sur le parquet de leur nouvelle maison ; son fils s’activait si bien à décharger la voiture qu’il bouscula avec un colis trop grand un lustre qui éclata en mille morceaux : « Fils, tu apprends la voie difficile » (« Son, you learn the hard way ») arrive à dire Carl, ouvrant un œil malgré son épuisement, illustrant, comme le dit avec humour sa femme, son sens inné de la non-directivité1. Cinq années allaient s’écouler avec intensité pour toute la famille. Les deux enfants y joueaient leur adolescence, dans une maison bâtie et embellie avec amour, entourés d’amitié, pendant que la guerre mondiale se développait en Europe et en Asie. David s’orienta (pointed) vers la médecine et entra à l’école médicale de Cornell, à New York. « Je suis heureux de la carrière de mon fils, écrira en 1971 Carl Rogers, mais si je l’ai poussé à l’accomplir ce n’aura pas été une tentative consciente »2. David deviendra plus tard directeur du département de médecine de l’université Vanderbilt, pendant huit ans, puis doyen de l’école de médecine de l’université John Hopkins et vice-président chargé des affaires médicales de cette même université. De son côté, Nathalie, témoignant d’une vive sensibilité artistique, alla à Stevens College, dans le Missouri, mais se tourna avec succès (« c’est une personne très sensible et de grand secours [helping] »3) vers la psychologie clinique et la guidance infantile, le conseil d’étudiants (actuellement dans la région de Boston). « L’intégrité et la sensibilité de nos enfants nous ont donné d’énormes satisfactions »4, dira Carl en pensant à l’époque de Colombus. Médecine et psychologie, en leur avenir, étaient différenciées et réconciliées.
Professeur à l’université d’Etat de l’Ohio
Parallèlement à l’adolescence de ses enfants, cette période de cinq ans en milieu universitaire fut professionnellement marquée pour Carl par la confirmation de sa situation singulière, l’amorce de luttes difficiles et une publication fondamentale. Entreprenant d’enseigner et de faire pratiquer activement aux étudiants de l’Ohio ce qu’il savait sur la thérapie, son contrôle scientifique, et le counseling, Rogers rencontra un vif succès auprès des étudiants mais découvrit l’originalité radicale de son expérience clinique et de sa théorisation propre. « J’étais arrivé à l’université de l’Ohio au bon moment. De nombreux étudiants avaient été formés dans une optique de psychologie expérimentale qu’ils trouvaient sans intérêt. Quand j’entrai en scène, moi un psychologue qui m’occupais d’êtres humains, ils vinrent en masse à mes séminaires et à mes cours et nombre d’entre eux me demandèrent de patronner leur thèse de doctorat. J’étais alors trop naïf pour me douter des jalousies que je déclenchais chez les autres professeurs en acceptant toutes ces thèses. En revanche, nombre de mes meilleurs amis sont issus de ce groupe choisi d’étudiants en doctorat »5. Une étude de l’un d’entre eux frappe notamment Rogers : celle conduite sous sa direction, à partir de 1941, par W.L. Kell, auprès de jeunes délinquants, en vue d’étudier les facteurs permettant de prévoir leur comportement futur. Rogers se souviendra longtemps des résultats de cette recherche et évoquera encore la surprise qu’il en eut, quelque vingt ans plus tard, au cours d’une rencontre avec des psychologues existentiels. Alors que Kell avait pris avec soin des notes objectives sur le climat familial, la vie scolaire, l’ambiance culturelle et le quartier, les rapports sociaux, le carnet de santé et l’arrière-plan héréditaire de soixante-quinze délinquants, établissant (par surcroît seulement) une notation simple pour mesurer leur connaissance de soi, il s’avéra que « pour leur réadaptation, à notre grand étonnement, le degré de compréhension de soi était le meilleur élément de prévision, donnant un taux de corrélation (inférieur) de 0,84 avec le comportement, tandis que la qualité des rapports sociaux donnait 0,55 et le climat familial 0,36. Nous n’étions pas du tout préparés à admettre ces conclusions »6. Une nouvelle étude, sur un nombre égal de cas, confirme le fait en 1944 : la variable sensible n’est pas sociologique ou institutionnelle mais psychologique ; les vrais déterminants de la délinquance éventuelle ne sont ni le milieu familial ni l’influence des compagnons, mais bien le réalisme de la conscience de soi, qui permet à certains de vivre « symboliquement toutes les possibilités et de choisir la façon d’agir la plus satisfaisante »7, ce qui assure leurs chances de réadaptation. La signification et la force de la liberté sont là. La croissance de la subjectivité est fondamentale : en dépit de beaucoup de résistance de sa part, Rogers découvrait ici une confirmation de ce que lui avait inculqué Kilpatrick et qu’il allait observer de plus en plus dans son expérience de psychothérapie8.
Luttes et controverses
Un an après son arrivée à Colombus, en décembre 1940, Rogers est invité à présenter ses idées à l’université du Minnesota ; il provoque de très vives réactions : « Pour la première fois, je compris qu’une idée nouvelle et personnelle qui m’apparaît à moi-même comme brillante et grosse de possibilités peut présenter une menace pour autrui »9. Rogers ne cesserait dès lors de rencontrer de virulentes oppositions, de soulever des remous et des hargnes, de déclencher des agressivités et de provoquer incompréhensiblement des anxiétés et des controverses : ainsi avec ses gros sabots de paysan, invoquant expérience et liberté : « […] Je me suis habitué à être sans cesse attaqué, mais je continue à être étonné par les réactions que suscitent mes idées. Je suis conscient de les avoir toujours énoncées comme sujettes à révision et comme pouvant être acceptées ou rejetées par le lecteur ou par l’étudiant, et pourtant mon point de vue a soulevé de la part des psychologues, conseillers psychologiques et enseignants, des critiques virulentes et méprisantes. Leur fureur s’est un peu calmée au cours des dernières années (vers 1960), mais elle a été remplacée par celle des psychiatres dont quelques-uns voient, dans mes méthodes, une forte menace contre leurs principes les plus chers et les mieux établis »10. Dès lors, psychiatres et psychanalystes ou enseignants se relaieront sans cesse pour entretenir des « critiques orageuses », avec la complicité antagoniste de certains « disciples », « partant en guerre contre tout le monde, armés d’idées parfois exactes, parfois erronées, sur mon travail et ma personne »11. Rogers note avec humour : « Je me suis parfois demandé si ce sont mes ennemis ou mes soi-disant amis qui m’ont fait le plus tort »12. Cette boutade reste vraie en France comme on a pu s’en apercevoir depuis 1966 et 1968. Rogers ajoute : « C’est peut-être à cause de cette situation désagréable qui me fait voir les gens se battre à cause de moi, que j’ai appris à considérer comme un précieux privilège de m’échapper pour être seul »13. On retrouve ici, dans l’adulte, la conduite de l’enfant de Chicago qui ne s’attardait pas dans la cour d’école, emplie des affrontements puérils. Secoué, concassé, déconcerté, Carl eut à douter à nouveau de lui-même et à se poser des questions difficiles. Il avait dû, à peu près dans le même temps, « vers la quarantaine » (during my forties), subir « une période de presque une année » où il ne sentit « absolument aucun désir sexuel — pour quiconque. Aucune cause médicale ne fut trouvée ». Et Carl précise alors : « Helen était confiante que mes besoins normaux reviendraient et simplement “resta avec moi” (stood with me) dans cette situation difficile (predicament). Il est aisé de penser à de possibles causes psychologiques, mais aucune d’elles n’allait (clicked) en ce qui me concerne. Cela reste un mystère pour moi. Mais son amour tranquille et continu m’apporta beaucoup et fut probablement la meilleure thérapie que je pouvais avoir. En tout cas, progressivement je redevins sexuellement normal »14. Dans ces circonstances, sentant néanmoins qu’il avait quelque chose à dire, Carl se recentra avec ténacité sur son expérience et ses convictions en rédigeant à Colombus un ouvrage qui eut dès sa publication en 1942 un grand retentissement et devint un « best-seller » de la psychologie : Counseling and Psycotherapy (80 000 exemplaires en anglais vendus en 1967). Il y donnait au terme de « non directivité » une notoriété qui n’a pas cessé, et il y publiait le premier cas de psychothérapie intégralement reproduit à partir d’un enregistrement. Il rédige également, en 1942, dans la revue American Journal of Orthopsychiatry, une étude sur « l’utilisation d’interviews enregistrées pour l’amélioration des techniques psychothérapeutiques ».
La démarche thérapeutique des années quarante
Si on essaie de situer sa démarche
thérapeutique à cette époque, on peut constater, avec Léonard
Carmichael dans sa préface à Counseling and Psychotherapy :
« L’orientation (approach) actuelle de l’aide psychologique,
ainsi que le signale le docteur Rogers, consiste non pas à fournir comme
un service la résolution de problèmes spécifiques, mais à enseigner une
technique par laquelle des personnes adopteront des habitudes d’esprit
et de vie qui leur permettront de résoudre, au fur et à mesure qu’ils
surgissent, leurs propres problèmes. Le but du conseiller est la produc- Dans le premier chapitre de ce livre, Rogers pose pour celle-ci une hypothèse de base : « La relation d’aide psychologique est une relation permissive, structurée de manière précise, qui permet au client d’acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rende capable de progresser à la lumière de sa nouvelle orientation. Cette hypothèse a un corollaire naturel : toutes les techniques utilisées doivent avoir pour but de développer cette relation libre et permissive, cette compréhension de soi dans l’entretien d’aide, et cette orientation vers la libre initiative de l’action »17. Et plus loin, il ajoute : « Il y a centration sur l’individu et non sur le problème »18. L’accent est donc mis sur « l’élément vécu » plutôt que sur l’aspect intellectuel et « sur la situation actuelle plutôt que sur le passé de l’individu »19. Rogers définit ensuite les quelque douze étapes caractéristiques de cette « expérience de maturation » : « 1. l’individu vient chercher une aide, se prenant progressivement par la main20 ; 2. la situation d’aide est normalement définie21 ; 3. l’aidant encourage l’expression libre des sentiments qui concernent le problème22 ; 4. le conseiller accepte, reconnaît et clarifie les sentiments négatifs23 ; 5. quand l’individu a complètement exprimé ses sentiments négatifs, il essaie timidement l’expression de tendances positives qui favorisent sa maturation24 ; 6. le conseiller accepte et reconnaît les sentiments positifs exprimés comme il a accepté et reconnu les sentiments négatifs… C’est l’acceptation de ses impulsions de maturité ou d’immaturité, de ses attitudes agressives ou de ses attitudes sociales, de ses sentiments de culpabilité et de ses expressions positives, qui donne à l’individu la possibilité pour la première fois dans sa vie de se comprendre lui-même tel qu’il est. Il n’a aucun besoin de se défendre de ses sentiments négatifs. On ne lui donne pas l’occasion de survaloriser ses sentiments positifs. Et dans ce type de situation, la compréhension de soi (insight) se met à affleurer spontanément25 ; 7. cette nouvelle perception, cette compréhension, cette acceptation de soi, constituent le plus important aspect de toutes la méthode26 ; 8. mêlé au processus de compréhension de soi — et il faut souligner que les étapes indiquées ne sont pas exclusives et ne se poursuivent pas dans un ordre rigide — il y a un processus de clarification des décisions et des modes d’action possibles. Souvent ceci est imprégné d’une attitude quelque peu désespérée27 ; 9. nous rencontrons maintenant un aspect fascinant de cette thérapie, l’initiation aux actions positives mineures, mais hautement significatives28 ; enfin en 10. se produit une compréhension de soi plus complète et plus précise29 ; en 11. une action positive intégrée de plus en plus importante… L’aidant et le client travaillent maintenant ensemble dans un sens nouveau. Leur relation personnelle est à son sommet30 ; en sorte qu’en 12. il y a sentiment d’un besoin décroissant d’aide et le client reconnaît que la relation doit cesser »31. Alors « le conseiller peut répondre à ces sentiments. Il n’y a aucun doute que nous nous impliquons affectivement, jusqu’à une certaine saine mesure quand le développement de la personne se produit sous nos yeux. Un terme est fixé pour les séances, et quoique l’on mette fin à la thérapie avec peu d’empressement, il est sain de la clore »32.
Précautions, subtilité et modestie
Sur la base de ses étapes, Rogers aborde avec précision et raffinement les phases initiales et conclusives. Il se prémunit dès le premier instant contre toute précipitation, toute lenteur ou toute intervention pesantes qui accroîtraient la dépendance du client à son égard, et il juge peu opportun le raidissement des attitudes du thérapeute dans une recherche de diagnostic. Cependant il met l’accent sur le sérieux et l’intensité de sa relation et de son étude : « Rester vigilant en permanence au sentiment du client, utiliser des mots non pas comme des matraques mais comme des outils chirurgicaux pour libérer la croissance, demande un gros effort au praticien »33. Il étudie avec soin les notes ou les enregistrements pris sur les entretiens successifs, afin de « dégager l’interview de traitement de l’âge préscientifique où “n’importe quoi est bon” pourvu que l’aidant ait de bonnes intentions… pour aller vers un stade où toute expression, qu’elle soit de l’aidant ou de l’aidé, est reconnue comme ayant son importance et ses effets, qu’ils soient retardateurs ou stimulateurs, sur la croissance psychique du client. En conséquence, les comptes rendus doivent être beaucoup plus complets ; ils constituent des instruments de travail et non simplement une activité pour avoir l’air occupé. Entre les entretiens, ces notes et ces comptes rendus doivent être étudiés soigneusement »34. Et Rogers consigne cette remarque essentielle : « Un examen attentif et minutieux de comptes rendus enregistrés convaincra de l’évidence du fait que la plupart des aides psychologiques et des soi-disant psychothérapies consistent à prendre un couteau de boucher pour disséquer un moustique, ou un énorme tracteur pour cultiver des plantes microscopiques. Il est absolument vital de reconnaître que ce qui se passe dans l’entretien est très subtil et que les potentialités de croissance peuvent être entièrement détruites par la manipulation “sauvage” qui caractérise la plupart de nos relations. Comprendre les forces subtiles qui opèrent, les reconnaître et coopérer avec elles, exige un maximum de concentration et d’étude soigneuse, et… de rigueur des comptes rendus complets qui décrivent le processus »35. Subtilité, « forces subtiles », Rogers reviendra sans cesse sur cette alerte de délicatesse dans la force, très liée à une vision biologique et rurale. Contre l’esprit de lourdeur, Rogers insiste également pour une thérapie sans durée pesante (ou interminable), avec des visées modestes : l’aidant ne saurait être un « superman psychologique, omniscient, hypersage, au-dessus des petites réactions des gens ordinaires »36.
En pratique
Pour donner une idée de la démarche pratique de Rogers à cette époque, nous citerons un extrait d’une thérapie, la première entièrement enregistrée et publiée. Cette thérapie concernait un étudiant de vingt ans, Herbert Bryan, qui avait beaucoup lu de psychologie et qui avait déjà cherché de l’aide auparavant, ce qui compliquait son cas. La thérapie s’est cependant effectuée avec succès en sept entretiens. Son étude complète devrait importer à tout chercheur ou à tout praticien en thérapie ou en sciences humaines. Voici, tiré de La relation d’aide et la psychothérapie37, le tout début du troisième entretien avec son style parlé bien traduit, assorti des remarques didactiques faites par Rogers. C représente le conseiller ou thérapeute, S, le sujet ou client ; les chiffres indiquent le nombre des phrases ou mots (items) antérieurement et successivement prononcés par les interlocuteurs.
Troisième entretien C 190. Alors, comment va la bataille aujourd’hui ? S 190. J’ai compris ce que vous vouliez dire juste en quittant le bureau la dernière fois. L’idée m’est venue que tous les aspects de la personnalité devraient être reconnus : c’est-à-dire, devraient être considérés comme moi-même, et j’avais l’impression que si la névrose était considérée comme une étrangère indésirable et que je continue à mener une lutte pour son expulsion, il y aurait un ressentiment qui ne pourrait que se barricader plus profondément. C 191. M-Mm. S 191. Alors j’ai pensé que peut-être une autre méthode serait meilleure, c’est-à-dire… nous pourrions dire que nous sommes tous citoyens, ce qui est vrai, et que nous allons œuvrer pour faire un pays meilleur… en travaillant ensemble. C 192. M-Mm. S 192. Alors, j’ai… en d’autres termes, j’ai réalisé qu’essayer de la pousser en dehors de moi, si l’on peut dire, provoquerait une résistance comme… euh…, ce serait exactement comme si… comme de se débarrasser d’une partie précieuse de la personnalité. Je veux dire qu’après tout, il y a là mon énergie nerveuse… C 193. M-Mm. S 193. […] et que tout essai pour
la pousser au-dehors ou s’en débarrasser se- Commentaires
C 190. Une remarque d’ouverture négligente comme celle-ci n’est peut-être pas si négligente qu’il le semble. L’aidant a donné au client l’occasion de manifester librement par sa réponse des sentiments optimistes ou pessimistes ou de choisir n’importe quel autre sujet qui prédomine dans son esprit. Ce type d’ouverture est beaucoup plus satisfaisant que des questions plus directives : « Avez-vous remarqué une amélioration depuis notre dernière entrevue ? » ou « Avez-vous réfléchi à ce dont nous avons parlé la dernière fois ? » S 190 - S 193. Cette longue déclaration de M. Bryan a un intérêt théorique considérable, parce qu’il indique l’assimilation d’une interprétation donnée par le thérapeute trois jours auparavant. En dépit du fait que cette interprétation a soulevé de la résistance et n’a pas été acceptée à ce moment-là (voyez S 92 - S 103, et aussi S 176), elle a été peu à peu acceptée dans l’intervalle. Il existe sans aucun doute des interprétations qui, rejetées au début, finissent effectivement par être acceptées. Nous savons peu de choses sur les conditions d’apparition de ce phénomène. C 194. Vous pensez que peut-être, c’est une partie de vous-même après tout. S 194. Oui, et que je devrais changer… c’est-à-dire envisager la thérapie comme un changement dans la personnalité plutôt que comme une méthode pour se débarrasser de certaines choses. Il semble qu’avec cela à ma conscience, il n’y aura pas autant de résistance au changement que si je considérais le changement comme un rejet de quelque chose. C 195. M-Mm. Et est-ce que cela… vous aimeriez à nouveau considérer tout l’aspect intellectuel de cela… est-ce que cela a changé quelque chose dans votre… sentiment sur les choses, et ainsi de suite ? S 195. Eh bien, j’ai adopté une concentration non intellectuelle de cela dans mes moments perdus. J’essaie d’obtenir un sentiment d’unité envers tous les aspects de ma personnalité, et dans le même temps, ne pas nécessairement les prendre tels qu’ils sont sans essayer de les changer, mais en même temps ne pas me considérer moi-même comme moi et l’ennemi, mais plutôt faire que le moi inclue tous les aspects. Et c’est une façon de collaborer avec les négativités, et je ne sais pas exactement comment les faire se changer en positivités, mais au moins j’ai décidé de ne pas essayer de les rejeter, parce que ce sera… Je sens qu’il y a là quelque forme de résistance à perdre, que ça pousse les sentiments négatifs à se retrancher d’autant plus profondément que vous faites un effort pour les rejeter, je pense. C 196. M-Mm. S 196. Maintenant, d’un autre côté, j’ai senti qu’il pourrait y avoir une tendance, peut-être à l’autre extrême, à adopter trop de l’attitude de Popeye… « Bon, je suis ce que je suis, et voilà tout ce que je suis », et c’est tout. C’est très bien philosophiquement, mais je ne pense pas que ce serait très bien psychologiquement. C 197. Spécialement pas depuis que vous sentez effectivement cela si fortement. Je pense qu’il existe des forces assez diverses, ou des forces travaillant à des buts divers, en ce qui vous concerne. Vous ne pouvez revendiquer plus d’unité et plus de satisfaction qu’il n’y en a. S 197. D’accord… ce que je voulais dire, c’est que je ne veux pas obtenir une autosatisfaction sereine en disant : « Eh bien, je suis comme je suis ». Je ne veux pas être autosatisfait, autrement il n’y aura plus aucune motivation pour un changement. (Silence.) Il y a eu un recul dans mon travail. L’appareil photo a besoin d’être encore réparé. Il ne sera pas prêt avant la semaine prochaine, mais je pense que je peux m’en procurer un autre. Je remarque que j’ai fait un effort pour en dégotter un autre, plutôt que d’attendre jusqu’à la semaine prochaine, que le premier soit arrangé.
Commentaires
C 195. Ceci est une question directive tout à fait superflue. Le lecteur peut facilement formuler une réponse à lui substituer, qui clarifierait le sentiment qui vient d’être exprimé. Le psychologue semble manifester les mêmes signes d’impatience qui ont caractérisé le deuxième entretien. C 197. L’aidant essaie une interprétation basée sur la dernière entrevue. S 197 montre qu’elle n’est pas acceptée par le client. S 190-S 197. Il est intéressant de voir que jusque-là le client répondait aux commentaires faits par l’aidant lors de l’entretien précédent, en particulier à C 177 et C 178. Il épuise ce sujet à l’item S 197 et après un silence continue en exprimant des attitudes plus significatives auxquelles il porte un intérêt spontané.
L’aube des recherches
On peut réfléchir sur les tendances, les souplesses et les exigences impliquées dans ce texte. Il faut ajouter que les précautions, les subtilités essayées par Rogers sont vérifiées par lui dans des processus de recherche raffinés dont nous reparlerons longuement en raison de leur importance38. C’est à l’occasion de ces recherches que naît sous sa plume et celle de Porter le concept de clivage « directif/non directif » qui a retenti depuis lors. Il apparaît que des comportements et des procédés sont utilisés de façon quantitativement et significativement différente par les thérapeutes directifs et les thérapeutes non directifs. Tout d’abord « il y a une moyenne de cent sept interventions de la part de l’aidant par entretien dans la catégorie des entretiens directifs, et seulement quarante-neuf par entretien dans la catégorie des entretiens non directifs »39. Le conseiller non directif parle moins, mais il parle encore. En second lieu, la fréquence moyenne des questions précises ou d’explications est respectivement de trente-quatre et de vingt par chaque entretien directif, alors qu’elle n’est que de cinq et de quatre pour chaque entretien non directif ; mais pour ces derniers, par contre, viennent, en tête, des comportements de reconnaissance des sentiments ou de l’attitude vécus par le client (dix en moyenne par entretien) ou même d’interprétation de sentiments exprimés ou antérieurs (plus de six en moyenne) qui sont rares pour les entretiens directifs40. Rogers pourrait écrire : « Pour le groupe directif, c’est l’aidant (the counselor) qui choisit le début désirable et socialement approuvé que le client doit atteindre ; puis il s’efforce d’aider le client à l’atteindre. Une implication inavouée est que l’aidant est supérieur au client, puisqu’on admet que ce dernier est incapable d’accepter la pleine responsabilité du choix de son propre but. L’entretien d’aide non directif est fondé sur l’hypothèse que le client a le droit de choisir ses propres buts vitaux, même s’ils sont en contradiction avec les buts que l’aidant aurait choisis pour lui »41. Rogers opte pour l’indépendance psychologique de chaque individu contre le conformisme social et le « droit du plus capable à diriger le moins capable »42. On retrouve ici sa révolte rurale essentielle. Il ressent l’utilité de son approche pour « l’immense majorité des clients qui ont la possibilité de trouver à leurs problèmes des solutions raisonnablement adaptées ». Ses affirmations sont cependant modulées de nuances et de réserve provisoire : sa méthode ne peut être « la seule méthode »43, notamment pour des catégories particulières de clients (« les psychotiques, les anormaux et peut-être d’autres »)
Ouverture
Centré sur sa thérapie et les recherches qui lui permettaient d’approfondir et de clarifier sa démarche, attaché aux travaux pratiques qu’il inaugurait pour la formation des psychothérapeutes, Rogers ne se repliait d’autre part aucunement sur lui-même : devenu président en 1944 d’une association nouvelle, l’Association américaine de psychologie appliquée, il négocie efficacement, sur des bases de structures démocratiques, la réunification de celle-ci avec l’apa, l’Association américaine de psychologie, dont il devint le président en 1946. Il a dit de ces négociations : « Ce fut un privilège d’être impliqué dans cette entreprise “politique” (statesmanlike) »44. L’époque de Colombus s’achève sur cette opération constructive ainsi que sur une participation « à l’effort de guerre en enseignant les rudiments du counseling psychologique aux membres du personnel de l’uso, qui étaient submergés par les problèmes personnels des recrues »45. Il eut à former au counseling plusieurs milliers de cadres et de volontaires46. Un cours d’été à l’université de Chicago, en août 1944, offrit l’occasion d’une invitation plus ample : l’un des dirigeants de l’université de Chicago et le président de l’Association des étudiants pressèrent Rogers de définir, de mettre sur pied, et de diriger un centre de conseil psychologique pour assurer l’aide aux étudiants. Helen cette fois éprouva quelques réticences à quitter leur agréable maison de Colombus, alors qu’il était difficile, en raison de la guerre, de se loger. Mais les enfants étaient à leurs collèges, et la chance aidant à nouveau, un grand appartement avec une jolie vue sur la lac Michigan put être trouvé, à distance de marche du centre de counseling. Carl, assuré des possibilités pour Helen de recréer un environnement plaisant et accueillant, accepta un poste de professeur de psychologie et la mission d’organiser le centre, pour la rentrée 1945, après un été de « récupération depuis l’épreuve de la guerre et une opération »47.
Chapitre V
Chicago ou la montée
Carl et Helen revinrent tous deux, dans le prestige conquis, à la ville de leur enfance, en l’automne 1945, la paix étant revenue dans le monde, et les douze années qui suivirent « furent les plus productives et les plus enrichissantes » de la vie de Carl1. Pour ses loisirs, Carl découvrirait une nouvelle activité, un « hobby » : la construction de mobiles où il se réjouit de combiner des problèmes d’équilibre mécanique et d’esthétique créatrice, comme le note Helen (et aussi, sans doute, de retrouver les problèmes des structures flexibles, en évolution incessante).
Le Counseling Center à Chicago
L’organisation du Centre de conseil psychologique passionna Rogers. Il en avait défini le principe dans un texte présenté en août 1944 (quand il avait été pressenti) et qui reste actuel pour des bureaux d’aide psychologique universitaire (bapu) dont le besoin est de plus en plus urgent pour le monde étudiant, et qui se sont largement développés dans le monde. « Le but premier d’un organisme de conseil psychologique aux étudiants est d’aider l’étudiant à se venir en aide lui-même et à devenir plus intelligemment autonome (more intelligently self-directing). « Pour parvenir à ce but, le conseiller doit chercher à créer une situation de profonde compréhension et d’acceptation qui permettra à l’étudiant de reconsidérer plus clairement ses problèmes et ses inquiétudes et de se diriger plus intelligemment et d’une manière plus rationnelle. « L’organisme doit avoir pour objectif de traiter l’étudiant comme un individu pris dans sa totalité. On n’y cherchera pas à traiter l’individu comme un faisceau de problèmes séparés : pédagogiques, professionnels (vocational), sociaux, etc. On y reconnaîtra clairement que c’est l’individu tout entier qui a des difficultés d’équilibre (adjustement). « Ce n’est pas le propos du conseiller d’assumer une responsabilité dans la vie personnelle de l’étudiant ni de le diriger (control) vers des solutions qui pourraient paraître satisfaisantes au conseiller ou à d’autres. Ce n’est pas, non plus, le propos du conseiller de contrôler l’environnement de l’étudiant en manipulant ses programmes, les règlements ou d’autres facteurs afin de faciliter l’équilibre (l’ajustement) de l’étudiant. « En bref, le conseiller ne cherchera à contrôler ni l’étudiant, ni son environnement universitaire. Au contraire il offrira à l’étudiant une situation dans laquelle il pourra travailler, en toute clarté et indépendance, à un ajustement à l’expérience universitaire et à une vie ultérieure qui soit réaliste au point de satisfaire son désir personnel de croissance et de maturité. « Les conseils psychologiques doivent être gratuits pour les étudiants. Le conseiller doit être toujours physiquement et psychologiquement accessible. Il reste à étudier le nombre de conseillers nécessaires. « On ne cherchera à juger cet organisme ni sur la précision des dossiers, ni sur la complexité de l’organigramme, mais sur le sentiment qu’aura l’étudiant d’avoir réussi à élaborer un plan d’action satisfaisant pour lui (a satisfying plan of action for himself) »2. Carl Rogers s’acharna à réaliser ce projet, réunissant et animant une équipe au sein de laquelle il sut faire régner un climat « d’immense liberté et de créativité ». Cette ambiance chaleureuse se maintint en face d’oppositions qui vinrent surtout du département de psychiatrie de l’université. Déjà, au cours des dix premiers mois de son fonctionnement, plus de six cents clients fréquentèrent le centre où ils bénéficièrent d’une aide psychologique qui ne s’étalait pas sur de longues durées : le nombre moyen de séances de thérapie fut alors de l’ordre de cinq (la thérapie publiée en 1942, le « cas Bryan », comportait elle-même huit entretiens). Le chiffre de séances tendit à devenir plus grand dans la suite, cependant que le nombre des clients du centre s’accroissait considérablement.
approfondissements à Chicago
La notoriété acquise, Carl Rogers dispose à Chicago de moyens importants et bénéficie d’un privilège de son université : disposer d’un trimestre de congé hors du campus. Helen et lui choisissent les mois d’hiver de Noël à mars, et vont refaire leurs forces au Mexique ou aux Caraïbes, s’adonnant à la peinture et à la photographie en couleur, explorant des îles, se livrant à la pêche sous-marine, collectionnant des coquillages. Ce contact profond avec une nature chaleureuse permit à Carl de soutenir et de développer une activité professionnelle intense, même s’il dut en payer chèrement le prix en 19493. Tout d’abord, Rogers accroît et approfondit le courant thérapeutique qu’il entraîne. Il prolonge son intervention en vue d’organiser la profession de psychologue et de thérapeute : il préside de 1946 à 1947 l’apa, s’intéressant à la mise au point de la formation clinique, et soulevant dans un discours de président, mal reçu à l’époque, des hypothèses marquantes sur la structure de la personnalité. Plus tard, il présidera, de 1957 à 1958, l’American Academy of Psychotherapy. Il lui est offert d’autre part de
réaliser son « rêve d’une recherche sur la psychothérapie »4.
Obtenant d’importantes subventions, notamment de la Fondation Rockfeller,
il pourra coordonner une bonne douzaine de projets différents et
publiera avec R.F. Dymond, en 1954, Psychotherapy and Personnality
Change (« Psycho- Il rédige également de nombreuses études : la nomenclature de ses publications, dans cette période de douze ans, compte près de soixante titres, soit la moitié de sa bibliographie entre 1930 et 1962. Il inspire dans le même temps de nombreuses thèses brillantes, qu’illustrent les noms d’émules tels que E.H. Porter, Victor Raimy, Thomas Gordon, Arthur Combs et Eugène Gendlin, pour ne citer que les mieux connus en Europe. Porter publiera notamment en 1950 un livre étrange, un manuel efficace d’introduction au conseil thérapeutique (An Introduction to Therapeutic Counseling). Cet ouvrage présente des extraits de séances de thérapie et propose, pour leur analyse, une série d’exercices suggestifs, aidant les thérapeutes en formation à une progression dans l’affinement des attitudes tout en évitant un vain technicisme. L’influence de Rogers se développe à cette époque (1948) au Japon, par les soins de Fujio Tomoda et Ragan J. Fox. Un centre japonais de counseling est ouvert ; des séminaires de formation sont organisés, des recherches instituées. Moris Suiji, Tadashi Masaki sont également très actifs. Et Masaki établira en 1954 un office de counseling à l’université de Kyoto ; de jeunes rogériens s’attachent à répandre la pratique de la thérapie et de la pédagogie centrée sur le client qui semble s’adapter d’emblée à la mentalité orientale. Ils tentent d’en approfondir les fondements théoriques6. Et l’inspiration rogérienne ne cessa de s’étendre au Japon, comme on le précisera au prochain chapitre, à l’occasion d’un voyage triomphal en 1961.
Le paradoxe d’un « temps d’épreuve »
Paradoxalement dans cette période, au sommet de sa notoriété, alors qu’il finissait son mandat de président de l’importante American Psychological Association, au début de 1949, Carl Rogers éprouva une « période de détresse personnelle », à l’occasion de la thérapie d’une cliente profondément perturbée. « Je comprends aujourd’hui, écrivait-il dans son autobiographie, que je la pris en main maladroitement, oscillant entre une attitude chaude réelle envers elle et une attitude beaucoup plus « professionnelle » et réservée lorsque je me sentais menacé par l’intensité de sa perturbation psychotique. Je déclenchais ainsi chez elle une intense hostilité à mon égard en même temps qu’une dépendance et un amour qui bouleversèrent complètement mes défenses. Je m’entêtais à penser que je devais être capable de l’aider et je continuais à la revoir, bien après avoir perdu tout pouvoir thérapeutique et pour seulement entretenir ma souffrance. Je reconnaissais que beaucoup de ses prises de conscience étaient plus appropriées que les miennes et j’y perdais toute confiance en moi. En quelque sorte, je cessais d’être moi-même dans cette relation. La situation est très bien résumée par un de ses rêves où un chat me déchirait les boyaux en ne voulant pas réellement le faire. Cependant, je continuais à maintenir cette relation, destructrice pour moi, parce que je reconnaissais que sa situation était désespérément précaire, au bord de la psychose et que je me sentais obligé de l’aider. Progressivement je réalisai que j’étais moi-même en train de verser dans une profonde dépression et soudain il s’imposa à moi que je devais m’échapper. Je suis très reconnaissant envers le Dr Louis Cholden, le jeune psychiatre plein de promesses qui travaillait au Centre de conseil psychologique à cette époque, d’avoir accepté de prendre cette malade en charge sur-le-champ. Peu après elle sombra dans un accès psychotique avec de nombreuses idées délirantes et des hallucinations. Quant à moi, je revins chez moi et dis à Helen que je devais partir sur-le-champ »7. Helen Rogers, de son côté, précise : « Et nous l’avons fait. En une heure les valises étaient faites (we were packed) et nous roulions en auto droit devant nous — vers le sud et l’est — sans destination dans la tête. Il appela ceci sa “période de fuite” (escapade period). Cela dura plusieurs mois. Nous sommes finalement allés nous percher dans notre retraite du lac Seneca et avons passé un mois de vie à la dure (roughing) dans notre cabanon par les froides températures de mai (1949) dans l’état de New York. Il y eut des périodes de réel désespoir que nous partagions (weathered) ensemble. Il ne m’apparut jamais qu’il ne pourrait pas ou ne voudrait pas recouvrer la santé (recover). Nous errions sur les collines et je lui appris tout ce que je savais sur l’art de peindre. Nous passions tous les deux beaucoup d’heures à savourer, à explorer et à peindre la campagne »8. Ainsi ce qu’une femme avait défait en lui, une femme allait aider à ce que cela se refît. Le voyage-fuite du couple Rogers (the runaway trip) eut lieu en mai et juin 1949. « Tout le temps Helen conserva la tranquille assurance que je m’en sortirais en temps utile, et sa bonne volonté à m’écouter, lorsque j’étais capable de parler, me fut d’un grand secours. Cependant, quand nous revînmes j’était encore assez profondément convaincu de mon incapacité totale en tant que personne, et de l’absence de tout futur pour moi dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie »9. La situation était si sérieuse à son retour que Rogers n’osait pas demander à un des membres de son équipe de le reprendre en thérapie, comme cela était avant son départ. « Je suis très reconnaissant à un membre de notre groupe qui m’a dit simplement qu’il était évident que j’étais dans une détresse profonde, que ni moi, ni mes problèmes ne l’affolaient et qu’il était prêt à m’offrir une relation thérapeutique. J’acceptai en désespoir de cause et graduellement arrivai à un point où je pus à nouveau me valoriser et même m’aimer et être beaucoup moins craintif devant l’amour d’autrui. Ma propre attitude thérapeutique vis-à-vis de mes clients est devenue plus libre et plus spontanée depuis cette époque »10. Rogers ajoute à ce texte mémorable, à cette « confession » où il se présente honnêtement et sans fard, avec sa vulnérabilité, ce témoignage : « A cette époque où j’avais si cruellement besoin d’aide sur le plan personnel, j’ai été heureux de trouver dans les thérapeutes que j’avais formés des personnes de plein droit (in their own right), indépendantes de moi, et capables de m’offrir le genre d’aide dont j’avais besoin. Depuis, j’ai compris encore mieux que le point de vue que je soutenais représentait la sorte de psychothérapie que je souhaitais pour moi-même. Et quand j’en eus besoin je trouvai cette aide »11. Cet aveu sincère éclaire de nombreux problèmes. Tout d’abord on peut émettre l’hypothèse, à sa lumière, que tout thérapeute construit sans doute la pratique et la théorie qui traitent les problèmes auxquels il est personnellement plus sensible. Ce qui veut dire qu’il n’est pas licite de reprocher à un psychologue, à un formateur, ou à un thérapeute ses limites, ses crises ou ses déficiences12 : loin de l’empêcher d’être efficace, elles peuvent aider un individu dans son activité professionnelle, s’il les aborde et s’il consent à ne pas les camoufler et à ne pas « plastronner ».
La thérapie centrée sur le client
Au-delà de cette épreuve, à moitié de son séjour à Chicago, en 1951, Rogers publia l’ouvrage qui donnait une forme renouvelée à son approche thérapeutique, en lui offrant une dénomination définitive : Client-Centered Therapy, « la thérapie centrée sur le client ». Si le terme « non directif » est encore utilisé dans cet ouvrage par lui, c’est presque toujours associé à « centré sur le client » et entre guillemets. Il l’utilisera à peine dans les ouvrages ultérieurs : deux titres le comportent, en 1945 et 1946, sur plus de deux cents titres. En 1969, dans Liberté pour apprendre ?, le mot n’est même utilisé que par une institutrice citée par Rogers et parce qu’elle précise qu’elle lui préfère, pour la situation que sa pédagogie crée, le terme d’« auto déterminé » (self-directed). Sans doute la négation est ambiguë : elle donne une connotation négative qui a contaminé des attitudes justifiant à tort leur distance et leur silence ou leur opaque froideur. Rogers, visant une chaleur plus grande, a recherché une dénomination plus positive et plus rationnelle, vectorielle en quelque sorte. Cette désignation indique un projet signifiant plus que des précautions signifiées qui se révéleraient ensuite obsessionnelles dans une négativité non suffisamment niée. Le mot « client » s’est alors imposé à lui et à son équipe de façon croissante, parce qu’en dépit de ses imperfections, il renvoie de la façon la plus précise à l’image de l’individu (qui vient activement et volontairement obtenir (gain) de l’aide pour un problème, mais sans aucune notion d’abandon (surrendering) de sa propre responsabilité sur la situation »13. Avec ces connotations, poursuit Rogers, ce terme évite celles de malade ou d’objet d’expérimentation. Et il peut tout naturellement se transformer en étudiant (student), client lui-même d’une aide qu’il recherche sans se dessaisir de sa responsabilité d’apprentissage, et à laquelle il a légalement droit. La centration (centeredness) sur le client implique d’autre part une dénotation active : le thérapeute (comme l’enseignant) ne se fige pas sur ses propres acquisitions ou sur ses titres ni sur ses réactions personnelles face à l’interlocuteur ; mais il « se concentre pour essayer de comprendre le client comme le client se voit lui-même »14. C’est la définition d’un concept de l’empathie dont Rogers fera le succès et que nous approfondirons ultérieurement15. Rogers essaie donc d’abandonner les « restes de directivité subtile » qu’il maintenait dans les débuts de la thérapie non directive. Et il se remet plus souplement au vécu imprévisible de la relation. Par suite, « le thérapeute doit mettre de côté sa préoccupation d’un diagnostic et sa perspicacité de diagnostic »16. Il est attentif à lui-même dans l’entretien non pour connaître ses projections et ses tentations de catégorisation du client, mais au contraire en vue de se maintenir attentif, avec sensibilité, au client en voie de devenir, reconnu et soutenu sans impatience comme responsable de ses choix progressifs et par suite de ses évolutions.
La pratique approfondie
Rogers cite un exemple de dialogue confiant, quoique difficile, avec une jeune fille, Miss Gil, qui s’est montrée, dans nombre d’entretiens thérapeutiques, sans espoir à propos d’elle-même, constatant le fossé (gap) entre son idéal du moi et ce qu’elle est : La cliente : « Et je suppose que si j’acceptais le fait que je ne vaux rien, alors je pourrais aller n’importe où — et avoir une petite pièce n’importe où — avoir un travail mécanique n’importe où — et revenir clairement à la sécurité de mon monde de rêve où je fais des choses, où j’ai des amis intelligents, où je suis une merveilleuse sorte de personne ». Le thérapeute : « C’est réellement un dur combat — creusant en cela comme vous êtes — et à certains moments l’abri de votre monde de rêve vous paraît plus attirant et plus confortable ». La cliente : « Mon monde de rêve ou le suicide ». Le thérapeute : « Votre monde de rêve ou quelque chose de plus permanent que les rêves ». La cliente : « Oui (un long silence — un changement complet de la voix). Aussi je ne vois pas pourquoi je gâcherais votre temps — en venant deux fois par semaine — Je ne vaux pas cela — qu’en pensez-vous ? » Le thérapeute : « C’est à votre portée (up to you), Gil — Ça ne gâche pas mon temps — Je serai heureux de vous voir — toutes les fois que vous voudrez — mais c’est selon ce que vous souhaitez sur ce point — suivant que vous ne voulez pas venir deux fois par semaine ? — ou suivant que vous voulez venir deux fois par semaine ? une fois par semaine ? C’est à votre portée »… Long silence… La cliente : « Vous ne suggérez pas que je vienne plus souvent ? Vous n’êtes pas alarmé et vous ne pensez pas que je dois venir ici chaque jour — jusqu’à ce que j’en sorte ». Le thérapeute : « Je crois que vous êtes capable de prendre personnellement votre décision. Je vous verrai toutes les fois (whenever) que vous voudrez venir ». La cliente : (une note de terreur dans la voix) : « Je ne crois pas que vous soyez alarmé — je vois — parce que je peux être effrayée de moi-même — mais vous n’êtes pas effrayé pour moi ». — (Elle se lève — un air étrange sur son visage.) Le thérapeute : « Vous dites que vous pouvez être effrayée de vous-même — et vous vous étonnez parce que je ne semble pas être effrayé pour vous ? » La cliente : (un autre court rire) « Vous avez plus de confiance en moi que je n’en ai » — (elle nettoie la saleté de son vernis à ongles et sort de la pièce) — « Je vous verrai la semaine prochaine — (un court rire) peut-être. » (Elle s’en va en marchant lentement)17. Dans cette situation délicate, le thérapeute ne pratique pas une méthode mécanique de renvoi de ce qui est exprimé au client. Il réexprime avec beaucoup de nuance (notamment dans sa seconde intervention, « quelque chose de plus permanent que le rêve, pour réverbérer le mot “suicide” »). Il explicite également ce qu’il ressent personnellement en profondeur (troisième intervention, où il affirme « c’est à votre portée ») sans toutefois prendre la place du client pour les choix décisifs, notamment le choix de venir en thérapie et le choix de la cadence des entretiens, mais aussi, plus dramatiquement, le choix de vivre. Rogers, se posant alors la question du droit pour le thérapeute de permettre sérieusement à un client « de considérer la psychose ou le suicide comme une issue sans faire un effort positif pour prévenir (prevent) ces choix »18, répond que dans ces moments pathétiques « plus profondément il se fonde sur la force et les potentialités du client, plus profondément il découvre cette force »19. Et il énonce après beaucoup d’interrogations, une assertion centrale : « Il m’apparaît que c’est seulement si le thérapeute veut complètement (is completely willing) que n’importe quelle conséquence, n’importe quelle direction, puissent être choisies — qu’il réalise alors seulement la force vitale de la capacité et de la potentialité de l’individu à faire des actions constructives. C’est s’il est consentant (willing) à ce que la mort soit le choix, que la vie est choisie ; à ce que ce soit la névrose qui soit le choix, que la mortalité de la santé est choisie »20. En ce point crucial où il appuie et où il valide son hypothèse centrale, Rogers met en évidence que son approche ne consiste pas à placer habilement le client en soumission aux valeurs culturelles et sociales, mais en expérience de ses propres régulations, base d’une confiance vitale. Il désigne une propriété de l’organisme humain à se recentrer psychiquement, après avoir pu analyser des tentatives d’excentrations grâce à un climat chaud mais non contraignant ni restrictif : c’est à l’occasion de cette propriété d’automodération que Max Pagès a proposé une « loi d’inversion de mouvement21 » pour les orientations et pulsions intérieures, quand elles sont accueillies sans subtile contrariété ou réactionalité, sans reprise en dépendance, sans reproche. L’angoisse accueillie se recueille, le dégoût de soi constaté se mue en goût de devenir soi, la fuite énoncée mais non dénoncée se stabilise en reprise.
Thérapie et transfert
Cette précaution à l’égard des dépendances aux normes sociales se retrouve et se précise dans la précaution avec laquelle Rogers déjoue les risques de dépendance transférentielle. Le concept de transfert n’avait pas été évoqué dans son précédent livre (il ne se trouve aucunement à son index analytique). Il est au contraire fréquemment repris dans Client-Centered Therapy. On sait comment le transfert de rapports et de statuts antérieurs (affectifs et sociaux) se situe au centre des débats de la psychanalyse et de la psychothérapie. Rogers cite un texte de Freud, dans l’encyclopédie britannique : « Le transfert est une preuve du fait que les adultes n’ont pas dépassé leur dépendance enfantine d’antan ; il coïncide avec la force qui a été nommée “suggestion” ; et c’est seulement en apprenant à en faire usage que le médecin est capable d’amener (induce) son patient à dépasser ses résistances intérieures et à progresser au-delà de ses régressions. Ainsi le traitement psychanalytique agit comme une seconde éducation de l’adulte, comme la correction de son éducation d’enfant »22. Rogers ajoute la description de la méthode de l’analyste vis-à-vis d’un transfert, par Otto Fenichel : « La réaction de l’analyste en transfert est la même qu’à l’égard de toute autre attitude du patient : il interprète. Il voit dans l’attitude du patient une déviation des pulsions inconscientes et il essaie de montrer ceci au patient »23. Rogers reconnaît alors que, dans sa forme de thérapie, il se produit habituellement des segments de transferts, mais qui restent la plupart du temps discontinus et légers. Une relation transférentielle structurée et dépendante ne se développe pas, parce que le thérapeute rogérien ne la recherche pas et parce qu’il ne soutient pas une situation de supériorité et de distance affichée à l’égard du client. La façon de recevoir les tendances transférentielles sans se défendre contre elles apparaît dans les entretiens où le thérapeute rogérien s’abstient d’interprétation et de pression pour orienter la situation. Ainsi, dans le cinquième entretien d’une jeune femme mariée, Mme Dar, celle-ci raconte un rêve où elle voit son thérapeute la rejeter, son histoire étant, dit-elle, fort « sordide ». Le thérapeute : « Votre sentiment était en quelque sorte que j’étais en train de juger plus ou moins votre situation comme mauvaise, passablement mauvaise ». La cliente : « c’est juste. Que vous étiez… j’étais l’accusée et vous étiez le juge et… » (silence) Le thérapeute : « Le verdict était : “coupable” ». La cliente : (elle rit) « Je pense que c’est ça (elle rit). C’est tout à fait ça. Je ne voyais pas comment je pourrais revenir sur la situation. Je veux dire les circonstances ; vous m’aviez déjà jugée et, par conséquent, je ne voyais vraiment pas, comment je pourrais parler encore ». Le thérapeute : « Mhm… » La cliente : « Sauf à propos d’autres choses. Et, heu, cela ne m’a pas quittée. J’y ai beaucoup pensé ces derniers temps ». Le thérapeute : « Vous pensiez presque que vous étiez toujours en train d’être jugée ». La cliente : « Eh bien ! pourquoi aurais-je senti cela ? Heu, oui, bien sûr, j’ai probablement transporté mes propres pensées dans votre cerveau et, par conséquent, je heu…, il n’y avait pas de doute à leur sujet. C’était tout simplement impossible de les changer. C’était le verdict. Je suppose, à ma façon, je me jugeais moi-même ». Le thérapeute : « Vous sentez que peut-être, vous étiez vous-même le juge vraiment »24. Dans cet extrait, la tendance au transfert se dénoue devant la « compréhension » du thérapeute, ainsi que Rogers le note. La cliente a vu avec évidence que le thérapeute « n’est pas en train d’essayer de la jauger, de diagnostiquer à son propos, de l’évaluer scientifiquement, de la juger moralement… Conséquemment, quand elle a le sentiment que le thérapeute fait un jugement moral sur elle, et quand ce sentiment est aussi accepté, il n’y a rien sur quoi cette projection puisse tenir. Elle doit être reconnue comme venant d’elle »25. Pour donner un exemple plus extrême, Rogers présente, à partir de notes prises au cours des entretiens, le cas d’une jeune femme d’une trentaine d’années, Miss Tir, « si profondément perturbée qu’on l’aurait probablement diagnostiquée comme psychotique en termes d’évaluation externe »26. Son traitement eût relevé d’un hôpital psychiatrique, plutôt que d’un centre de counseling. Elle vint suivre une trentaine d’entretiens au cours desquels elle fit beaucoup de progrès, qui s’accrurent dans les dix mois suivants27. Au neuvième entretien, elle explique qu’elle a enlevé son manteau avant d’entrer, parce qu’elle avait peur que le thérapeute l’aide et qu’elle aurait pu se retourner et l’embrasser : Le thérapeute : « Vous pensiez que ces sentiments d’affection pourraient faire que vous m’embrassiez si vous ne vous protégiez pas vous-même d’eux ». La cliente : « Bien, une autre raison pour laquelle j’ai quitté mon manteau là est que je désire être dépendante — mais que je veux vous montrer que je n’ai pas à être dépendante ». Le thérapeute : « Vous désirez à la fois l’être, et prouver que vous n’avez pas à l’être ». Et, vers la fin de ce neuvième entretien : La cliente : « Je n’ai jamais dit à des gens qu’ils étaient la plus étonnante (wonderful) personne que j’ai jamais connue, mais je vous le dis. Ce n’est pas seulement sexuel — C’est plus que cela ». Le thérapeute : « Vous vous sentez réellement attachée très profondément à moi ». Au dixième entretien, vers la fin : La cliente : « Je pense émotionnellement que je meurs d’envie d’avoir des rapports (intercourse) sexuels mais je n’ai rien fait sur ce point. La chose que je désire est d’avoir un rapport sexuel avec vous. Mais je n’ose vous le demander, parce que je m’effraie que vous soyez non directif ». Le thérapeute : « Vous avez cette affreuse (awful) tension, et demandez vivement d’avoir des relations avec moi ». La cliente : (poursuivant sur ce filon — Finalement) « Pouvez-vous faire quelque chose sur ce point ? Cette tension est excessive ! Voulez-vous diminuer cette tension… Pouvez-vous me donner une réponse directe ? Je pense que cela pourrait nous aider tous les deux ». Le thérapeute : (avec douceur — « gently ») : « La réponse serait non. Je peux comprendre combien désespérément vous sentez tout cela ; mais je ne voudrais pas faire cela ». La cliente : (silence, un soupir de soulagement) « Je pense que cela m’aide. C’est seulement quand je suis bouleversée (upset) que je suis comme cela. Vous avez de la force, et cela me donne de la force »28. Rogers note la responsabilité selon laquelle le thérapeute exprime une limitation et articule un « non ». Il ne cherche pas à s’esquiver devant la pression de la cliente ; mais il n’alléguera pas qu’un rapport sexuel ne l’aiderait pas, elle. Tout en indiquant sa compréhension et son acceptation de l’expérience que la cliente vit, il prend simplement la responsabilité de sa propre conduite. Par la suite, au douzième entretien, la cliente se montre violente, agressive contre le thérapeute, après deux minutes de silence, lui déclare sa haine, souhaite qu’il ne soit pas né ou qu’il soit mort, sans le regarder : La cliente : « Vous pensez que mon père a fait de vilaines choses avec moi, mais il n’en est rien ! Vous pensez que ce n’était pas un homme bon, mais il l’était. Vous pensez que je désire des rapports sexuels, mais je ne les désire pas ». Le thérapeute : « Vous sentez que je me représente absolument de travers (absolutely misrepresent) toutes vos pensées ». La cliente : « Vous pensez que vous pouvez faire venir les gens ici vous raconter tout, et qu’ils penseront qu’ils seront aidés, mais ils ne le seront pas ! Vous aimez seulement les faire souffrir… »29. Le thérapeute continue à recevoir le transfert négatif de Miss Tir et à réexprimer les sentiments projetés avec une tonalité empathique dans la voix, difficilement déchiffrable, remarque-t-il, sur les mots écrits qui paraissent pâles à côté du vécu. La cliente arrive à parler de conflits profonds puis de ses hallucinations avec une tension terrifiante dans la voix, mais une attitude très différente. Elle en vient enfin à dire : La cliente : « Je savais au bureau que j’avais à me débarrasser de ceci quelque part. Je sentais que je viendrais vous le dire. Je savais que vous comprendriez. Je ne pouvais pas dire que je me haïssais. C’est vrai, mais je ne pouvais le dire. Aussi ai-je justement pensé à toutes les choses laides (ugly) que je pourrais vous dire à la place ». Le thérapeute : « Les choses que vous sentiez à propos de vous-même, vous ne pouviez les dire, mais vous pouviez les dire à mon propos ». La cliente : « Je sais que nous atteignons un fond rocheux (rock bottom)…30 » Le transfert se dénonce et se dénoue de lui-même, dans la mesure où, même pour un matériel profond, un client peut en venir à réaliser progressivement, sans être tancé par des interprétations, que les attitudes qu’il a vis-à-vis des autres et les qualités qu’il leur attribue, peuvent résider dans ses propres perceptions. Non recherchée pour des raisons théoriques, non alimentée par des interventions pratiques, non provoquée par des obligations de « libre association », la dépendance (la remise de responsabilité) ne se structure pas démesurément, mais se projette en continu pour se dénouer. Le thérapeute n’ayant pas donné prise à sa fixation, le transfert peut être un épisode, un ovule expulsable, mais non un noyau fécondé dans la relation thérapeutique. Et c’est la croissance de responsabilité qui peut se développer comme cela ressort des essais toujours opiniâtres de validations scientifiques que Rogers entreprend et renouvelle, et sur lesquels nous reviendrons.
La « rencontre » de Kierkegaard
Ses activités de thérapie et ses activités de recherche à Chicago mettent Rogers en contact avec de nombreux assistants et chercheurs. Il participe d’autre part à d’importants symposiums sur les valeurs et la science. Il découvre alors, en 1951, au-delà de son rétablissement, que sa réflexion et l’aspect central de son travail thérapeutique « pouvaient légitimement être qualifiés d’existentiels ou de phénoménologiques »31. Sous la pression de ses étudiants et de ses collaborateurs, Carl se met en effet à lire l’œuvre de Kierkegaard. Il citera dans ses ouvrages La maladie à la mort et le Post-scriptum aux miettes philosophiques. Et c’est une véritable rencontre : « Quoique Kierkegaard vécût il y a cent ans, je ne peux m’empêcher de le considérer comme un ami, doué de sensibilité et d’un haut degré de perception »32. Et Rogers ajoute que la lecture de son œuvre l’a détendu et l’a encouragé à avoir confiance dans son expérience personnelle. Kierkegaard exprime, en effet, l’importance de l’existence et de l’expérience face aux séductions et aux complications intellectualistes, représentées en son temps par une hypersystématisation de la dialectique hegelienne. Il analyse le désespoir, « maladie à la mort » aussi bien que l’angoisse. La conscience de soi dont il parle ne se réduit pas à une dimension intellectuelle, elle adhère à la vie. « Plus la conscience est développée, plus le moi l’est aussi ; plus il y a de conscience, plus il y a de volonté ; et plus il y a de volonté, plus aussi il y a de moi. Un homme sans aucune volonté n’est pas un moi ; mais plus il a de volonté, plus aussi il a de conscience de soi »33. Et envisageant le désespoir sous la synthèse du fini et de l’infini, Kierkegaard ajoute : « Le moi est la synthèse consciente d’infini et de fini qui se rapporte à elle-même et dont la tâche est de devenir soi, ce qu’elle ne peut qu’en se rapportant à Dieu. Mais devenir soi, c’est devenir concret, ce n’est devenir ni fini ni infini… Si donc le moi ne devient pas lui-même il n’est pas lui-même ; mais ne pas être soi, c’est justement le désespoir »34. Etre vraiment soi-même, par contre, c’est échapper au désespoir, en ne demeurant plus une façade ou en ne subsistant plus dans l’effroi, « la crainte et le tremblement », dépassés par la passion. « Ce que j’appelle proprement humain, c’est la passion, dans laquelle chaque génération comprend entièrement l’autre et se comprend elle-même — Ainsi, pour ce qui est d’aimer, aucune génération n’a appris d’une autre à aimer… Mais la passion la plus haute en l’homme est la foi…35 » Et c’est dès lors affronter l’angoisse qui « est la réalité de la liberté parce qu’elle en est le possible »36. Mais c’est aussi associer réflexion et imagination : « Le moi est réflexion et l’imagination est réflexion ; elle donne du moi un reflet qui en est la possibilité ; et l’intensité de ce médium est la possibilité de l’intensité du moi. D’une manière générale, le fantastique, c’est ce qui conduit l’homme dans l’infini en ne faisant que l’éloigner de lui-même et en l’empêchant ainsi de revenir à lui-même »37. Plutôt donc le paradoxe (où la limite et le dépassement de la limite s’équilibrent dans la personnalité en compréhension d’elle-même) que le dévoiement dans l’intellectualisme et le symbolisme échevelés (où se complaît certaine psychologie ; on sait laquelle, pense Rogers). La philosophie de la subjectivité et la psychologie d’un moi intense, telles que Kierkegaard les présente, se situent, on le sait et on le voit, en pleine réflexion religieuse à un point où le luthérianisme rencontre l’orthodoxie et le catholicisme. Quel fut l’impact de cette réflexion sur Rogers, au moment même où il subissait la grande crise de sa vie ? Il est intéressant de noter qu’il a étudié avec soin le long Post-scriptum aux miettes philosophiques : même si on n’oublie pas qu’il déclare que « sur divers points, Kierkegaard, par exemple, n’éveille rien en moi »38. Et il cite du Post-scriptum : « L’existant ne cesse d’être dans le devenir ; le penseur subjectif qui existe réellement reproduit sans cesse dans sa pensée cette existence qui est la sienne, et met toute sa pensée dans le devenir. Il en va ici comme pour avoir du style ; n’a a proprement parler de style que celui qui ne finit jamais quelque chose, mais aussi souvent qu’il commence “les eaux de la langue se mettent en mouvement”, en sorte que l’expression la plus quotidienne apparaît sous sa plume avec une fraîcheur nouvelle-née »39. Rogers devait aimer aussi les pages ultérieures du texte qu’il a cité : « L’existence elle-même, l’exister, est un effort, et est tout autant pathétique que comique ; pathétique, parce que l’effort est infini, c’est-à-dire dirigé vers l’infini, parce qu’il est réalisation d’infini, ce qui signifie le plus haut pathos ; comique, parce que l’effort est une contradiction interne »40. Et son sens rural devait s’accommoder d’un tel humour et de la remarque que « l’effort continu devient la seule chose qui ne contienne pas de déception »41. Devenir subjectif, se comprendre soi-même en renouvelant et en dépassant l’invitation socratique, c’est-à-dire accéder au simple, devient la grande affaire, la plus haute tâche assignée à chaque homme. La vérité est vécue dans la tension d’un paradoxe : « L’incertitude objective appropriée fermement par l’intériorité la plus passionnée, voilà la vérité, la plus haute vérité qu’il y ait pour un sujet existant »42. La vie, chacun doit l’apprendre par soi-même : « Et c’est pourquoi je dois me comprendre moi-même »43. Mais, « le vrai savant ne détruit pas la vie. Il s’approfondit amoureusement dans son magnifique travail »44. Rogers devait tirer parti des incitations de Kierkegaard : non seulement dans son action de thérapie et de recherche mais aussi pour soutenir des approches de plus en plus « révolutionnaires » en pédagogie.
Radicalisme en pédagogie
A l’université de Chicago comme au Centre, la démarche pédagogique de Rogers, redécouvrant les principes établis par Dewey et Kilpatrick, tendit à se faire, en effet, radicale, sur l’hypothèse qu’il est impossible d’enseigner dogmatiquement et directement quelque chose d’important à quelqu’un. Il est seulement possible de faciliter l’apprentissage des individus, autant que ceux-ci perçoivent les connaissances acquises comme soutenant la maintenance et le rehaussement de la structure de leur moi. La possibilité de ramener la tension du moi à un niveau minimum coïncide avec la recherche des connaissances signifiantes45. Ces principes ont été appliqués aussi bien pour des cours de statistiques et de mathématiques qu’en matière de relations humaines, de psychologie ou de thérapie : « Mes cours devinrent de passionnantes réunions par petits groupes où l’on s’apportait mutuellement des informations complètes sur les sujets d’un réel intérêt. Se retrouver ainsi, libérés, était souvent une expérience traumatisante. Un étudiant hors pair, qui devint plus tard un responsable du Centre de conseil psychologique, quitta mon premier cours en disant d’un air dégoûté à un de ses camarades : “Ce salaud ose se dire professeur”. Cependant, le ferment qu’il avait reçu continua à lever en lui, car il revint plus d’une année après »46. Cette méthodologie neuve avait des « effets-retards » ou provoquait de soudaines accélérations : elle déclenchait des alertes en profondeur. Rogers a raconté la procédure qu’il se mettait à utiliser pour son enseignement. Dès le premier cours, il réunissait en cercle les étudiants de psychologie et offrait à chacun l’occasion d’expliciter le projet (purpose) personnel qu’il avait en venant à ce cours. De son côté, pour faciliter l’exploration des projets, il présentait, pièces sur tables, de façon succincte mais précise, comme un ensemble de disponibilités, des matériaux et des manières de travailler : « Des discussions de groupe, des exposés s’ils le désiraient, des études de matériels publiés et de cas non publiés, l’observation de sessions de thérapie par le jeu, la visite de thérapeutes au travail, l’écoute d’enregistrements de thérapie, etc.47 » Il proposait donc, pour les études à faire, un lot important de possibilités auxquelles il attachait du prix et qui l’engageait personnellement (en signe de congruence) : mais il précisait d’emblée que ce matériel n’était en aucune manière imposé aux étudiants. Il appartenait, en effet, à ceux-ci de décider, individuellement et en groupe, des moyens qu’ils emprunteraient, en élucidant leurs objectifs réels, et en usant pleinement de leur spontanéité et de leur disponibilité : c’était mettre en œuvre et signifier une prise en « considération positive inconditionnelle » des étudiants. Car, le matériel montré, Rogers précisait par son écoute et la sobriété ou l’adéquation de ses interventions en miroir ou en réponse, qu’il était à la disposition du groupe, en tant qu’expert ou que source de renseignements (resource-finder) mais aussi comme simple membre. Dans leur relation à lui, rien d’obligé, rien d’exclu. Il était prêt à avoir des conversations, à faire des exposés sur le savoir qu’il avait, ou à exprimer sa propre façon d’envisager les choses : mais seulement « si on le lui demande », et selon la condition expresse que les étudiants « se sentent libres d’accepter ou de refuser cette offre »48, à tout moment, l’exposé fût-il commencé. Car « répondre aux sentiments et aux attitudes des étudiants passe avant son intérêt personnel à exposer ce qui relève de sa discipline »49. Quelque information que puissent demander un individu ou un groupe, il était prêt aussi à en rechercher avec les étudiants eux-mêmes les possibilités d’obtention. Dans la rencontre pédagogique, à ses yeux, comme il le précise encore dans le Développement de la personne, rien ne doit être écarté : ni les problèmes réels vécus par les étudiants (voire l’expression « des sentiments relatifs aux parents, des sentiments de haine à l’égard des frères et sœurs ou à l’égard de soi »50) ; ni ses sentiments à lui (« d’indifférence, de satisfaction, d’étonnement ou de plaisir »51) à l’égard des activités des individus ou du groupe, au moins sous réserve qu’ils n’exercent sur les étudiants aucune influence restrictive et qu’ils ne soient donc ni une stimulation ni un frein. Et Rogers répond à l’interrogation : « A-t-on le droit de laisser se manifester pareils sentiments dans le cadre de l’école ? Selon ma thèse, certainement. Ils sont liés à l’évolution de la personne, à l’efficacité de sa connaissance et de son équilibre pratique ; et le fait de traiter de tels sentiments avec compréhension et acceptation a un lien certain avec celui d’apprendre la géographie du Pakistan ou de savoir faire une longue division »52. Parce qu’une connaissance ne peut être acquise avec authenticité que lorsqu’elle est reliée à des situations perçues comme touchant à des problèmes personnels ; et parce que le fait pour les étudiants de pouvoir considérer le cours comme un temps utilisable pour résoudre des questions importantes pour eux les libère et leur permet de progresser grâce à l’appui d’une compréhension « empathique ». Il n’est pas trace de laisser-faire ou de désinvolture dans une telle méthodologie. D’autant plus que, s’il ne présente aucune restriction au contenu du travail interne que les étudiants voudront choisir, Rogers juge cependant utile de produire, au besoin, les exigences externes par rapport auxquelles ce travail doit être accompli de façon responsable. La non-directivité ou la centration sur le client n’ont pour lui de signification que par référence à des limites externes53, ou à des limitations internes aux groupes d’étudiants, de même nature que les contraintes contenues réellement dans la vie. « L’étudiant saura utilement qu’il ne peut entrer dans une école d’ingénieurs sans tel niveau mathématique ; qu’il ne peut obtenir du travail dans telle société à moins d’avoir un diplôme universitaire…, qu’il ne peut même conduire une voiture sans passer un examen sur le code de la route. Ces exigences sont requises non de l’enseignant, mais par la vie… Il pourrait y avoir d’autres exigences analogues à l’intérieur de l’école. L’étudiant pourrait être confronté avec le fait qu’il ne peut entrer au club de mathématiques avant d’avoir atteint un certain niveau à des tests mathématiques standardisés ; qu’il ne peut développer un film avant d’avoir montré des connaissances adéquates en chimie et dans les techniques de laboratoire ; qu’il ne peut s’inscrire à la section spéciale de littérature avant d’avoir montré à la fois une large culture et ses aptitudes à écrire. L’évaluation se place dans la vie comme un ticket d’entrée, et non pas comme un gourdin pour récalcitrants… On laisserait l’étudiant libre de choisir, en personne se respectant, se déterminant par elle-même, s’il désire faire un effort pour obtenir ces tickets d’entrée »54. Rogers avait dès le début précisé, en regardant les diverses tentatives d’enseignement centré sur l’étudiant : « C’est dans le cadre (within) des limitations imposées par les circonstances et l’autorité, ou imposées par l’instructeur comme une nécessité pour son propre confort psychologique, qu’une atmosphère de permissivité, d’acceptation, de confiance dans la responsabilité des étudiants, est créée »55.
Le climat spécifique et ses phases successives
Un programme de cette nature ne peut néanmoins être mis en application sans que des objections et des anxiétés n’apparaissent. Sitôt qu’un enseignant tel que Rogers laisse la parole au groupe des étudiants, celui-ci va instinctivement tester l’authenticité, la cohérence des propositions qui lui ont été faites. Une pression affective s’exerce donc très vite pour inciter l’enseignant à reprendre la direction de l’enseignement, pour sonder ses masques et ses retraits éventuels au lieu de la présence annoncée. A cet effet, un climat particulier s’établit, analogue à celui des réunions déstructurées (telles que le training-group ou « groupe de base »). Les intéressés se sentent déconcertés : ils avaient l’habitude de suivre, nolens volens, les indications du professeur ; ils étaient rassurés par l’ordonnance d’un cours, voire séduits par son éloquence persuasive ; ils sont maintenant dans l’incertitude, mais en demeure de constater leur ambiguïté et de se montrer responsables et libres ; frustrés de direction et de guidage, ils sont mis au contact de leur angoisse propre et en présence de l’anxiété de leurs interactions réciproques ; ils ne peuvent plus se raccrocher à un martelage des normes extérieures, agitées ou rappelées par l’enseignant. Celui-ci intervient, en effet, mais pour donner de l’information à propos des choix formulés ou pour refléter de temps à autre la situation émotionnelle qui s’instaure inéluctablement, tout en contrôlant ses propres sentiments, afin de ne pas suivre ses désirs de « prendre le pouvoir » et de « manipuler » le groupe. Le climat consécutif à la méthodologie engagée a été décrit de façon pertinente par un étudiant s’adressant à Rogers : « Je puis me souvenir des premières réunions. Tension… attitude défensive… épaisses tranches de silence profond… explosions impulsives d’hostilité… rapides éclairs d’intuition par-ci, par-là… confusion et rationalisation… projections subtiles et interprétations mordantes. Cela était dur pour nous d’aller au-delà. Nous étions tellement dépendants de l’autorité habituelle. Nous nous rebellions contre le fait d’avoir à prendre la responsabilité de notre propre instruction. Nous voulions recevoir quelque chose de vous. Nous voulions recevoir quelque chose du cours… Beaucoup d’entre nous eurent des moments difficiles avant de sortir de cette dépendance. Quelques-uns n’y arrivèrent pas. Quant à moi, je me dandinais pendant les trois ou quatre premières semaines plutôt confus et parfois indifférent. Plus tard, je commençais à lire et à penser à propos de ceci ou cela en thérapie. Je lus ce que je voulais. Je me mis à approfondir. Je ne ressentais aucune pression de votre part ou de la part de la classe. Je lus pour moi, j’appris pour moi. J’étais satisfait de moi sans devenir béat. J’allais en classe voir ce que je pourrais glaner, au cours du libre échange des idées ; j’exprimais mes propres sentiments quand je sentais que je le pouvais et j’écoutais les autres discuter sur des problèmes. Je sentais que j’étais réellement « dans le coup». L’heure parut chaque semaine plus courte… Je me sentais complètement libre dans ce cours. Je pouvais venir ou ne pas venir. Je pouvais arriver en retard et partir avant l’heure. Je pouvais parler ou être silencieux. J’appris à connaître beaucoup mieux nombre d’étudiants. J’étais traité comme un adulte. Je ne sentais aucune pression de votre part. Je n’avais pas besoin de chercher à vous plaire ; je n’avais pas à vous croire. Je n’ai jamais autant lu pour un seul autre cours comme je le fis pour le vôtre, et en outre c’était les lectures les plus significatives et les plus efficaces que j’aie pu faire. Je crois que cette confiance en moi qui émergeait se transporta sur les autres études. Ma femme a noté mon attitude nouvelle à l’égard de l’étude et mon intérêt vivant au travail. Nous sommes tous les deux heureux de cela »56. Rogers demanda aux étudiants des essais d’auto-évaluation de leur progression, avec diverses variantes. Pour la mise en évidence de sa confiance dans les personnes, dans quelques cas (not infrequently) il poussa au maximum d’extrémité sa tendance, en dépassant les compromis pratiques dont il recommanda depuis toujours l’utilité. Il se contentait alors, compte tenu qu’il avait affaire à des groupes d’étudiants de troisième cycle et en psychothérapie, d’ouvrir chaque séance avec quelque variante de « que désirez-vous que nous discutions ou fassions aujourd’hui ?57 » C’est cette méthode extrême (the most extreme) qui a souvent et seulement été retenue de lui. Il recherchait en avant de lui les élongations maximales de sa recherche pratique, mais sous le contrôle des possibilités de la thérapie, et pour certains groupes définis et mûrs.
Le défi à Harvard
Ce radicalisme affûté en forme de défi, fut présenté de façon mémorable en avril 1952 à l’université de Harvard, au cours d’un séminaire consacré aux problèmes de l’influence de l’enseignement scolaire sur le comportement humain. On lui avait demandé de faire une démonstration d’enseignement centré sur l’élève (student-centered). Préparant sa contribution, à Mexico, où il passait des vacances d’hiver (peignant, faisant de la photographie et se plongeant dans Kierkegaard), Carl Rogers se souvint qu’il avait « parfois réussi à déclencher en classe des discussions significatives en exprimant d’abord une opinion très personnelle et en essayant ensuite de comprendre et d’accepter les réactions et les émotions souvent très divergentes qu’elle soulevait chez les étudiants »58. Il s’astreint donc à noter de façon accentuée ce qu’il ressentait de son expérience d’enseignant et d’étudiant, en évitant toute banalité ou convention. Il présenta par suite devant un aréopage d’une centaine d’enseignants de Harvard, en principe habitués à l’autocritique, avec précaution croyait-il, des observations interpellantes et concises (en quelque dix minutes) mitigées de ses propres expressions de surprise et de commentaires, telles que : « Mon expérience m’a conduit à penser que je ne puis enseigner à quelqu’un d’autre à enseigner… Il me semble que tout ce qui peut être enseigné à une autre personne est relativement sans utilité et n’a que peu ou point d’influence sur son comportement59… J’en suis arrivé à croire que les seules connaissances qui puissent influencer le comportement d’un individu sont celles qu’il découvre lui-même et qu’il s’approprie… La conséquence de ce qui précède, c’est que mon métier d’enseignant n’a plus pour moi aucun intérêt… Les résultats de l’enseignement sont ou insignifiants ou nuisibles… — En conséquence, je m’aperçois que je ne m’intéresse qu’à apprendre et de préférence des choses importantes qui ont une influence sur mon comportement. Je trouve satisfaisant d’apprendre, que ce soit en groupe, en relations individuelles comme en thérapie ou tout seul »60. Rogers notait aussi l’efficacité qu’il y avait, pour enseigner, à abandonner les attitudes défensives, à exprimer aux autres ses incertitudes et à se laisser guider, par son expérience, vers des buts encore obscurs. Il admettait néanmoins les conséquences, « étranges voire aberrantes », qui résultaient de ses considérations : serait-ce un renoncement à l’enseignement ? (dans le sens d’Ivan Illich, parlant vingt ans après d’une « société sans école »), aux examens ? aux diplômes ? ou à toute conclusion ? Rogers avait espéré, par l’exposé de cette problématique, susciter une réaction mais avoua ne pas s’être attendu au « tumulte » qui s’ensuivit : au-delà des dénégations et des discussions houleuses, les uns et les autres se mirent à s’exprimer, « avec une franchise croissante » et une grande diversité, sur leurs propres sentiments à propos de la pédagogie61.
Une onde de choc
Ces descriptions montrent à nouveau l’esprit précurseur de Carl Rogers. L’événement de 1952 fut l’épicentre d’une onde de choc qui n’a pas fini d’ébranler les postulats tranquillisants de l’enseignement, en Amérique et ailleurs. Max Pagès, en effet, avait été un des étudiants de Rogers durant l’été 195162. Il publiait en France, dans l’Evolution psychiatrique, dès son retour en 1952, un long article présentant la thérapie rogérienne. Et il entreprenait, d’autre part, de répandre les démarches concrètes de pédagogie, dans leur forme plutôt radicale, d’abord dans les grandes entreprises puis dans les universités (à partir de 1960). Il rappella ultérieurement son expérience avec Rogers : « Nous étions quatorze, nous nous assîmes tout autour d’une salle assez petite, après avoir été accueillis par Rogers (que chacun d’entre nous avait déjà rencontré individuellement). Rogers s’assit au milieu de nous et nous invita à nous présenter. Chacun le fit brièvement et, je me rappelle, en ce qui me concerne, avec une grande anxiété. Puis Rogers prit la parole très brièvement pour indiquer un certain nombre de moyens qui étaient à notre disposition si nous le désirions, pour nous aider dans notre travail : des listes bibliographiques, la participation comme observateur ou thérapeute adjoint à des séances de psychothérapie de groupe, l’étude d’un matériel enregistré, le travail avec des instructeurs, dont lui-même qui appartenait à l’état-major de la clinique de l’université… puis il se tut, ayant clairement indiqué par son ton qu’il n’avait pas d’autres indications à nous donner. « Je me souviens encore du sentiment d’intense excitation avec lequel je quittai cette séance : le contact avec une attitude non directive vécue fut un choc extraordinaire. Le fait de découvrir qu’une attitude exactement conforme à celle qui était décrite dans les ouvrages de Rogers, pouvait être, en fait, appliquée, m’enthousiasma et me rendit anxieux à la fois. Jusqu’alors, au fond, je n’avais pas vraiment cru qu’une telle attitude fût possible. « Des autres séances, une douzaine au total, je garde l’impression générale suivante : une grande confusion des échanges, de monstrueuses tensions et rivalités internes sous-jacentes ; Rogers intervenait dans l’ensemble ni plus ni moins fréquemment que les autres et tout à fait sur le même plan, contribuant à la discussion librement et semblant n’avoir rigoureusement aucun souci au sujet de la conduite d’ensemble de notre travail. Il semblait satisfait du point qui venait en discussion au moment présent, quel qu’il fût. Mon état d’esprit personnel resta pendant toute la session caractérisé par un mélange d’étonnement, de tension, et par dessus tout de satisfaction et de bien-être »63. Quarante-cinq ans plus tard, Max Pagès se souviendrait qu’il avait été attiré par la façon de Rogers d’intégrer deux positions contraires : l’une, d’exigence scientifique très rigoureuse et de subjectivité « où il allait plus loin que les psychanalystes »64, mais aussi une autre, celle d’établir « un décloisonnement professionnel ». Et il précise alors : « Je ne me suis jamais considéré comme un disciple de Rogers. En fait, j’étais bien un disciple de Rogers, mais je n’étais pas un disciple soumis, au sens ou cela veut dire adhérer à une doctrine. Je n’ai jamais pu adhérer à une doctrine. Je n’aliénais pas mon esprit critique mais j’étais enthousiasmé »65. Ainsi, aux Etats-Unis et par rebonds au Japon, en Belgique ou en France, adossé à son activité thérapeutique et à ses entreprises d’enseignant, associant pleinement ses élèves à ses recherches, développant le counseling universitaire, Rogers se plaçait délibérément du côté de ses puînés (comme jadis avec ses frères). Il provoquait les mandarins, fustigeait les dogmatismes, dénouait les conformismes : il éveillait beaucoup de controverses (notamment avec Skinner en 1956) mais aussi nombre d’espoirs créateurs. Dès lors, pour l’atteindre, on chercherait à saper sa propre sécurité de psychologue, en prétextant qu’il n’abordait que des thérapies superficielles et qu’il ne faisait pas grand-chose pour la formation des adultes. Il tiendrait alors le défi d’une thérapie des schizophrènes.
Chapitre VI
Wisconsin ou l’apogée d’une carrière
A l’université du Wisconsin, près de quarante ans auparavant, Carl et Helen avaient fait leurs débuts dans la vie universitaire : et ils s’étaient retrouvés, grâce à cette alma mater avant de s’épouser. Au printemps 1957, Carl, qui venait de recevoir la première médaille d’honneur de l’apa, est invité pour un semestre par le département des sciences de l’éducation dans cette université. Il organisa, au cours de ces mois, des séminaires fructueux pour le personnel enseignant, les étudiants de troisième cycle en psychologie, en counseling et éducation. En cette université où il avait réussi comme étudiant, à partir de laquelle il était parti pour la Chine et où il avait élaboré son autonomie par rapport au groupe familial, Carl est à nouveau tenté de s’arracher à l’ambiance du Centre de conseil psychologique et au Chicago de son enfance et de sa croissante notoriété. On le pousse à rédiger le projet d’un poste qui le séduisait. « Je décrivis, constate-t-il, un poste impossible : emploi à la fois en psychiatrie et en psychologie, possibilité de former des psychologues et psychiatres, temps libre pour la psychothérapie et la recherche avec des individus normaux et psychotiques (les deux groupes extrêmes où je sentais que mon expérience était insuffisante) et d’autres exigences irréalisables »1.
Le départ pour Madison
Toutes ses conditions sont acceptées. Malgré le bouleversement de son équipe de Chicago, et quoiqu’il dût s’aventurer dans des départements de psychologie et de psychiatrie encore sceptiques, Carl précipite sa décision. A la fin de l’été 1957, Helen et lui partent s’installer à Madison, dans une belle maison également située sur les bords du lac Monona. « Cette fois, note Helen, il avait l’occasion d’avoir plus d’impact en psychiatrie et de faire des recherches en psychothérapie »2. Helen retrouvait avec joie le Wisconsin de leur jeunesse : elle aurait aimé y vivre la fin de ses jours. Carl abandonne, à son arrivée, la clientèle individuelle pour se consacrer à la thérapie ardue des schizophrènes. Il était « impatient de voir ce qui pourrait être accompli là et était profondément impliqué dans un large programme de recherche »3. Dans leurs projets, les Rogers se retrouvent entourés de chaude amitié. Carl trouva de grands sujets de photographies à faire sur les arbres givrés et le lac gelé. Et il est appelé de toutes parts à de nombreuses et fécondes manifestations.
Le dialogue avec Martin Buber
Il rencontre à Ann Arbor, en avril 1957 à l’université du Michigan, Martin Buber, dont il avait beaucoup apprécié l’œuvre en même temps que celle de Kierkegaard. Martin Buber était alors professeur de philosophie à l’université de Jérusalem. Existentialiste, il avait écrit dès 1923 Ich und Du (« Je et Tu »), puis en 1925 Über das Erzieherische (« De la fonction éducatrice »). On peut citer en 1930, Zurisprache (« Dialogues »), en 1936, Die Frage an den Erirzelnen (« La question qui se pose à la personne ») et en 1942, un ouvrage en hébreu sur Le problème de l’homme. Il publia plus tard, en 1953, Elemente des Zwischenmenschlichens (« Eléments de l’interhumain »). Cette année-là, en août 1953, à la demande de Louis Massignon, professeur au Collège de France, Buber prenait part à un jeûne collectif pour demander la compréhension entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, quelques jours avant la déposition de Mohamed V — qui participa lui-même, ainsi que trois mille Marocains à ce jeûne. Et Martin Buber demandait le mois suivant au comité chrétien d’Entente France-Islam de s’associer à un jeûne à l’occasion du Yom Kippour pour que s’établissent la justice et la paix entre Arabes et Juifs, en dépit de leurs différences et de leurs différends. En 1958, après la rencontre avec Rogers, Buber publia un Post-scriptum à Ich und Du (« Je et Tu »). Il y fait allusion interrogative au « véritable psychothérapeute » qui ne se contente pas d’« analyser » son malade, mais qui se donne pour tâche « la régénération du centre atrophié de la personne ». Buber précise : « On n’y parviendra que si, d’un grand regard de médecin, on saisit l’unité latente, ensevelie sous les décombres de l’âme qui souffre. Or, pour cela, il faut une attitude de partenaires, entre personnes ; la considération d’un objet et son examen n’y mènent pas ». Et Buber ajoute cependant, pour le thérapeute : « Comme le pouvoir d’éduquer, le pouvoir de guérir n’est donné qu’à celui qui vit en face de vous sans être livré à votre emprise ». Il y a donc une « limitation normative de la mutualité », de la réciprocité, dans une relation thérapeutique, ce qui pourrait altérer l’authenticité recherchée par le thérapeute rogérien4. Mais cette limitation, cette incomplétude ne pouvait être dirimante pour l’« approche », par construction approximative, tendue à s’ajuster, pratiquée par Carl Rogers avec la coopération de son client. Comment Rogers, de son côté, se souvient-il de Buber ? « C’était un amical petit gnome » (a friendly little gnome) écrit-il, « qui était réellement effrayé (frightened) à l’idée de tenir un dialogue public avec moi parce qu’il ne connaissait seulement qu’un petit morceau de mes écrits et il était plein de crainte (fearful) de toute la perspective (prospect). Nous allâmes ensemble fameusement, cependant, et je fus réellement touché de ce que, le lendemain, quand il me rencontra pour le petit déjeuner (breakfast), il fût encore en train de penser au fait que je n’avais pas classé les schizophrènes à part comme une espèce (kind) séparée de personnes. Il avait pris clairement conscience qu’il les regardait comme malades (diseased), comme un groupe de gens définitivement différents, avec lesquels on ne pourrait pas se rencontrer comme des égaux »5. Rogers ne cesse de citer Martin Buber, dans ses écrits, notamment depuis 1960. Dans Le développement de la personne, il rappelle un passage de leur dialogue qui l’avait beaucoup frappé, et où Buber propose, dans le projet de toute relation, de « confirmer l’autre » : « Confirmer, dit-il, signifie… accepter toutes les potentialités de l’autre… Je peux reconnaître en lui, connaître en lui la personne qu’il devait devenir dès sa création. Je le confirme en moi-même et puis en lui par rapport à ces potentialités qui peuvent maintenant se développer et évoluer »6. C’est le sens d’une rencontre profonde, à un niveau de subjectivité intense et en approfondissement croissant, dans un dialogue « Je-Tu ». « Au commencement est la relation »7, pose Martin Buber qui constate d’autre part que les bases du langage ne sont pas des mots isolés, mais des couples de mots, et qu’il dénomma des « mots-principes ». « L’une de ces bases de langage, c’est le couple Je-Tu. L’autre est le couple Je-Cela, dans lequel on peut aussi remplacer Cela par Il ou Elle sans que le sens en soit modifié. Donc le Je de l’homme est double, lui aussi. Car le Je du couple verbal Je-Tu est autre que celui du couple verbal je-Cela »8. Mais alors que la réalité du mot fondamental Je-Cela implique une séparation, et qu’il naît d’une distinction naturelle, la réalité du mot fondamental Je-Tu, pour Buber, naît d’une liaison naturelle : et cette liaison lui paraît analogue à celle que l’enfant ressent dans le sein de sa mère : « C’est une liaison si vaste et si universelle qu’en lisant certains textes mystiques juifs on croit déchiffrer à demi une inscription primitive, lorsqu’on lit que dans le sein maternel l’homme est initié au tout, mais qu’il l’oublie à la naissance. Et cette liaison subsiste au fond de lui, elle est la figure secrète de son rêve »9. Comme pour Rank, Rogers a pu aimer cette structure maternelle (et transmaternelle mais non pas régressive) explicitée dans la relation Je-Tu. Mais quels sont les caractères de celle-ci ? « La relation avec le Tu est immédiate. Entre le Je et le Tu ne s’interpose aucun jeu de concepts, aucun schéma et aucune image préalable et la mémoire elle-même se transforme quand elle passe brusquement du morcellement des détails à la totalité. Entre le Je et le Tu, il n’y a ni buts, ni appétits, ni anticipation…10 » Cette épuration du rapport interpersonnel, malgré les appréhensions qu’avait exprimées Buber dans son dialogue avec Rogers, convient bien aux attitudes rogériennes, en prudence contre les préjugés et les diagnostics qui détaillent et morcellent la considération d’autrui. Au surplus, Rogers avait pu expérimenter en thérapie la remarque de Buber : « Quand un rapport immédiat s’établit, tous les rapports médiats deviennent sans valeur »11. Seules, pour lui, se renforcent la réciprocité de l’échange, la « mutualité » de l’action, dans l’intensité d’une présence vivifiée entre partenaires différents mais mis à niveau d’égalité, d’équité. L’homme devient un Je au contact du Tu. Car « relation est réciprocité. Mon Tu agit en moi comme j’agis en lui. Nos élèves nous forment, nos œuvres nous édifient… Nous vivons dans le torrent de la réciprocité universelle, unis à lui par un lien ineffable »12. Cependant la re-lation intense doit être entretenue, car sinon, par la pesanteur des rapports, « dans le monde où nous vivons, le Tu devient immanquablement un Cela »13. Et Buber décrit les risques qui pèsent sur un monde de consommation, d’objectivation maniaque. « Le Je du mot fondamental Je-Cela,
le Je pour lequel aucun Tu concret ne s’anime, mais qui est environné
d’une multiplicité de “contenus” n’est qu’un passé, n’est nullement
présent. En d’autres termes : dans la mesure où l’homme se satisfait des
choses qu’il expérimente et utilise, il vit dans le passé et son instant
est dénué de présence. Il n’a que des objets…14 »
Buber critique alors les conceptions qui soutiennent la dégradation en
Je-Cela des rapports humains et qui accusent de sentimen- Traitant plus généralement de l’épanouissement des forces créatrices dans la personne, Buber s’en prend aux aspects réducteurs qui viennent d’un usage abusif de concepts et pratiques analytiques, ou de « routines pantechniques » : « En face de ces doctrines et méthodes d’appauvrissement psychique, on ne doit cesser de montrer la polyphonie primordiale de la nature intime de l’homme, polyphonie où nulle voix ne peut être “réduite” à l’autre, et dont l’unité ne saurait être trouvée analytiquement, mais seulement perçue dans la consonance de l’instant »16. Polyphonie dans « l’instant » au lieu du découpage dans le passé : une telle considération se raccorde naturellement aux positions de Rogers par rapport à la psychanalyse. Elle rejoint aussi ses concepts en pédagogie, laquelle ne saurait être fondée sur le seul développement de l’« instinct d’auteur » (et de propriétaire du savoir). « L’expérience de ce qui fait dire Tu, ce n’est plus l’instinct d’auteur qui nous y conduit, c’est l’instinct des attaches. Cet instinct-là est quelque chose de plus grand que ne le savent les libidinistes : le désir de voir le monde devenir une personne présente à nous, une personne qui vienne à nous comme nous allons vers elle, qui nous élise et nous reconnaisse comme nous l’élisons et la connaissons, qui se confirme en nous comme nous nous confirmons en elle.17 » Rogers se ressent comme « confirmé » par la recherche enthousiaste et raffinée de Buber, en quête d’« entretien authentique » et de « parole dialogique ». Et comme lui, il perçoit l’importance du développement de la personne dans chaque individu, l’aspect primordial d’une subjectivité puissante en chacun des membres d’une structure sociale. Car, « une véritable communauté, une organisation commune empreinte d’authenticité ne se réaliseront que dans la mesure où deviendront réels les Individus dans l’existence responsable desquels se renouvelle la chose publique »18. Toute autre position verse dans l’idéologie et l’essentialisme.
La thérapie existentielle
Encouragé dans ses références vivantes à l’existentialisme, Rogers participe, en septembre 1959, à une conférence de psychologie existentielle qui se déroule lors de la rencontre annuelle de l’apa (Association américaine de psychologie). Il se range délibérément aux côtés de Rollo May, Abraham Maslow, Gordon Allport et du philosophe Herman Feidel, quoiqu’il exprimât son intérêt concomitant pour une approche expérimentaliste en psychothérapie. Car, pour lui, « notre tradition positiviste, avec ses définitions opérationnelles et ses recherches empiriques, peut nous être utile pour dégager ce que comportent de vérité les principes ontologiques de thérapie établis par Rollo May, les principes de dynamique de la personnalité définis dans les commentaires de A.H. Maslow et aussi les conséquences qu’entraînent les différentes perceptions de la mort telles qu’elles sont présentées par Herman Feifel »19. Mais comme Rollo May, il pressent « une profonde affinité entre la méthode existentielle et la pensée des psychologues américains »20, tels que William James ou John Dewey, dans la mesure où ils insistent, aussi bien que Kierkegaard, pour requérir « l’immédiateté de l’expérience et l’union de la pensée et de l’action »21. Avec les psychologues et psychanalystes existentiels, Rogers constate que le freudisme a pris une texture dogmatique et rigide, abstraite, oubliant ce qui était demeuré de vivant tragique en Freud. Mais « la méthodologie souffre toujours d’un retard culturel », soutient Rollo May, alors que le problème moderne de la thérapie est de mieux « rendre justice à la richesse et à l’étendue de l’expérience humaine »22. Porté par ses intuitions subtiles de non-directivité, Rogers devait être attiré par la proclamation existentialiste de la liberté, malgré le poids des conformismes et des déterminismes. « La méthode existentielle, assure Rollo May, remet à la place d’honneur la décision et la volonté. Non dans le sens du “libre arbitre contre le déterminisme” ; car cette solution est morte et enterrée. Il ne s’agit pas non plus de nier ce que Freud décrit comme l’expérience de l’inconscient, ces facteurs ont une action certaine et les existentialistes qui insistent beaucoup sur le “fini” et les limites de l’homme en savent certainement quelque chose. Ils soutiennent cependant, que dans le processus de révélation et d’exploration des forces déterministes de sa vie, le patient s’oriente d’une certaine manière par rapport aux faits et se trouve ainsi engagé à faire un choix, si insignifiant soit-il, à faire l’expérience de la liberté, si fragile soit-elle. L’attitude existentielle en psychothérapie ne “pousse” pas le malade à se décider mais, par cette mise en valeur de ses pouvoirs de volonté et de décision, elle lui évite d’être engagé par le thérapeute, doucement et par inadvertance, dans une direction plutôt que dans une autre. Le fait important est que la conscience de soi, la conscience qu’a la personne que le vaste flot d’expériences, complexe et mouvant, est son expérience — apporte immanquablement au moment voulu l’élément de décision.23 » Rogers en convient à son tour. Si le thérapeute est « franchement naturel » et rencontre le malade comme une personne, celui-ci se voit « confirmé (pour employer l’expression de Buber) non seulement dans son être mais aussi dans ses potentialités. Il peut se manifester, craintivement bien sûr, comme un individu indépendant et irremplaçable. Il peut bâtir son propre avenir à travers la succession des prises de conscience. Cela signifie qu’étant plus ouvert à l’expérience il peut se permettre de vivre symboliquement en tenant compte de tous les possibles. Il peut de son plein gré vivre en lui-même et ressentir, dans ses pensées et dans ses sentiments, les forces créatrices qu’il possède, les tendances destructrices qu’il se découvre, les risques de croissance et le défi de la mort. Il peut juger, en conscience, ce que être signifie pour lui et ce que signifiera pour lui ne pas être. Il devient une personne humaine autonome, capable d’être ce qu’il est et de choisir son chemin »24. Il y a comme une sorte de procédure de vaccination dans le processus thérapeutique ainsi décrit : dans le fait de s’habituer à soi et de se fortifier dans le lieu profond et atténué de l’entretien, grâce à des choix (si « insignifiants » soient-ils), et selon une exploration « symbolique » de tous les possibles, pour s’accoutumer à toutes les toxines potentielles, en développant progressivement des anticorps d’équilibre.
Activités durant les années de Madison
En 1960, Rogers dirige, pour de jeunes thérapeutes, un séminaire de dix jours, qui eut un grand succès à l’université de Denver. Retiré à la suite de ce séminaire près d’Estes Park, dans une vieille maison de bois, il assemble les matériaux de son ouvrage célèbre Le développement de la personne, à partir de différents articles et études qu’il sélectionne, réécrit et préface. Le livre paraîtra en 1961, cependant que Carl fait durant l’été une tournée triomphale au Japon : cinq séminaires d’une semaine (sur sept semaines de séjour), à l’invitation même des Japonais, comble d’honneur pour un Américain. On notera que la totalité de son œuvre a été traduite et publiée en japonais, représentant seize volumes depuis lors. C’est que l’influence rogérienne s’est notablement étendue en ce pays où la pensée de Dewey avait été répandue entre 1913 et 1926, durant l’ère Taisho. Le rapport à l’Unesco de M. Misumi, en 1972, note : « Au japon, le counseling non directif, ou psychothérapie centrée sur le client, forme le noyau des conceptions de conseil et de thérapie. Quand on dit counseling, il est presque exact de dire que cela signifie psychothérapie centrée sur le client. Une étude d’Oki jette quelque lumière sur la vérité de cette assertion. L’étude montre que 80 % du personnel travaillant dans les offices de counseling des universités et des autres institutions éducationnelles pratiquent une approche de “psychothérapie non directive” et approximativement 45 % de ceux qui travaillent dans les hôpitaux et les centres de guidance infantile agissent (opèrent) selon cette orientation »25. Un questionnaire rempli par cent quatre-vingt-huit thérapeutes cliniciens, en 1963, fait par exemple ressortir 44,70 % de formes de thérapie rogérienne, contre 20 % de formes directives, 7 % de formes psychanalytiques et 5 % de psychodrame, notamment. Le succès de l’approche rogérienne au Japon tient vraisemblablement au côté « oriental » qu’on observe souvent en elle et que Rogers trouva sans doute jadis dans son séjour en Chine. Un an après avoir accompli ce retour vers l’Orient, Rogers passe l’année 1962-1963 comme collègue (fellow) à Stanford, au centre pour les études avancées dans les sciences du comportement. Il y fait la rencontre stimulante de deux anglais, Michaël Polanyi, physicien devenu philosophe des sciences, et Lancelot Whyte, historien des idées (un livre important sur L’homme et la science de l’homme sortira plus tard d’un symposium tenu avec eux en 1966). « Je subis une autre influence importante, note Rogers, en rencontrant Erik Erikson (un homme admirable dont le simple aspect est thérapeutique), ainsi que plusieurs autres psychanalystes, étrangers ou américains. J’appris d’eux, ce que j’avais au fond soupçonné, à savoir que la psychanalyse en tant qu’école de pensée était morte, mais que par fidélité et autres motifs, personne, à part des analystes très courageux, ne mentionnait ce fait, tout en développant des théories et des directions de travail très éloignées, voire entièrement opposées aux théories freudiennes »26.
L’approche thérapeutique des schizophrènes
Rogers s’était donc orienté, dans
son activité de thérapeute, vers les cas difficiles : il fut amené à
une liberté plus grande et à une gamme plus étendue dans ses démarches
auprès des clients. Il fallait bien avoir recours, devant des individus
très perturbés, et souvent de niveau socioéconomique et culturel très
faible, « à des ressources autres que les verbalisations des patients
si on voulait établir des relations significatives (meaningful) »27.
Dans une telle situation, « le thérapeute pourrait au moins partager, en
tâtant le terrain (tentatively) et sans peser (without
imposing), son flux vivant de sentiments (his own ongoing flow of
feeling) sa propre considération du patient, son espoir pour
l’établissement d’une relation, ses façons d’imaginer (his imaginings)
ce qui est en train de se passer dans le patient en ce moment. Cette
nouvelle façon d’être avec le client ou le patient requiert de la part
du thérapeute une conscience plus profonde du flux changeant de sa
propre expérience (experien- Pour préciser ces indications, Rogers transcrit l’extrait d’un « entretien » avec un schizophrène muet (inarticulate) M. Vac, hospitalisé et passablement déprimé : Le thérapeute : « Et je suppose que votre silence me dit, soit que vous ne voulez pas, soit que vous ne pouvez pas débuter (come out) maintenant, et c’est bien (okay). Aussi je ne voudrais pas vous importuner mais je vous demande seulement de savoir que je suis ici ». Un très long silence de dix-sept minutes. Le thérapeute : « Je vois que je vais avoir à m’arrêter dans quelques minutes ». Un bref silence. Le thérapeute : « Il est difficile pour moi de savoir comment vous vous êtes ressenti, mais il me semble que pour une part du temps peut-être vous en aviez assez que je ne sache pas comment vous vous sentiez. N’importe comment, il me semble qu’une part du temps il est ressenti comme très bon de laisser aller (let down) et de… relâcher la tension. Mais comme je le disais, je ne sais pas réellement ce que vous ressentez. C’est seulement la voie de ce qui m’apparaît. Est-ce que les choses ont été assez mauvaises récemment ? » Un bref silence. Le thérapeute : « Peut-être ce matin vous désirez justement que je la ferme et peut-être que je devrais, mais je persiste à penser que j’aurais mieux à faire, je ne sais pas, pour être en contact avec vous par quelque manière ». Silence de deux minutes. M. Vac bâille. Le thérapeute : « Cela sonne comme découragé ou fatigué ». Un silence de quarante secondes. Le client : « Non, seulement pouilleux » (lousy). Le thérapeute : « Chaque être est pouilleux, hein ? Vous vous sentez pouilleux ? » Silence de quarante secondes. Le thérapeute : « Voulez-vous venir vendredi midi, à l’heure habituelle ? » Le client : bâillements et murmures inintelligibles. Silence de quarante-huit secondes. Le thérapeute : « Seulement quelque chose de senti profondément est tombé dans ces sentiments de pouilleux. Pouilleux, hein ? C’est quelque chose comme ça ? » Le client : « Non ». Le thérapeute : « Non ? » Silence de vingt secondes. Le client : « Non. Je ne serais (ain’t) d’aucun bien pour personne, il n’y en a jamais eu, il n’y en aura jamais ». Le thérapeute : « Vous sentez cela maintenant, hein ? Que vous êtes juste rien de bien pour vous, rien de bien à quiconque, seulement que vous êtes complètement sans valeur, hein ?… C’est cela réellement des sentiments de pouillerie. Sentir seulement que vous n’êtes rien de bien du tout, hein ? » Le client : « Et oui (yeah). C’est ce que m’a dit l’autre jour ce type avec lequel je suis venu en ville ». Le thérapeute : « Ce type avec lequel vous êtes venu en ville vous a réellement dit que vous n’étiez bon à rien (no good). Est-ce cela que vous êtes en train de dire ? Est-ce que j’entends correctement ? » Le client : « Euh, hum ». Le thérapeute : « Je devine que la signification de cela, si je comprends bien, est qu’il y a quelqu’un qui signifie quelque chose pour vous et par ce qu’il pense de vous ? Mais il vous a dit qu’il pense qu’il n’y a rien de bon du tout en vous. Et cela réellement renverse les étais qui vous soutiennent (Vac pleure doucement). Cela fait justement venir les larmes ». Silence de vingt secondes. Le client : « Cela m’est égal » (I don’t care through). Le thérapeute : « Vous nous dites que cela vous est égal, mais cependant je présume qu’une part de vous s’en soucie, car une part de vous pleure à ce sujet »29. Sur cet extrait, Rogers observe que les réponses sont clairement « centrées sur le client » dans le respect pour la personne du client, mais que les catégories ne sont plus celles de la première période où les thérapeutes s’expliquaient selon une technique standardisée.
Les recherches à l’université de Wisconsin
Dans cette direction complexe, à l’université de Wisconsin, travail et recherches furent loin d’être aussi satisfaisants que les autres activités. « Professionnellement, constate Rogers, il y eut des hauts et des bas. C’était la première fois au cours de ma carrière que j’essayais d’être simplement un membre du personnel enseignant et non le chef d’une équipe. Je ne réussis pas trop bien à plus d’un point de vue »30. Rogers, dégagé de la position de leader qu’on lui avait reproché de conserver, s’adapta mal au type de négociations universitaires entre pairs et supporta de moins en moins le système tatillon et élitique des examens, surtout en psychologie où seulement un étudiant de troisième cycle sur sept parvenait au doctorat. Il réussit mieux, paradoxalement, du côté de la psychiatrie, malgré le niveau des internes en psychiatrie, qu’il trouva très faible à son arrivée mais qu’il parvint à améliorer notablement, développant le goût de la recherche où il s’engageait lui-même à fond. Il mit, en effet, rapidement sur pied (sans doute trop rapidement comme il le reconnaît) une équipe qui finit par regrouper, autour de douze thérapeutes (dont lui-même), d’orientations différentes, plus de deux cents chercheurs, pour une étude relative à l’impact de la relation thérapeutique sur les malades schizophrènes hospitalisés et relativement chroniques. Cette fois Rogers abordait les cas les plus difficiles, affrontant ses détracteurs, et tentant de montrer l’universalité de sa démarche clinique. Le projet de recherche fut construit avec la coopération des médecins et des administrateurs de l’hôpital d’Etat de Mendota. Il intéressa de nombreux psychologues, des spécialistes, des secrétaires, mais également des étudiants appelés à effectuer des choix et des tris statistiquement traités. Il fallut de nombreuses et difficiles réunions de coordination et de régulation. Mais dispersé entre trop d’activités, Rogers ne consacra, pense-t-il « ni assez d’énergie, ni assez de temps »31 pour développer les conditions d’autonomie de son équipe. Il y eut des flottements, des incidents, des malhonnêtetés même, notamment pendant qu’il séjournait à Stanford. A son retour, Rogers eut du mal à maîtriser la situation et jugea que cette période fut sans doute la plus douloureuse et la plus angoissante de toute sa vie professionnelle. Une grande partie du travail de recherche dut être refaite complètement. « C’est le moment effrayant où beaucoup de données classées disparurent. C’est la décision de recréer ces données par une nouvelle évaluation, avec des instruments de mesure améliorés, de tous les segments d’entretien établissant ainsi une nouvelle base de recherche sur laquelle nos analyses et nos découvertes pourraient être plus solidement bâties »32. A bout de bras, l’œuvre fut cependant publiée en 1967, sous le titre The Therapeutic Relationship and its Impact, a Study of Psychotherapy with Schizophrenics (« La relation thérapeutique et son impact, une étude de la thérapie des schizophrènes »). C’est un livre « monumental », comme le projet de recherche qu’il a lui-même décrit, comportant, après vingt pages d’introduction, six cent vingt-cinq pages denses d’études approfondies, utilisant les ressources de l’informatique. Mais Rogers tirerait entre-temps les conséquences de la situation. Revenu à l’université du Wisconsin au printemps 1963, il se dégagea d’abord du département de psychologie. Tout en demeurant au département de psychiatrie, il obtenait du président de l’université l’autorisation de diriger un séminaire interdépartement, ouvert à la fois aux enseignants et aux étudiants. Ce séminaire sur « la philosophie des sciences humaines » eut une grande vogue, Rogers ne put répondre qu’à la moitié des demandes. Sur ce succès, en fin de l’année 1963, il lui parut possible et souhaitable de répondre à une invitation pressante et renouvelée qui lui était formulée par Richard Farson, au nom d’une association fondée avec son appui dès 1959, le Western Behavioral Sciences Institute (Institut de l’ouest pour les sciences du comportement). Quoi qu’il lui en coûtât de partir de Madison, abandonnant un environnement « délicieux », il décide, en accord avec Helen, de quitter le monde universitaire, se libérant enfin, selon sa propre logique, des contingences bureaucratiques, des cloisonnements et de « la jungle anti-éducative du contrôle des connaissances, des programmes, des examens et des diplômes accordés à contrecœur »33. Il s’estimait quitte également à l’égard du monde des hôpitaux psychiatriques. Ainsi, moins de six ans et demi après le retour à Madison, Carl partait avec Helen pour la côte orientale, se retrouvant dans la condition de « nomade professionnel » qui fut toujours la sienne, comme il l’observe.
Chapitre VII
Groupes et humanisme
La Jolla
Depuis janvier 1964, les Rogers se sont installés à la Jolla, en Californie. Cette fois ce ne sont plus les flots fermés d’un lac, mais ceux de l’océan qu’ils aiment à voir de leurs fenêtres, se ressentant devant leur miroir, dit Helen1, « comme une part très réelle du processus de devenir », pour une méditation d’orientation plus positive que celle du Cimetière marin de Paul Valéry. Après quatre années de compagnonnage direct au wbsi, Carl fonde, en 1968, à la même adresse, avec quelques-uns de ses collègues, un centre distinct pour les études de la personne, le csp (Center for Studies of the Person). Libéré des raideurs universitaires, il se tourne dorénavant vers des problèmes institutionnels et éducatifs, s’adonnant à la pratique de groupes « intensifs » entreprise dès avant 1946 et enfin à l’action auprès des individus « normaux ». Il abandonnait, en effet, la pratique de la thérapie individuelle en arrivant à La Jolla. « La raison en est que je ne peux plus me soumettre à l’horaire régulier que la thérapie individuelle demande ; une seconde raison est que je trouve une satisfaction de nature très semblable dans le travail avec des groupes et ceux-ci peuvent être programmés (scheduled) dans des blocs de temps intenses. Je ne conduis pas de nombreux groupes durant l’année, je suppose seulement de six à dix, étant plus souvent impliqué brièvement dans des groupes conduits par d’autres »2. Rogers se détendait des contraintes qu’il s’était imposées en s’insérant dans les structures traditionnelles. Il se trouvait d’autre part avec Helen dans une ambiance effervescente où de nombreuses écoles nouvelles se manifestaient et foisonnaient (la Gestalt Therapy avec Perls, la bioénergétique sous différentes formes, mais aussi la pensée marcusienne et tant d’autres). « Nos espoirs les plus fous se trouvèrent dépassés », écrit-il, ajoutant : « Je m’étais toujours arrangé, à peu de chose près, pour en faire à ma tête. Mais je découvris soudain à quel point en faire à sa tête, en rencontrant scepticisme et opposition, diffère d’une initiative prise dans une atmosphère d’encouragement et de stimulation interdisciplinaire fraternelle. Je me sentais plus inventif, plus productif que jamais »3.
Le groupe intensif
En 1946 et 1947, à l’université de Chicago, Rogers et ses associés au centre de counseling avaient pratiqué, à la demande de l’administration des anciens combattants, un entraînement de groupe pour des consultants. Ceux-ci avaient à s’occuper de la réinsertion dans la vie active de gi’s rapatriés : on les fit se rencontrer et s’exercer à la communication en profondeur, à la connaissance de leurs attitudes et de leurs procédures, dans le cadre d’expériences de groupe intensif. Cette tentative parut si probante que l’équipe du centre continua à organiser des séminaires d’été de ce type. Des contacts avec les groupes organisés à Bethel, sous l’inspiration des successeurs de Lewin, permirent d’accroître le champ des objectifs et des méthodes applicables à des processus de groupe, notamment au moment de l’installation à La Jolla. Rogers, cependant, ne se rendit jamais à Bethel : « Je crois que c’est autour de 1963-1965 que je rencontrai Warren Bennis, Lee Bradford et un certain nombre d’autres gens remarquables du ntl. Je pense que j’aurais à dire que le seul qui ait été pour moi intellectuellement et personnellement important fut Warren Bennis, quoique j’aime et respecte nombre des autres leaders des ntl »4. Cependant Rogers distingue le « T. group » (training-group ou groupe de diagnostic) façonné à Bethel, du Basic Encounter Group (ou groupe de rencontre de base) qu’il adopte plus habituellement. Dans le premier, l’accent est mis souvent soit sur l’acquisition d’habiletés ou d’aptitudes en relations humaines, soit plus profondément sur une exploration de phénomènes collectifs et structures de groupe, alors que dans le groupe de rencontre l’accent est placé sur le développement personnel et l’épreuve de relations interpersonnelles à travers un processus expérientiel dans une micro-institution. Rogers pour sa part note aussi, outre les deux formes précédentes, la grande variété des formes de groupe : groupe de sensibilisation (ou Sensivity Training Group), groupe à tâche, groupe de conscientisation sensorielle ou corporelle, atelier de créativité, groupe de développement organisationnel, groupe centré sur la formation d’équipe, groupe de Gestalt Therapy, groupe de traitement de toxicomanes ou « synanon ». Comment se situent les caractères
particuliers du groupe de rencontre de base (Basic Encounter Group)
ou plus simplement groupe de rencontre ? Tout d’abord au niveau des
interventions de l’animateur, appelé préférentiellement le « facili- L’espoir de Rogers est de devenir autant un participant du groupe que son facilitateur, jouant consciemment ces deux rôles. « J’essaie de progresser au-dedans de moi, et dans les groupes où je sers de facilitateur, en donnant à la personne entière, avec ses idées et ses sentiments — sentiments imprégnés d’idées et idées imprégnées de sentiments — la faculté d’être totalement présente »5. Rogers tend à commencer les groupes de rencontre d’une façon extrêmement peu structurée, par de simples observations du genre : « Je fais l’hypothèse (I suspect) que nous nous connaîtrons beaucoup mieux à la fin du séminaire que maintenant »6. Il écoute avec soin toute personne qui s’exprime, surtout sur la signification immédiate de ce qu’elle dit et à quoi il essaie de répondre : il tente de rendre la situation sauve (secure) pour chacun, au moins par la qualité de l’écoute qu’il lui prête, à quelque niveau (intellectuel, superficiel, émotionnel, interpersonnel, etc.) que se placent la personne ou le groupe. Le critère opératoire est, pour Rogers, de vivre avec le groupe exactement là où il est, et non pas de moraliser sur sa situation, en dénonçant les « fuites » des membres ou leur échec de communication. Ce qui ne l’empêche pas, s’il le ressent profondément, d’expliciter tranquillement un sentiment d’ennui pour une conversation qui demeurerait indéfiniment superficielle. Il répond davantage « aux sentiments présents qu’aux déclarations sur les expériences passées »7, sans exiger cependant une règle de communication stricte sur l’ici et maintenant. Il se dispose à une présence
maîtrisée d’écoute paradoxale ou dialectique : d’une part cette écoute
est spontanée, néanmoins elle est maîtrisée, et cependant elle reste
sans contrôle sur ce qui arrive. Il s’efforce de réexprimer ce qui est
le plus significatif dans ce qu’une personne dit, s’il est besoin de
clarifier, ou de répondre à ce qui est le plus personnellement
signifiant. Il lui importe d’aider les individus à se dégager du langage
de conformisme ou de ce que j’appelle pour ma part l’« onfor- Il n’encourage donc pas des niveaux d’épaisseur groupale dans les relations qui s’instituent, mais il met l’accent sur le vécu des individus dans leurs rapports interpersonnels et émotionnels ou sentimentaux. Il se garde explicitement de requérir un « onzième commandement »8 qui obligerait à exprimer toujours les sentiments qu’on éprouve. Il ne se construit pas d’autre part pour lui-même un commandement qui interdirait au facilitateur d’exprimer, qu’ils soient positifs ou négatifs, ses propres sentiments profonds (une loi rigide d’« abstinence », telle qu’elle existe pour nombre de psychanalystes, et qui reprend curieusement un concept religieux). Il ressent, en effet, l’importance d’une discrétion professionnelle nécessaire au facilitateur (qui doit traiter ses problèmes propres dans des séances de régulation ou de thérapie) mais à condition que cette conduite habituelle ne soit pas abusivement défensive : parfois, en effet, il y a opportunité à l’expression d’un problème propre au facilitateur pour l’approfondissement de la vie d’un groupe9. Par contre, Rogers se garde, comme à son habitude, des jugements et des commentaires interprétatifs sur les individus. Même sur le processus suivi par le groupe, il ne fait de commentaire qu’exceptionnellement (very sparingly, littéralement de façon très frugale, avec beaucoup de parcimonie10). En revanche, Rogers se rapproche, sans excès, des tendances modernes dans les groupes en Amérique et en France : où le non-verbal, les mouvements et le contact physique (loin d’être interdits au nom d’une loi proscrivant l’acting-out, le passage à l’acte) sont encouragés pour leur valeur de signification et de spontanéité. Il se trouve intéressé à ces modes d’expression par l’exemple même de sa propre fille, Nathalie Fuchs et d’une de ses petites filles, Anne Rogers, étudiante. Au cours d’une conversation entre eux, Nathalie remarque : « Je pense que notre culture a un retard terrible (hang up) sous le rapport du contact physique. On lui donne seulement la signification sexuelle — qu’elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Nous nous privons de beaucoup de chaleur et d’un grand soutien en interprétant le contact physique de cette manière »11. Rogers est sensible à cette voie de libération affective qui écarte les restrictions puritaines, si apparentes dans la froideur anglo-saxonne, comme il a toujours lutté contre les dogmatismes religieux, scientistes, psychologisants ou psychanalytiques. Voilà donc les caractéristiques du travail au sein des groupes auquel s’adonne désormais de façon préférentielle Rogers. Il reconnaît qu’on peut travailler autrement. Il se défie profondément, pour sa part, d’une exploitation de la mode que représente le groupe et des manipulations qu’effectuent certains animateurs notamment : en édictant des règles, en cachant leurs objectifs réels, en évaluant la qualité du travail par la dramatisation obtenue, en se donnant trop d’importance dans leurs rôles ou leur prétendue qualification, en attaquant des défenses des participants à coups d’interprétations sur leurs comportements, en obligeant à des exercices introduits sans discussion, en se faisant le centre émotionnel du groupe, ou se maintenant sur une distanciation affective à l’écart du groupe12. Rogers devait appliquer ses vues dans des séminaires de groupes de rencontre, en Australie (du 24 janvier ou 5 février). Il séjourna deux mois dans ce pays, donnant de nombreuses conférences dans diverses universités et visitant les régions.
Le dialogue avec Tillich
Peu après son retour d’Australie et un an après son installation au wbsi, ce fut semble-t-il pour Rogers, un événement signifiant que son dialogue enregistré avec le théologien Paul Tillich. Robert Lee, l’un des producteurs de l’émission, déclare : « Le 7 mai 1965, deux des plus importants personnages de notre temps sont apparus devant les caméras de la radio-télévision au San Diego State College. Le résultat de la rencontre a été une conversation de qualité rare et vitale ». Paul Tillich était alors âgé de soixante-dix-neuf ans et il devait mourir quelques mois plus tard. Né en Russie, il avait longtemps vécu et enseigné en Allemagne, à Dresde : il y avait rencontré le mouvement psychanalytique en pleine croissance. En 1933, il avait été chassé par les nazis et il s’était installé aux Etats-Unis à partir de 1940. Il avait continué à enseigner et à publier des œuvres, ce qui l’avait placé au premier rang des penseurs chrétiens modernes. On lui doit notamment une monumentale Théologie systématique qui continue à exercer une influence profonde. Paul Tillich a essayé de redéfinir le christianisme dans les termes de ses liens au monde et de sa signification pour la culture occidentale du xxe siècle. Au cours de leur rencontre, Rogers essaya de dégager leurs points d’accord, notamment sur « l’importance de l’affirmation de soi (self affirmation), sur le “courage d’être”, et par suite sur la critique de l’“approche” ultra-scientifique », positiviste, dans les sciences de l’homme. Tillich convint avec Rogers que, de façon définitive, l’homme a une nature essentielle, reprenant des propos qui lui importaient. Cependant à l’affirmation optimiste de Rogers : « Si je peux créer un climat d’extrême (utmost) liberté pour l’autre individu, je peux réellement avoir confiance dans les directions où il s’engagera »13, il oppose une première objection : « Qui est suffisamment libre pour créer une telle situation de liberté pour les autres »14, étant donné le mélange de la nature essentielle de l’homme et de sa nature tant altérée (estranged) qu’ambiguë ? Rogers répond à cette objection par une proposition de non perfectionnisme : il n’est pas indispensable de créer une complète liberté car « même des tentatives imparfaites pour créer un climat de liberté, d’acceptation et de compréhension semblent libérer une personne au point qu’elle puisse se mouvoir vers des buts réellement sociaux »15. Mais Tillich évoque l’aspect « démonique » de l’existence humaine, c’est-à-dire ses tendances ambiguës et créatrices mais en définitive destructrices. Celles-ci l’emportent sur le bon vouloir des individus, comme Freud ou Marx l’ont mis en lumière (et les termes d’humanité déchue ou pécheresse ne sont pas suffisants pour rendre compte de ces faits). Rogers tente alors d’expliquer les structures démoniques par l’altération (estrangement) que l’enfant subit de la part des conduites éducationnelles répressives et qui vont au rebours des sentiments de satisfaction réellement perçus par lui. Tillich revient sur le problème de l’enfant, qu’il interprète en termes d’état mythologique « d’Adam et d’Eve avant la chute », en innocence rêvante (dreaming innocence) : « Pour moi, le lent processus de transition de l’innocence rêvante à l’actualisation de soi (self-actualization) d’un côté et à l’altération de soi (self-estrangement) de l’autre… sont deux actes entremêlés de façon ambiguë »16. Cette réflexion amène Rogers à préciser que, pour lui, « la personne peut seulement accepter l’inacceptable en elle qu’autant qu’elle est dans une étroite relation au sein de laquelle elle fait une expérience d’acceptation (acceptance) »17. Sur ce point Tillich est d’accord : « Je crois que vous êtes absolument dans le vrai en disant que l’expérience d’homme à homme, de pardon (forgiveness) ou mieux d’acceptation de l’inacceptable, est une pré-condition tout à fait nécessaire à l’affirmation de soi »18. Mais il ajoute (par-delà les modalités de confession et d’aveu ou d’élucidation en entretien thérapeutique) que l’acceptation est une médiation, un « médium », à travers quoi on accède à une « dimension de l’ultime ». Celle-ci interpelle l’individu au-delà des jugements et des moralisations, et elle est le centre de ce qu’on appelle « la bonne nouvelle » dans le message chrétien. Ces remarques sur « l’ultime signification de la vie », induisent Rogers à expliciter nettement sa position : « Je réalise parfaitement que moi et beaucoup d’autres thérapeutes, sommes intéressés dans le genre de perspectives (issues) qui impliquent (involve) le travailleur religieux et le théologien et cependant, pour moi-même, je préfère mettre ma réflexion (thinking) sur ces perspectives en termes humanistes, ou attaquer ces perspectives à travers les cheminements de l’investigation scientifique. J’avoue que j’ai une réelle sympathie pour le point de vue moderne qui est en quelque sorte symbolisé dans la proposition que “Dieu est mort” ; c’est-à-dire que la religion n’a plus du tout à parler aux gens (no longer does speak to people) dans le monde moderne »19. Et Rogers interroge Tillich sur son besoin d’exprimer encore sa pensée en termes religieux et suivant un langage théologique. Tillich oppose alors, à une dimension horizontale de la vie, une « ligne verticale » vers quelque chose qui n’est ni transitoire ni fini, mais inconditionnel et ultime, non pas au-delà de la mort, mais dans l’expérience immédiate du temporel, « de l’éternel dans le temporel »20. Cette dimension ne peut être exprimée que par les symboles des grandes traditions religieuses, qui ont besoin de traduction et d’interprétation, mais non pas de remplacement. Carl Rogers imagine la dimension verticale évoquée par Tillich non pas comme montante mais comme descendante (going down). Et il explique qu’à certains moments de dialogue en profondeur, dans une relation Je-Tu, il se ressent comme en accord (tune) ou en ressourcement avec les forces de l’univers opérant comme au travers de lui ; il se voit, alors, ainsi qu’un scientifique expérimentant son pouvoir d’opérer la fission de l’atome (splitting). De son côté, Tillich s’associe à l’image de la ligne verticale descendante (aussi bien que montante), et il évoque sa tendance personnelle à traiter du « sol de l’être » (ground of being), telle qu’elle peut être rencontrée dans toute expérience créative. En toute rencontre de personne à personne, « il y a quelque chose de présent qui transcende la réalité limitée du Toi et de l’Ego de l’autre et de moi, et je l’ai parfois appelé à des moments spéciaux la présence du sacré, dans une conversation non religieuse »21. Ce qui lui permet de rappeler, à ce propos et à celui des scientifiques, le principe de Thomas d’Aquin : « Si vous connaissez quelque chose, alors vous connaissez quelque chose au sujet de Dieu ». Rogers détourne de suite la conversation vers le thème de la « personnalité optimale » (comme visée d’un effort, en thérapie ou dans le domaine religieux). Elle se situe pour lui dans une possibilité d’attention à ce qui se passe en soi-même et dans la relation à l’autre. « Je sens que je suis tout à fait satisfait (pleased) dans mon travail de thérapeute si je constate que mon client et moi aussi, sommes en mouvement vers ce que je pense être comme une plus grande ouverture à l’expérience. »22 A cela Tillich opine que la notion d’« ouverture » lui est familière : les symboles religieux « ouvrent » quelque chose en nous ; plus encore, on doit se maintenir ouvert à l’expérience de l’Esprit ; et, à supposer que dans la terminologie des psychologues on considère que cette expérience est particulière, il reste, cependant, que « nous devons nous garder ouverts à toutes expériences »23, et à la possibilité pour elles d’une « ultime expérience ». Devenir social n’est à ses yeux qu’une partie d’un concept plus large, celui d’agapè, c’est-à-dire d’amour qui vise à maintenir « la foi dans une signification ultime de la vie ». Etre référé à l’ultime est au cœur de la foi et de l’amour, à soi et aux autres, c’est-à-dire de l’affirmation de soi et de l’acceptation de soi, « une des choses les plus difficiles à atteindre »24. Retrouvant des accents de Dewey, Rogers remarque que « l’individu qui est ouvert à son expérience établit une valorisation continue de chaque moment et de la conduite à chaque moment, en sorte (as to whether) d’être référé à son propre accomplissement, à sa personnelle actualisation »25. Cette façon de situer le problème de la valorisation en forme de processus et non de catégories sied également à Tillich qui resitue cette valorisation dans l’agapè. Rogers, quant à lui, se retourne vers une précaution d’écoute et vers l’exemple du jeune enfant, non perturbé encore par des concepts et des standards construits par les adultes. On ne peut s’empêcher, en lisant attentivement les termes de ce dialogue, de ressentir l’impression d’une suite d’interrogations auxquelles Rogers refuse un retentissement direct et un aboutissement, contrairement à son habitude. La perspective religieuse ne le met pas à son aise26.
L’homme et la science de l’homme
La perspective scientifique lui sied mieux. Avec quelques collègues du wbsi, Rogers s’était proposé d’étudier fermement la philosophie des sciences du comportement, et notamment les modèles de science auxquels elles se réfèrent, et ceux qui seraient à prévoir pour l’avenir. Il avait toujours été préoccupé par la démarche scientifique et sa consistance particulière pour une approche de l’homme. Dès 1955, il publiait un article sur « Personnes ou science : une question philosophique « (repris ensuite dans Le développement de la personne). Et en 1959, il notait face aux tendances expérimentales, dans un texte qui fut publié en français, sa conviction que « le point de départ de l’espèce particulière de compréhension qui s’indique du nom de science peut se situer n’importe où et à n’importe quel niveau de complexité. Ce qui importe par rapport à la connaissance scientifique, c’est la pénétration de l’observation et le caractère discipliné, créateur, de réflexion — non l’usage d’instruments et de laboratoire »27. S’opposant au dogmatique des théorisations en alertant sur leur tendance à l’éparpillement ou à leurs extrapolations indues, il explicitait aussi sa conviction d’une vérité « une » mais imparfaitement connue, en sorte qu’une théorie déterminée pourrait « fournir une explication de domaines de plus en plus éloignés de sa source »28. Et il citait un poème de Tennyson, se déclarant comme lui convaincu « de ce que la pleine compréhension d’une simple plante révélerait “la nature de l’homme et de Dieu” »29. La chance d’une présence en Californie de divers savants, philosophes et chercheurs, permit en 1966 une rencontre de grande ampleur. A celle-ci participèrent des personnalités du Salt Institute for Biological Sciences (notamment Jacob Bronowski et Jonas Salk), des professeurs de la nouvelle université à San Diego, mais aussi Yehoshua Bar-Hillel, philosophe de l’université hébraïque de Jérusalem qui se montrera un ardent débatteur, et enfin Michael Polanyi que Rogers avait déjà rencontré en 1963. Polanyi était professeur emeritus à l’université de Manchester et au collège Morton, à Oxford. Initialement, il avait fait carrière en médecine et en chimie avant de devenir, en 1948, professeur d’études sociales. Il avait publié des ouvrages, tels que The Logic of Liberty, The Study of Man (et une étude devenue un classique, Personnal Knowledge (le savoir personnel). Il avait indiqué que sa préoccupation professionnelle la plus forte était « d’établir des fondements meilleurs que ceux dont nous disposons actuellement pour assurer les croyances sur lesquelles nous vivons et devrons vivre, même en étant incapable de les justifier adéquatement aujourd’hui »30. Sa pensée rencontre celle de Teilhard de Chardin qu’il cite, et que Rogers découvrit aussi dans une œuvre de l’auteur du Phénomène humain31. Parmi les autres protagonistes, Jacob Bronowski s’était distingué comme mathématicien, il était bien connu d’autre part pour des travaux sur l’histoire de l’intelligence et la philosophie de la science et notamment par des ouvrages aux titres significatifs : Science and Human Values (Science et valeurs humaines) et The Identity of Man. De son côté, William Coulson était un des directeurs du wbsi, docteur en philosophie (à l’université Notre-Dame) et en psychologie (à l’université de Berkeley). Rogers et Polanyi, en précurseurs des évolutions scientifiques de la fin du siècle, se rencontrèrent sur la nécessité de développer des méthodologies scientifiques qui n’évacuent pas la personne réelle dans l’être humain considéré (par exemple un enfant délinquant), et qui ne traduisent pas en termes de fatalité mécanique des hypothèses d’évolution dans les comportements. Polanyi évoque l’origine de la révolte hongroise de 1956 : les intellectuels communistes hongrois se rebellèrent contre le point de vue affirmant que les idées des individus ne seraient que des superstructures du processus économique et devraient par suite tomber sous le contrôle nécessaire du Parti ; ils ressentaient, au contraire, dans la recherche de la vérité, un pouvoir et une responsabilité intrinsèques et irréductibles. On sait ce qui advint après 1989 et les positions d’hommes tels que Soljetnitsyne, Vaclav Havel, ou Mandela. Mais une telle position n’est pas toujours vécue dans les milieux scientifiques qui, en Amérique comme ailleurs, induisent un déterminisme strict, mécaniste, inerte, face aux contestations de personnes. Le terme de « science » devrait être oublié pour une dizaine d’années, propose Polanyi (pour une cure de désintoxication) afin d’éviter de lui donner une acception réductrice et magique ; laquelle se fait au dépens de la créativité et corrompt la psychologie (behavioriste) ou la sociologie qui ne proposent plus de choix significatifs ou d’issues. Rogers énonce une « responsabilité éthique » qui s’impose aux psychologues et sociologues : il leur faut placer la connaissance selon des formes et des voies qui puissent s’insérer dans le champ réel des situations raciales, nationales et internationales et qui aident à traiter de façon compréhensible les tensions interpersonnelles et intergroupales. Cette position engagée retrouve les lignes de vue que Mounier avait établies en créant, il y a soixante ans, le « personnalisme »32. Rogers précise néanmoins que traiter les tensions n’est pas nécessairement se donner pour but de les réduire en toutes situations. Mais il convient avec Polanyi qu’un savant ne peut se désimpliquer, dans son travail, de ses jugements de valeurs, surtout s’il faut bâtir une nouvelle culture. Au cours des échanges avec les autres participants, un conflit se manifeste entre leur conception et une tendance défendue notamment par Bar Hillel. Pour celle-ci, relativement traditionnelle « le savant (scientist) ne parle pas de lui-même ou pour lui-même. Quand il parle, il n’exprime aucune opinion, aucune croyance ni aucune conviction. En tant que savant, il médiatise un savoir vrai provenant de la méthodologie de la science, laquelle prévoit l’erreur par elle-même. Ainsi, la science est autocorrective (self-correcting) et les questions de valeur (value issues) qui s’élèvent dans les sciences du comportement sont essentiellement des pseudo-problèmes »33. La science résoudrait les problèmes de valeurs dans son propre mouvement, de façon impersonnelle et presque automatique. Polanyi et Rogers défendent, au contraire, en précurseurs toujours, l’importance de la subjectivité dans la démarche scientifique qui se fonde aussi sur la « vérifi-cation interpersonnelle et intersubjective ». Des choix de direction et de valeurs sont à faire constamment et ils ne se présentent avec aucune évidence. Rogers avait précisé antérieurement, au cours d’une controverse avec Skinner, que, lorsque celui-ci « indique que la tâche des sciences du comportement est de rendre l’homme efficace, bien élevé, etc., il est évident qu’il faut un choix. Il aurait pu aussi bien choisir de le rendre soumis, dépendant, grégaire par exemple »34. De plus, « la science, loin d’être automatiquement en état d’autocorrection, est habituellement la plus grande source de l’erreur humaine, précisément parce qu’elle est aussi perçue comme la source de la certitude et de la vérité »35. Il n’est pas possible de fermer les yeux sur les grandes questions morales qui sont au centre de l’entreprise scientifique, pas plus que sur le fait que les chercheurs sont mus par un désir de vérité. On ne peut « rétrécir » la science au point d’ignorer l’importance des personnes et leur poids dans les démarches de recherche et d’investigation. C’est dans l’effervescence de ces échanges intellectuels, religieux et philosophiques que Rogers, ayant voyagé vers le Japon et l’Australie, se laisse séduire par l’idée d’un voyage en France et en Europe, pays de la controverse et des précisions « précieuses ».
Chapitre VIII
La rencontre de l’Europe en 1966
Il y eut un long échange de lettres dans l’année 1965, entre Max Pagès et Carl Rogers, avant que celui-ci ne se détermine à venir en Europe avec sa femme. Il pesait soigneusement les termes de sa venue, et discutait les formes de sa participation. Il arriva à Paris le 14 avril 1966. Dès son arrivée, il dirige d’abord, à Paris, des journées préparatoires à un séminaire de huit jours qui se tient à Dourdan, près de Paris, du 18 au 24 avril 1966, réunissant autour de lui et de Max Pagès une centaine de participants encadrés par neuf « moniteurs »1. Rogers, après une conférence à la Sorbonne, est ensuite trois jours au centre d’un colloque de quatre cents personnes, les 28, 29 et 30 avril. Il fait avec sa femme quelques journées de tourisme en France et tient en Belgique, en Hollande, des meetings qui lui furent réconfortants. Il en avait besoin car le travail en France fut difficile.
Préparations
Dans la préparation du séminaire, les « moniteurs » avec Max Pagès s’étaient ingéniés à répartir les échanges entre des réunions plénières autour de Rogers, des réunions de petits groupes autour de chaque moniteur, des projections de films et des activités de rencontre à l’initiative de participants (notamment de sous-groupes par catégories)2. Ils s’étaient avisés de tenir une conduite flexible dans les séances de petits groupes (plus que pour des T-group habituels), compte tenu de l’incertitude sur l’impact qu’auraient les séances plénières avec Carl Rogers. Ils s’étaient préoccupés, principalement des problèmes que devait soulever la relation triangulaire entre les participants, Rogers et eux-mêmes : par le jeu des transferts sur les uns et les autres, les moniteurs risquaient d’apparaître comme des « ersatz » de Rogers, des « écrans » (screens) entre lui et les participants ; des « complices » mais aussi des « rivaux » (des élèves qui veulent surpasser leur maître, des Européens réagissant à un Américain). Le fait que la principale figure d’autorité devait rester extérieure aux petits groupes, même si Max Pagès en faisait de même, allait créer un problème spécial : les moniteurs durent participer aux séances plénières et coopérer avec Rogers pour analyser les relations des participants à l’égard de leur « staff »3. Ils durent aussi faire attention à la solitude de Rogers parmi eux, accrue par le fait du recours permanent à la traduction, Rogers ignorant le français.
Le séminaire de Dourdan
Malgré ces alertes et en dépit de la préparation durant deux jours en petit groupe avec Rogers, les moniteurs allaient curieusement tenter de capter Rogers, de l’isoler des participants du séminaire ; ils refuseraient longtemps qu’il prenne à son gré ses repas avec ceux-ci ; ils se défendraient aussi (dans leur ensemble) de tenir leurs réunions de régulation avec Rogers et Pagès devant les participants, comme Rogers le demandait et comme jadis Lewin l’avait expérimenté positivement (à l’origine de la création du T-groupe)4. Continûment les moniteurs exercèrent des pressions multiples sur Rogers. Certains l’accusèrent même, devant lui ou dans les couloirs vis-à-vis de leurs propres participants de petits groupes, d’être « destructeur » (et même « paranoïaque », « vulnérable », etc.) : jusqu’au moment où les conflits dérivés sur lui se réverbérèrent en retour sur le staff et provoquèrent la fin des séances de régulation fermées et un débat plus ouvert devant tous les participants. Rogers devait résister, d’autre part, à la séduction de certains sous-groupes des participants (des psychiatres, notamment) qui cherchaient à se réunir de façon secrète avec lui pour discuter de la thérapie par exemple : il propose invariablement, en mesure de décloisonnement, l’ouverture des échanges à tous les participants. Les films sur la thérapie, tournés par un institut de recherche et qu’il avait apportés, donnèrent lieu à de nombreuses interrogations : le film sur lui-même et sa cliente d’un jour, Gloria, une jeune femme récemment divorcée, fut apprécié davantage que celui sur une séance de Gestalt Therapy de F. Perls avec la même Gloria, Perls apparaissant trop peu à son avantage physique dans les images. Un film de télévision sur une séance de groupe de rencontre donna lieu à de nombreuses querelles, tant il apparaissait que Rogers se déplaçait avec liberté et se centrait volontiers sur des catharsis émotionnelles chez les participants. Rogers, soutenu par sa femme, par quelques animateurs et par un nombre croissant de participants, devait sortir victorieux de cette épreuve très dure. Au cours de la dernière séance plénière (précédant l’ultime réunion des petits groupes), il fut question du combat de Jacob contre l’ange, Jacob blessé retrouvant davantage de force de ses blessures mêmes. Et ultérieurement, un participant du colloque où se retrouvèrent nombre de participants du séminaire, posa l’interrogation caractéristique : « En écoutant certains participants du séminaire de Dourdan, on avait l’impression qu’ils avaient participé à une mesure grandiose au cours de laquelle ils avaient vu le Christ. Ce n’est pas une question mais j’aimerais que vous puissiez donner votre impression ou votre explication »5.
Les évaluations sur Dourdan
Les évaluations sur ce séminaire ont été recueillies et analysées à la suite d’une proposition de questionnaire établi par Rogers lui-même en France à la mi-mai 19666, au cours d’un voyage à petites étapes vers le Midi. Ce questionnaire fut légèrement remanié par l’arip7, et envoyé tardivement (six mois plus tard). Il ressort d’une analyse d’une soixantaine de réponses au questionnaire (soixante-neuf reçues pour cent trois envoyées) quelques constatations. Tout d’abord l’hétérogénéité des témoignages, la « diversité des attitudes des participants devant la relation de leur expérience »8 frappent les personnes qui ont dépouillé les réponses. Ceux des dix-huit participants qui se montrent le moins impliqués indiquent « simplement » qu’ils ont « fait une belle expérience », « participé à une très intéressante démonstration ». On relève dans ce sous-groupe, des propos tels que : « Mon impression sur ce séminaire est d’avoir assisté à un conflit violent entre quelques membres du staff ». « Très grande satisfaction en constatant que la personnalité de Rogers était congruente avec ses écrits ». « Séminaire très important, où j’ai vu un homme réagir très librement et vivre une théorie qui est issue de toute sa vie ». Un deuxième sous-groupe de dix-huit personnes manifeste une implication moyenne, ayant trouvé « une occasion de comprendre, vivre, échanger, rencontrer ». Par exemple, un participant écrit : « Dourdan a été pour moi l’occasion de rencontres avec des personnes, avec des idées, avec moi-même ». Enfin vingt-cinq personnes présentent des références à un vécu profond. Par exemple l’une d’elles témoigne : « Le séminaire de Dourdan a été comme un tournant dans ma vie ; pour la première fois, alors que j’avais fait un certain nombre de groupes déjà, j’ai pu me situer librement »9. En ce qui concerne la caractérisation de l’expérience, dix-sept participants la décrivent comme instructive, enrichissante, signifiante. Quinze la reconnaissent comme un point culminant, un tournant dans leur vie. Huit signalent qu’elle a été une expérience riche, « extraordinaire » mais « difficilement communicable ». Pour cinq participants, cette expérience a été facilitatrice d’une évolution déjà amorcée ; pour cinq autres personnes elle a été une rencontre à un niveau exceptionnel ; et pour quatre elle va jusqu’à évoquer « des sentiments religieux ». Cependant, huit participants la décrivent comme une épreuve déroutante, irritante, douloureuse : mais « nous n’avons pas d’exemple où l’aspect déroutant, irritant, douloureux ne soit pas assorti de propos plus positifs » notent les commentateurs10. La rencontre avec Rogers a fait l’objet de nombreuses réactions et appréciations : sa personne apparaît plus importante que l’image qu’on s’en était faite (d’après ses écrits ou ceux qui lui sont consacrés) sauf pour « un participant isolé dont les propos sont par ailleurs désabusés »11. Les appréciations « ont en général un caractère positif voire dithyrambique. Quelques-uns font pourtant état d’une certaine irritation devant le comportement de Rogers, lui reprochant sa superficialité, son anti-intellectualisme »12. Le dépouillement des réponses fait apparaître un sentiment fréquent de nostalgie pour la grande richesse des moments vécus à Dourdan, nuancé de la part d’une dizaine de participants, par des attitudes critiques. Ainsi un participant assure : « Une compréhension systématiquement chaleureuse m’a paru une façon subtile de réduire l’autre, et de maintenir le groupe dans une attitude infantile13. Toutefois, je crois que ce rôle de maître a été créé bien plus par l’attente démesurée des disciples qui enfermaient Rogers dans ce rôle que par Rogers lui-même. Il me semble que Rogers devait avoir peur de rater son séminaire avec des Français, peur qui a dû s’amplifier au cours de ses contacts avec l’équipe de l’arip et que cette peur l’a poussé plus ou moins consciemment à “anschlusser” le grand groupe par-dessus l’arip… » Cette réflexion critique ne donne pas l’image de ce qui a été communément vécu par les participants de Dourdan. Le commentaire général se conclut, en effet, par la remarque : « Tout se passe cependant comme si les critiques en général adressées n’étaient qu’un aspect secondaire du témoignage des participants. On ne trouve aucun protocole exclusivement négatif »14. Cette remarque indique assez que, malgré les difficultés rencontrées, Rogers avait conduit avec les moniteurs une action enrichissante et originale, par-delà tous les problèmes de lutte entre l’imitation (et la tartuferie) ou la contre-orthodoxie, face à Rogers.
Le colloque de Paris
Quelques jours après le séminaire de Dourdan, un colloque devait réunir à Paris, tout près de la place d’Iéna et de la statue équestre de Washington désignant de son épée le cœur de Paris, quatre cent douze participants15. Ceux-ci travaillèrent trois longues journées « épuisantes et fécondes ». Chaque journée prenait son départ sur une communication de Carl Rogers, écoutée par la plupart selon un dispositif de traduction simultanée, et, grâce à la voix de deux interprètes : Maggy Misrahi et Georges Carasso. Un débat par échanges oraux et questions écrites se déroulait alors, suivi de dialogues avec des personnalités diverses, et entrecoupé par des réunions de groupe sans animateur : les participants avaient été répartis de façon hétérogène, en mêlant des origines et professions diverses, en une quarantaine de groupes installés dans diverses salles de travail (notamment dans le sous-sol du musée Guimet, consacré à l’art oriental). La première journée était consacrée à une présentation d’ensemble et aux préoccupations thérapeutiques. Carl Rogers fit un exposé sur le thème : « Etre en relation ; quelques réflexions sur des découvertes personnelles ». Dans l’après-midi, après une réunion de petits groupes, fut projeté le film sur la thérapie centrée sur le client, où Rogers est filmé avec « Gloria »16. Cette séance entraîna de nombreuses controverses, notamment en raison d’un moment du film où Rogers montra sa liberté à l’égard des problèmes du transfert ; Gloria lui disant : « Mince, j’aurais aimé vous avoir pour père, je ne sais même pas pourquoi cela m’est venu à l’esprit », Rogers répond directement, sans ambages : « Je vous trouve une bien gentille fille (daughter)… mais vous regrettez vraiment de ne pas avoir eu la possibilité de causer ouvertement avec votre propre papa ». Dans le commentaire qui terminait le film, Rogers précisait : « Ma réponse a été absolument spontanée : elle m’apparaissait comme une fille bien gentille, c’est-à-dire ma fille ». En soirée se tint un dialogue difficile entre Carl Rogers et le docteur Clavreul, secrétaire de l’Ecole freudienne de Paris (et ami fidèle de Lacan). Le lendemain, Rogers présenta des idées relatives à la pédagogie : « Relations interpersonnelles, et facilitation d’un processus d’apprentissage authentique ». La suite de la matinée fut remplie par un dialogue de Carl Rogers avec des enseignants de l’Institut national de recherche et de documentation pédagogique, notamment, à l’époque, MM. Dieuzede, Brunswic et Marquet. Il y eut aussi un échange de vues avec M. Haby qui fut nommé en 1974, ministre de l’Education nationale et qui était à l’époque au cabinet du ministre de la Jeunesse. L’après-midi, après une réunion des petits groupes, Max Pagès et Guy Palmade ouvrirent une controverse serrée sur l’orientation non directive. L’intérêt central du troisième jour était philosophique. Après un discours sur « quelques réflexions concernant les tendances actuelles de la philosophie dans les sciences du comportement », Rogers dialogua avec Paul Ricœur (à l’époque professeur à la Sorbonne, mais enseignant aussi à l’Union Theological Seminary de New York). La clôture du colloque s’effectua l’après-midi, après une dernière réunion des petits groupes.
Animation et contestation
Dès l’ouverture du colloque, Rogers avait fait d’emblée une déclaration qu’il avait soigneusement pesée pour éviter d’être emprisonné dans le carcan de la notoriété : « Je suis Carl Rogers. Je suis ici et maintenant. Je ne suis pas une autorité, un nom, un livre, une théorie, une doctrine… Je suis une personne imparfaite qui essaie de trouver la vérité dans ce domaine difficile des relations humaines. Allons-nous pouvoir parler, nous rencontrer en toute vérité, partager quelque chose ensemble ? » Ainsi, Rogers luttait-il contre ses doutes, pas seulement contre la culpabilité de la notoriété mais bien plutôt contre le mythe de Carl Rogers : mais son défi à se revendiquer, en tant que personne vivante, limitée, démunie, sans armes ni armure, différente des images et attentes que s’en faisaient les participants, et soucieuse de rencontrer ceux-ci à neuf et à nu, frustra, alimenta des soupçons et des incrédulités, souleva de nombreuses controverses ; il fit émerger, au sein de l’auditoire, de fortes oppositions, et il encouragea l’ironie. Devant la surenchère des sarcasmes, Rogers en vint, à la seconde ou troisième matinée du colloque, à analyser avec humour le paradoxe de tant de Français empressés à se réunir autour de lui aux fins de le critiquer ; il trouvait plaisant qu’on s’efforçât de démontrer si pesamment la futilité qu’on accordait à sa pensée. Déjà, dans la préparation du
séminaire et du colloque de Paris, un animateur anglais qui participait
à notre équipe, Gurt Higgins, avait bondi littéralement quand Rogers
avait explicité les termes de sa présentation « in Europe » : « Mais
Carl, vous êtes une autorité, vous êtes un nom, vous êtes des livres…
vous n’avez pas le droit de dire cela ! » Je revois la scène et la
réponse, tendue mais sans raideur, de Rogers, disant en substance : « Je
comprends, Gurth, que vous ne soyez pas d’ac- Par la suite, au travers de son programme dense, le colloque se révéla très animé. Rogers fut pris à partie pour ses conceptions qualifiées d’« angéliques », mais aussi en raison de ses critiques à l’égard du dogmatisme de la psychanalyse aux usa, et enfin sous des références politiques. On lui reprocha de n’avoir pas « pu soutenir le dialogue »17 (notamment par son refus de la discussion théorique), de prendre « des accents prophétiques qui souvent surprennent… On pense à l’optimisme américain, pour qui l’homme est invariablement tourné vers le progrès, et le bonheur, et on peut imaginer que la psychologie rogérienne est un produit du puritanisme américain et une réaction contre la psychologie freudienne, issue, elle, du puritanisme européen que dévore l’idée de la douleur, du mal et de la mort »18. Un certain nombre des participants furent déçus (et vexés) du dialogue avec Clavreul : Rogers se montra un débatteur coriace et ne se laissa pas conduire ou réduire par son interlocuteur. On lui fit rigueur du « fading » de la communication, de son inaccessibilité et en même temps de son accueil des mouvements affectifs. « Rogers apparaissait aux uns comme vaguement paranoïde, aux autres comme parfaitement sympathique… Finalement Rogers est plus stimulant par ce qu’il ne dit pas, que par ce qu’il dit. Il offre matière à réflexion, à contestation : il verse à profusion le scandale dans les esprits »19. On s’offusqua de la sincérité de son subjectivisme, de son « ton prédicant » (Roustang), de son désir de se présenter comme personne imparfaite et non comme autorité ; on incrimina sa culture américaine, on lui fit grief de la guerre du Viêt-nam (Rogers murmura placidement alors : « On a l’air de connaître mes sentiments mieux que moi ») ; on objecta : « Sa psychologie qui traite tous les conflits sociaux comme de simples malentendus, n’est-elle pas finalement une idéologie qui sert bien les intérêts et la bonne conscience de la classe possédante »20. On l’interpella sur les difficultés rencontrées par l’application de la non-directivité dans les établissements d’enseignement. Les assauts furent sévères ; on prétendit qu’il était « très peu rogérien »21. Rogers se sentit terriblement seul, défendant sa personnalité contre toutes les images que quatre cents personnes s’étaient faites de lui et voulaient lui imposer. Il n’était pas soutenu par la plupart des organisateurs du colloque (une crise s’ensuivit au sein de l’arip). Le président de l’association critiqua ses positions de façon sévère22. Je le revois encore, partant seul un soir, avenue d’Iéna, visiblement à bout de patience. Il me confia plus tard : « A Dourdan, j’ai beaucoup apprécié que les membres du staff arip soient capables d’apporter et d’exprimer les sentiments négatifs qu’ils avaient à mon égard et vis-à-vis de ma façon de penser, car j’ai pensé que cela rendait le séminaire meilleur. Pour le colloque, où il n’y avait pas beaucoup de chances de travailler les choses en profondeur, je ne crois pas que cela ait été si constructif »23. Comme le nota plus tard, à tête reposée, dans le Bulletin de psychologie de la Sorbonne, Georges Quintard, certains des organisateurs avaient enfermé Rogers « délibérément dans une situation qui lui était pénible »24 et qu’il pouvait ressentir comme un « piège ». Cependant, malgré difficultés et controverses, en dépit du « caractère encore imparfait du support théorique », Quintard, comme un très grand nombre de participants, retenait les apports positifs de ces journées : « On ne peut discuter la nouveauté de sa technique thérapeutique, elle rappelle au psychanalyste qu’avant même d’interpréter, l’essentiel est d’entendre et de comprendre et que c’est particulièrement difficile ; elle met l’accent sur cette communication avec soi-même, libre, et qui évoque le rêve par la richesse de ses contenus. Elle se base sur un type de relation beaucoup plus souple qu’en psychanalyse, permettant au thérapeute différents rôles dont celui du frère dont nous avons considéré l’intérêt thérapeutique. Sur le plan théorique, Rogers ne parle pas de structure de la personnalité. Il la voit comme « un devenir, une tendance permanente au changement, allant ainsi de façon audacieuse et originale au-delà de la psychanalyse »25. Quintard concluait, en raison des conséquences multiples (notamment en pédagogie), que ce colloque restait « un événement sociologique important ».
Non-conformisme, audace et sentiments positifs
Rogers, sur la route de Dijon, écrivit le 15 mai 1966 à Max Pagès et aux membres de l’arip une lettre où il consignait quelques constatations d’importance. « Je me rends compte, à la fois à partir de l’observation de votre groupe et à partir de notre expérience en Californie, de la force des pressions à être conventionnel et prudent. Je sais que vous avez essayé de résister à de telles pressions ». Il ajoutait : « Le fait de penser à cela m’a aidé à comprendre dans quel sens j’ai paru à certains d’entre vous à la fois dangereux et destructeur. C’est dangereux d’exprimer des sentiments vrais et spontanés. C’est destructeur car une telle expression peut démolir les défenses intellectuelles des autres, érigées avec tant de soin. Cela a été tout à fait mystérieux pour moi que je puisse être considéré comme dangereux et destructeur mais je pense que je comprends vraiment comment j’ai pu le paraître. Je ne ressens le besoin de faire aucune excuse et je n’éprouve aucun regret à l’égard du séminaire de Dourdan ni à l’égard du colloque à Paris. Je pense que nous avons travaillé tous ensemble, pas toujours facilement, de façon à faire de ces rencontres un grand succès ». Réfléchissant sur la différence « absolument incroyable » entre les Français d’une part et les Belges ou les Hollandais de l’autre (ceux-ci ayant accueilli avec simplicité et chaleur les mêmes exposés qui avaient été reçus à Dourdan de façon très froide et critique), Rogers en vient à une observation capitale : « Ma seule réaction est que l’idée que j’ai eue concernant le cauchemar du Français est plus profondément vraie que je ne l’ai réalisé à ce moment-là… De façon exagérément simplifiée, cela signifie simplement que l’expression ouverte, sans inhibition, des sentiments chaleureux est quelque chose qui vous rend à tout le moins mal à l’aise, et au pire, vous fait très peur et vous rend exagérément prudent et négatif ». Rogers concrétisait cette observation en se référant aux réactions qu’avait soulevées le film où il apparaissait avec Gloria dans un tournage réalisé par l’institut de recherche. « Par pur hasard, j’ai reçu une lettre qui m’a été transmise de Gloria le dernier jour de ma présence à Paris ». Rogers rappelait qu’il ne l’avait vue qu’une demi-heure en entretien thérapeutique, qu’il l’avait entraperçue ensuite deux fois, par hasard et qu’il avait reçu deux lettres en vingt mois. Il transcrivait des passages caractéristiques de la lettre reçue à Paris : « J’espère que mes enfant auront des sentiments à mon égard, dans les années à venir, semblables à ceux que j’ai éprouvés pour vous », « la dernière fois que je vous ai écrit, je me sentais seule et vide. Je veux donc vous dire maintenant que ma vie est si pleine, je ressens tellement d’amour et je trouve effectivement que c’est plus facile d’être moi-même. Il m’est difficile d’exprimer ma gratitude et mon amour ». Rogers ajoutait alors le commentaire suivant : « Si je cite si longuement, c’est parce que je pense que ce sont précisément de telles expressions qui amènent beaucoup d’entre vous à se tortiller avec malaise et à être prudents et réservés. Comment est-il possible que de tels sentiments puissent exister chez une femme avec laquelle j’ai passé moins d’une heure ? Je suis certain que vous pouvez expliquer tout cela en des termes très psychanalytiques mais je vous demande de considérer les simples faits. Elle m’a aimé comme son père pendant cette interview et il est évident que ce sentiment a duré parce que je lui ai totalement permis de le ressentir. Je me suis senti très proche d’elle pendant l’interview et je lui ai volontiers laissé savoir, spontanément, que je ressentais cette proximité. Et qu’en a-t-il résulté ? A-t-elle exercé des demandes sur moi ? Non. A-t-elle été dépendante de moi ? Non. Cette proximité lui a-t-elle causé du tort ? Non. L’a-t-elle aidée dans une faible mesure à devenir une femme plus mûre et plus complète, aimant un père, laissant derrière elle toute dépendance affective à son égard ? Je le crois. Tout ceci illustre ce que j’ai dit dans ma première causerie à Dourdan que “j’ai appris que ce n’est pas dangereux ni de donner ni de recevoir des sentiments chaleureux et positifs” »26. Face aux susceptibilités françaises, de telles considérations expliquent les profonds conflits qui avaient animé le séjour de Rogers en France. Pour beaucoup, de telles prises de conscience des différences réciproques furent libératrices. Elles concrétisaient en France le défi de Rogers, ouvert au devenir et à ses positivités, conçus selon une perspective néo-personnaliste27.
Objections ou oppositions
Ce qui se passait à ce colloque devait cependant tendre à se perpétuer en France. Au vif attrait, à l’intérêt marqué, qui furent portés aux idées et pratiques rogériennes dans les années soixante (et qui eurent leur acmé en 1968), succéda un reflux affectif sinon même passionnel. Il y avait eu séduction, il y aurait rétraction, dans les milieux universitaires oscillant entre une déception et un rejet à l’égard de la personne et des thèmes porteurs de Carl Rogers. Ceux-ci furent significativement contractés dans l’expression de non-directivité, devenue pourtant anecdotique sinon anachronique pour Rogers et ses coéquipiers : mais elle fut en France exagérément déclinée et partialement interprétée, comme nous l’avons déjà fait remarquer. Alors qu’il y avait de denses problématiques sur lesquelles débattre avec Rogers, il faut déplorer que des procès de tendance superficiels en aient écarté trop vite. Rappelons-les sans insister. Il était américain, donc naïf et conquérant ; il ne faisait pas allégeance au marxisme, il était donc indifférent à la politique et aux injustices sociales ou coloniales ; il était réticent, ou sévère, pour la psychanalyse dans son pays, il aurait donc été superficiel ; il insistait sur le primat de la personne, c’est donc qu’il était insensible aux structures et aux institutions ; il rappelait l’importance des sentiments et intuitions accueillis, il négligeait donc les savoirs, professionnels ou savants, et mettait par suite en discrédit la pédagogie et les didactiques comme toute expertise. Il y eut beaucoup de « donc » dans les propos ou écrits qui lui étaient consacrés, mais aussi beaucoup d’à-peu-près et de négligences. Je ne reprendrai pas ici l’analyse serrée que j’en avais entreprise et publiée, en 1974, dans la rédaction de Pensée et vérité de Carl Rogers : les curieux pourront la consulter dans les bibliothèques. J’y détaillais, sur une quarantaine de pages, les licences, les extrapolations impatientes, les outrances de style et les imperfections de forme qui entachaient nombre de publications ou de déclarations le concernant. Il y eut trop d’erreurs matérielles : de dates, de lieux, ou de pagination. Il se trouva trop d’inexactitudes dans les références, comme trop de fautes de traduction à propos des termes utilisés par Rogers. Il fallut déplorer trop de citations tronquées ou coupées des contextes éclairant leur réelle portée. Il en résultait, par suite, ou il s’y ajoutait, nombre de reformulations négligentes en lieu et place des citations réelles, des imputations inexactes d’assertions qui n’étaient pas celles de Rogers, des amalgames et mélanges douteux avec des œuvres ou des pratiques de personnalités aux antipodes, sans compter les interprétations aussi hasardeuses que péremptoires. Péchés de jeunesse ? Mais le temps les a dissous ou les absout de lui-même, nous laissant le soin de les expliquer ou d’apercevoir leur signification.
Significations
Il faut reconnaître, en premier
lieu, l’obstacle des langues, ou des langages, en réception orale ou en
lecture. On connaît, dans l’apprentissage de l’anglais, le dan- Plus profondément, sur le plan grammatical, les Anglo-Saxons, et tout particulièrement Rogers, utilisent pour leurs verbes des formes « progressives », en ing, qui caractérisent des modes « de déroulement de ce qui est exprimé par un verbe : … en aspect progressif ou continu ou duratif »28. Le sens d’on becoming a person traduit par « le développement de la personne » risque d’être altéré par nos habitudes françaises : on peut penser à un état atteint ou à une visée générale, alors qu’il est question d’un mouvement continu, d’une évolution non terminée, et d’un processus singulier à poursuivre. Ces simples remarques nous mettent sur la tonalité d’une dissonance des cultures d’outre-Atlantique et de France. Cartésiens ou réputés tels, rationalistes ou plutôt intellectualistes viscéraux (si on convient d’une telle formulation à la limite d’être taxée d’« oxymoron » !), psychologues ou universitaires, nous sommes, en effet, portés à substantiver des faits plus qu’à accompagner des processus, quitte à risquer l’absolutisation, si naturelle au tempérament français. Nombre d’entre nous ne pouvaient donc concevoir sans les radicaliser les positions et dispositions fluides exposées par Rogers. Il devait en résulter une insuffisante prise en compte des indications prudentes inhérentes à leur audace. On ne lui sut pas gré des précautions énoncées dans ses formules opératoires avec des « si » conditionnels29 : nous en reparlerons. On omit de considérer les relativisations qu’il introduisait, clairement, dès leur départ, dans ses pratiques par l’énoncé et la maintenance de limites ; dans la prise en charge ; dans le temps de relation ; dans les actions agressives ; dans l’affectivité induite30. Cette relativisation par des limites (d’elles-mêmes limitées) était pourtant inhérente à la négation qui est introduite dans l’expression « non-directivité » : pour son enseignement universitaire, il la concrétiserait, comme on le verra dans un prochain chapitre, selon des exigences (requirements) que devaient honorer ses étudiants. On oublia ou négligea aussi le traitement sérieux qu’il consentait aux contraintes intellectuelles, institutionnelles ou sociales, qui s’imposent en toute relation : notamment en psychothérapie ou en enseignement. On s’offusqua même des approximations successives énoncées par Rogers, malgré ou à cause de sa rigueur, en ses pratiques ou formulations : et qu’explicite son terme favori d’« approche », qu’on ne saurait dévaluer en laisser-faire. Plus gravement, on déforma en modèles, à reproduire à l’identique, les exemples de pratiques qu’il proposait ouvertement, aux fins d’arrimer les échanges ou les discussions à des réalités concrètes et d’établir une variété. On crut volontiers qu’il voulût n’admettre qu’une forme unique d’éducation et d’enseignement ou de psychothérapie31 : lui imputant, dès lors, les discrédits universitaires, pourtant chroniques depuis des siècles en France, portés sur la pédagogie ou la psychologie. Dans le même temps, on l’accusa, contradictoirement, et d’un dogmatisme « prédicant » et d’un scepticisme lié à la distance qu’il prenait vis-à-vis des radicalisations. Ses concepts-repères,
permettant au psychothérapeute de s’orienter dans le flux changeant de
son psychisme au cours d’une relation, furent dûment transformés en
principes inflexibles, en règles impératives. La
« congruence » devait être établie d’emblée et sans oscillation ; elle
devenait irréelle. La considération positive inconditionnelle était
déviée en « libre acceptation inconditionnelle » : « libre » appelant la
règle de libre association, en psychanalyse, et quelque automatisme ;
« accepta- De telles réductions, de tels raidissements pouvaient-ils être évités ? Et aurait-on pu accéder aux problématiques profondes auxquelles l’approche rogérienne convoquait la pensée française ?
Portée des problématiques
On ne peut nier que cette approche devait heurter nos habitudes de catégorisations séparatives, comme nos logiques coupantes excluant toute marge paradoxale. Elle devait faire ressortir nos réflexes de défense professionnelle (catégorielle ou disciplinaire), la défiance de nos procédures de thérapie ou d’éducation à l’égard des émotions ou de l’affectivité, notamment des sentiments positifs, mal reçus ou suspectés en raison de nos traditions intellectualistes, brillantes ou jansénistes. Des questions étaient par son fait posées à nos tentations absolutistes, à nos prétentions quasi nobiliaires, à nos goûts de classicisme et de classements clos, à nos propensions à l’abstraction sans grand retour aux singularités concrètes, ainsi qu’à notre intolérance jacobine à l’égard de toute simplicité ou différence. Carl Rogers, psychologue paysan, solide mais subtil, déconcertait nos contenances citadines (courtisanes ?…). S’il faut aller cependant aux questions ou thèses qui restent en attente, on pourra retrouver une topique de l’optimisme en procès, une autre de la conception du conflit en mesure ou en démesure, un questionnement sur les limites de la rationalisation, sans oublier l’interpellation profonde sur les rapports de la personne humaine et des structures sociales en toute relation. Nos réactions, malgré tout, soulevaient de vraies problématiques. Car, en formes interrogatives, il pourrait être posé : a-t-on le droit d’être systématiquement, méthodologiquement optimiste, à propos de la nature humaine et des réalités sociales ? La confiance pratiquée à l’égard de tout individu, inconditionnellement, est-elle sur le plan technique et responsable, décente ? Quid alors sur les droits de l’Homme (1789) ou de l’Enfant (1989) ? Et quid du rapport au Mal, à la Religion ? Mais aussi comment traiter les conflits, intropersonnels ou interpersonnels et collectifs : en les euphémisant ou en les surdramatisant ? en les dénouant ou en accédant à des ruptures insolites et à des déflagrations catégoriques ? Jusqu’où peut aller le devoir de rationalité, sans obérer les marges d’un irréductible irrationnel, sous-jacent, récursif (au sens où le délimite Michel Serres : « Le réel n’est pas rationnel : il est intelligent, et rationnel par plaques »32) ? Enfin, jusqu’où peut aller l’affirmation de la personne humaine en prise avec les institutions de toutes sortes, et en double risque : d’un narcissisme obtus (sinon paranoïaque) ou d’une dissipation dans les structures par identification (l’Etat, Le Parti, La Profession, Le Pays, La Cause, etc.) ? Comment résister à toutes les inerties d’émotion fusionnelle et de conformisme, ou d’enfermement ? Ou, comment maîtriser les penchants au chantage affectif et à la manipulation ? Par rapport à toutes ces questions, qui restent brûlantes pour notre fin de siècle, on ne peut minimiser au-delà de ses attitudes et de ses audaces, la force interpellante de son approche. Car il reste que l’essentiel de sa praxis est de travailler à l’émergence des personnalités hors des conformismes de toutes natures, idéologiques, affectifs, groupistes, dogmatiques, institutionnels, pour que ces personnalités s’affrontent de plus en plus librement aux idées, aux relations et aux institutions qui les environnent. Comme l’écrivit Gilbert Mury, « contribuer à ce qu’un jeune travailleur, un étudiant, un salarié, une mère de famille, trouvent la force d’être eux-mêmes par-delà les modèles de comportement en place, est-ce, ou n’est-ce pas déjà de la subversion ?33 » Le passage à une démarche plus autonome (plus cartésienne) s’effectue en constatant à tous les niveaux (intellectuels, affectifs, relationnels) les pressions subies, afin de les désenfler, de les dépressuriser : en sorte de les utiliser sans s’immerger en elles de façon panique, construisant alors des fantasmes groupaux (et inhibiteurs). Je pense souvent sur ce thème à la présence invisible et mythique de l’« Ange exterminateur » dans le film de Buñuel qui porte ce titre. De grands bourgeois espagnols n’osent plus quitter la riche demeure où ils sont venus souper au sortir de l’opéra (et où ils sont restés sans personnel de maison, seuls avec le maître d’hôtel), parce que chacun convainct chaque autre qu’il est impossible de franchir les portes. Toute initiative est sapée ; et bien que les portes soient réellement ouvertes, personne n’ose les approcher ; l’énergie des individus va dès lors être usée en conflits de neutralisation et de ressentiment ou de destruction. Et les gens de l’extérieur n’osent venir au secours, jugeant que si nul ne sort c’est qu’une puissance ou un mal fantastique interdit le passage des seuils. Ainsi un tabou mythique rend des êtres prisonniers de leur promiscuité, de leurs rapports institutionnels ou secrets : jusqu’à ce qu’une femme aide chacun à revenir au moment précédent celui où chacun a cru que les portes étaient closes irrémédiablement ; alors, tous ceux qui ont résisté ressentent la disposition de leur liberté réelle et sortent sans problème. A la façon de ce mythe, trop souvent les individus se murent dans la dépendance (en groupes ou en organismes), non seulement par le travers de relations biaisées qui restreignent abstraitement leurs dispositions réelles d’accessibilité, mais encore par des symbolisations autodissuasives (les « Tigres de papier » dont parla Mao-Dsedung). Ces symbolisations amplifient la puissance contraignante des structures internes ou externes, elles placent l’ange exterminateur sur beaucoup de voies possibles : il importe que les individus explorent ces négativités, puis découvrent à tâtons les issues, restreintes mais réelles, qui leur permettent de cheminer hors de leurs fascination réciproque. Le groupe ou séminaire de rencontre pour Rogers peut être un lieu de démythification des tabous, des dogmatismes, des inféodations : non pour inviter à l’isolement, mais pour soutenir une personnalité dans la croissance de sa singularité étayée par celle des autres. Car il est faux que les structures (approximations pour stabiliser le tourbillonnement des relations et des actions de production ou de consommation) soient supérieures à chaque individu, et, minotaures modernes, qu’elles le dévorent absolument. En réalité, les structures sont souvent invoquées de façon magique, et leurs pressions de coincement sur l’individu sont fantasmatiquement amplifiées. J’ai déjà décrit le combat d’Oedipe, le rationaliste, répondant avec simplicité aux questions du Sphinx — Structure ; et comment, au lieu d’être dévoré en se fascinant de complication hypothétique, il fit disparaître le Sphinx, s’ouvrant la route de Thèbes34. Ce combat correspond, en des temps modernes, à la lutte sur le positivisme d’Auguste Comte. Et je vois Rogers aller dans une direction analogue, dans sa lutte contre les interdictions aussi bien que les licences, dans son débat contre toutes les formes de l’inertie infiltrée dans les institutions sociales. Dans le travail de groupe, si des débordements d’affectivité se manifestent, ce n’est pas en tant qu’ils sont le fond de l’être qu’ils importent, mais parce que des énergies de l’individu se sont incurvées en bouchons obturant des voies de communication et d’accessibilité : leur émergence est par suite, non le signe d’un envahissement émotionnel de l’individu, mais au contraire le symptôme d’un dégagement des libres circulations et des équilibres indifférents nécessaires à la croissance de la rationalité et de la présenciation. Dans le travail d’enseignement et de pédagogie, Georges Snyders qui fut un censeur impitoyable de Rogers, reconnut néanmoins après quarante-six pages de réquisitoire : « En attendant, Rogers nous amène à nous poser des questions essentielles : à quelles conditions une coopération pédagogique est-elle possible entre deux personnalités — ou plus réellement entre la personnalité du maître et celle du groupe-classe, sans que l’une écrase l’autre ? A quelles conditions un maître peut-il juger, évaluer et en même temps comprendre ce qui se passe dans l’expérience de l’élève, la ressentir “empathiquement” ?… Rogers dévoile les risques inhérents au rapport pédagogique et incite par là l’enseignant à une vigilance constante… Rogers nous fait prendre conscience que le métier d’enseignant doit être un long effort pour échapper à cette sorte de pesanteur qui risque d’entraîner la relation pédagogique vers des formes dégradées »35. Qui dirait mieux ?
Chapitre IX
Vers le personnalisme
Rentré d’Europe, où il venait de prendre un nouveau « baptême du feu », Rogers investit son énergie dans la vie chaleureuse de son institut. Il est intéressant de regarder les rapports d’activité, destinées au conseil de direction, et qu’il consacre à la période de juillet 1966 à avril 1967.
Activité au wbsi
Il relate d’abord, sur le terrain de ses activités de groupe, la conduite de huit séminaires importants (workshops) réunissant des effectifs nombreux (trois supérieurs à la centaine, deux de l’ordre de soixante à soixante-quinze) et s’adressant aussi bien à des éducateurs, des enseignants, des présidents qu’à des formateurs de puéricultrices ou à des jésuites. Il note un cours sur la motivation et la conduite humaine à l’université de Californie, la supervision de trois thèses de doctorat d’état, des conférences à des auditoires nombreux de psychologues ou de travailleurs sociaux (de 1 000, 2 000, 3 000 et 4 000 auditeurs) ou à des groupes universitaires ainsi que des consultations pour groupes étendus. En fait de production écrite, il a terminé l’édition de son travail de recherche (avec deux cents collaborateurs) sur les schizophrènes, coopéré à l’édition de Man and the Science of Man, publié plusieurs des articles sur le groupe et la pédagogie (qui sont réunis et édités ultérieurement les uns et les autres), rédigé son autobiographie. Il fait état des nombreux articles qui ont suivi sa visite en France, ainsi que des progrès de la publication de son œuvre complète au Japon. Il conclut son rapport et reconnaît qu’il a été actif (busy) : « […] Probablement trop actif. Je réponds trop aux demandes des autres plutôt que de suivre mon propre courant. Egalement, j’ai été un peu plus influencé par des motivations économiques cette demi-année qu’auparavant. Vivant sans salaire, j’ai senti la nécessité d’accepter parfois des obligations que je n’ai acceptées que parce qu’elles payaient très bien »1. Rogers se proposait de tenir plus libre son calendrier pour l’été et l’automne 1967 afin de rédiger deux livres sur l’éducation et les groupes : « Quand je regarde en arrière vers ma carrière, je ressens que, tandis que j’ai toujours besoin d’être immergé dans des activités pratiques telles que le groupe de rencontre, l’enseignement et le reste, mon plus grand impact est venu du fait d’abstraire les principes centraux et les concepts qui surgissent de ces expériences et de les écrire dans une forme suffisamment claire pour qu’elle puisse être donnée comme test de recherche aux autres. J’espère suivre ce mode (pattern) d’activité »2. Rogers note aussi son souci de rester en dehors des responsabilités de direction et d’administration du wbsi. En fait, il se détache de celui-ci progressivement à partir d’un projet important, qui a renouvelé son action sur le monde de l’enseignement.
Une démarche pédagogique renouvelée
Libre de ses mouvements, se dégageant d’un enclavement dans la psychothérapie, Rogers approfondit, en effet, sa démarche pédagogique. Il lui donne une allure moins radicale, il l’assortit de précautions et de formes nouvelles ; il l’étend enfin, avec fougue, à des dimensions institutionnelles. Car, préparant la publication de Liberté pour apprendre ?, Rogers se sent effectivement surpris par un sentiment d’urgence : il désire aider de toutes ses forces « les maîtres et les éducateurs dans un moment de crise particulièrement saisissant »3. Au sein d’un monde marqué par un
changement constamment accéléré, Rogers s’interroge avec anxiété sur les
possibilités des systèmes actuels d’enseignement : sont-ils à même de
préparer les individus et les groupes à vivre heureux, ou serait-ce
impossible ? Peuvent-ils résoudre des tensions raciales, chaque jour
plus explosives, ou aboutira-t-on à une guerre civile généralisée ?
Préparent-ils des êtres responsables, « capables de communiquer avec
autrui, dans un monde où augmentent les tensions internationales en même
temps qu’un nationalisme absurde », ou conditionneront-ils « un
holocauste devenu inévitable » ? Seront-ils capables d’entrer en prise
directe avec les problèmes concrets de la vie moderne, ou
s’enfonceront-ils dans le conformisme et la régression à moins qu’ils ne
capitulent devant des organismes à but lucratif. Enfin « est-ce que les
enseignants seront capables de “rencon- Devant le défi des changements vertigineux qu’apportent la science, la technologie, les communications et les relations sociales, Rogers constate qu’on ne peut s’en tenir aux réponses fournies dans le passé : il faut mettre sa confiance dans les processus par lesquels les nouveaux problèmes sont rencontrés. C’est pourquoi, proposant le plan d’un « changement autodirigé » (self-directed) au sein d’une institution scolaire, Rogers avoue qu’il aurait aimé annoncer sa perspective sous un appel sans équivoque : « Plan pratique pour une révolution scolaire »5. Cette révolution indispensable ne peut être réalisée que par les enseignants, mais en contact renforcé avec toutes les parties prenantes de la relation éducative, étudiants ou élèves, parents et administration, monde extérieur ; et à condition de leur procurer des moyens précis de s’engager dans l’expérimentation avec leurs classes, ainsi que des bases théoriques et des vues personnelles6. C’est une entreprise aussi bien concrète que philosophique, orientée vers le dégagement des libertés dans les élèves ou les étudiants autant que dans les enseignants eux-mêmes. Rogers reprend et développe, par conséquent, ses thèses sur l’apprentissage signifiant pour l’individu, dans l’initiative, suivant la profondeur progressive et par l’autoévaluation croissante. C’est à un enseignement expérientiel qu’il convie, avec la médiation de procédés concrets et pratiques autres que le seul exposé (trop fréquemment utilisé) ou la notation. Mais Rogers, cette fois, prend la précaution de souligner ce qui était jusque-là implicite dans sa démarche ; il ne présente pas de nouveaux modèles contraignants, propres à être répétés identiquement, mais des exemples démontrant la possibilité d’inventer d’autres choses que le mode traditionnel (et présentement obsessionnel) d’instruire. Décrivant une expérience tentée par une institutrice, il renchérit sur son alerte : « Bien entendu, l’expérience menée par Melle Shiel ne représente d’aucune manière le modèle que d’autres devraient imiter. En effet, l’une des choses les plus importantes dans l’expérience ici rapportée est le fait que l’auteur n’a pris le risque de donner la liberté à ses élèves que dans la mesure où elle pouvait s’y hasarder, et qu’autant qu’elle se sentait raisonnablement à son aise en le faisant »7. On retiendra le critère : être et demeurer raisonnablement à l’aise. Rogers présente en deuxième lieu la méthode d’un professeur de College, le Dr Faw, qui donne une liberté dans certaines limites (within limits) à ses étudiants. Et il fait à ce propos deux remarques : tout d’abord, il se dit « émerveillé de voir de combien de manières différentes certains enseignants parviennent à donner une certaine liberté à leurs élèves »8 ; en second lieu, à défaut de prendre l’exemple de A.S. Neil à Summerhill qu’il apprécie, il a choisi la méthode du Docteur Faw, « notamment parce que ce dernier lui paraît être à la fois un homme prudent dans ses hardiesses et un novateur plein de modération. Son exemple démontre qu’il n’est vraiment pas nécessaire d’être un révolté incendiaire pour entreprendre une approche nouvelle des problèmes pédagogiques, pourtant bien éloignées des principes traditionnels »9. Prudence et hardiesse, novation et modération ou aise, exemples multiples mais étendus sur toute une gamme, par ces contrastes et ces paradoxes réfléchis, Rogers entend signifier qu’il ne fournit pas des modèles à reproduire obsessionnellement et impulsivement, mais des exemples à partir desquels découvrir, pour soi, des modalités de pédagogie personnalisée favorisant la personnalisation des enseignés. Il s’est aperçu que certaines de ses formulations antérieures, au lieu de libérer des inspirations éducatrices, avaient produit des modes d’imitation forcée et, par suite, contradictoires à son projet essentiel. Il avait déjà vu combien la « non-directivité » au lieu d’être respectée dans sa démarche de liberté et de créativité, s’était réduite, trop souvent, par le fait de zélateurs ou la mauvaise interprétation de contradicteurs, à une sur-modélisation du silence, de la distance, de la rigidité, de la froideur, et de l’autocensure (et du surcontrôle sur les élèves, par contrecoup) chez le professeur ou l’éducateur. Les exemples de ses démarches antérieures, tels qu’il les avait décrits comme exemples et questionnement, étaient devenus malgré lui des modèles entraînant dépendance et imitation : en sorte que la non-directivité, au lieu de rester dialectique, en tant qu’alerte pour réduire l’intervention du responsable (enseignant ou thérapeute) à des minima utiles, s’était dogmatisée en modèle absolu et univoque de silence et de rigidité emprunté à l’image (plus ou moins fantasmée) de la cure psychanalytique. La non-directivité ne saurait signifier pour l’enseignant (ou le thérapeute) masque de ses propres valeurs et castration de ses pensées sur les hommes et les situations, mais délimitation transactionnelle : pour mieux être aux autres comme à soi, dans la relation pédagogique ou institutionnelle. Et de la sorte, non-directivité en mesure rogérienne renvoie immédiatement à non-modélisation, c’est-à-dire, non pas une destruction chimérique des modèles, mais une délimitation des modèles à leur valeur incitatrice de modalités multiples, assouplissant les possibilités et les choix. Sur cette non-modélisation, Rogers s’exprime avec force dans Liberté pour apprendre ?, une troisième fois, à propos de sa propre expérimentation pédagogique : « Tout véritable enseignant possède une manière bien à lui d’aider ses élèves à apprendre. Il y a sûrement plus d’une voie qui mène à ce résultat. Mais malheureusement on n’a guère publié de comptes rendus sur la manière de travailler d’un enseignant donné. Je crois que les professeurs qui débutent pourraient tirer profit de ces rapports »10. Et plus fortement, à nouveau : « Il serait regrettable que quelqu’un s’efforce de donner son cours exactement comme moi »11.
L’enseignement autodirectionnel
Ces alertes bien rythmées, Rogers attire l’attention sur diverses caractéristiques. Tout d’abord, proposer un contrat de liberté ne peut être entendu comme s’imposer à soi non plus qu’offrir une formule unique, en tout ou rien. Ainsi, Melle Shiel, tentant une expérience de liberté dans une classe, constate qu’un certain nombre d’enfants se sentent « frustrés et mal à l’aise devant l’absence de direction par la maîtresse »12. La discipline aussi reste complexe avec des enfants-problèmes dont il ne faut pas « attendre trop et trop tôt »13. Pour ajuster la non-directivité, ou plutôt pour assurer un enseignement centré sur l’élève, elle établit une intervention sur un mode pluraliste : « J’ai alors divisé la classe en deux groupes. La plupart font partie du groupe non dirigé. Les quelques autres sont dirigés par moi : ce sont des enfants qui ont demandé à en revenir à l’ancienne méthode et ceux qui, pour diverses raisons, se sont montrés incapables de fonctionner dans la situation d’autodétermination ». Remarquons au passage que, dans
tout son livre, Rogers ne cite qu’une seule fois le terme « non
directif », et encore par la voie d’une citation de Melle Shiel
déclarant : « Pour décrire notre régime, j’emploierais plutôt le terme
d’“autodé- Rogers note que, dans cet exemple, l’enseignante garde du réalisme et de la souplesse dans sa démarche, et qu’elle « se fie à son jugement pour savoir ce qu’il convient de tenter et quand il faut battre en retraite. Elle n’essaie pas d’appliquer le plan conçu par un autre »15. Il en est de même pour l’exemple du professeur Volney Faw, proposant une méthode plastique, facile à adapter. Cette « méthode ne menace personne »16 ; ni l’enseignant qui continue à instruire, ni l’étudiant qui a un choix d’initiatives cadrées dans un ensemble pourtant traditionnel. Rogers se rend compte qu’il ne sert à rien, par des radicalismes, de faire monter les angoisses et les défenses individuelles ou institutionnelles. Réfléchissant sur sa façon de faciliter un cours (en 1969), Rogers observe alors : « Je constate qu’il est très facile de donner la liberté à un groupe ». Il rappelle qu’il a découvert, depuis quarante ans, que c’était avantageux, mais que ceci peut constituer pour d’autres éducateurs un risque et un danger, en sorte qu’il est légitime de ne donner que le degré de liberté qu’on est capable d’offrir « en toute sincérité et sans (se) sentir mal à l’aise »17`. Et il ajoute la précision capitale : « En fait, il y a dix ou quinze ans, j’aurais probablement donné encore davantage de liberté au groupe : je leur aurais donné l’occasion (et le devoir) de construire tout le cours. J’ai constaté que ceci éveille une grande dose d’anxiété et beaucoup de frustration, de colère contre moi (“Nous sommes venus pour que vous nous appreniez quelque chose”, etc.). Je ne suis pas certain que ces ressentiments soient nécessaires. Dès lors, soit lâcheté de ma part, soit sagesse, j’en suis venu à formuler assez de limites et d’exigences (“requirements”) — ce qui peut être perçu comme une structure — pour que les étudiants puissent, sans malaise, commencer à travailler. Ce n’est qu’au fur et à mesure que le cours avance qu’ils saisissent que chaque “exigence” prise à part et toutes ensemble ne sont que d’autres manières de dire : “Faites exactement de ce cours ce que vous voulez en faire et dites et écrivez exactement ce que vous pensez et sentez”. Mais la liberté paraît moins pénible et moins anxiogène lorsqu’elle est présentée en des termes classiques comme une série d’“exigences” »18. Ce texte fondamental rappelle, par conséquent, que la liberté n’est recevable que si elle n’est pas une source excessive d’incertitude et donc d’angoisse. Mais les délimitations qui maîtrisent celles-ci, sous forme d’exigences (requirements), doivent être conçues de façon à permettre leur dépassement progressif, par leur intériorisation au cœur de l’apprentissage. Par exemple, Rogers demande, comme requirement, à chaque étudiant de donner un compte rendu simple mais honnête des lectures qu’il a faites dans des livres indiqués ou non sur la liste bibliographique remise par lui, mais avec une appréciation du niveau de profondeur des lectures. Cette exigence est évidemment intériorisable. « La seconde exigence est que vous rédigiez une note, aussi brève ou aussi longue que vous le désirez, au sujet des valeurs personnelles les plus importantes pour vous. Vous indiquerez comment ces valeurs ont changé — ou n’ont pas changé — en fonction du cours. Une troisième exigence est que vous me fassiez parvenir votre propre évaluation de votre travail ainsi que la note que vous estimez mériter »19. Rogers demande que lui soient communiqués les critères de jugement sur le travail accompli, et annonce qu’en cas de différence dans l’estimation de l’étudiant sur lui-même et son estimation à lui, il y aura échange afin de se mettre d’accord sur ce qu’ils pourraient signer en conscience. Il demande enfin une réaction personnelle et confidentielle sur le cours, à n’ouvrir éventuellement qu’après la notation. Ces exigences d’auto-appréciation sont des appuis pour le dégagement en chacun d’une liberté : elles ont pour objet de canaliser l’angoisse, par une confiance signifiée opératoirement et soutenue. Ces exigences se révélèrent efficaces et utiles, à l’expérience. Elles apportent leur correctif dialectique à des formulations qui pouvaient apparaître dissolvantes, « incertaines, effrayantes »20 dans une non-directivité imaginée sous sa forme excessive, car celle-ci paraîtrait faire fi de l’angoisse et de la progressivité utiles pour une approche de la liberté en apprentissage. Et Rogers rappelle l’importance de
la relation interpersonnelle entre l’enseignant et chacun des enseignés
pour favoriser un apprentissage où chaque personne est concernée et
prend en profondeur la responsabilité de sa formation : le professeur
peut « utiliser avec grand profit » ses « capacités didactiques », sa « compé-
L’intervention institutionnelle en pédagogie
Le groupe de rencontre permit à Rogers de faire le joint entre l’expérience acquise dans des relations interpersonnelles et la mise au point d’une stratégie, d’un « plan » d’évolution nécessaire et naturelle des structures sociales, et particulièrement des institutions scolaires. Le « plan » revenait à réunir dans
des groupes de rencontre d’une semaine environ (avant la rentrée
scolaire) tout d’abord des administrateurs scolaires, mis ainsi en
mesure de mieux affronter les tensions émotionnelles consécutives à des
changements (de relation et de rapport) avec leurs subordonnés, leur
entourage, ou leurs supérieurs. Puis il proposait, au cours de petites
vacances, de réunir des groupes d’enseignants volontaires,
ultérieurement une classe ou un cours entier, professeurs et élèves
réunis, enfin des groupes mixtes, administrateurs, enseignants élèves ou
étudiants et parents. Pour que l’action se poursuive et s’étende, des
« facilitateurs » de nouveaux groupes de rencontres étaient choisis
parmi les premiers participants, et recevaient une formation accélérée
(en trois semaines, au cours de vacances) en vue de relayer les
animateurs initiaux qui ne gardaient qu’un rôle de consultants des
nouveaux facilitateurs. Le plan devait être ramassé dans le temps, en
sorte que neuf séminaires (de un à dix groupes de rencontre),
rassemblant des centaines de personnes, touchent « une partie
suffisante du corps administratif, du corps professoral et de la
communauté des étudiants pour que les effets n’en soient pas perdus »22.
Rogers mettait beaucoup de soin au choix des « facilitateurs » retenus
suivant leur comportement peu défensif et sincère. Il entendait diriger
avec cohérence le séminaire de leur formation, ayant un souci de
définir le groupe de rencontre sur un exemple de simplicité : au cours
de ce séminaire, les facilitateurs en formation auraient à animer des
groupes de rencontre proposés à des personnes de leur entourage, afin
de réfléchir ensuite sur un essai vécu des fonctions de facilitation.
Rogers prenait mesure des risques calculés qui pourraient se présenter
au cours de toutes les phases de son plan. Il entendait contrôler les
effets produits par le recours à une évaluation renouvelée mais aussi
grâce à une recherche complémentaire conduite simul- Le projet, après deux ans d’attente, fut enfin appliqué à partir de l’été 1967 dans un groupe institutionnel comportant une faculté (College) de pédagogie, plusieurs établissements secondaires et un grand nombre d’écoles primaires. Ce groupe, dans la région de Los Angeles, était animé par un ordre religieux féminin23. Des crédits provenant de diverses fondations purent être réunis, permettant un début de recherche, et surtout la rémunération d’une équipe d’animateurs-facilitateurs, « qui devint par la suite le Centre d’études de la personne »24. Le plan avait, ainsi, sa première conséquence institutionnelle. En quatre-vingt-dix jours (dans le dernier trimestre de 1967), après quelques modifications apportées au plan initial par un comité mixte de responsables appartenant aux deux institutions, toutes les premières phases furent réalisées : quarante-cinq administrateurs et professeurs du College, volontaires, répartis en quatre groupes, firent successivement deux expériences de groupes de rencontre. Ensuite trente-six personnes, volontaires également, professeurs ou administrateurs de trois établissements secondaires, participèrent à deux week-ends de groupe de rencontre. Puis quarante élèves déléguées des trois établissements de second cycle, en trois groupes, firent un groupe de rencontre pendant un week-end ; et un mois plus tard, elles furent réunies avec les professeurs volontaires, toujours en week-end, en groupes mixtes, après le dénouement des résistances. En quatrième lieu, cent quatre-vingts personnes — enseignantes, personnel administratif et directrices de vingt-deux écoles primaires — furent réunies en groupes de rencontres, au cours de deux week-ends, à un mois d’intervalle. Enfin des réunions, rassemblant des professeurs du College avec certains membres du Centre pour les études de la personne, permirent d’étudier le renouvellement de l’enseignement d’une part, et le programme des groupes de rencontre d’autre part : et une assemblée des étudiants du College fut tenue avec la participation de professeurs et des facilitateurs. Par-delà les analyses, les
critiques et certains « désarrois » (surtout, au début, chez les
administrateurs), des réactions positives et des changements
constructifs (autodéterminés) dans les relations et les méthodes
d’enseignement furent constatés, de façon croissante. A partir du
printemps de 1968, la communauté de la faculté de pédagogie (College)
se révéla divisée (bipolarisation), et le recours aux animateurs du
Centre d’études de la personne diminua, cependant que de nouvelles
procédures étaient utilisées pour la prise de décision et les relations.
Les chercheurs associés au projet constataient de nombreux changements
chez les individus qui avaient participé aux groupes de rencontre,
étudiants ou professeurs. Les communications étaient transformées ainsi
que les structures, au College aussi bien que dans les
établissements primaires ou secondaires : la « participation » se
développait, malgré la « bi-
Le Centre d’études de la personne (The Center for Studies of the Person)
Le plan pour une révolution éducationnelle conduisit, comme on le voit, à la création du Centre d’études de la personne, en fin d’année 1967. Une brochure définit dès le départ les buts de ce centre qui groupa assez vite à la Jolla une cinquantaine de membres (dont trente-quatre docteurs d’université, et huit candidats au doctorat). Ces buts étaient : — explorer (exploring) les richesses de la personne ; — aider (helping) les individus à découvrir et à faire plus pleinement l’expérience de leur vie ; — approfondir (deepening) les relations interpersonnelles ; — découvrir (discovering) ce que signifie pour les gens être plus personnel, humain et communicatif dans leurs organisations et leurs sociétés. Dans ces perspectives, différents projets d’activité furent mis en chantier : — un projet d’innovation éducationnelle, pour un changement autodirigé (avec Carl Rogers et Doug Land) ; — un programme relatif à l’abus de la drogue chez les adolescents ; — un programme « La Jolla » (une rencontre de trois semaines d’été pour des éducateurs, des psychologues, des conseillers et des membres du clergé) ; — un service d’organisation de conférences et colloques ; — un centre de recherche informatique (design) au service des étudiants ; — un projet pour les institutions communautaires ; — un service d’organisation de séminaires de formation ; — un plan de rencontres interraciales ; — un institut pour l’éducation vis-à-vis de la drogue ; — un projet de « psycréation « (production de jeux, d’audiovisuel, pour les besoins des formateurs, des entreprises, etc.) ; — un projet de développement universitaire (innovations pour des formes expérimentales de cours dans les sciences humaines) ; — un projet d’entraînement à l’entrée au travail (pour des gens sans formation professionnelle) ; — un service de conférenciers et de matériel d’enseignement ; — un projet de thérapie et conseil pour adolescents, adultes et couples. Mais ce centre n’était pas comme les autres et les projets d’activité ne peuvent masquer l’originalité de sa contexture affective et administrative. Voici comment Rogers décrit la perception qu’il a de celle-ci : « C’est une organisation (ou une non-organisation comme c’est peut-être le cas) en continuel changement. Initialement, nombre de nos politiques étaient adoptées en dehors de nécessités financières extrêmes aussi bien qu’elles pouvaient se différencier avec antipathie des organisations structurées. Graduellement, nous en sommes venus à réaliser que nous étions peut-être en train de construire une non-organisation dans laquelle la personne de demain pourrait être heureuse »27. Et Rogers se met à énoncer un certain nombre de principes (features) inhabituels : « Si vous désirez nous rejoindre, vous ne pouvez solliciter un emploi, parce qu’il n’y a pas d’emplois au sens ordinaire. Vous aurez à trouver un moyen d’être intégré à quelqu’une des activités que les membres du centre conduisent. Si vous deveniez significativement impliqué sur une période de temps importante et que vous désiriez vous joindre à nous, alors le groupe pourrait voter pour savoir si oui ou non les membres désirent vous avoir comme associé. Si vous êtes pris comme membre, vous vous obligeriez vous-même à quelque participation modeste aux fonctions communes du centre. Vous sauriez également que vous devez être responsable de trouver votre propre support. Celui-ci pourrait être trouvé dans la conduite d’une recherche ou bien dans celle de projets d’éducation (grant) ou de groupe, acceptant un emploi d’enseignant ou de conseiller, écrivant ou gagnant (earning) des royalties, faisant des films ou dans quelque modalité qui ait un sens pour vous. Vous saurez que, si vous perdiez votre source de revenu (support), le groupe se sentirait concerné en définitive et essaierait de vous suggérer d’autres tâches, mais ne vous garantirait pas votre revenu à venir (further). Vous aurez à tabler sur vous comme vous le désirez. Notre directeur, tout à fait correctement, s’appelle lui-même le « non-directeur », il n’a aucune autorité sur personne (mais il apprécie le titre parce que cela lui permet de parler au nom du centre pour les gens extérieurs, et de développer des opportunités variées pour les membres du centre). Pour chacun de nous vous serez simplement un « membre », mais pour vos relations avec le monde extérieur vous pourrez choisir n’importe quel titre (excepté directeur) qui vous aiderait le plus dans votre travail. (J’ai choisi « collègue résident », resident fellow.) Si vous désirez démarrer un nouveau projet, il ne serait pas nécessaire d’obtenir l’approbation du groupe (à moins qu’il n’y ait un risque d’interférence avec notre statut d’activités sans profit) »28. Malgré l’aspect étrange de ces considérations, le centre fait l’objet de nombreuses demandes d’admission, en raison de l’esprit communautaire qui relie ses membres. « En aucune façon nous n’avons à être ensemble. En conséquence, nous pouvons plus librement partager nos espoirs et nos frustrations, nos sentiments de friction interpersonnels, nos déceptions et notre fierté à l’égard du groupe »29. Et Rogers relève la gaieté et le caractère stimulant des réunions hebdomadaires de staff. Une somme raisonnable mais minimum d’affaires y sont traitées. « Nous avons une organisation qui est une famille (a psychological home) que tous chérissent, mais duquel nous nous éparpillons pour accomplir une myriade de choses hautement diverses. Le seul élément qui peut-être lie nos activités est que presque tous les membres ont comme part de leur objectif l’enrichissement et l’étayage de la vie des personnes et l’effort pour comprendre davantage ce qui constitue un tel enrichissement et accomplissement.30 » Ce n’est pas une utopie pour une nouvelle abbaye de Thélème. Mais c’est une « non-organisation » effective qui renouvelle sur le plan institutionnel l’orientation non directive : par elle est testé un système d’association souple et légère, non empâtée dans des préoccupations de continuité ou d’argent, et permettant à des individus de se soutenir efficacement dans leur autonomisation radicale, au lieu de se réduire et de se censurer comme il est trop habituel. Préfiguration de formes sociétales nouvelles pour une civilisation à venir ? Ou mode de ce « Temps des tribus » dans lequel nous serions entrés, selon le sociologue Maffesoli ?
Une activité renouvelée, soutenue et toujours contestée
On conçoit que Rogers, émancipé des lourdeurs bureaucratiques de l’université et même de celles des comités et associations traditionnels, respire et se ressente en pleine créativité, accomplissant enfin les rêves réalistes de sa jeunesse. Son emploi du temps est significatif. D’octobre 1968 à septembre 1969, le compte des activités de Carl Rogers permet de relever sept séminaires importants : pour des présidents ; le staff d’un centre de consultation universitaire ; un groupe de soixante-dix enseignants, éducateurs et étudiants, de l’université de Columbia (après une crise), des enseignants, des animateurs de groupes d’une assemblée de travailleurs pour la santé mentale (quatre cents personnes). Il accomplit un enseignement dans une université sur les valeurs et la condition humaine, et un autre sur le commandement et le comportement humain, il assure la supervision de quatre thèses de doctorat ; il participe au jury d’oral de deux personnes ainsi qu’à la sélection de futurs « thésards ». Il démarre enfin son projet d’innovation éducationnel. Et il conduit trois programmes de formation pour des « facilitateurs » de groupe de rencontre, à la Jolla et dans diverses universités. Il prononce d’autre part de nombreuses conférences (une douzaine) avec des auditoires de plusieurs centaines ou de milliers d’auditeurs. Il participe à six dialogues de groupe (directement ou par téléphone). Il coopère avec Coulson à l’édition d’ouvrages sur la personne et produit des enregistrements d’interviews sur les techniques de groupe. Il fait l’objet de sept interviews, à la télévision ou directement. Il écrit de nombreux articles. Il publie enfin, en début 1969, Freedom to learn, traduit en 1972 sous le titre Liberté pour apprendre ?, où sont rassemblés toutes ses entreprises en pédagogie depuis 1966. Malgré ces activités créatrices, il ne faudrait pas imaginer que la tâche soit encore facile pour Rogers. En Californie, il doit toujours se battre contre le scepticisme de ses compatriotes, et contre l’inertie ou le goût de la complication qu’il rencontre même chez les plus créateurs. Edgard Morin put s’en rendre compte, en janvier-février 1970 : « C’est un con ! Il est dépassé ! A chaque tentative pour rencontrer Rogers, je me heurte à ce dédain, et je n’insiste pas trop. Finalement la présence de la piquante Escoffier-Lambiotte me stimule, et je me persuade qu’il faut absolument qu’elle le rencontre, afin de moi, le rencontrer. On m’avise avant le rendez-vous, qu’il y a eu scission dans son Centre d’études de la personne et qu’il reste presque seul. Villa harmonieuse, sur la très haute colline, un homme avec un beau masque, mais amer, incapable de s’arracher à une idée fixe. Oui, mais : cette idée fixe, c’est la grande idée qu’il a apportée ; cette idée est simpliste, enfantine, sommaire, mais comme toute grande vérité, isolée et hypostasiée. Ce n’est pas encore le nouvel Emile, mais c’est le nécessaire anti-Emile : “Learning in great. Teaching is ridiculous”. (Lire Freedom to learn, Merril, 1969)31 ». En fait, en dépit des dédains et des rumeurs, ou malgré la distance et le silence de beaucoup d’Américains des Etats-Unis (un long rapport sur l’utilisation du groupe dans les institutions scolaires et universitaires, rédigé pour l’Unesco par un professeur de Stanford, en 1972, ne fait aucune mention de lui)32, Rogers voit se développer l’activité du Centre d’études sur la personne. Il peut tranquillement se réjouir de l’ambiance de jeunesse qui l’environne. Il lui est possible d’écrire en février 1973 : « Le Centre d’études de la personne continue à prospérer (flourish). Il me donne un splendide groupe de gens plus jeunes avec lesquels je puis interagir (interact) personnellement et professionnellement et je l’aime »33. Assuré de cette entreprise, Rogers coopère à des interventions dans de multiples institutions sociales, notamment celles du « mariage » (animé par tant de renouvellements et d’incertitudes), mais également celles des milieux hospitaliers. Il s’engage (working for) pour les élections présidentielles, en faveur de Mac Govern34. Il soutient l’action d’un centre pour la communication interculturelle (Center for Cross-Cultural Communication) qui étend ses entreprises sur les deux Amériques mais aussi en Europe et en Asie : ce centre devait lui fournir l’occasion de plusieurs séminaires en Allemagne, en France, en Hollande et en Suisse, pour l’automne 1974. Si sa santé se maintient, celle de sa femme a été éprouvée par des crises d’arthritisme, l’immobilisant complètement. Une opération avant l’été a redonné à Helen ses possibilités de mouvement après une alerte difficile. « Helen a fait beaucoup de progrès (much improved). Elle nage chaque jour !35 » Et Carl Rogers regarde son époque, s’intéressant aux courants nouveaux. Quelques livres récents, qui « ne sont pas nécessairement de grands livres », lui paraissent signifiants et ont eu un réel impact sur lui : Bodies in Revolt (Corps en révolte), de Thomas Hanna, paru en 1970 ; The Teaching of Dom Juan (Les enseignements de Dom Juan) et The Natural Depth in Man (La profondeur naturelle de l’homme)36. Il avait été intéressé, auparavant par The Greaning of America, de Chas Reich, paru en 1970 ; par The Making of a Counter Culture (La fabrication d’une contre-culture), de Téo Roszat, paru en 1969 ; et par The Pursuit of Loneliness : American Culture at the Breaking Point (La poursuite de l’isolement : la culture américaine au point de rupture), de Philip Glater, paru en 197037. Sa pensée et son œuvre se poursuivent.
Chapitre X
L’ouverture institutionnelle
Comme on vient de le voir, les rencontres avec de multiples groupes sociaux, et sur des domaines d’activité multiples, échappant à l’université et à ses contraintes, encouragèrent en Carl Rogers une prise de liberté par rapport à ses réserves ou à ses rigidités personnelles. Ses implications dans des groupes de rencontre, amorcées dès 1958 grâce à l’insistance de ses anciens assistants Gordon et Farson (auquel il dut, rappelons-le, son installation en Californie) l’avaient touché en profondeur, comme le raconte sa fille Nathalie : « J’ai vu un formidable (tremendous) changement en lui ». Auparavant, « il pouvait aider d’autres gens à s’ouvrir par rapport à eux-mêmes mais il ne disait rien sur lui-même. Les expériences de groupe qu’il a eues l’ont changé dans sa manière d’être, devenue beaucoup plus révélatrice de lui-même (self-revealing), beaucoup plus ouverte sur ses besoins (needs) et se montrant affectueux ou démonstratif… Je ne pense pas qu’il lui serait arrivé de se lever et de se mouvoir physiquement vers quelqu’un, et de façon très proche, avant qu’il eût été dans des groupes de rencontre, connaissant que ce serait solide (matter) et ressenti comme bon aussi bien pour lui que pour l’autre personne »1. La présence des époux Rogers en Californie avait effectivement accru le nombre et la qualité des implications de Carl dans des séminaires et des groupes de rencontre de 1964 à 1968, comme on l’avait vu également en France en 1966 (même si sa démarche avait paru réservée ou distante à certains). Il rencontrerait alors aussi bien des psychologues que des chefs d’entreprise, des administrateurs d’université, des travailleurs sociaux et des infirmiers, mais aussi des groupes interraciaux de prévention sanitaire, des couples, des adolescents, des professeurs et des élèves, ainsi que nombreuses autres personnes2.
Premières rencontres institutionnelles
Dans les années soixante-dix, un nouveau pas fut franchi : et ce serait en 1971, d’abord avec son fils, David. Celui-ci après avoir exercé comme doyen et directeur dans le cadre de l’université et de l’hôpital John Hopkins3, était devenu président de la fondation Robert Wood Johnson, la seconde grande fondation privée, aux Etats-Unis, pour le soutien (sponsoring) de la recherche médicale. Il fut proposé à Carl et David, par Orienne Strode, membre du Centre pour l’étude de la personne (csp), de l’aider à mettre en œuvre un projet portant sur les dimensions humaines dans la formation médicale. Il s’agissait, par des groupes de rencontre, d’aider des formateurs de médecins à devenir plus conscients de leurs propres mouvements et retentissements intérieurs (feelings), mais aussi de ceux de leurs étudiants et des patients. L’expérience extensive qui s’ensuivit donna à Carl l’occasion de rédiger les termes d’une étude sur les groupes de rencontre dans les champs aussi bien professionnels que populaires. Il publia, chez Harper et Row, en 1970, Carl Rogers on Encounter Groups, qui eut un succès foudroyant (« An impressive quarter million copies »4). Cet ouvrage fut publié en français, en 1973, par Daniel Le Bon qui m’avait demandé d’en assurer la préface.
L’Irlande du Nord
Cependant l’évolution des intérêts et des engagements de Carl Rogers allait prendre un nouvel élan. Jusque-là, en effet, il n’avait jamais pensé que sa démarche pouvait avoir quelque particulière signification politique. Sans doute, il s’était personnellement exprimé, antérieurement, en politique, mais comme citoyen, notamment contre la guerre au Viêt-nam (et il nous avait confié ses sentiments sans ambiguïté à ce sujet, en 1966, à Paris, alors même que des assistants du colloque l’incriminaient à propos de cette guerre, comme américain). Mais il y aurait plus cette fois : en 1972, il fut invité, par les soins de Bill Mac Gaw, à coanimer avec un prêtre catholique, Pat Rice, un difficile dialogue de seize heures, sous caméras, en vue de réaliser un film documentaire sur les échanges possibles quoique véhéments au sein d’un groupe constitué de huit Irlandais de Belfast et d’un Anglais : soient cinq protestants et quatre catholiques. Le tournage eut lieu à Pittsburgh, dans les studios de wqed. Carl Rogers consacra quelques pages à cet événement, dans son ouvrage On personal Power qui fut traduit en 1979 sous le titre Un manifeste personnaliste : « Pendant nos séances, les haines, les soupçons, les méfiances des deux groupes en opposition étaient tout à fait manifestes ; présents parfois sous une forme déguisée, ces sentiments s’exprimaient peu à peu de façon plus ouverte. Les individus ne parlaient pas seulement en leur propre nom, ils se faisaient les interprètes des rancœurs et idées préconçues accumulées depuis des générations. Il y a eu seize heures d’échanges en groupes, pourtant, au cours de cette période incroyablement courte, ces haines vieilles de plusieurs siècles ne se sont pas seulement atténuées, dans certains cas elles se sont même profondément transformées. C’est la preuve que des attitudes de facilitation peuvent créer une atmosphère grâce à laquelle peut se produire une expression ouverte. L’expression ouverte, dans ce genre de climat, mène à la communication. Une meilleure communication mène très souvent à la compréhension, et la compréhension balaie beaucoup des anciennes barrières »5. Sa biographe Howard Kirschenbaum commente pour sa part cet événement modeste mais significatif : « Quoique le degré de sincérité émotionnelle et d’intimité (closeness) ne fût pas aussi grand qu’il apparaît habituellement dans les groupes de rencontre, une réelle communication et une compréhension améliorée (improved) prirent place finalement. En fait les participants apprécièrent si fortement leur expérience, qu’au risque de leurs propres vies, ils travaillèrent en équipe, revenus en Angleterre et en Irlande, pour montrer le film dans des salles de cinéma et conduisirent des discussions avec les assistants »6. Et Rogers se demanda ce qui serait arrivé, si au lieu d’un seul groupe, il y en avait eu progressivement des dizaines, puis des milliers, en économie sur les coûts militaires. Précurseur ! J’ai personnellement vu le film de ce dialogue dur projeté à l’Unesco, avec Charles Devonshire qui l’avait apporté. C’est un document pathétique, témoignant de la violence des haines politico-religieuses et de leur difficile expression : mais il rendait sensible l’importance cathartique de leur déroulement accompagné et soutenu par une médiation empathique et confiante, respectueuse des dignités réciproques. Le film reste visible. Il importe de noter que dès cette époque, Charles Devonshire, « Chuck », allait développer un Centre de rencontre interculturel (Center for Cross-Cultural Communication), depuis San Francisco, en liaison intime avec Rogers et l’équipe de la Jolla. Il travaillera bientôt intensément en Europe : en France où il aidera certains d’entre nous à mettre sur pied et à conduire des séminaires approfondis ; en Angleterre, en Italie, en Espagne, mais aussi dans les Pays de l’Est où il entraîne Carl, comme on le reverra. Avec son appui, il édifie, basé à Lugano, un Institut international pour l’approche centré sur la personne, le Person-centered Approach Institute International (pcaii).
Politique enfin !
Le déclic final est dû à Alan Nelson, interpellant en 1973 Rogers à propos de « la politique (The Politics) de l’approche centrée sur le client ». Comme le note sa biographe, « Rogers répondit qu’il n’y avait aucune politique de l’approche, signifiant qu’aucun programme (agenda) politique, partisan, libéral ou conservateur, n’y était impliqué. Nelson éclata de rire à cette réponse, arguant que la philosophie centrée sur le client était révolutionnaire en ce qu’elle mettait les traditionnelles relations de pouvoir sens dessus dessous, cherchant à donner aux clients et aux étudiants un pouvoir et un contrôle sans précédent sur leurs vies, que ce soit en thérapie ou en modalités éducationnelles. N’était-ce pas politique cela ? Ceci fit déclic (clicked) pour Rogers »7. Carl put en ces conditions se rappeler, en cette année 1973, alors qu’il avait reçu la haute distinction professionnelle (Distinguished Professionnal Contribution Award) de l’importante Association américaine de psychologie (apa), ce qu’il avait fait, dans ses débuts, pour bousculer les politiques des milieux universitaires et médicaux, ouvrant à lui-même et à de nombreux psychologues le droit de pratiquer des thérapies malgré la résistance des psychiatres : en donnant un statut scientifique au counseling. Et, faisant allusion aux oppositions incessantes et aux ambivalences qu’il dut affronter, sur presque un demi-siècle d’activité professionnelle, non « politiquement correcte » au gré des conformistes, il put dire alors avec humour : « D’après ce qu’on m’en a rapporté, je serais faible d’esprit, non scientifique, fanatique, trop facile pour les étudiants, bourré d’enthousiasmes étranges et déroutant à propos de choses éphémères, comme le moi, les attitudes des thérapeutes ou les groupes de rencontre. J’ai jeté le discrédit sur les mystères universitaires les plus sacrés : les cours magistraux et tout le système d’évaluation, depuis les grades les plus élémentaires jusqu’au sommet convoité du doctorat »8. Il était donc déjà entré dans les luttes publiques, alors que d’importants mouvements politiques et sociaux s’étaient dans le même temps développés, pour les droits civiques, la Paix, les étudiants et les femmes. Et il était patent que « tous s’étaient mis à parler d’un commun langage de la reprise du pouvoir (empowerment) par les individus. Ils rejetaient la conception d’un contrôle venant du haut, des limitations artificielles à propos de la capacité des Noirs, des Vietnamiens, des étudiants et des femmes à accomplir leur plein potentiel. Ils cherchaient à rendre “le pouvoir au peuple”, à rendre les gens capables de prendre les décisions qui affecteraient leurs vies »9. Rogers put réaliser « que l’œuvre de sa vie apportait un fondement psychologique à ces mouvements politiques et que ces mouvements suggéraient une dimension politique à son travail qu’il n’avait pas reconnue »10. Il put ajouter à sa réflexion la connaissance des idées de Paulo Freire, dont La pédagogie des opprimés parut, traduite en anglais, vers 1970. Il déclara bientôt, dans On
Personnal Power en 1977, que l’approche centrée sur le client, définie
par rapport à la thérapie et à l’éducation, devait s’élargir à une large
variété de champs d’application (mariage, familles, administrations,
minorités, rapports interraciaux, interculturels et même internationaux).
Il lui sembla alors que ce serait une meilleure solution d’adopter un
terme aussi large que possible : « Cen-
L’approche institutionnelle
L’actualisation de cette nouvelle ouverture d’exploration et d’intervention devait s’effectuer cette fois par l’entremise de la fille de Carl, Nathalie (Natalie), comme elle le raconte elle-même : « Alors que j’avais étudié avec mon père et fait des recherches pour lui, je n’avais jamais été sa collègue. En 1974, je rendais visite à mes parents, à La Jolla, et je demandais à mon père (Dad) : “Aimeriez-vous que nous travaillions ensemble ?” “Bien sûr, je le voudrais” répondit-il. Que devons-nous faire ? Je m’assis à la machine à écrire et tapais un projet de séminaire (workshop) résidentiel de dix jours. Nous avons invité une équipe (staff) de cinq personnes, repris mon projet initial et reformulé ensemble (co-designed) un programme résidentiel sur le thème : “L’approche centrée sur la personne”. Pendant six étés nous avons travaillé ensemble dans diverses parties du monde, de San Diego à Nottingham en Angleterre, avec de soixante à cent cinquante participants à chaque “programme” »12. Nathalie ajoute : « Ces séminaires pca (approche centrée sur la personne) étaient de formidables expériences d’apprentissage pour tous, “staff” ou participants tout autant »13. Ainsi donc s’ouvrit et put s’amplifier une longue suite de séminaires approfondis, de grand « format » (par le nombre important de personnes notamment réunies en plénières (community meetings) et implantés sur un large domaine de pays et d’institutions : offrant à Rogers « la décade la plus satisfaisante de sa vie »14. Howard Kirschenbaum a fait la recension suivante de cette « décade » : « De 1977 à 1985, à côté de la douzaine de séminaires et de conférences qu’il tint aux Etats-Unis, Rogers se rendit au Brésil trois fois, au Mexique cinq fois, en Espagne deux fois, en Angleterre trois fois, en Italie deux fois, en Autriche quatre fois, en Allemagne de l’Ouest trois fois ; en Finlande, au Venezuela, en Afrique du Sud, au Japon, en Suisse, en Hongrie et en Irlande, en vue de répandre (spread) l’approche centrée sur la personne. Nombre de ces voyages duraient plusieurs semaines et comportaient deux séminaires ou plus dans chaque pays. Il fit également, sur le plan personnel, des voyages en Chine, en Suisse, au Kenya et au Zimbabwé »15. La France n’est pas mentionnée ! Pourtant Carl Rogers passa avec nous cinq jours au cours d’un long séminaire, à Evry, dans la première quinzaine de juillet 1979. Il tint aussi une conférence de presse, à Paris, le 4 juillet, pour présenter « un manifeste personnaliste ». Il y eut, parmi ses interlocuteurs, Stéphane Lupasco et Didier Anzieu. Enfin, en 1986, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, lui-même et sa collègue Ruth Sanford entreprirent un voyage de quatre semaines en Afrique du Sud comportant des séminaires centrés sur la personne à Johannesburg et le Cap ; un voyage de trois semaines en Union Soviétique, avec deux séminaires intensifs et trois grands meetings publics à Moscou et Tbilissi ; et un voyage d’une semaine en Hongrie pour un séminaire à Szeged, près de Budapest. Le séminaire en Espagne (1978)
A défaut de détailler les éléments marquants de toutes ces nombreuses manifestations à l’étranger, il peut être utile de s’arrêter quelques instants sur des séminaires tels que ceux tenus en Espagne, puis en Afrique du Sud, en Autriche et en URSS. Le séminaire en Espagne a été de « grand format »16 : cent soixante-dix personnes, de vingt pays différents furent réunis pour une douzaine de jours, d’abord dans un grand hôtel de Madrid, ensuite dans un centre d’études à l’Escorial. L’une des originalités de ce workshop devait être la présence en continu de deux équipes de cinéastes, l’une allemande, l’autre américaine, libres de filmer les divers moments de la vie du séminaire. Une autre originalité était la participation de cinquante Espagnols (dont trente ne parlant ni ne comprenant l’anglais) : en pleine période effervescente, politiquement décisive pour l’Espagne sortant de l’époque franquiste avec l’aide du roi Juan Carlos, depuis son avènement en 1975. Et le séminaire se déroulait au cours de la semaine sainte et de la semaine pascale, dont on sait l’importance qu’elles prennent en Espagne. Une troisième caractéristique tenait à la composition internationale du « staff » : outre Carl Rogers, il y avait vingt « facilitateurs », dix Américains et dix Européens (Allemands, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais et Suédois). Ces facilitateurs devaient travailler en couples mixtes américano-européens : j’eus à cofaciliter un groupe de rencontre avec mon amie Gay Swenson, qui parlait le français (et l’avait enseigné) et que j’avais rencontrée avec chaleur l’année précédente à La Jolla. Une quatrième originalité fut qu’il
photographia chaque arrivant, et en lui remettant le cliché « Polaroïd »
instantané à coller sur un tableau de « trombinos- Le déroulement du séminaire devait comporter, comme habituellement, une suite (non programmée d’avance) de réunions plénières des cent soixante-dix personnes (community meetings), des séances de groupes de rencontre (réunissant entre quinze et vingt participants avec un couple de facilitateurs), ainsi que des activités ou ateliers multiples, proposés à tous ou à quelques-uns, et dirigés aussi bien par des participants ou des facilitateurs, à leurs initiatives. Il se ferait aussi beaucoup d’échanges informels. Avant que les participants n’arrivent, le « staff » se prépara. Les uns et les autres firent connaissance. Sans doute, il y avait au départ un large consensus sur l’orientation et le style du séminaire. Carl Rogers, plus tard, devait transcrire, pour un séminaire analogue, ce qui s’était dégagé, progressivement, de la praxis de ces grands groupes : « Le but sera d’associer un apprentissage expérientiel et cognitif — l’approche personnelle et intellectuelle. […] Les étapes initiales seront organisées par l’équipe responsable, mais la structure d’ensemble et les modalités seront une production commune, créée pour répondre aux besoins des participants, y compris des facilitateurs »17. Il y eut donc, dans cet esprit, des discussions très ouvertes, patientes, au sein du « staff », en vue de préciser les dispositions de conduite, notamment pour les « étapes initiales », qu’adopteraient les facilitateurs. Le premier débat vif se souleva à propos de la langue qui serait utilisée au cours du séminaire. Certains européens, comme Reinhardt Tausch de l’université de Hambourg, insistèrent pour qu’il y eut obligation du seul usage de l’anglais : Taush n’avait lui-même autorisé à rejoindre le séminaire que des participants allemands pratiquant couramment cette langue. Avec quelques autres, et soutenu par Charles Devonshire (qui avait développé des relations interlinguistiques dans des actions organisées par son Center for Cross-Cultural Communication), je plaidais pour que la liberté soit laissée à chacun de choisir la langue qui lui permettrait l’expression la plus sûre, la plus sincère, de ses sentiments et de ses idées, quitte à ce que lui-même ou tout autre membre du groupe traduise ses propos ou ses sentiments en anglais et aussi en espagnol. Car il eût été politiquement maladroit et culturellement indécent de ne pas prendre en considération et en charge les trente espagnols n’ayant pas l’usage de l’anglais. Et il importait d’expérimenter, d’« expériencer », la solidarité d’une communication interculturelle la plus ouverte, en évitant de donner l’impression d’une domination américaine ou d’un dédain des minorités linguistiques de notre groupe. Les facilitateurs américains étaient restés discrets au long du débat, qui les intéressait vivement. Mais il leur parut, comme à Rogers et comme à presque tous, en fin de compte, opportun que la liberté de la langue soit offerte18. Il fut ensuite décidé qu’au cours de la première réunion plénière chaque facilitateur pourrait se présenter à son gré et selon son choix de langue (je me souviens de m’être présenté brièvement en anglais et d’avoir traduit moi-même en français, attendant qu’on traduise en espagnol). On évoqua ensuite, librement et sans précipitation, les multiples possibilités d’organisation, en petits et grands groupes, comme en éventualités d’atelier. Il importait de voir explicitées, par les divers participants, des idées et des suggestions, selon leurs besoins et leur créativité : en sorte que puissent émerger, à partir des propositions et des échanges en désordre, la structuration de chaque jour et celle du séminaire, à un terme de mûrissement non défini à l’avance. Le seul cadre temporel annoncé serait celui imposé par les contraintes hôtelières fixant les repas. Au cours du déroulement du séminaire, on doit noter que, pendant les deux premiers jours, les participants ne purent se décider à rompre avec l’envoûtement du grand groupe plénier, ni à provoquer une structuration hâtive. Pour beaucoup, cependant, la situation, chaotique, sans références, était à la limite du supportable. Dans cette « eau-mère » en surfusion, un petit groupe, animé notamment par Brian Thorne, proposa, à la fin du deuxième jour, un noyau de cristallisation des échanges et rencontres par l’affichage d’une répartition quotidienne d’activités définies. Ce partage établissait trois temps : une matinée consacrée aux groupes de rencontre (la composition des divers groupes fut fixée au hasard, par tirage des noms selon un critère de la plus grande différenciation des origines). L’après-midi était ouverte aux offres d’organisation d’ateliers ou autres activités. Le soir de 18 h 30 à 21 heures était réservé à une réunion plénière, officielle, en community meeting. Cette structure, à l’expérience, se montra féconde : en intensité des matinées, en créativité incroyable des après-midi, mais aussi en profondeur des échanges multiculturels, multilingues, des séances plénières. Bien des caractérisations émotionnelles et intellectuelles que décrivit Carl Rogers dans le chapitre huit d’un Manifeste personnaliste, pourraient être reprises pour aider à discerner et comprendre la valeur des relations et des conflits, la qualité des évolutions personnelles et des projets institutionnels qui ont pris place et forme dans les petits groupes et surtout dans le grand groupe, soumis d’autre part au miroir des prises de vues par les cinéastes. Il est possible de dégager trois caractéristiques qui furent signifiantes dans ce séminaire. Tout d’abord, dans les premières séances plénières, un Espagnol maîtrisant bien l’anglais, fut tenté de devenir un interprète officiel, et unique, du grand groupe, dans la traduction de l’espagnol en anglais ou de l’anglais en espagnol. L’initiative d’un autre Espagnol permit de sortir de cette situation réductrice en raison de la prise de pouvoir monopolistique qu’elle impliquait : il se mit à parler en catalan et requit de son compatriote une traduction en castillan. La bonne humeur du groupe permit ensuite une entraide très variée, sans monopole, dans les communications : les uns ou les autres, à tour de rôle et selon leurs compétences linguistiques ou leurs sensibilités, s’employèrent à traduire dans les divers sens les paroles émises, pour tout l’auditoire ou pour un voisin selon les cas. L’expérience nous montrait que cette forme coopérative, compréhensive et empathique, de traduction, loin de freiner les communications et les spontanéités, enrichissait au contraire, par sa tranquille régulation, l’approfondissement des émotions ou des idées et des sentiments exprimés. Et il en fut de même dans les groupes de rencontre, où certains remplirent sans exclusive un rôle de médiateur linguistique et culturel. Et il se fit la même convivialité interculturelle dans les réunions du « staff », chaleureuses ou passionnées selon les moments, assurant par la prise en considération de ses propres remous émotionnels, en écho du vécu multiple des retentissements individuels, la régulation d’ensemble du séminaire. Un second caractère singulier de celui-ci provint de sa situation temporelle, en Espagne, pendant le temps pascal. Le jour de Pâques 1988, la messe fut dite, au centre qui nous abritait, par un jésuite irlandais, travaillant courageusement, dans son Irlande du Nord, à la réconciliation entre Catholiques et Protestants. Il fut assisté au cours de cette messe par un pasteur américain. Nombre de participants de toutes croyances tinrent à assister, avec ferveur et respect, à cet office qui leur fut ouvert et qui prit un caractère émouvant ; Carl Rogers fit lui-même partie de l’assistance. Au moment de l’Eucharistie, le prêtre invita tous ceux qui le souhaitaient à prendre part au partage de la communion, en rappelant avec précision ce que celle-ci signifiait pour les croyants catholiques. Ce furent des moments poignants. Enfin, un troisième caractère tint à l’ambiance, sensible en Espagne à cette époque de reconstruction historique, fortement connotée sur le plan politique. Très vite, dans les propositions d’atelier, un groupe de jeunes Espagnols, fortement motivés, proposa d’organiser un après-midi d’étude sur le sens et l’impact politiques de l’approche centrée sur la personne. Rogers indiqua qu’il y participerait volontiers. Un jeune attaché culturel américain, très au contact de ces Espagnols, accepta de les aider. Et je leur fis part de ma participation à leur projet. Au fil des jours, l’implication de ces jeunes Espagnols dans la multiplicité des activités de chaque journée empêchait toutefois la tenue d’une réunion préparatoire. Devant cette difficulté, ils vinrent me trouver un jour, me proposant de quitter la réunion plénière du soir pour assurer la préparation requise afin d’honorer leur proposition. Je leur donnai mon accord, à condition de nous expliquer devant tous. Le soir, ces jeunes exposèrent donc, dès le début du community meeting pourquoi ils comptaient quitter bientôt le grand groupe, afin de préparer un atelier sur la politique en rapport avec l’approche centrée sur la personne. Il y eut alors des réactions véhémentes : le temps du community meeting était sacré ; il y avait d’autres moments dans les après-midi ; le sujet de la « politique » surprenait, et il était plutôt suspect ou à tout le moins secondaire sinon étranger à un auditoire à dominante de psychologues, d’enseignants, de membres des professions libérales ou médicales et de travailleurs sociaux. La plus vive protestation venait, à ma surprise, de plusieurs facilitateurs américains. Mais Rogers restait silencieux. Je fis savoir que j’accompagnerais le groupe des jeunes Espagnols dans leur travail ; j’eus à supporter une verte prise à partie, en raison de ma responsabilité de facilitateur. J’indiquai que je ne quitterais la réunion plénière que lorsque je serais suffisamment sûr, dans mon expérience interne, de ne pas partir par dépit, par ressentiment, ou par réactionnalité contre les réactions que nous supportions. Et je rappelai que les jeunes Espagnols, et moi-même, aurions pu nous absenter sans prévenir : personne ne s’en serait aperçu, et, d’ailleurs, chacun avait le droit, objectivement, s’il ne se sentait pas dispos, de ne pas assister à la réunion plénière ou à d’autres activités. Notre annonce ouverte était une marque d’esprit démocratique et posait le problème de la souplesse des normes dans une collectivité, et de la marge responsable consentie à des minorités. Les échanges continuèrent assez vifs. Quand je me sentis suffisamment détendu, en équilibre intérieur, je sortis avec les jeunes Espagnols. Nous travaillâmes ferme. Plus tard, le jeune attaché culturel américain vint nous rejoindre : la réunion plénière avait continué, avec une forte émotion, à se saisir du problème de la politique, après notre départ. Et Rogers, qui n’était pas intervenu jusque-là, mais avait patiemment laissé s’exprimer les points de vue divers, exprima sa vive surprise de voir comment, au nom de l’approche centrée sur la personne, un grand groupe voulait censurer certains de ses membres et leur interdire une activité responsable. Ultérieurement, l’atelier préparé par notre petit groupe se tint, et il y eut de profonds échanges centrés sur les positions de Carl Rogers et les préoccupations des Espagnols. De ce séminaire, j’ai retenu aussi la remarque d’un jeune Français disant en substance qu’auprès de Carl Rogers, il éprouvait le sentiment qu’il laissait à chacun une place, aussi bien physiquement que moralement et intellectuellement. Beaucoup d’engagements profonds s’établirent à partir de ce mémorable séminaire de l’Escorial, au niveau européen. Les lieux m’invitèrent à parler avec Rogers du style baroque et de son inspiration dans ce qui se passait entre nous tous, de façon non « classique » mais foisonnante. On peut aussi évoquer ses positions vis-à-vis du phénomène religieux.
Le refus du phénomène religieux ?
Cet homme qui reconnaît dans son autobiographie que sa vie a été marquée par la chance, si proche de sa femme et de ses amis, et aussi sensible à son rôle « d’unité infiniment petite au sein d’un vaste univers », s’est relativement peu exprimé à propos de ses positions métaphysiques et religieuses. Il s’en était expliqué à notre demande, dans une lettre du 20 février 1972 : « On m’a souvent interrogé sur mes vues religieuses ; et cela me rend toujours perplexe de savoir comment répondre. Je sens vraiment que c’est une chose très constructive d’en être venu à reconnaître que « Dieu est mort ». Ce que cela signifie pour moi est que, quoi qu’il arrive à un homme, ou aux hommes en général, maintenant ou dans le futur, cela ne dépend que de l’homme lui-même. Je ne crois pas qu’il y ait aucune force surnaturelle qui puisse venir en aide. Je n’ai aucun recours (I have no use for) à une foi ou à une religion organisée, à une église ou à la prière, à la vie après la mort, ou à d’autres choses qui sont communément regardées comme des parts de la religion. Je pense que Jésus a été un révolutionnaire réel, et que beaucoup de ses idées sont encore signifiantes aujourd’hui ». Issu d’une famille aux fortes convictions religieuses, fondamentalistes, Carl Rogers a été amené à prendre, relativement tôt, ses distances, et à laisser dans l’ombre le domaine religieux. Il précisait, à la suite du texte précédent : « Si cela sonne tout à fait négativement, j’ai aussi la conviction (belief) qu’il est manifeste qu’il y a quelque sorte de force qui est à l’œuvre dans cet univers changeant, et que cette force opère dans les hommes aussi bien que dans les planètes. Je n’ai aucune idée de ce que ce peut être, soit que nous la pensions comme une force personnelle soit comme quelque chose entièrement au-delà de notre compréhension. Je crois qu’il y a dans l’univers un ordre défini par des lois (a lawful order) et que nous sommes bien plus efficaces (effective) quand nous sommes en accord avec cet ordre, que nous soyons en train de parler de la fission de l’atome ou de l’achèvement d’un progrès thérapeutique avec un individu. « J’espère que ceci explique clairement que je refuse d’être étiqueté (labelled) dans le champ religieux. L’affirmation que je produisais quand on me poussait au pied du mur sur cette question était que “je suis trop religieux pour être religieux”. Je crois que ce paradoxe résume très bien ma position. Je suis un idéaliste, un humaniste, et je travaille vers quelques-uns des mêmes buts que ceux vers lesquels travaillent des personnes religieuses, mais je n’ai que peu ou pas besoin des étiquettes (labels) ou des concepts (constructs) de la religion. » Une des fondatrices du Counseling Center de l’université de Chicago avec Carl, Elisabeth Sheerer devait dire, dans une interview de 1990 : « Il s’agissait d’un domaine pénible pour lui. Nous avons appris très tôt qu’il ne convenait pas de parler religion avec Carl. C’était un sujet tabou parce que cela le mettait mal à l’aise ». Brian Thorne, qui cite ce texte, pouvait à bon droit penser à une évolution progressive vers la spiritualité à la fin de sa vie, notamment par le commentaire de Carl, en 1986, à la description d’une rencontre thérapeutique : « J’ai parfaitement conscience que ce compte rendu participe du mystique. Ce que nous éprouvons en nous, c’est évident, comprend du transcendant, de l’indescriptible, du spirituel. Je suis poussé à croire que comme beaucoup d’autres, j’ai sous-estimé l’importance de la dimension spirituelle »19.
Maladie et mort d’Helen
Les voyages à l’étranger, son importante production d’ouvrages denses (Le manifeste personnaliste, 1977, traduit en français en 1979 ; Way of Being, 1980 ; Freedom to Learn in the 80th, 1983), durent se faire alors que Carl eut à vivre des moments éprouvants dans la relation avec sa femme. Helen devint en effet gravement malade à partir de 1977. Déjà, au cours d’un voyage à La Jolla, l’été de cette même année 1977, nous avions rencontré Helen, fatiguée mais si accueillante, et Carl, chez eux, dans leur agréable villa ceinte du jardin où Carl s’adonnait à sa passion pour les plantes. Il y avait dans ce jardin des colibris et je fis remarquer à Carl que « l’approche » des fleurs par ces oiseaux était, métaphoriquement, analogue à celle qu’on lui devait, en pratique interpersonnelle : s’approchant et s’éloignant incessamment des corolles par l’effet de leurs ailes (puissamment articulées dans leur corps minuscule), sans les blesser ni s’en éloigner, pour recueillir leur nectar. Je songeais à cette maîtrise d’une présence-distance ajustée, ou, plus précisément à cette régulation d’une présenciation-distanciation, si on veut bien utiliser le terme de distanciation proposé pour définir, selon Berthold Brecht, l’attitude adéquate d’un acteur par rapport au personnage dont il remplit le rôle. Et je proposai aussi à Carl, avec son acquiescement, le concept de « non-défensivité », pour illustrer également l’alerte constitutive de sa démarche, de façon moins contestable que le terme de non-directivité. Dans cette rencontre amicale avec les Rogers, nous avions pu comprendre, ma femme et moi, les difficultés de santé d’Helen. Par la suite, nous avons rencontré Rogers seul, dans diverses réunions, dans des rencontres sur la plage de La Jolla, ou à des invitations au restaurant qui nous furent faites par lui-même ou par ses proches amis. Les préoccupations pour la santé de sa femme éprouvèrent fortement Carl. Sans doute, à cette époque, était-il attiré par des relations avec d’autres femmes. Dès 1975, il se lia intimement avec Ruth Sanford à un congrès de l’American Academy of Psychotherapists, à la suite duquel, ayant dîné avec le physicien Tretjof Capra, ils allèrent danser, comme ils le firent souvent ensuite20. Rogers se sentit bientôt partagé entre d’une part le souci d’être présent à Helen devenue très dépendante de lui en raison de la maladie et des hospitalisations (avec des alternatives d’espérance et de désespoir) et d’autre part, le besoin de préserver sa propre personnalité, ses activités professionnelles et son évolution affective. Celle-ci était désormais accélérée par sa moindre réserve à l’égard des autres personnes, au plan sensible et physique. Carl écrit courageusement, dans A way of being, qui paraîtra en 1980 : « Elle faisait de remarquables progrès dans sa lutte pour retrouver, souvent par une pure (sheer) force de volonté, une vie plus normale, bâtie autour de ses propres projets. Mais cela n’a pas été aisé. Elle eut d’abord à choisir si elle désirait vivre ou s’il n’y avait pour elle aucun attrait, aucun sens, à continuer de vivre. A ces moments, je l’ai défiée, contrecarrée, contrariée (baffled) et blessée par le fait de ma propre vie indépendante. Quoiqu’elle fût si malade, je me sentis gravement encombré, écrasé (burdered) par notre étroite façon confinée d’être ensemble (close togetherness) renforcée par son besoin de sollicitude. Aussi, j’ai décidé, pour ma propre survie, de vivre une vie de mon choix (of my own). Elle est souvent blessée par cela, et par le changement en cours de mes valeurs. De son côté, elle se replie sur le vieux modèle d’être une femme qui aide et supporte. Ce changement la met en contact avec sa colère contre moi et la société lui donnant ce rôle socialement approuvé. Pour ma part, je m’irrite contre chaque impulsion à revenir à notre ancienne communauté complète ; je résiste opiniâtrement à ce qui m’apparaît comme un contrôle. Aussi il y a beaucoup plus de tensions et de difficultés dans nos relations que jamais auparavant, beaucoup plus de sentiments que nous nous efforçons de dépasser (to work through), mais il y a aussi plus d’honnêteté, dans la mesure où nous tentons de construire de nouvelles façons d’être ensemble. Ainsi cette période a comporté luttes et tension. Mais elle a contenu une profusion d’expériences positives »21. Carl eut besoin d’être aidé par un collègue dans cette douloureuse situation, si déchirante pour lui, comme il avait dû l’être autrefois à Chicago, après son retour de leur « voyage-fuite » en 1949. Il y eut aussi entre eux, avant que la santé d’Helen ne déclinât trop, la rencontre avec un médium, désintéressé, qui avait fait expérimenter à Helen un « contact » avec sa sœur décédée, impliquant des faits que le médium ne pouvait avoir connus. Les messages, reçus sur une table de leur salon, étaient « extraordinairement convaincants », reconnut Carl22. Plus tard, Helen fit des rêves à propos de membres de sa famille qui la rendirent certaine de les retrouver « de l’autre côté ». Elle fut même éprouvée par des visions de figures méchantes et du diable. Un ami lui ayant suggéré que ce pouvait être des créations de son propre esprit, elle les rejeta, disant avec humour au diable qu’« il avait commis une faute de venir et qu’elle ne partirait pas avec lui »23. De fait, il ne réapparut jamais. Et, en revanche, Helen eut des visions d’une lumière blanche et inspirée qui la soulevait de son lit d’hôpital et la reposait à nouveau. De son côté, Carl avait senti la distance entre elle et lui se creuser considérablement. S’il désirait prendre soin d’elle, il n’était plus sûr du tout de l’aimer. Un jour, cependant, alors qu’elle était proche de sa mort et qu’il allait à l’hôpital comme d’habitude pour l’aider à manger son repas du soir, il se sentit intimement pénétré par l’importance de l’amour qu’il lui avait porté, de la signification qu’elle avait eue dans sa vie, du nombre des initiatives positives auxquelles elle avait « contribué » au cours de leur long compagnonnage. Il perçut également qu’il lui avait déjà dit toutes ces choses auparavant, mais que, cette nuit, elles avaient pris une intensité et une sincérité décisives. « Je lui dis qu’elle ne devrait pas se croire obligée de vivre, que tout était bien avec sa famille, et qu’elle devrait se sentir libre de vivre ou de mourir, comme elle le désirerait. Je lui dit aussi que j’espérais que la lumière blanche reviendrait à nouveau cette nuit. D’une manière évidente, je l’avais libérée du souci de sentir qu’elle devait vivre — pour les autres. J’appris plus tard, après l’avoir quittée, qu’elle appela ensemble les infirmières du palier, les remercia pour tout ce qu’elles avaient fait pour elle et leur annonça qu’elle se préparait à mourir (she was going to die). Au matin, elle était dans le coma, et le matin suivant, elle mourut paisiblement, avec sa fille tenant sa main, plusieurs amis et moi-même présents »24. Des amis, au cours d’une séance avec le médium mentionné plus haut, eurent l’impression d’un dialogue avec elle dont ils firent part à Carl : elle aurait entendu tout ce qui s’était dit quand elle était dans le coma ; elle aurait revu la lumière blanche et des esprits venant pour elle, elle restait au contact de sa famille ; elle avait la forme d’une jeune femme ; sa mort avait été très paisible et sans tristesse. Rogers eut le sentiment, comme il nous le confia à un séminaire à Evry, en 1979, trois mois plus tard, qu’Helen lui envoyait le message d’être heureux. D’une incrédulité totale à propos de l’au-delà ou des manifestations paranormales, il devenait alors moins ferme dans son agnosticisme : « Je considère maintenant qu’il est possible que chacun de nous soit une essence spirituelle continuant et durant au-delà du temps, et occasionnellement incarnée dans un corps humain »25. « A cause ou en dépit » de la mort de sa femme, Rogers accepta plus d’invitations immédiates que jamais à participer avec ses amis à des séminaires en Amérique ou ailleurs : au Venezuela, pour des éducateurs ; à Rome, avec une équipe internationale, pour une turbulente manifestation ; à Paris, pour des facilitateurs en formation mais aussi à Long-Island, à Princeton (ce lui fut dur), en Pologne (fascination workshop, près de Varsovie) et aussi à New York26. Un peu plus tard ce serait notamment les interventions en Afrique du Sud, en Autriche (pour l’Amérique centrale) et en URSS, qu’il est intéressant d’analyser. Il nous faut observer, auparavant, que pendant ces intenses années, à partir de 1980, Carl avait « rejoint la jeune génération. A l’âge de soixante-dix-huit ans, il développa des relations intimes, amoureuses, sexuelles, avec trois femmes et maintint ces trois relations simultanément pour les six ou sept années suivantes. C’étaient des femmes d’âge mature, professionnelles, qui comprenaient et acceptaient la situation et chérissaient leur relation avec Rogers, comme il le fit avec elles ». Howard Kirschenbaum précisait : « Il s’arrangeait pour maintenir chacun de ces compagnonnage (partnership) comme une relation discrète, délicate et précieuse »27.
Afrique du Sud (1982 et 1986)
Carl Rogers effectua ses voyages en Afrique du Sud, accompagné par Ruth Sanford : le premier en 1982, du 25 juillet au 17 août, le second en 1986. Sur sa demande, il avait reçu la promesse de rencontrer une large « variété » de gens et de groupes : en 1982, avec Ruth, ils rencontrèrent près de quinze cents personnes, Blancs ou Noirs, Métis, Indiens et Chinois, de milieux fortunés ou de ghettos noirs, universitaires, étudiants, membres d’organisation d’aide ou de conseil, directeurs d’école, mineurs, écrivains, journalistes, psychologues, hommes d’affaire, sorciers soignant des malades. Carl et Ruth en faisaient la recension détaillée en tête du rapport de cent quarante-trois pages, établi à partir d’enregistrements dictés par l’un ou par l’autre et réciproquement vérifiés. Ils notaient aussi les activités touristiques et culturelles réalisées, notamment l’assistance à des danses tribales chez des mineurs et la visite du Parc national Kruger. Entre autres expériences, au cours de leur rencontre avec les directeurs d’école noirs de Soweto (ouverte et conclue avec des prières et des chants), Carl parla de l’universelle curiosité des jeunes, mais aussi, en référence à des recherches récentes, à l’extinction progressive de leur enthousiasme. Et il évoqua sa propre expérience de vie responsable, attachée à la terre, dans la ferme où il avait grandi. Interrogés sur le point de savoir s’ils avaient eu des problèmes analogues, les directeurs évoquèrent leur problèmes d’aliénation, le petit nombre d’enfants restant plus de quatre ans à l’école, leurs bas salaires, la pénurie des moyens, et du côté des familles, l’absence des pères éloignés par leur travail de survie difficile et le travail des mères comme personnel de maison dans des familles blanches. A propos du maintien de la discipline et de l’intérêt des élèves, Rogers cita une phrase d’une étude d’Aspy-Rœbuck : « Cela paie d’être humain dans la classe », ce qui déclencha un échange émotionnel. Il fut question des punitions corporelles sévères, pouvant aller jusqu’à des blessures. La majorité des présents soutenait l’idée de considérer l’enfant comme une personne digne de respect quoiqu’il ait besoin de discipline et de guidage. Mais un directeur intervint avec une véhémence sincère : « Si vous épargnez les verges, vous spoliez l’enfant ». Carl et Ruth répondirent que quoique en désaccord avec sa déclaration, ils respectaient son courage de s’exprimer à rebours des opinions tenues par ses collègues et par eux. Cet accueil des sentiments réels et non pas convenus, autorisa des témoignages approfondis portant sur les difficultés à renoncer à une conduite autoritaire, mais aussi sur les résultats obtenus par un participant pratiquant avec patience une attitude plus respectueuse des enfants. Ruth observa, d’autre part, que dans cette assistance dont la moitié était féminine, les hommes parlaient la plupart du temps28. Mais ce fut une constatation plus générale que firent alors Ruth et Carl ; l’Apartheid, l’oppression dominatrice se propageait des uns sur les autres, en droit comme en fait. Elle n’existait pas seulement entre blancs et noirs, mais aussi, de façon troublante, entre hommes et femmes noirs, entre noirs collaborationnistes ou non, entre adultes et enfants, entre enseignants et élèves, mais aussi entre maris et femmes noirs (obligées de demander la permission à leurs maris aussi bien pour aller à l’église que pour assister aux réunions, même avec Ruth et Carl, alors que les hommes pouvaient se permettre toutes les libertés hors du foyer sans qu’il soit possible de les questionner ou d’en parler avec eux). Devant travailler souvent avec de vastes auditoires (de plusieurs centaines de participants) au cours de séminaires de week-end, sans possibilité d’organiser de petits groupes, Carl et Ruth adoptèrent plusieurs dispositifs. Tout d’abord ils introduisirent une procédure d’échange interpersonnel approfondie, entre eux deux. Ils firent également, avec des volontaires, mais choisis au dernier moment par Ruth, des démonstrations d’entretiens avec Carl, centrés sur la personne, notamment devant six cents participants, comportant pour Carl et son interlocuteur un moment initial de recueillement tranquille en vue d’oublier toute technologie suspicieuse29. Dans une université blanche, à
Stellenbosch, devant deux cents étudiants et pro- Carl et Ruth conduisirent aussi devant leurs grands auditoires des entretiens de groupe entre personnes blanches et noires (sept Blancs et quatre Noirs). Malgré les fortes difficultés rencontrées, ces grandes réunions se terminèrent habituellement par des manifestations d’enthousiasme intense : elles firent prendre conscience des possibilités potentielles de dialogue entre les communautés opposées, mais aussi entre femmes et hommes. Au terme de leur premier périple en Afrique du Sud, s’ils étaient frappés par la dureté des conditions de vie dans ce pays où les populations noires étaient malmenées et parquées dans des ghettos, et où les Afrikaners affirmaient une culture rigide basée sur une conception austère de l’Ancien Testament, ils constataient aussi l’extrême complexité de la situation interculturelle : non pas fondue selon un « melting-pot », mais cloisonnée comme dans un pigeonnier, selon des cases hermétiquement closes, « chacune séparées des autres par une multitude mystificatrice de lois et de règlements »31. Ils pouvaient, en forme de bilan (prophétique ?) néanmoins conclure : « Nous avons trouvé les Blancs de l’Afrique du Sud accueillants, intelligents, courageux, amicaux, d’orientation conviviale, loyaux à l’égard de leur pays. C’est une population belle, avec d’énormes capacités. Nous avons trouvé les Noirs avec lesquels nous sommes entrés en contact généralement gais, en dépit de leur angoisse sous-jacente, incroyablement patients, riches de leur lien à la nature, pleins d’espoir, fiers de leur héritage — présentant encore un grand réservoir de potentiel humain. Nous avons trouvé ici une émouvante ardeur pour le dialogue. Les gens ont été depuis trop longtemps fermés les uns aux autres. Ils désirent déborder les barrières qui leur ont été imposées et réellement se toucher. […] Il y a une réelle chance qu’un changement significatif dans le système puisse s’effectuer sans violence »32. Cette vue prophétique, en 1983, était consolidée en 1986 par une nouvelle aventure de cinq semaines en Afrique du Sud, marquée par des rassemblements en nombre égal de Noirs et de Blancs en grands groupes et en groupes de rencontres articulés. Rogers pouvait en dire « qu’il n’avait jamais eu l’expérience de telles profondeurs de rage, de dépit et de souffrance (de la part des Noirs) et d’une telle peur et d’une telle culpabilité, ou de tels torts reconnus (de la part des Blancs). La meilleure conclusion de ce voyage fut l’invitation urgente de revenir en 1987 »33. De son côté, Ruth prenait acte des progrès réalisés depuis leur précédent voyage : « Les gens étaient visiblement plus confiants, ouverts et désireux d’engager une rigoureuse confrontation avec leurs propres sentiments »34. Rogers ne pourrait accomplir le voyage projeté pour 1987, en raison de sa mort. Mais peu après celle-ci, à la suite de deux ans de préparation, en 1990, Nelson Mandela fut libéré et l’évolution vers la démocratie, annoncée, souhaitée et prévue par Carl et Ruth, allait devenir effective par la rencontre interpersonnelle du président de Klerk et du futur président Mandela, consacrée par le prix Nobel de la Paix.
« Le défi de l’Amérique centrale » (1984)
Parmi les dernières activités par lesquelles Carl Rogers manifesta son intuition pionnière (prophétique ?) de l’évolution des temps, il faut noter le séminaire portant sur « le défi de l’Amérique centrale » et qui se tint en Autriche, près de la frontière hongroise, à Rust, du 1er au 4 novembre 1984. Cette année 1984, Carl Rogers avec l’aide de Gay Swenson et du Centre d’études de la personne, avait créé un Institut pour les applications à la paix des approches centrées sur la personne. Une des réalisations d’un projet pour la paix (Carl Rogers Peace Program) fut alors ce séminaire de Rust, « The Central American Challenge », notamment centré sur les conflits relatifs au Nicaragua, et organisé avec la collaboration de l’université pour la paix, des Nations Unies, dont le président-fondateur était le professeur Rodrigo Carazo, ancien président du Costa-Rica. Après une laborieuse préparation (en raison des distances et des différences de cultures), la « conférence » eut lieu avec l’aide du gouvernement autrichien. Une cinquantaine de personnalités furent alors réunies, sans ordre du jour (agenda) prédéterminé, ce qui est plutôt inhabituel pour une rencontre internationale, sous la responsabilité de Carl Rogers et de Rodrigo Carazo, assistés de huit facilitateurs du Centre d’études de la personne. Les participants parlaient anglais ou espagnol, trois interprètes assurant une traduction « consécutive » : celle-ci permettait une première prise en considération de l’attitude expressive de chaque personne qui parlait, en attendant la traduction immédiate de son message verbal35. Après les surprises et les tâtonnements perplexes des premières réunions plénières, une organisation souple fut mise en œuvre le deuxième jour : le matin, réunion plénière de dix heures à treize heures ; l’après-midi, quatre réunions simultanées de petits groupes (de dix à douze personnes) avec la présence de deux « facilitateurs » s’appliquant à laisser ouverts les échanges de vue, de quinze heures à dix-sept heures trente ; en soirée, des exposés, l’un par Rogers, l’autre par Carazo, suivis de discussions. Rogers avait, dès le début, assuré les présentations du « staff », remercié tous ceux qui avaient aidé, souligné qu’on pouvait utiliser toute voie qu’on voudrait choisir. S’il se trouva des représentants qualifiés des pays d’Amérique latine, Carl Rogers, malgré ses efforts et quoiqu’il y eut la présence de personnalités des Etats-Unis, n’avait pu obtenir la participation de représentants officiels du département d’Etat, qui, après une acceptation initiale, s’étaient récusés au dernier moment. Parmi la cinquantaine de participants (équilibré en nombre pour les sexes et les bords politiques), il faut noter, en contrepartie, outre l’ancien président du Costa-Rica, l’actuel vice-président de ce pays, trois représentants de ministères des Affaires étrangères, sept ambassadeurs, sept parlementaires, mais également les anciens présidents de l’Honduras, du Salvador et de la Colombie ; deux ambassadeurs, l’un du Nicaragua, l’autre du Venezuela. Il y avait aussi douze académiciens et dix-sept représentants d’institutions et de fondations intéressées aux problèmes de la paix (peace-oriented). Tous ces gens venaient de dix-sept pays : Allemagne de l’Ouest, Autriche, Chili, Costa-Rica, Colombie, Etats-Unis, Honduras, Hongrie, Inde, Israël, Mexique, Nicaragua, Philippines, Pologne, Salvador, Suède, Suisse. Notons qu’à la moitié du séminaire, Leopold Gratz, ministre des Affaires étrangères d’Autriche rendit solennellement visite aux participants avec l’appui des médias36. Dans le climat de sécurité psychologique établi par le « staff », soutenant l’expression des sentiments les plus vifs, des relations de confiance purent se stabiliser, après un démarrage pourtant brutal. Un Américain interpella, en effet, un officiel nicaraguayen, en lui demandant : « Pourquoi restreignez-vous la liberté de votre peuple ?37 ». Le Nicaraguayen regretta que ce soit à propos de son pays que commencent les échanges de vues, mais il exprima le souhait que les participants des Etats-Unis repartent dans leur pays avec certains faits précis ; et il raconta quelques modalités d’intervention des Etas-Unis, traitant son pays de « république bananière ». Des Vénézuéliens intervinrent aussitôt pour dériver vers d’autres sujets ce thème brûlant du face à face trop immédiat entre Américains du Nord et Nicaraguayens — Rodrigo Carazo devait, par la suite, souligner dans son groupe, la totale franchise qui se manifesta dans l’approche de tous les problèmes. « Il n’y a pas eu de langage diplomatique. Sur le plan politique, il y a eu des clarifications. Nous avons même été rudes à certains moments, et cela a été dur pour moi de me montrer ainsi. Les hommes sont un mélange de cœur et de raison »38. Carl Rogers pouvait observer : « Ce
fut une expérience positive, profondément satisfaisante. Nous avons appris
que des gens de haut statut, responsables politiques, hauts
fonctionnaires, façonneurs (shapers) éminents des opinions
publiques, sont dans une importante mesure, vraiment semblables aux gens
avec lesquels nous avons habituellement affaire. Ils désirent un contact
plus personnel, une communica- « Optimisme prudent », reconnaissait de son côté Larry Salomon qui fut facilitateur. Ou naïveté américaine ? Ou rêve de Rogers qui commencerait à devenir vrai, comme le titrait le Los Angeles Time du 30 octobre 1985 ? Rappelons que, par la suite, des négociations impulsées par le président (en fonctions) du Costa-Rica établirent la paix au Nicaragua, valant à ce président un prix Nobel de la Paix. On peut se souvenir aussi qu’une parlementaire suédoise, présente à Rust, annonça son désir d’organiser à Stockholm un séminaire analogue et qu’un Palestinien demanda si une telle approche était possible entre populations du Moyen-Orient. Il n’est pas interdit de penser aux négociations entre Shimon Pérès et des représentants d’Arafat qui eurent lieu en Suède, permettant une grande avancée vers la paix.
« Réception enthousiaste » en URSS (1986)
Rogers avait, en juillet 1985, participé à un séminaire de deux semaines, à Budapest, avec trois cents participants, organisé par Charles Devonshire et Alberto Zucconi. Avec eux, accompagné de Ruth Sanford, il alla au printemps de 1986 en Italie et en Grèce. Mais l’étape cruciale, et la dernière, fut effectuée dans ce qui était encore l’empire d’urss. Carl, aidé de Ruth, écrivit un large rapport, qui fut publié par le Journal of Humanistie Psychology (vol. 27, n° 3), en été 1987 (et republié dans The Carl Rogers Reader). Cette fois, à la suite de l’intervention patiente d’un ami de l’association de la psychologie humaniste, parlant russe, Francis Macy, Rogers et Ruth Sanford furent invités officiellement avec lui, en juin 1986, par le docteur Alexei Matyushkin, directeur de l’Institut de psychologie générale et pédagogique de Moscou, leurs frais de séjour payés intégralement. Il s’agissait d’un programme réparti entre le 25 septembre et le 15 octobre, où furent alternés des séminaires résidentiels de cinq à six jours et des conférences publiques, à Moscou et à Tbilissi : sur les thèmes (topics) de l’éducation humaniste, de l’instruction individualisée et des méthodes en vue de stimuler la créativité : « Nous eûmes du mal à croire que ces deux thèmes étaient désirés par les officiels soviétiques, mais ils l’étaient »41. Les rencontres publiques (public meeting) rassemblèrent des auditoires très nombreux : près de quatre cents à l’Institut du dr Matyushkin, neuf cents à l’université de Moscou (étudiants et professeurs) et, finalement presque deux mille au total à Moscou, en comprenant les participants aux séminaires résidentiels. Les meetings « publics » duraient trois heures dans la matinée et trois heures l’après-midi. Ruth et Carl adoptaient la procédure qu’ils avaient mise au point en Afrique du Sud : un échange approfondi entre eux, traduit par deux interprètes, Dima et Irina ; la proposition agréée puis la réalisation devant le grand public d’un entretien de thérapie conduit par Carl, avec une personne (choisie, pendant une interruption de séance, par Ruth), entretien qui malgré les difficultés pratiques se révéla, non pas « artificiel » mais « intense et profond »42 ; enfin une longue et large discussion ouverte avec le public. « Nous avons trouvé, écrira Carl, un énorme intérêt porté à la psychologie humaniste et à l’approche centrée sur la personne. Il y avait une très large connaissance de mon travail. Quand je demandais à l’auditoire de l’université combien de gens avaient lu au moins un article ou un chapitre de moi, au moins 85 % d’entre eux ont levé la main »43. Nombre d’articles et de textes de Rogers se révélèrent avoir été traduits en russe et diffusés. Et Rogers apprécia la qualité professionnelle des nombreux thérapeutes et psychologues, plus nombreux, de fait, que les éducateurs, ainsi que leur ouverture personnelle, même s’il fit quelque humour sur la complication des procédures bureaucratiques locales (« plus compliquées même que les politiques semblables aux Etats-Unis »44). Avec l’aide de Francis Macy, Ruth et Carl surent discerner les voies d’adaptation de ce qu’ils apportaient à des personnes de cultures si différentes des leurs. Les séminaires intensifs posèrent de
difficiles choix d’admission, tant il y eut de demandeurs. Ils réunirent
une quarantaine de personnes, au lieu des trente souhai- Beaucoup de problèmes personnels qui furent alors exposés étaient en rapport avec la grande fréquence des divorces et avec les enfants dans ces situations. Une enseignante s’exprima très longuement à propos de ses élèves et de son travail dans une école expérimentale. Le troisième jour, Carl et Ruth proposèrent une expérience d’empathie par triades : un observateur, un « client » et un « thérapeute » volontaire, en échange réel (et non pas en jeu de rôles) avec une rotation successive des positions. Après une première démonstration devant tout le groupe, celui-ci fut distribué en triades, qui furent efficaces pour faire constater par tous que les gens avaient effectivement pratiqué « ce qu’ils avaient lu à propos de l’écoute, parlé à son propos, enseigné à son propos !46 » Il devint possible à Carl de relater, brièvement mais significativement, les changements qui apparurent chez certains participants : arrivant à se rencontrer personnellement ; ou trouvant une signification à leur vie propre (en référence à l’un des facilitateurs) ; faisant un geste affectueux à l’égard d’une enfant rejetée ; établissant de nouvelles relations professionnelles avec leurs subordonnés ; changeant d’attitude vis-à-vis de leurs conjoints ; retrouvant la possibilité de pleurer. Dans l’ensemble, il sembla à Carl que si les participants étaient souvent insensibles les uns aux autres, cependant tout changeait quand quelqu’un s’exprimait avec son cœur ou avec des sentiments viscéraux. Ils se sentaient souvent dépourvus d’aide pour changer. Mais, aussi bien à Moscou qu’à Tbilissi, une grande libération d’expression libre apparaissait à la fin des séminaires : de façon tout à fait analogue à ce qui se passe « dans les groupes semblables aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique, au Japon, en Pologne, en Hongrie, en Italie, et au Royaume-Uni » observait Carl. Il ajoutait, en incluant alors spécialement l’Afrique du Sud, que dans chaque culture, il y a « la faim pour une communication plus profonde et plus personnelle et le désir d’être accueilli (accepted) comme une personne réelle »47. Ruth avait constaté avec Carl la tension qui existait entre les femmes et les hommes, et qui ne fut discutée ouvertement qu’à Tbilissi. Ils remarquèrent aussi qu’il n’y eut jamais de discussion ouverte à propos des systèmes de gouvernement, mais qu’il y eut souvent l’expression d’un désir aigu pour plus de dialogue et de compréhension entre leurs nations, ainsi qu’une espérance pour la paix. A leur surprise, Carl et Ruth furent aussi invités par le Dr Matyushkin a une rencontre avec son conseil scientifique, composé de membres de l’Académie des sciences et d’autres instituts, en présence de participants du séminaire et de trois cent cinquante personnes. Le principe fut que les participants au séminaire, hommes et femmes, prennent la parole sur leurs expériences, en l’ayant demandé par écrit : trente d’entre eux demandèrent à parler ; neuf seulement purent s’exprimer dans la durée d’une heure et demie. « Il était clair qu’ils s’étaient réappropriés leur pouvoir (they had empowered themselves), et qu’ils entendaient simplement dire la très grande audience que le séminaire avait signifiée pour eux. Leurs propos étaient très impressionnants, couvrant à la fois les aspects personnels et professionnels de leur expérience »48. Tous ces propos furent enregistrés. Certains portèrent : sur l’aspect scientifique de l’approche centrée sur la personne ; sur la nature de la science elle-même ; sur la thérapie et l’écoute libératrice ; sur la manière d’être attentive de Carl et de Ruth avec leurs silences et leurs voix ou leurs regards offrant de vraies réponses ; sur l’entente possible entre les deux grands pays ; sur la possibilité d’être réel ; sur la juste situation d’un psychologue entre des professeurs et leurs élèves ; sur la façon d’apprendre à l’intérieur de soi-même au cours des silences ; sur les voies pour être soi-même49. Les principes de l’approche avec sa formulation en termes d’hypothèse (si certaines conditions existent, toutes définissables et, même, mesurables, alors un processus définissable devrait émerger, avec des caractéristiques qui pourraient être décrites) se voyaient explicités comme une expérience vraiment scientifique en termes soviétiques, mais en permettant leur compréhension de façon expérientielle autant que cognitive, selon une confiance courageusement maintenue par les facilitateurs à l’égard des individus et des groupes50. Dans des périodes de temps aussi limitées (quatre jours pour les séminaires) des changements notables d’attitude et de comportement étaient donc observables, à la grande surprise des collègues soviétiques. « Le fait qu’un homme et une femme pouvaient travailler confortablement ensemble, sans compétition, en tant qu’individus séparés et différents, fut souvent commenté, et sembla avoir eu un impact net sur cette société dominée par les hommes »51. Carl et Ruth apprirent beaucoup de leurs rencontres sur les attentes professionnelles et personnelles des gens, leur faim de communication avec les Américains, la grande variété des cultures dans l’urss, la grandeur de l’histoire de la Russie, la crainte de la guerre accentuée par les souvenirs encore vifs des ravages dus à la précédente. Ils revinrent en espérant un nouveau voyage en ce pays, avec un grand nombre d’Américains, pour des rencontres à une grande échelle.
Retour, fête et nouveau départ
Le retour d’urss, en cette fin de l’ère gorbatchévienne, aurait donc un caractère prémonitoire sur l’ouverture des pays de l’Est qui allait se produire à partir de la chute, aussi symbolique que réelle, du mur de Berlin en 1989, trois ans plus tard. Précurseur des mouvements en préparation ? Sourcier des courants sous-jacents ? ou personnalité empathique, comprenant les évolutions en cours dans la civilisation en cette fin de siècle (dont le sociologue français Maffesoli, dans son ouvrage Le temps des tribus, avait assuré (p. 24) : « On peut dire qu’on assiste tendanciellement au remplacement d’un social rationalisé par une socialité à dominante empathique ») ? En toute hypothèse, Carl Rogers apparaissait en cette fin de l’année 1986, comme un homme de son temps. Et ses amis lui préparèrent une digne et chaude célébration de son anniversaire, pour ses quatre-vingt-cinq ans, avancée au 22 décembre 1986, afin de profiter des vacances et pour ne pas gêner son départ vers l’Afrique du Sud, prévu pour janvier 198752. Cent cinquante collègues et amis honorèrent Carl Rogers et le Centre d’études de la personne au Lyseum Theater de Horton Plazza. Parmi les messages de vœux, on peut noter ceux du docteur Jonas Salk (célèbre pour son vaccin contre la poliomyélite) et de l’acteur Dennis Weaver, mais surtout celui de l’ancien président Carter : « Votre œuvre comme faiseur de paix (peacemaker) est internationalement connue et hautement respectée, le monde devrait utiliser un plus grand nombre de citoyens tels que vous ». Ainsi, en légitime euphorie et en fête se préparait un ultime voyage de Carl Rogers avec Ruth Sanford, « l’esprit dansant », comme il l’avait appelée un jour. Et, certes, ils dansèrent souvent ensemble, sur des airs classiques, jusqu’à même cette nuit de janvier 1987 où, après une longue séance de travail, Rogers suggéra à sa compagne d’aller à Las Vegas pour le week-end, ce qu’il n’avait jamais fait ni imaginé faire jusqu’ici et qu’il trouvait amusant de réaliser. « Ils y allèrent. Ils visitèrent les night-clubs, dansèrent, jouèrent un peu (gambled a bit) et eurent beaucoup de bon temps. Plus tard, revenus à La Jolla, ils mirent des disques et chantèrent ensemble des airs à la mode (show tunes). Au milieu de la nuit, Rogers fit une chute en se rendant à la salle de bain et fut conduit en urgence à l’hôpital avec un col du fémur cassé. Il supporta bien l’opération, mais la nuit suivante, il eut une crise cardiaque et tomba dans le coma. Selon ses vœux, les systèmes de réanimation artificielle furent débranchés après trois jours, le 4 février 1987. Carl Rogers mourut avec autour de lui sa famille et quelques-uns de ceux qu’il aimait »53, le jour même arrivait au Centre d’études de la personne la lettre annonçant « sa nomination pour le prix Nobel de la paix en 1987 »54. Ainsi se finit sur des pas de danse
et des chansons, mais aussi sur une espérance de gloire, un grand destin
de psychologue rigoureux et de révolutionnaire « tran- 1. Cf. J. Attali, Chemins de sagesse : traité du labyrinthe, Paris, Le Seuil, 1996. 2. Howard Kirschenbaum, Positive Regard, Carl Rogers and other Notables He Influenced, Science an Behavior Books, California, Palo Alto, 1995, p. 71. Notons qu’en 1956, Rogers fut l’un des trois premiers psychologues à recevoir la haute distinction de l’apa (American Psychological Association) qui venait d’être créée, les deux autres bénéficiaires étant Wolfgang Kohler et Kenneth Spence (ibid., p. 34). 3. Ibid., pp. 34-35. 4. Ibid., p. 71. 5. H. Kirschenbaum et V. Henderson, The Carl Rogers Reader, Introduction, Boston, Houghton Mifflin cy, 1989, p. XIII. 6. Ibid. 7. B. Thorne, Comprendre Carl Rogers, Paris, Privat, 1994, p. 90. 8. Ibid., p. 90. 9. H. Kirschenbaum, Positive Regard, p. 51. 10. Ibid., p. 65. 11. B. Thorne, op. cit., p. 32. 12. Ibid., p. 123. 13. H. Kirschenbaum et V. Henderson, op. cit., pp. XIII et XIV. 14. D.J. Cain; « Celebration, Reflection and Renewal », dans : Person-Centered Review, vol. 5, n° 4, Sage publications, 1990, p. 358. 15. C. Rogers, Autobiographie, Paris, Epi, 1971, p. 85. 16. Cf. Ortega y Gasset, La révolte des masses, Paris, Stock. Traduit en 1961, p. 19 : « Partout l’homme-masse a surgi […], un type d’homme hâtivement bâti, monté sur quelques pauvres abstractions et qui pour cela se retrouve identique d’un bout à l’autre de l’Europe ». 17. J.P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960, p. 66. 18. Ibid., pp. 4 et 263. 19. Ibid., p. 9. 20. E. Schrödinger, « La signification de la mécanique ondulative », dans : Louis de Broglie, Physicien et penseur, Paris, Albin Michel, 1953, p. 23. 21. B. Nicolescu, Troisième millénaire, n° 2, p. 10. 22. Cf. B. d’Espagnat et le développement d’un concept de « non-séparabilité » en physique nucléaire, à propos de la réalité. Dans : A la recherche du réel, Paris, Gauthier-Villars, 1979, p. 95 : « Un enseignement majeur de la physique contemporaine fondamentale est — encore une fois — que la séparation spatiale des objets est elle aussi en partie, un mode de notre sensibilité ». Ibid., p. 46 : « La distance n’est pas de façon intrinsèque, entre tel et tel élément de la réalité indépendante. C’est nous qui la mettons, d’une certaine manière… » Cf. du même auteur, Une incertaine réalité, Paris, Gauthier-Villars, 1985, pp. 111 et 239. 23. Cf. E. Nagel, K. Gödel et al., Le théorème de Gödel, Paris, Le Seuil, 1989 (éd. originales 1931 et 1958), p. 143 : « On peut démontrer rigoureusement que dans tout système formel consistant contenant une théorie des nombres finitaires relativement développée, il existe des propositions arithmétiques indécidables et que, de plus, la consistance d’un tel système ne saurait être démontrée à l’intérieur de ce système ». 24. F. Varela, Autonomie et connaissance, Paris, Le Seuil, 1989, p. 14. 25. Ibid., p. 224. 26. Ibid., p. 21. 27. F. Varela, Connaître, Paris, Le Seuil, 1989, p. 99. 28. C. Rogers, dans : Rogers et Kinget, Psychothérapie et relations humaines, Louvain, ed. universitaires, 1962, tome I, p. 152. 29. E. Morin, « De la complexité : complexus », dans : Les théories de la complexité , autour de l’œuvre d’Henri Atlan, Paris, Le Seuil, 1991, p. 285. 30. F. Varela, Autonomie et connaissance, op. cit., p. 224. 31. M. Cassé, dans : J. Audouze, Michel Cassé et Jean-Claude Carrière, Conversations sur l’invisible, Paris, Belfont, 1988, p. 253. 32. Ibid., p. 256. Egalement : « L’aberration, la marge, l’exception, l’incertitude, tous ces mots qu’autrefois on appelait des erreurs, sont à l’ordre du jour ». 33. I. Prigogine, Les lois du chaos, Paris, Flammarion, 1994, p. 42. Ibid., p. 43 : « Le simple fait que des systèmes puissent devenir chaotiques n’est pas une nouveauté ». 34. I. Prigogine, La fin des certitudes, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 7. 35. I. Prigogine et I. Stengers, La nouvelle alliance, Paris, Gallimard, 1979. 36. C. Rogers, Un manifeste personnaliste, Paris, Dunod, 1979, p. 219. 37. Interview de P. Ricœur, dans le Monde de l’éducation, juillet-août 1985 : « Nous ne vivons plus dans un consensus global de valeurs qui seraient comme des étoiles fixes. Nous évoluons dans une société pluraliste, religieusement, politiquement, moralement, philosophiquement où chacun n’a que la force de sa parole. Notre monde n’est plus enchanté ». La tâche de l’éducateur moderne est donc d’« aider les individus à s’orienter dans des situations conflictuelles, à maîtriser avec courage un certain nombre d’antinomies ». 38. E. Enriquez, « Perspectives psychosociologiques sur l’adaptation », dans : L’inadaptation, phénomène social, Paris, Fayard, 1964, pp. 72-73 : « Le terme même de modèle d’équilibre implique qu’il peut exister dans le monde des déséquilibres, du désordre, des évolutions, qu’il ne s’agit pas de nier ces perturbations ni a contrario la nécessité d’instaurer un ordre, mais que la prise en considération de ces phénomènes doit amener à rechercher activement des paliers d’équilibre. Alors que le modèle d’ordre est (ou se veut être) un modèle pour l’éternité, le modèle d’équilibre admet l’histoire, les conflits, les débats et mieux encore se nourrit des contradictions. A l’idée d’un ordre tout fait, il substitue l’idée d’un ordre sortant du désordre, d’un ordre relatif qui sera lui aussi remis en question et donnera naissance à un nouvel ordre et ceci indéfiniment. Un tel modèle empêche d’admettre une fin de l’histoire… » 39. Cf. J.F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Editions de Minuit, 1979, p. 63 : « Dans la société et la culture contemporaine, société postindustrielle, culture postmoderne, la question de la légitimation du savoir se pose en d’autres termes. Le grand récit a perdu sa crédibilité, quel que soit le mode d’unification qui lui est assigné : récit spéculatif, récit de l’émancipation. On peut voir dans ce déclin des récits un effet de l’essor des techniques et des technologies à partir de la Deuxième Guerre mondiale […]. Mais il faut d’abord repérer les germes de “délégitimation” et de nihilisme qui étaient inhérents aux grands récits du xixe siècle pour comprendre comment la science contemporaine pouvait être sensible à ces impacts bien avant qu’ils aient lieu ». 40. P. Ricœur, La critique et la conviction, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 84. 41. Ibid., p. 101. 42. Pour plus d’approfondissement, on peut consulter mon étude sur « La psychosociologie et ses contextes », dans : L’aventure psychosociologique (ouvrage coordonné par V. de Gaulejac et M. Pagès), Paris, ddb, 1997, pp. 21-41. 43. C. Rogers, Client-Centered Therapy, Houghton Mifflin Company, Boston, 1951. 44. C. Rogers, Un manifeste personnaliste, op. cit., p. 1. 45. Ibid., p. 211. 46. Ibid., pp. 209-210. 47. Selon les termes d’une déclaration du ministre de l’Education nationale au Sénat. 48. Article premier de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989. 49. Rapport sur la promotion de la santé des jeunes en Europe, 1994. 50. C. Rogers, Liberté pour apprendre ?, Dunod, 1976, p. 53. Rogers ajoute : « Si j’avais donné le cours dix ans plus tôt, je l’aurais fait très différemment. Peut-être que dans cinq ans je le ferai d’une manière nouvelle et, je l’espère, plus créative ». 51. C. Rogers, Autobiographie, op. cit., p. 77. 52. Ibid., p. 79. 53. Ibid., p. 87. 54. Ibid., p. 92. 55. Ibid., p. 87. 56. Ibid., p. 83. 57. Ibid., p. 81. * Traduction Navarro. 1. Littéralement : both been reared on farms, « tous les deux élevés dans des fermes ». Nuance supplémentaire, le verbe to rear signifie « élever des animaux, cultiver des plantes ». Cependant rearing of children désigne « la puériculture ». Autobiographie, p. 7. 2. Ibid., p. 7. 3. J.P. Resweber, La pensée de Martin Heidegger, Privat, 1971, p. 17. 4. C. Rogers, Autobiographie, pp. 7-8. 5. Ibid., p. 9. 6. Ibid., p. 8. 7. Ibid., p. 10. 8. Lettre à l’auteur, 12 mai 1971. 9. C. Rogers, Autobiographie, p. 9. Rogers revient sur ce point dans son livre de 1972, Becoming Partners, p. 24. 10. Lettre à l’auteur du 12 mai 1971. Rogers, cependant, s’est senti par la suite éloigné de John : « (C’est) un homme religieusement très conservateur et il est président de la compagnie de construction de mon père. Lui et moi avons très peu en commun et nous nous voyons très peu ». 11. H. Rogers, « A Wife’s View of Carl Rogers », dans : Voices, 1965, vol. I, n° 1 American Academy of Psychotherapists ed. 12. C. Rogers, Autobiographie, p. 10. 13. Ibid., pp. 11-12. 14. Ibid., p. 13. 15. Ibid., p. 14. 16. Voir plus loin, chapitre xiii. 17. Ibid., p. 14. 18. Ibid., p. 15. 19. Ibid., p. 15. 20. Ibid. 21. Ibid., p. 79. 22. Ibid., p. 17. 1. C. Rogers, Autobiographie, p. 22. 2. Lettre à l’auteur du 20 février 1973. 3. Dans un bulletin de l’ymca, The Intercollegian, juin 1922, p. 2. 4. Lettre à l’auteur du 20 février 1973. 5. Millenium, règne du Messie sur la terre, pendant mille ans, avant le jugement dernier, cf. Le Petit Robert. 6. The Intercollegian, juin 1922, p. 1. 7. Ibid., pp. 1-2. 8. Ibid., pp. 1-2. 9. Ibid., pp. 1-2. 10. C. Rogers, Autobiographie, p. 23. 11. C. Rogers, dans : The Intercollegian, juin 1922, p. 2. 12. Saint-John Perse, Œuvre poétique, t. 1, nrf, p. 195. 13. P. Teilhard de Chardin, Hymne à l’univers, Paris, Le Seuil, 1961, p. 19. 14. Interview de Krishnamurti par André Voisin, ortf, première chaîne, 24 octobre 1972. 15. C. Rogers, Autobiographie, p. 23. 16. Ibid. 17. Ibid., p. 25. 18. Ibid., p. 26. 19. Ibid., p. 27. 20. C. Russel Fish, G. Sellery, E. Byrd. 21. C. Rogers, Autobiographie, pp. 24-25. 22 Ibid., p. 26. 23. H. Rogers, op. cit. p. 95. 24. C. Rogers, Autobiographie, p. 31. 25. Cité par Kilpatrick, Philosophy of Education. 26. C. Rogers, Autobiographie, p. 31. 27. Ibid., p. 32. 28. Ibid. 29. M. Pages, L’orientation non directive, Dunod, 1965, p. 2. 30. C. Rogers, Autobiographie, p. 33. 31. Cité dans : G. Deledalle, L’idée d’expérience dans la philosophie de John Dewey, puf, 1967. John Dewey a vécu de 1859 à 1952. Son rayonnement a été considérable, non seulement aux Etats-Unis mais également au Japon, au Mexique, en Turquie (avec Kemal Atatürk), en urss, en Angleterre, tous pays où il a enseigné et conseillé. En Suisse, son influence sur Claparède et Piaget a été importante. 32. Lettre à l’auteur du 20 février 1973. Dans cette lettre, Rogers précise également : « Je doute d’avoir lu aucun des livres de Dewey complètement ; j’ai lu nombre de ses papiers et je sens que je suis d’accord avec son mode de pensée (thinking). Je me suis promis de les relire maintenant mais je ne l’ai pas fait ». 33. Kilpatrick, Philosophy of Education, Ed. 1951, p. 11. 34. Dans Freedom to learn ?, 1969 ; trad. : Liberté pour apprendre ? Dunod, 1971. 35. Kilpatrick, Philosophy of Education, p. 214. 36. Ibid., p. 166. 37. Ibid., p. 19. 38. Ibid., p. 19. 39. Ibid., p. 9. 40. Ibid., p. 7. 41. Ibid., p. 298. 42. Ibid., p. 297. 43. Ibid., p. 431. J. Dewey, Democracy and Education, 1916, p. 42 : « La croissance n’est pas quelque chose qu’on fait pour eux ; c’est quelque chose qu’ils font ». Nous reviendrons ci-après sur la pensée de Dewey. 44. J. Dewey, Democracy and Education, p. 84. 45. Carl Rogers, Autobiographie, p. 34. 46. Voir précédemment, p. 18. 47. C. Rogers, Autobiographie, p. 35. 48. Ibid., p. 34. 49. H. Rogers, op. cit., p 95. 50. Carl Rogers, Becoming Partners : Mariage and its Alternatives, a Delta Book, Ed. Dell Publishing Co, New York, 1972, cf. Réinventer le couple, Paris, R. Laffont, 1974. 1. C. Rogers, Autobiographie, p. 36. 2. Ibid. 3. Ibid. 4. Ibid. 5. Ibid., p. 86. 6. Rogers et Kinget, Psychothérapie et relations humaines, t. 1, p. 149. 7. C. Rogers, Autobiographie, p. 37. 8. C. Rogers, Le développement de la personne, Dunod, 1966, p. 9. 9. C. Rogers, Autobiographie, p. 38. 10. Ibid., p. 39. 11. C. Rogers, Le développement de la personne, Dunod, 1966, p. 9, cf. H. Kirschenbaum, Positive Regard, op. cit., pp. 9 et 10. 12. Ibid., p. 12. 13. H. Rogers, op. cit., p. 95. 14. C. Rogers, Autobiographie, p. 41. 15. Ibid., p. 44. Cf. H. Kirschenbaum, op. cit., p. 12. 16. Lettre à l’auteur du 12 mai 1971. 17. O. Rank, Dom Juan, écrit en 1922, Denoël et Steele, Paris, 1932, p. 241. 18. O. Rank, Le traumatisme de la naissance, publié en 1924, traduit en français vers 1928. Paris, Payot, p. 16. 19. Voir Keyserling, Psychanalyse de l’Amérique, Paris, Stock. 20. Cité dans la post-face du livre Le traumatisme de la naissance, p. 227. 21. C. Rogers, La relation d’aide et la psychothérapie, t. 1, p. 227. Cf. M. Pagès, dans L’orientation non directive, Dunod, 1965, p. 47 : « En ce qui concerne les rendez-vous, dans la pratique de l’école de Rogers, le client fixe lui-même la périodicité des rendez-vous et est juge du moment où ils doivent être interrompus. Contrairement à la plupart des psychanalystes, le thérapeute rogerien n’émettra pas d’avis sur ce point. Par contre, la durée du rendez-vous, en général d’une heure, est fixée par le thérapeute. Cela correspond et à une hypothèse sur la durée optima et à une nécessité d’organisation du travail du thérapeute lui-même ». (Et aussi au besoin d’établir la clarté d’une limite objective, non manipulable.) 22. O. Rank, Dom Juan, p. 39. 23. Ibid., p. 136. 24. Ibid., p. 136. 25. Ibid., p. 137. 26. Ibid., p. 144. 27. Lettre à l’auteur du 12 mai 1971. Rogers précisait : « Il est mort au lit avec sa femme à côté de lui mais elle ne permit pas une autopsie, aussi nous n’avons jamais réellement su la cause de sa mort ». 28. C. Rogers, Autobiographie, p. 45. 29. Ibid., p. 47. 30. C. Rogers, Le développement de la personne, p. 11. 31. C. Rogers, Autobiographie, p. 47. 32. C. Rogers, Le développement de la personne, p. 12. 1. H. Rogers, op. cit., p. 96. 2. Lettre à l’auteur du 12 mai 1971. 3. Ibid. 4. C. Rogers, autobiographie, p. 51. 5. Ibid., p. 49. 6. C. Rogers, Psychologie existentielle, divers auteurs, Paris, Epi, 1971, p. 96. 7. Ibid., p. 97. 8. Cf. C. Rogers, Le développement de la personne, p. 172, note 1 : « Au fur et à mesure de mon expérience de la psychothérapie, j’en vins à accorder foi aux découvertes de cette étude et d’une étude postérieure (1944) qui la confirmait ». 9. Ibid., p. 12. (La conférence faite au Minnesota constitue le chapitre II du livre Counseling and Psychotherapy, (1942), traduit en français sous le titre La relation d’aide et la psychothérapie, Ed. esf, Paris, 1970, 2 t. Cet ouvrage conserve curieusement sa fraîcheur). 10. Ibid., p. 14. 11. Ibid. 12. Ibid. 13. Ibid. 14. C. Rogers, Becoming Partners, p. 25. 15. La relation d’aide et la psychothérapie, t. 2, p. 446. 16. Ibid., p. 447. 17. Ibid., t. 1, p. 33. 18. Ibid., p. 42. 19. Ibid., p. 43. 20. Ibid., p. 44. 21. Ibid., p. 46. 22. Ibid., p. 48. 23. Ibid., p. 50. 24. Ibid., p. 51. 25. Ibid., pp. 52-53. 26. Ibid., p. 53. 27. Ibid. 28. Ibid., p. 59. 29. Ibid., p. 55. 30. Ibid. 31. Ibid., p. 56 32. Ibid. 33. Ibid., p. 261. 34. Ibid., pp. 261-262. 35. Ibid. 36. Ibid., pp. 267. 37. Ed. esf, Paris, 1970, traduit par J.P. Zigliara. L’extrait est tiré des pp. 328-330. 38. Voir plus loin, chapitre xiv. 39. La relation d’aide et la psychothérapie, p. 127. 40. Ibid., tableau p. 129. 41. Ibid., p. 132. 42. Ibid., p. 133. 43. Ibid. 44. J’ai traduit directement et littéralement de Autobiography, p. 362. Voir la traduction trop libre dans l’Autobiographie, p. 50. 45. C. Rogers, Autobiographie, p. 52. 46. Howard Kirschenbaum, « Carl Rogers », dans : Positive Regard : Carl Rogers and other Notables he influenced, Palo Alto, Science and Behavior Books, 1995, p. 20. 47. Ibid., p. 20. 1. C. Rogers, Autobiographie, p. 54. 2. Ibid., pp. 53-54. Nous avons corrigé et complété la traduction qui était douteuse. Par exemple, le mot « adjustement » se traduit imparfaitement par le mot « adaptation » qui est plus passif : « équilibre » ou « ajustement » sont meilleurs. 3. Voir paragraphe suivant. 4. C. Rogers, Autobiographie, p. 56. 5. Voir plus loin, chapitre xiv. 6. Cf. le rapport de Jyuji Misumi, établi à la demande de l’Unesco pour une table ronde à Mexico (décembre 1972) : « Applied Group Dynamics, Counseling and Education : Research and Practises in Japanese Educational System », pp. 121-122. 7. C. Rogers, Autobiographie, p. 60. Tout ce livre est à approfondir. 8. Helen Rogers, « A Wife’s Eye View of Carl Rogers », dans : Voices, journal publié par l’American Academy of Psychotherapists, 1965, vol. 1, n° 1, p. 97. 9. Lettre à l’auteur du 10 février 1973. 10. C. Rogers, Autobiographie, p. 61. 11. Ibid., pp. 61-62. 12. Je pense à tant et tant de psychologues ou de psychanalystes français que je connais ou qui sont bien connus… Et je ne dis rien des psychiatres. Mais je pense aussi à la remarque de Freud, citée par Laplanche et Pontalis, à l’article « Contre-transfert » de leur Vocabulaire de psychanalyse : « Aucun analyste ne va plus loin que ses propres complexes et résistances internes ne le lui permettent ». 13. C. Rogers, Client-Centered Therapy, p. 7. 14. Ibid, p. 30. 15. Voir plus loin, ch. xiii. 16. C. Rogers, Client-Centered Therapy, p. 30. Rogers a noté que le diagnostic n’était pas utile pour la thérapie, du côté du client. Toutefois, du côté du thérapeute, le diagnostic pouvait parfois aider le thérapeute à affronter la situation d’entretien ou de sécurisation : « Si d’avance, ils connaissent les impulsions au suicide, ils peuvent mieux les accepter » dans : Psychologie industrielle, hommes et techniques, n° 169, 1959, p. 152. 17. C. Rogers, Client-Centered Therapy, pp; 46-47. 18. Ibid., p. 48. 19. Ibid. 20. Ibid., pp. 48-49, voir également chap. xii, et plus loin, chap. xiii. 21. Voir plus loin. 22. C. Rogers, ibid, pp. 189-199. 23. Ibid, p. 199. 24. Ibid., p. 202. 25. Ibid., p. 203. 26. Ibid., p. 210. 27. Rogers observe avec honnêteté que près d’un an après la fin des entretiens thérapeutiques, cette cliente eut une nouvelle poussée conflictuelle. Elle ne put joindre son thérapeute qui était à l’étranger. Elle eut en ces conditions une rechute dans un épisode franchement psychotique, un mois après, dont elle se remit graduellement, au moins en partie. 28. C. Rogers, Client-Centered Therapy, p. 211. 29. Ibid., p. 212. 30. Ibid., pp. 212-213. 31. C. Rogers, Autobiographie, pp. 82-83. 32. C. Rogers, Le développement de la personne, p. 153. 33. S. Kierkegaard, La maladie à la mort, traduction Tisseau, p. 24. 34. Ibid., pp. 24-25. 35. S. Kierkegaard, Crainte et tremblement, traduction Tisseau, Paris, Aubier, pp. 204-205. 36. S. Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, traduction Ferlov et Gateau, Paris, nrf, 1935, p. 62. 37. S. Kierkegaard, La maladie à la mort, p. 26. 38. C. Rogers, Le développement de la personne, p. 153. 39. S. Kierkegaard, Post-scriptum définitif et non scientifique aux miettes philosophiques, p. 58. 40. Ibid., p. 60. 41. Ibid., p. 80. 42. Ibid., p. 134. 43. Ibid., p. 96. 44. Ibid., p. 99. 45. Cf. C. Rogers, Client-Centered Therapy, pp. 389-391. 46. C. Rogers, Autobiographie, pp. 57-58. 47. C. Rogers, Client-Centered Therapy, p. 398. Voir également dans Le développement de la personne, p. 210, les moyens offerts : « Livres, lieu de travail, nouvel outil, occasion d’observer un procédé industriel, exposé fondé sur ses propres travaux, image, graphique ou carte, voire ses propres réactions émotives ». 48. Le développement de la personne, p. 209. Je préfère ma traduction. 49. Ibid., p. 210. 50. Ibid., p. 208. 51. Ibid., p. 209. 52. Ibid., p. 208. 53. Voir dans : C. Rogers, La relation d’aide en psychothérapie, le passage important sur les limites, t. 1, pp. 101-113. 54. C. Rogers, Le développement de la personne, p. 211. 55. C. Rogers, Client-Centered Therapy, p. 397. 56. Ibid., pp. 394-395. 57. Ibid., p. 397 : « Perhaps the most extreme method is one which has not unfrequently been used by the writer ». 58. C. Rogers, Le développement de la personne, pp. 195-196. 59. Ibid., p. 197. 60. Ibid., pp. 197-198. 61. Ibid., p. 196. 62. Cf. M. Pagès, L’orientation non directive, Dunod, 1965, p. 107. Il est intéressant de noter le titre de l’ouvrage autobiographique de M. Pagès, qui introduisit Rogers en France, Le travail d’exister : roman épistémologique, Paris, ddb, 1996. 63. Ibid., p. 107. 64. M. Pagès, Le travail d’exister, op. cit., 1996, p. 136. 65. Ibid., p. 140. 1. C. Rogers, Autobiographie, p. 64. 2. H. Rogers, op. cit., p. 97. 3. Lettre à l’auteur du 10 avril 1973. 4. M. Buber, La vie en dialogue, traduction Loewenson-Lavi, Paris, Ed. Aubier, 1959, p. 98. Cf. ibid. : « Toute relation de Je-Tu, au sein d’un rapport qui rend spécifique l’action exercée par une partie sur l’autre et que détermine un but, existe en vertu d’une mutualité astreinte à ne pas devenir complète ». 5. Lettre à l’auteur du 12 mai 1971. 6. Le développement de la personne, p. 44. 7. M. Buber, Je et Tu, traduction G. Bianquis, Aubier, 1969, p. 38. 8. Ibid., p. 19. 9. Ibid., p. 47. 10. Ibid., p. 30. 11. Ibid., p. 30. 12. Ibid., pp. 35-36. 13. Ibid., p. 37. Brian Thorne, dans Comprendre Carl Rogers, op. cit., p. 96, rappelle que Buber se demandait si « la thérapie centrée sur le client était plus susceptible de créer des individus que des personnes ». 14. Ibid., p. 37. 15. Ibid., pp. 34-35. 16. M. Buber, « De la fonction éducatrice », dans : La vie en dialogue, p. 224. 17. Ibid., p. 226. 18. Ibid., p. 197. 19. C. Rogers, dans : Psychologie existentielle, Paris, Epi, 1971, p. 95. Ce livre reproduit le compte rendu de la conférence de 1959, qui fut publié pour la première fois à New York, en 1965. 20. R. May, dans : Psychologie existentielle, ibid., p. 9. 21. Ibid. 22. Ibid., p. 34. 23. Ibid., p. 45. 24. C. Rogers, dans : Psychologie existentielle, p. 92. 25. H. Misumi, op. cit., p. 121. 26. C. Rogers, Autobiographie, pp. 71-72. On assure parfois qu’il y a actuellement une crise de la clientèle pour les psychanalystes américains. Il est de fait que dans le congrès de 1973, à Paris, les psychanalystes français et autres se sont montrés moins dogmatiques, désavouant le terrorisme intellectuel par lequel la pensée psychanalytique est souvent dénaturée, notamment en France. 27. Article : « Client-Centered Therapy », dans : American Hand Book of Psychiatry, éd. 1966, vol. III, ch. xiii, p. 189. 28. Ibid. 29. Ibid., pp. 189-190. 30. C. Rogers, Autobiographie, pp. 65-66. 31. Ibid., p. 68. 32. C. Rogers, The Therapeutic Relationship, p. xvi. Voir plus loin pour cette recherche. 33. Autobiographie, p. 74. 1. H. Rogers, op. cit., p. 98. 2. Lettre à l’auteur du 10 avril 1973. (Cf. la préface du présent livre) 3. C. Rogers, Autobiographie, p. 74. 4. Lettre à l’auteur du 2 février 1973. ntl : National Training Laboratories, importante association de formation et de recherche agissant aux Etats-Unis depuis 1947, à Bethel dans le nord-est du pays. 5. Carl Rogers on Encounter Groups, 1970, p. 46. Traduction française de Daniel Le Bon : Les groupes de rencontre, Paris, Dunod, 1973, p. 46. 6. Ibid., p. 47. — J’ai corrigé légèrement la traduction. 7. Ibid., p. 50. 8. Ibid., p. 53. 9. Ibid., p. 56. 10. Ibid. p. 57. 11. Ibid. p. 60. — J’ai légèrement modifié la traduction — Rogers écrit de ses petits enfants : « J’ai de bonnes relations avec mes six petits enfants quoique je les voie plus rarement que je ne le désirerais ». (Lettre à l’auteur du 12 mai 1971). 12. Carl Rogers on Encounter Groups, pp. 67-68. 13. P. Tillich et C. Rogers, Dialogue, radio-télévision, San Diego State College, Californie. Le texte de ce dialogue a été publié dans : H. Kirschenbaum et V. Henderson, Carl Rogers, Dialogues, 1989, pp. 64-78. 14. Ibid., p. 6. 15. Ibid., p. 7. 16. Ibid., p. 10. 17. Ibid., p. 7. 18. Ibid., p. 10. 19. Ibid., p. 15. 20. Ibid., p. 16. 21. Ibid., p. 18. 22. Ibid., p. 19. 23. Ibid., p. 20. 24. Ibid., p. 21. 25. Ibid., p. 21. 26. Rogers ne s’est pas senti en contact direct avec Tillich : « J’ai trouvé Paul Tillich très réservé. Il fut presque impossible d’entrer en dialogue réel avec lui. J’ai senti qu’il répondait à presque chaque question comme s’il allait la chercher dans un fichier (a card file) et qu’il tirait une portion d’exposé antérieur. Ce ne fut pas une discussion vraiment spontanée. A cet égard, il fut en quelque façon comme un intellectuel français. Il voulait être précis et correct plutôt que se laisser aller à dire quelque chose qui se serait révélé plus tard pas tout à fait correct. Martin Buber était d’une sorte différente ». (Lettre à l’auteur du 12 mai 1971.) 27. Rogers et Kinget, Psychothérapie et relations humaines, t. 1, p. 153. 28. Ibid., p. 156. 29. Ibid., p. 156. 30. The Man and the Science of Man, 1968, p. vii. 31. Indication orale à l’auteur et lettre du 20 février 1973 : « Je ne me souviens pas exactement de ce que j’ai lu de l’œuvre de Teilhard de Chardin. Je pense que c’est, The Nature of Man et aussi quelques-uns de ses autres matériaux (materials) — Serait-ce La place de l’homme dans la nature ? » 32. Rogers n’a rien connu de Mounier. (Lettre à l’auteur du 20 février 1973.) 33. Man and the Sciences of Man, p. 189. 34. C. Rogers, Le développement de la personne, pp. 267-268. 35. Man and the Science of Man, p. 190. 1. Jean Dubost, Eugène Enriquez, Lily Herbert, Gurth Higgin, André Lévy, Françoise Monnoyer de Galland, André de Peretti, Jean Claude Rouchy, Anne Ancelin Schutzenberger. 2. Un projet de placer dans l’emploi du temps des réunions semi plénières ou d’intergroupes ne fut pas agréé par Rogers, au cours des discussions. 3. Cf. le memorandum du 10 mai 1966 rédigé par Max Pagès, en anglais. 4. Cf. B. Mailhot, Genèse et dynamique des groupes, Epi, 1967. 5. Message écrit envoyé au cours du colloque. 6. Cf. lettre d’envoi de Carl Rogers du 17 mai 1966. 7. arip, Association pour la recherche et l’intervention psychologique (dont étaient membres, à l’époque et jusqu’en 1970, Max Pagès et l’auteur). 8. Analyse des résultats au questionnaire (séminaire de Dourdan, avril 1966). Documents arip, p. 1. 9. Ibid., p. 2. 10. Ibid., p. 4. 11. Ibid., p. 7. 12. Ibid., p. 8. 13. Il est piquant de rapprocher cette observation des remarques de Rogers à l’égard de ses propres parents. (Voir plus haut.) 14. Documents arip, ibid., p. 14. Le reste du rapport contient le dépouillement des réponses à des questions portant sur des échelles de changement d’attitude, d’évaluation des termes (tels que « positif ») ou de caractérisation du vécu. Pour l’expérience vécue dans les petits groupes, aucun participant ne la considère comme nuisible, voir négative. Deux seulement la jugent neutre, et trois confuse, mais les autres la considèrent comme constructive et même, pour près de la moitié, « profondément positive ». Pour ce qui est des réunions plénières, une personne seulement les a estimées nuisibles, et deux neutres ; les autres les ont évaluées comme utiles et constructives ou pleinement positives. A propos de l’influence du séminaire sur la conscience des sentiments de soi ou des autres, sept réponses seulement expriment des hésitations sur les changements perçus en eux. D’autres questions se rapportent à l’image que les participants se faisaient d’eux-mêmes avant le séminaire ; immédiatement après et six mois plus tard : les courbes montrent des modifications intéressantes. Les deux dernières questions posées se rapportent à des améliorations suggérées pour organiser des séminaires du type de Dourdan et aux réactions à l’égard du questionnaire. 15. Dont « cent quarante psychologues, quatre-vingts membres de l’administration et de l’industrie, quarante-cinq étudiants, quelques religieux, un grand nombre de médecins en majorité psychanalystes, des professeurs de l’enseignement supérieur, secondaire et primaire, public et privé, des éducateurs, conseillers ou assistants, et quinze journalistes. L’ensemble comprenait 10 % d’étrangers, des provinciaux et des Parisiens ». (Article de Simone Charlier dans la Quinzaine littéraire du 16 mai 1966.) 16. Aucun des assistants, même parmi les psychanalystes présents (qui critiquèrent le film), ne perçut que « Gloria » était aussi le prénom de la secrétaire de Jacques Lacan. 17. François Roustang, revue Etudes, juin 1966. 18. Frédéric Gaussen, dans le journal Le Monde, du 15-16 mai 1966. Cf. également P.B. Marquet, Rogers, Ed. universitaires, 1971, p. 19. 19. René Lourau, dans le journal Combat du 11 mai 1966. 20. Frédéric Gaussen, op. cit. 21. Gilles Ferry dans l’hebdomadaire l’Education nationale du 3 juin 1966. 22. Voir plus loin le fond des critiques. 23. Lettre à l’auteur, du 9 août 1966. « At Dourdan, I felt very pleased that the arip staff members were able to bring out and to express the negative feelings they had in regard to me and my thinking because I thought this made the whole workshop better. In the symposium, where there was not much of a chance to really work things through, I don’t believe it was as constructive ». 24. Georges Quintard, Bulletin de psychologie de la Sorbonne ; octobre 1967, t. XXI. 25. Ibid. 26. Extraits de la lettre du 15 mai 1966 à l’arip. 27. Pour une étude plus en profondeur du séjour en France, on se référera à notre livre Les contradictions de la culture et de la pédagogie, Epi, 1969, pp. 31-57. 28. Cf. D. Girard, Grammaire raisonnée de l’anglais, Paris, Hachette, 1978, p. 242, cf. également p. 42. 29. Cf. les « conditions nécessaires et suffisantes d’un changement thérapeutique de la personnalité » énoncées en 1967 : « Si ces six conditions (en tant qu’opératoirement établies) existent, alors, un changement constructif de la personnalité (en tant qu’établie) advient dans le client. Si une de ces conditions n’est pas présente, le changement constructif n’advient pas » (cité dans The Carl Rogers Reader, éd. par H. Kirschenbaum et V. Henderson, Houghton et Mufflin, Boston, 1989, p. 229. (Par la suite Rogers réduisit ces six conditions à trois.) 30. Cf. Carl Rogers, La relation d’aide et la psychothérapie, op. cit., p. 95 : « Certains peuvent trouver que l’idée de mettre certaines limites définies à la situation thérapeutique est une procédure artificielle et sans nécessité. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Chaque situation de conseil (counseling) a quelque espèce de limite, comme bien des thérapeutes amateurs ont pu s’en apercevoir à leurs dépens ». 31. Sa méthode ne peut être « la seule méthode », assurait-il déjà, dans La relation d’aide et la psychothérapie, op. cit., p. 133. 32. M. Serres, dans « Commencements », article pour une présentation de l’ouvrage La nouvelle alliance (de I. Prigogine et Is. Stengers) dans « Le Monde des livres », Journal Le Monde, 4 janvier 1980, p. 13. Cf. du même auteur, Le contrat naturel, Paris, F. Bourin, 1990, p. 47 : « Faut-il démontrer encore que notre raison fait violence au monde ? » Cf. également dans Le tiers-instruit, Paris, F. Bourin, 1991, p. 77 : « Nous avons quitté le bien platonicien, l’âge des Lumières, la victoire exclusive de la science classique, l’histoire unitaire de nos pères. […] Voici venu l’âge des lueurs. La connaissance éclaire le lieu - Tremblant - Coloré - Fragile - Mêlé - Instable ». 33. Gilbert Mury, Introduction à la non-directivité, Toulouse, Privat, 1973, p. 176. 34. Les contradictions de la culture et de la pédagogie, Paris, Epi, 1969. 35. G. Snyders, Où en sont les pédagogies non directives ?, Paris, puf, 1e édition 1973, p. 147. La seconde édition répondait point par point à mes critiques textuelles et matérielles. Dans la postface de Daniel Hameline à l’ouvrage de Snyders Y a-t-il une vie après l’école ? Paris, esf, 1996, p. 129, celui-ci relève : « Pourtant Snyders, malgré son art exaspérant de solliciter les textes et d’isoler les citations qui lui ont valu tant de remontrances indignées et justifiées, parvenait globalement à proférer des vérités fondamentales. Ce n’est par le moindre des paradoxes de ce penseur que sa capacité de faire du vrai avec du faux… ou, tout au moins, de rejoindre le vraisemblable avec de l’approximatif ». 1. Rapport de Carl Rogers au conseil de direction du wbsi, 1967. 2. Ibid. 3. C. Rogers, Liberté pour apprendre ?, p. 14. 4. Ibid., p. 15. 5. Ibid., p. 303. 6. Ibid., p. 15. 7. Ibid., pp. 8-9. J’ai corrigé la traduction dans les seize derniers mots pour la rendre plus littérale et plus directe. 8. Ibid., p. 25. 9. Ibid., p. 26. 10. Ibid., p. 52. 11. Ibid., p. 53. 12. Ibid., p. 12. 13. Ibid. 14. Ibid., p. 16. 15. Ibid., p. 20. 16. Ibid., p. 49. 17. Ibid., p. 68. 18. Ibid., pp. 68-69. — Et la remarque de Dewey : « Certes le but idéal de l’éducateur c’est la création, en chacun, d’un autocontrôle. Mais le simple retrait de tout contrôle extérieur ne suffit pas à garantir la création d’un autocontrôle. Il n’est pas difficile de tomber de Charybde en Sylla », dans : Expérience et éducation, p. 115. 19. Ibid., p. 56. 20. Ibid., p. 151. 21. Ibid., p. 103. 22. Ibid., p. 318. 23. Ibid., p. 327. L’ordre est celui du « Cœur immaculé de Marie ». 24. Ibid., p. 326. 25. Ibid., p. 343. 27. Document Rogers. 28. Ibid. 29. Ibid. 30. Ibid. 31. E. Morin, Journal de Californie, Le Seuil, 1970, pp. 233-234. 32. J. Crist, « Group Dynamics and the Teacher-Student Relationship : a Review of Recent Innovations », Standford Center for Research and Development in Teaching, janvier 1972. 33. Lettre à l’auteur du 20 février 1973. 34. Ibid. 35. Lettre à l’auteur du 7 avril 1973. 36. Lettre à l’auteur du 20 février 1973. 37. Lettre à l’auteur du 12 mai 1971. 1. N. Rogers (citée par Howard Kirschenbaum, Carl Rogers), dans : Positive Regard, Carl Rogers and other Notables he Influenced, Palo Alto, Science and Behavior Books, 1995, p. 60. 2. Cf. H. Kirschenbaum, op. cit., p. 60. 3. Voir ci-dessus, chapitre iv. 4. H. Kirschenbaum, op. cit., p. 61. 5. C. Rogers, Un manifeste personnaliste, Paris, Dunod, 1979, p. 106. Cf. p. 107 : « La hargne a besoin d’être entendue ». 6. H. Kirschenbaum, op. cit., p. 72. 7. Ibid., pp. 72-73. 8. Cité dans B. Thorne, Comprendre Carl Rogers, Toulouse, Privat, 1994, p. 82. 9. H. Kirschenbaum, op. cit., p. 73. 10. Ibid. 11. C. Rogers, Un manifeste personnaliste, op. cit., p. 5. 12. C. Rogers, « The Creative Journey », dans : Positive Regard, op. cit., pp. 199-200. 13. Ibid., p. 200. 14. C. Rogers, « Growing Older or Older and Growing », dans : Positive Regard, p. 80. 15. H. Kirschenbaum, op. cit., pp. 77-78. 16. Ibid., p. 74. 17. C. Rogers, Un manifeste personnaliste, op. cit., p. 123. 18. Reinhard Tausch eut du mal à se résigner, et il garda tout au long du séminaire une gêne. Il nous reprocha collectivement, un an plus tard, dans une lettre, ce choix de la pluralité des langues utilisables dans le séminaire. 19. B. Thorne, Comprendre Carl Rogers, op. cit., pp. 37-38. 20. Cf. Ruth Sanford, « On Becoming who I am », dans : Positive Regard, op. cit., p. 373. Capra a écrit « le Tao de la physique ». 21. C. Rogers, « A Way of Being », dans : Carl Rogers Reader, op. cit., p. 48. Carl indique également, à la même page : « Il y avait eu la célébration de nos noces d’or, trois ans auparavant… Ce fut une telle joie que notre fils et notre fille ne soient pas seulement nos rejetons, mais deux de nos meilleurs et plus proches amis, avec lesquels nous partagions nos vies intimes ». 22. Ibid., p. 52. Le collègue auquel Rogers demanda une aide dans sa détresse fut peut-être André Auw, qui dédicaçait un ouvrage publié par les éditions Aslan (Boulder Creek, Californie) en 1991 : « A Carl Rogers, maître (mentor) et cher ami, qui non seulement a allumé sa lampe pour moi dans la nuit noire, mais qui me permit d’en faire de même pour lui ». L’ouvrage avait pour titre Gentle Roads to Survival, (Les routes aimables pour survivre). Cf. p. 96 : « Je rencontrai alors Carl Rogers et commençai avec lui une longue association qui changea ma vie et ma façon de conseiller. J’appris beaucoup de lui en étant simplement en sa présence et en l’observant interagir avec d’autres gens. J’appris beaucoup plus de lui de cette façon que je ne le fis d’après des livres ou d’autres enseignants. […] Il faisait plus que de porter écoute au problème sur le mariage, les enfants ou le patron. Il portait écoute à quelque chose qui était par-dessous le problème externe. Etant en écoute avec le cœur, il entendait les sentiments qui représentaient l’impact de ce problème sur la personne. […] Les réels problèmes sont les peurs intérieures, les doutes de soi et les culpabilités cachées. Carl Rogers entendait ces problèmes du cœur parce qu’il écoutait avec son cœur ». Et André Auw exprime inlassablement sa vue, qui pouvait convenir à son ami Carl : You do what you have to do, « vous faites ce que vous avez à faire », page avant-dernière, « pour survivre aux moments difficiles ». 23. Ibid. 24. Ibid., p. 53. 25. Ibid. 26. Ibid., pp. 53-54. 27. H. Kirschenbaum, Positive Regard, p. 85. 28. Cf. document polycopié du rapport de 143 pages, p. 9. 29. Cf. la description citée dans The Carl Rogers Reader, op. cit. pp. 139-152. 30. Document polycopié, p. 141. 31. Ibid. 32. Ibid., p. 142. 33. The Carl Rogers Reader, p. 57. 34. Positive Regard, p. 423. 35. Cf. une interview du dr Salomon par Larry Porter, dans od practitionner, vol. 18, n° 3, septembre 1986. Egalement, The Carl Rogers Reader, pp. 457 et suiv. 36. The Carl Rogers Reader, p. 462. 37. Ibid., p. 461. 38. Ibid., p. 468. 39. Ibid., p. 458. 40. Ibid., p. 477. On doit noter que tous les participants apposèrent leur signature à un manifeste en douze points témoignant de leur espérance et de la qualité de l’approche centrée sur la personne en vue de traiter les conflits humains. Des évaluations du séminaire de Rust furent réalisées méthodologiquement par Larry Salomon. 41. The Carl Rogers Reader, op. cit., p. 479. 42. Ibid., p. 480. 43. Ibid., p. 481. 44. Ibid., p. 482. 45. Ibid., p. 486. 46. Ibid., p. 488. 47. Ibid., p. 493. 48. Ibid., p. 495. 49. Ibid., pp. 496-497. 50. Ibid., p. 499. 51. Ibid., p. 500. 52. Dans : « Rapport au Comité consultatif (adversory) de l’Institut pour les approches centrées sur la personne en faveur de la paix », par Gay Swenson, octobre 1986. 53. H. Kirschenbaum, op. cit., p. 87. 54. Positive Regard, op. cit., p. 341.
|
||
|
|
|||
| Bibliographie | |||
|
Quelques pages lui sont plus particulièrement dédiées:
|
une interview exclusive sur le sens des nouvelles réformes et l'évolution du métier |
|
|