|
Chapitre 3 – Où il s’avère
possible de tirer parti des cinq dernières minutes
Où le lecteur fait un détour sur les vingt-cinq manières
possibles de terminer un cours pour éviter qu’il ne se fasse
surprendre par la sonnerie.
Collègues enseignants, y aurait-il une chance de voir les idées
ou questions présentées au long de vos cours prendre tout leur
relief et leur sens, s’éclairer et se conclure, au cours des «
cinq dernières minutes ». « Bon Dieu, mais c’est bien
sûr ! », s’écria le commissaire Broussel, héros récurrent de
la série policière télévisuelle des « Cinq dernières minutes »
de la vieille ORTF.
Cinq minutes où tout se dénoue, les choses s’ordonnancent et se
délacent. Sans cette mise en scène de la résolution, tout le
reste n’aurait servi à rien et où ne pourrait rester en mémoire,
non plus qu’en apaisement.
Replongeons dans les archives de l’INA : nous découvrons presque
50 ans plus tard le concept originel, et tout aussi original à
l’ère de la télé-réalité Avant les cinq dernières minutes de
leur investigation, en direct, deux candidats enquêteurs
s’opposaient dans une course à la résolution de l’énigme du
jour, avec possibilité de requestionner les acteurs ! Tout
n’était donc pas joué, mais rien n’était clair. Et d’un coup,
tout devenait utilement lumineux et marquant.
Nos heures de cours séquencées ne sont-elles finalement autant
d’énigmes « policières » à résoudre, où peut se rejouer la scène
à la Broussel ? Serions-nous tous des Broussel ? Faisons en
sorte d’élaborer d’autres fins pour organiser nos cours, avec un
seul souci : raconter la fin de l’histoire, sans quoi leur
enseignement précédent serait vain.
En vue de différencier les formes variées suivant lesquelles une
phase conclusive peut être établie dans un cours ou une séance,
nous vous proposons un inventaire des comportements de
professeurs, incluant paroles, gestes et attitudes en fin de
cours (avant la sonnerie, ou en raison de la sonnerie), sinon
après.
Nous allons faire figurer en marge du texte de gros carrés
blancs ; vous êtes ainsi invités à cocher une ou plusieurs
pratiques envisagées ici, que vous pourrez expérimenter dans les
prochaines séances.

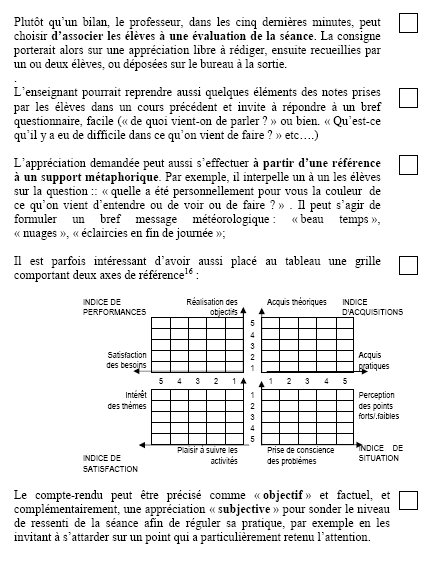
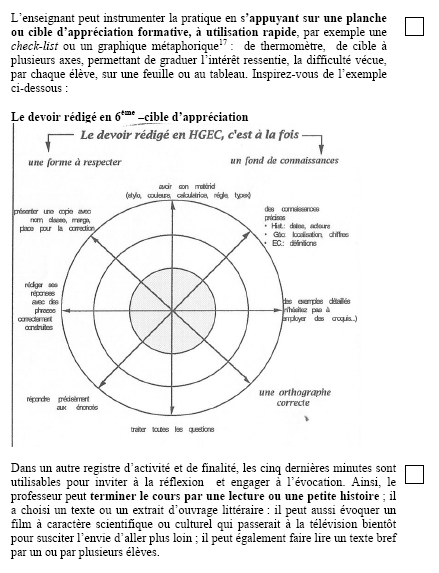
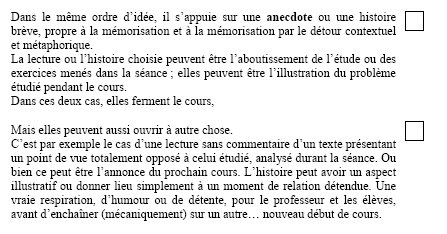
Et après, à la sonnerie ? Les cinq dernières minutes ont une
fin
Serait-ce en sonnerie brutale, en sonnerie d’alarme, en sonnerie
intrusive ? Aujourd’hui, les établissements sont encore peu
nombreux à avoir investi dans cet aspect de l’ergonomie
scolaire. Le moment est d’autant plus rude qu’il s’impose à
tous. Mais si le professeur ne l’organise pas, il doit prendre
la « main pédagogique » sur cet instant où se joue plusieurs
fois par jour, tous les jours de la semaine, toutes les semaines
de l’année scolaire, la « loi de l’Ecole ». C’est dire
l’importance stratégique à s’intéresser à cet « allant de soi »,
en préparation puis au moment de la « sonnerie ».


b-Les élèves ou une partie d’entre eux rangent leurs
affaires.
Si malgré tout, les élèves ou une partie d’entre eux rangent
leurs affaires et commencent à bouger, la situation peut
s’amorcer dans un rapport de force et d’inertie.
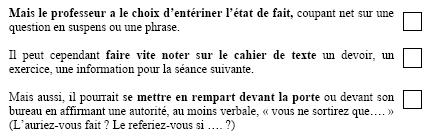
On pourrait imaginer qu’une fois, en réaction à ce type de
comportement impulsif d’élèves, le professeur lui aussi, à
l’instant de la sonnerie, se prépare à partir, presque plus vite
que les élèves. Ce serait un sujet à débattre la fois suivante,
sur le sens du cours, des échanges mutuels, du respect mutuel et
de la relativité du signal de l’organisation. Car, en a-t-on
débattu une seule fois, dans la « vie » d’un élève ?
c-Les élèves ont rangé leurs affaires.
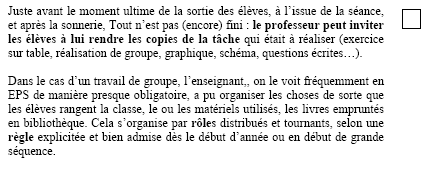
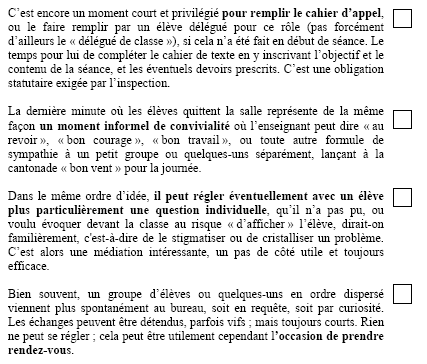
Remarques méthodologiques, ultimes et
préalables ou rétrospectives et anticipatrices, sinon
dissipatrices
Il va de soi que ce qui précède se réfère à une durée fréquente
de 55 minutes ; celles-ci donnent un cadre contraignant, trop
étendu dans certains cas, mais trop bref dans beaucoup d’autres.
Vous gagnerez à explorer le chapitre sur le « temps retrouvé »
un peu plus loin.
Si les fins des cours doivent être subies, elles gagnent
pourtant à être contrôlées.
En premier lieu,on peut réfléchir sur les fins subies :
elles sont soit imposées par la sonnerie, soit entraînées par
l’effritement de l’attention et devraient être toujours
accueillies avec bon sens.
Dans l’un ou l’autre cas, elles peuvent être soit entérinées par
le professeur (il accepte aimablement le fait accompli ?). Il
peut aussi la refuser et il peut s’en expliquer ou non .Elles
peuvent donner lieu à des activités de relance. On voit déjà
qu’il y a une petite complexité.
Quant aux fins contrôlées : une phase conclusive, on l’a
vu, peut ramasser, relier ou apprécier les éléments successifs
ou l’ensemble d’un cours. Il faut toutefois se garder de fausses
synthèses ou de conclusions « rhétoriques » (qui ne sont
sécurisantes que pour le professeur, lui donnant l’illusion que
son enseignement a été cohérent). Rappelons que la phase
conclusive pourra être tantôt :
-
élaborée par le professeur (conclusion de
cours, lecture finale)
-
élaborée par les élèves sur consigne du
professeur.
-
ordonné selon un caractère de clôture
(point final à une étude) ou un caractère d’ouverture (sur un
cours prochain) ou bien vers des perspectives pour les élèves
sans prolongements prévus sur une séance suivante.)
Soulignons encore qu’au cours de la préparation du cours, le
professeur aura pu se proposer une ou plusieurs de ces variantes
de phase conclusive, ainsi que l’horaire qui leur correspond.
Cette phase peut être aussi bien réduite à 5 minutes que plus
longue. De la variété encore, en responsabilité !
Le professeur devra de toute façon chercher à obtenir un
éclairage ou un point d’orgue qui feraient reprendre aux élèves,
dans leurs mots du début du XXIème siècle, « Bon Dieu, mais
c’est bien sûr. ». Pourquoi pas ?
Ceci concédé, ne nous-faut-il pas revenir vers la pluralité des
méthodes pédagogiques qui peuvent donner des possibilités, des
ressources, à notre enseignement au-delà des commencements, des
relances et des finitions ?
Sur
la méthodologie de la carte conceptuelle (ou mindmap),
voir la page
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf17/0102/ress/doc/p1_fad/cc.pdf
et le site de référence
http://www.petillant.com/ :
La carte
conceptuelle permet de représenter et d'organiser de manière
graphique l'univers d'un concept tel qu'il est perçu par un
individu ou plusieurs. Elle permet de fournir une image plus «parlante» pour l'esprit, quand le
langage écrit et parlé atteint ses limites descriptives. Enfin,
facilite l'apprentissage et l'appropriation de concepts
difficiles et peut permettre de structurer et mettre en lien un
grand nombre d'informations.
Elle est constituée de noeuds ou de cellules qui contiennent
les concepts. Les liens entre les concepts sont décrits par un
texte court et se terminent parfois par une flèche qui donne le
sens de la relation entre les concepts.
Exemple cité dans « organiser des formations p. 285
Voir notamment André de Peretti, Recueil de processus et
d’instruments d’évaluation formative, éd. INRP-CNDP, Paris,
1981, certains sont reproduits sur le site
http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm
|