|
Chapitre 16 - Où l’on peut
chercher à exploiter d’autres domaines métaphoriques
Où le lecteur continue sa navigation, dans l’intérêt d’utiliser
des métaphores et des analogies pour soutenir les savoirs à
acquérir ou les comportements à exercer par des élèves ou
étudiants dans le cadre de leur formation scolaire et
universitaire.
Il
peut être productif d’approfondir cette métaphore, d’en
rechercher les suggestions pragmatiques et conceptuelles,
qu’elle nous invite à « filer ».
Les
points d’appui ? Le point d’appui est nécessaire pour qu’on
puisse appuyer sur sa solide consistance un levier dont on veut
bénéficier de la force qu’il peut nous apporter pour renforcer
notre action. Mais qu’est-ce que cette force ?
Toute pratique professionnelle, responsable, ne s’effectue pas
au hasard. Mais elle doit se soutenir, pour réussir notamment à
intéresser des élèves et à soutenir leur intérêt attentif, leur
possible « joie de connaître ». Il faut donc rechercher dans les
motivations l’attente des élèves, par l’emploi de ressources
choisies, des points d’appui de l’action d’enseignement : afin
de rendre efficace l’énergie qui est mise en œuvre pour
enseigner et former.
En
toute activité humaine, au fait, pourquoi a-t-on besoin de
point d’appui et de tant de forces ?
Pour l’enseignant, la réalisation automatique d’un travail
intellectuel est complètement abstraite, sans réalités humaines
et scientifiques. L’action ne peut être efficace si elle ne
prend pas appui sur des ressources imaginatives, des moyens
analogiques.
Mais revenons sur la métaphore du point d’appui. Elle est
naturellement liée à l’outil complémentaire, le levier. Une
commune mise en œuvre assure une multiplication des énergies,
mises en œuvre par l’individu qui tient le levier comme nos
images ci-après peuvent l’illustrer.
 Force de levier
Force de levier
Le
« point d’appui » est lié à l’outil complémentaire qui est un
levier. Leur commune mise en œuvre assure une multiplication des
énergies sollicitées par l’individu qui tient le levier.
Rappelons que le levier est en équilibre quand la force motrice
et la force résistante sont inversement proportionnelles à leurs
bras de levier respectifs.
Le bras de levier est la distance entre la force en
question et le point d’appui.
La poids de la pierre est la force à vaincre; on l’appelle la
force résistante.
La force que le bonhomme déploie est la force développée par
l’utilisateur du levier; on l’appelle la force motrice.
 La
force efficace de l’action entreprise dépend du choix, de la
place, du point d’appui sur le terrain. En enseignement, cela
veut dire les motivations. Et de la longueur du levier. Que
serait-il dans notre enseignement ? Le degré de la longueur :
l’expérience et la compétence ? La
force efficace de l’action entreprise dépend du choix, de la
place, du point d’appui sur le terrain. En enseignement, cela
veut dire les motivations. Et de la longueur du levier. Que
serait-il dans notre enseignement ? Le degré de la longueur :
l’expérience et la compétence ?

Les
difficultés exprimées par les collègues montrent bien que la
vision de leur action professionnelle est simpliste. Il y a des
efforts délicats, par rapport à des tendances d’inertie ou de
violences qui s’expriment. Savoir où placer ses forces pour que
l’action soit utile. Parfois, une indication, un mot, une
variété d’organisation, un recours à des localisations de
l’emploi des forces permet de résoudre la tension sans grand
effort. Moins en tout cas que de réprimer les forces à l’œuvre
en la contrant par autant de moyens inefficaces.
 Progressons dans notre parcours
métaphorique, en visée professionnelle, selon l’escalade ou la
varappe
Progressons dans notre parcours
métaphorique, en visée professionnelle, selon l’escalade ou la
varappe
En escalade, ce n’est pas la peine de tant tirer sur les bras,
il faut pousser sur les pieds ! En escalade, plus on économise
son énergie, plus on a des espoirs d’aller haut. Il ne sert à
rien de forcer quand on peut passer en souplesse sans impatience
ni brusquerie risquée.
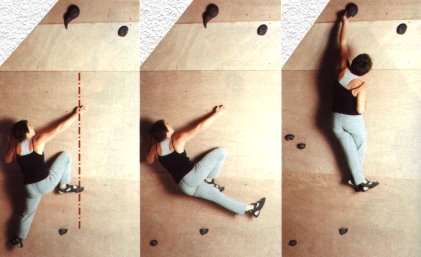
La technique permet au grimpeur de franchir la plupart des
obstacles, de trouver facilement le mouvement le mieux adapté au
relief, de composer avec tous les éléments de son corps, de
trouver au plus vite le point d'équilibre et d'enchaîner les
gestes avec un minimum d'efforts.
Cette technique suggère, analogiquement :
-
Dans tous les cas, avant de tenter un
mouvement, vérifiez que vous êtes bien équilibré.
-
Si vous vous sentez partir quand vous
décollez une main, inutile de forcer, revoyez vos appuis.
-
Il peut s’agir du choix de vos prises ou
de votre positionnement sur celles-ci.
L'assimilation de ces mouvements est plus ou moins longue, elle
peut durer de un mois à un an. En effet, un temps
d'apprentissage est indispensable avant d'acquérir le placement
idéal et la fluidité, puis les bonnes sensations. Variez les
mouvements, modifiez les points d'appui, sentez les
déséquilibres et corrigez-les...
Faites-en autant en enseignement ! Pensons que nos élèves ont
des pieds ! pour aller chercher des connaissances ; en CDI, sur
internet, en enquête dans l’environnement.
En quête, métaphorique !, de points d’appui, on peut penser, en
se reportant à l’architecture, si déterminé par ses appuis et
points d’appui, aux arcs-boutants des cathédrales par exemple
noble !
n
Inspirons nous d’abord de
l’architecture des cathédrales
Effectivement, le principe des points d’appui a nourri les
traités d’architectures depuis Vitruve ; les hommes ont constaté
recherché les solutions techniques, puis technologiques pour
élever plus haut et permettre de libérer un espace encore plus
grand.
La technicité a été grande à la période dite gothique, en fait
spécifiquement dans l’aire de la France « royale » : le « temps
des cathédrales » à la manière de Duby a d’abord été le temps
des audaces architecturales au service du pouvoir religieux.
La solution technique adoptée a consisté à reporter à
l’extérieur toute l’armature de la construction, à évider en
quelque sorte l’espace intérieur, pour en faire une nef
renversée inondée de lumière. Pour cela, la multiplication des
piliers-contreforts, renforcée par le poids des pinacles a
permis par arc-boutant successifs de procéder à des élévations
jusqu’alors jamais atteintes.
La maquette de la cathédrale de Notre-Dame de Paris permet de
visualiser d’un coup d’œil combien le système
piliers-arc-boutant constitue de fait un véritable exo-squelette,
rendant solidaire tout l’édifice, en annulant les forces entre
elles.
 
Il est tout à fait amusant de rapprocher la cathédrale de la
construction voisine sur la rive droite, mais de sept siècles
postérieurs : le Centre Pompidou. Pour une vocation par ailleurs
similaire, accueillir le plus grand nombre pour y célébrer
d’autres cultes, celui de la culture et de l’art contemporain,
les architectes ont retenu le principe médiéval de l’exo-squelette,
en reportant à l’extérieur l’armature de fer et de verre, sans
jamais la masquer… comme à Notre-Dame.

Pour nourrir notre propos, en le transposant à l’espace
d’éducation et de formation que constitue la classe, pour
l’appliquer au système professeur-groupe d’élèves, c’est donc en
multipliant les points d’appui, de fonctions différentes mais
complémentaires que l’enseignant peut s’assurer de libérer un
espace vaste et clair, une déambulation sans contraintes et une
vie durable pour tous.
Quels sont les arc-boutants, les pinacles que vous offrez à vos
élèves de manière que les espaces de pensée soient les plus
éclairés, les plus élevés ?

 Puis, prenons des images, des
idées sur le style d’architecture néo-contemporaine aérienne
Puis, prenons des images, des
idées sur le style d’architecture néo-contemporaine aérienne
Le
Phaeno de Wolfsburg, édifié en 2004, ressemble à un oiseau
mythique bétonné avec son bec crochu et ses grandes pattes.
L’ensemble du bâtiment (un triangle) repose sur 5 cônes où sont
logées l’accueil, la boutique et le restaurant. L‘usage du béton
(dont le précurseur est Le Corbusier) autorise toutes les formes
et facilite l’utilisation de courbes, de forme géométriques
récusant les lois de la gravité élémentaire.
Le
triangle, un plan libre développé d'un seul tenant sur 5.900 m2,
permet de dégager entièrement l'espace d'exposition des 250
expériences ludiques et pédagogiques pour enfants et adultes.
 . .
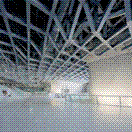 Le
ressort secret du Phaeno
(Wolfsburg), c’est le mouvement. Mais il faut bouger pour
actionner, déclencher et apprendre. La mobilité du corps
accompagne la mobilité de l’esprit. Le grand paysage de
l'architecte Zaha Hadid obéit aux mêmes règles. La jouissance de
l’espace accompagne la pédagogie. Le
ressort secret du Phaeno
(Wolfsburg), c’est le mouvement. Mais il faut bouger pour
actionner, déclencher et apprendre. La mobilité du corps
accompagne la mobilité de l’esprit. Le grand paysage de
l'architecte Zaha Hadid obéit aux mêmes règles. La jouissance de
l’espace accompagne la pédagogie.
Lourd et flottant, enveloppant et généreux, organique et dédié à
la science, ouvert et subtil, Phaeno fait vaciller nos
certitudes. Le dedans est le dehors, le verre pèse plus lourd
que le béton, l’absence de fonctions peut être une fonction.
Cette complexité aurait pu faire peur. C’est l’inverse qui se
produit. La position du bâtiment entre la gare et le la
passerelle de l'Autostadt, le rend incontournable.
L’architecture de Zaha Hadid (Prix Pritzker 2004) est une
architecture sculpturale. Elle crée des courbes insensées, des
formes indéfinissables. Beaucoup des ses projets ne voient pas
le jour, ils deviennent donc des oeuvres d’art à part entière.
Sa
construction peut être une belle image transposable à
l’enseignant. Elle est signifiante des possibilités de
construction intellectuelle, artisanale et concrète que nous
réserve l’avenir d’une civilisation en plein renouvellement : le
modernisme est dédié à l’éducation, aux sciences. Elle fait
miroir aux interactions des élèves et professeur, aux neurones
du paysage intérieur.
¾
Embarquons ! la métaphore
marine
Dans cette « navigation »
dans l’ouvrage et en exploration personnelle et collective au
gré amical des courants de cet ouvrage, et même jusqu’au centre
de cette « terra incognita » de notre profession
enseignante, nous vous proposons la métaphore du voilier
à bord duquel vous pourriez conjoindre ressources et points
d’appui.
Si vous avez au moins
une fois pratiqué la voile, sur un dériveur, vous connaissez
alors le principe du jeu entre forces et contraintes dans un
environnement aléatoire. De fait, le dériveur, par sa structure
et par votre action sur quelques appuis, se joue des
contraintes, voire parfois déterminismes naturels. Hegel parlait
à cette occasion d’une « ruse de l’Histoire »
en développant l’aspiration de ces premiers hommes qui prirent
la Mer contre toute Raison.
Et pourtant, vents et
courants sont pour la navigation des « ressources » qu’il
vous faut mobiliser grâce à la réalité d’un gréement et d’un
accastillage, autant de points d’appui.
Difficultés et
contraintes sont premières dans la navigation en mer : mais il
est possible de les utiliser pour vos objectifs, à condition de
savoir placer la dérive ou la quille, placer la voile dans la
direction utile, et notamment dans le sens contraire du vent,
dans l’inversion du vent.
Si
le goût de la Mer vous prend, il vous est loisible de connaître
la technique relative au voilier et à son équilibre ou
déséquilibre de forces.
Les
schémas techniques et l’analyse des forces en présence attestent
que ce sont bien les points d’appui, fixes telles que le
mat et la dérive, mais aussi l’action que vous engagez en
bordant la voile, qui provoquent le mouvement, selon la
direction et le cap que vous souhaitez. S’il advient une fois
qu’un point d’appui manque, votre route s’avère compromise, en
tout cas rendu bien difficile. Et vous perdez votre maîtrise de
la ressource que la Mer vous apporte.
Et
bien, il en sera de même pour votre système d’enseignement : il
vous importe de bien distinguer vos points d’appui, de les
maîtriser de manière experte pour jouer et profiter des
multiples ressources à votre portée.
On considère le voilier en
déplacement sur une direction rectiligne à vitesse constante,
celui-ci est en équilibre sous l'action de 3 forces : - P le
poids total du voilier . - F l'action du vent sur sa voile . -
R l'action de l'eau sur la coque . Ces 3 forces se trouvent
dans même plan Q , elles sont concourantes en un même point A
et leur somme géométrique est un vecteur nul .


Les expressions
nautiques sont intéressantes, telles que « mettre en panne »,
« prendre de l’allure », « être sous le vent »…mais aussi « être
au plus près « : cela peut se dire des élèves aussi bien que du
vent.
Mais on peut en guise d’appui, redescendre sur terre, et plus
précisément, de façon à accroître nos possibilités pratiques sur
« deux roues » en recherche d’équilibre.
 Dynamique de l’équilibre, Le
« petit vélo »
Dynamique de l’équilibre, Le
« petit vélo »
La
pratique du vélo repose formellement sur quelques principes
simples : trois points d’appui (le guidon, la selle, les
pédales) et une dynamique du déséquilibre en mouvement
permettant au quidam de finalement progresser sur deux appuis,
les pneus sur le sol.
L’allégorie a été utilisée en posant les questions des appuis,
sur ce que fait un adulte ou un élève qu’il peut et souhaite
mettre en œuvre.
Elle est suffisamment plaisante pour développer plus avant le
concept et vous permettre ici d’identifier différents éléments
de votre propre système de pilotage. Ainsi, les points d’appui
de votre action enseignante peuvent être expliciter dans la
grande variété de leur nature.

Cette métaphore est tout aussi communicable aux élèves eux-mêmes
avec beaucoup de bonheur.
Quelques autres domaines
métaphoriques
Pour terminer, très provisoirement, notre évocation des recours
métaphoriques utilisables, nous vous lançons quelques pistes
tout justes défrichées ; ces différents domaines ou pratiques
sociales sont puissamment évocatrices pour saisir ce que
« ressources » et « points d’appui » peuvent emporter, rapportés
à notre domaine spécifique de l’éducation et de la formation
hors de la seule physique.
Il
n’y a pas de travail d’intelligence et de cultures qui ne puisse
s’appuyer sur les images et l’imagination. Même dans les
sciences les plus abstraites et les plus difficiles, on a essayé
d’explorer l’ensemble des potentialités et les points d’appui
sur lesquelles les progressions se sont effectuées
. Ou plus simplement, pour éveiller l’intérêt des élèves, en
utilisant des analogies recherchées en divers domaines
disciplinaires.
En chimie
Dans un laboratoire, sur sa paillasse d’expérimentateur, le
chimiste use bien d’outils comme l’agitateur, mais aussi
recherche un catalyseur pour provoquer, faciliter ou
observer une réaction ; il tente de stabiliser une
production et pour cela, s’appuie sur les indications d’un
doseur. En enseignement, on peut évoquer des rôles de
facilitateur, de réacteur subjectif dans un débat.
En agronomie
L’allégorie agronomique avec la « culture » fonctionne
parfaitement pour l’éducation, c’est un « classique ». Ainsi,
en procédures culturales, on peut préparer le terrain
d’un chapitre à étudier, on peut aussi faire des adjonctions
temporaires (eau ? semences ?) à un travail ou une étude en
cours (en parfois, en peine ou en manque). L’expert est attentif
aux rythmes de développement, à la germination,
à la croissance et au mûrissement des idées et des
savoirs qu’il peut recueillir en lui; il faut au bon moment
procéder à la récolte ou se décider à la mise en
jachère au risque d’épuisement du terrain ! Les vacances
sont justifiées !
En médecine
Le
médecin est sans doute le professionnel le plus proche de
l’enseignant, avec la limite, qui n’est pas la moindre, que dans
la relation au « patient », c’est une relation inter-personnelle ;
alors que l’enseignement se veut groupal. Quoique….. Le médecin,
praticien, dans son acte de la consultation, conduit de
pair l’entretien, prend des mesures calibrées par
l’entremise d’outils standardisés ; mais il peut
s’appuyer sur des technologies plus fines et plus appareillées
telles que la radiographie, ou l’oxygénation ;
parfois, on peut user de pratiques plus décalées, mais efficaces
comme l’acupuncture. Pour confirmer un diagnostic, il est
parfois nécessaire de procéder à un examen de laboratoire.
Enfin, dans une mesure de prévention des troubles identifiés, on
peut faire une prescription de diététique, Alors,
« diététique » pour les lectures prescrites.
Les Arts à la rescousse
Le
monde littéraire, tant romanesque que théâtral présente un cadre
tout aussi riche, comme si la classe présentait les mêmes
caractéristiques, à filer… : les personnages, les
caractères, l’intrigue, les contrastes
poétiques, les scènes, les éclairages, les
levers de rideau etc…
La
peinture possède des registres tout à fait comparables : le
parti pris du peintre, la composition du tableau, le
cadre de ce qu’on doit voir, la palette graphique
des couleurs, les techniques employées en référence à des
pratiques rehaussées par des artistes reconnus, etc…
Le
cinéma, nous l’évoquerons souvent dans nos chapitres ; en
partageant une culture filmique et quelques techniques désormais
bien ancrées dans la culture collective : : scénario,
synopsis, découpage, dialogue, effets,
générique, prise de vue, rôles, cadrage,
gros plan, moyen plan, plan américain,
travelling avant, panoramique, fondu-enchainé,
vedette, suspens ad libitum
Nous pouvons penser de la même façon, de manière moins courante,
à la danse : quels sont les pas élémentaires pour
composer un ballet ? Avons-nous suffisamment travaillé la
technique des pointes ? Quelle scénographie
pouvons-nous imaginer et sur quel rythme pour permettre un bon
enchaînement dynamique, en s’appuyant sur les éléments du
décor et des costumes, quand bien même ils s’inspirent d’un
dépouillement tout contemporain, tel que l’on peut le
découvrir sur Arte le dimanche soir.
N’oublions surtout pas la musique ! : les modes majeur
ou mineur, la tonalité, les clés, les notes,
tonique et dominante, le rythme, le tempo,
l’instrument à cordes ou à chœurs,
l’interprétation, l’organologie, et … l’écoute du
silence.
Ah, les sports !
Dans notre nouvelle époque footballistique
et aujourd’hui rugbistique, nous retiendrons parcimonieusement
les phases d’échauffement, l’élan, l’appel,
le fait de prendre ses marques, mais aussi
l’inspiration avant démarrage, le second souffle,
et, allez, le finish à l’arraché.
Et
vous, quelles métaphores retiendrez-vous pour exprimer vos
propres ressources et points d’appui dans l’exercice exigeant et
passionnant de l’enseignement ?
Et sur le terme
« ressources »
D’après le Robert,dictionnaire
historique de la langue française, consulté au profit des
enseignants et formateurs :
ils sont dignes de disposer de
« ressources » pour diffuser avec bonheur leurs enseignements et
formations.
Le terme de « ressources » se place
originellement à coté de restaurer et de ressusciter.
On le trouve proche
Il apparaît vers 1155 en parlant d’une
pâte bien levée ou de ce qui vient en abondance. Il voisine
resordre au XXIème, puis resourdre (ressusciter, se
remettre debout : se rétablir, ou secourir. Au début du XVème
siècle, il s’appuie sur « risorge » : relever, rétablir.
Ainsi n’a-t-il pas oublié le latin, resurgere, doublet
populaire de resurgir : voilà un soubassement approprié à
l’attention demandée aux élèves.
Dans ses détours, ressources va
désigner le secours qui vient d’un pays, puis aussi le
relèvement ou le rétablissement. On ne peut omettre également le
déplacement métonymique sur les moyens : moyens pour faire face
à une situation difficile : comme en « dernière ressource ».
Le terme a pu naturellement désigner
la capacité physique de fournir un nouvel effort après une
dépense d’énergie.
Mais au XVIIème s., il se propose au
psychisme, explicitant une capacité de soutenir quelqu’un
moralement ; ainsi qu’en nombre, au pluriel : moyens d’action
inhérents à une situation, ou capacités inhérentes à une
personne : « plein de ressources », « homme de ressources ».
Le XXème siècle a aimé l’appliquer en
couture (laisser en suspens). Ou encore en informatique,
les « ressources » font parties d’un système utilisable par
différents utilisateurs.
Enfin, en fauconnerie, la ressource
prend le sens concret du redressement (remontée de l’oiseau), de
même qu’en aéronautique, remontée après un piquet.. Ce sont des
images bien appropriées à l’animation d’une classe ou d’un
groupe.
Voulez-vous une approche plus
actuelle ?
-
La ressource
désigne d’une part en économie les denrées ou médiation et
supports humains utilisés dans la production de biens et
services, incluant :
-
Ressource naturelle,
une denrée qui est évaluable par sa
matière et sa forme
naturelle.
-
Ressources humaines
(RH) ou capital humain , permettant d'évaluer la puissance
du travail humain.
-
Ressource
économique utilisée dans la planification des tâches et des
projets.
-
Ressource en
références épistémiques et en savoirs : les ressources
documentaires, en particulier les
ressources continues
-
En informatique,
les moyens incluant :
-
Ressource (Web), toute
entité identifiée par une
URI.
-
Ressource
(Macintosh), données associées à un fichier Mac OS.
-
Ressource
(Windows), données embarquées dans des fichiers exécutables
(.exe) et liens (.dll).
-
Ressource (Java),
application data.
-
En organisation,
les ressources comprennent :
-
les
ressources humaines
(gestionnaires et employés, dans notre cas, chef
d’établissement, personnels administratifs et enseignants,
CPE et documentalistes
-
les ressources
informationnelles (information et technologies
d’information), les ressources matérielles
(équipements, outils, bâtiments), les ressources
financières (budget, liquidité, capital-action).
cf.
Pour l’honneur de l’Ecole, d’André de Peretti, en
citant Gilbert Gadoffre et Lichnerowicz, séminaire
interdisciplinaire du collège de France, éd. Maloine,
Paris, 1980 Analogie et
connaissance, t. 1, aspects historiques :, « les hommes de
la Renaissance et l’analogie,
p.47). Maxwell, théoricien de l’électro-magnétique recourt à
la « métaphore scientifique ».L’analogie physique s’entend
par similitude partielle entre les lois d’une science et
celles d’une autre qui permet à chacune d’elle d’illustrer
l’autre.
|